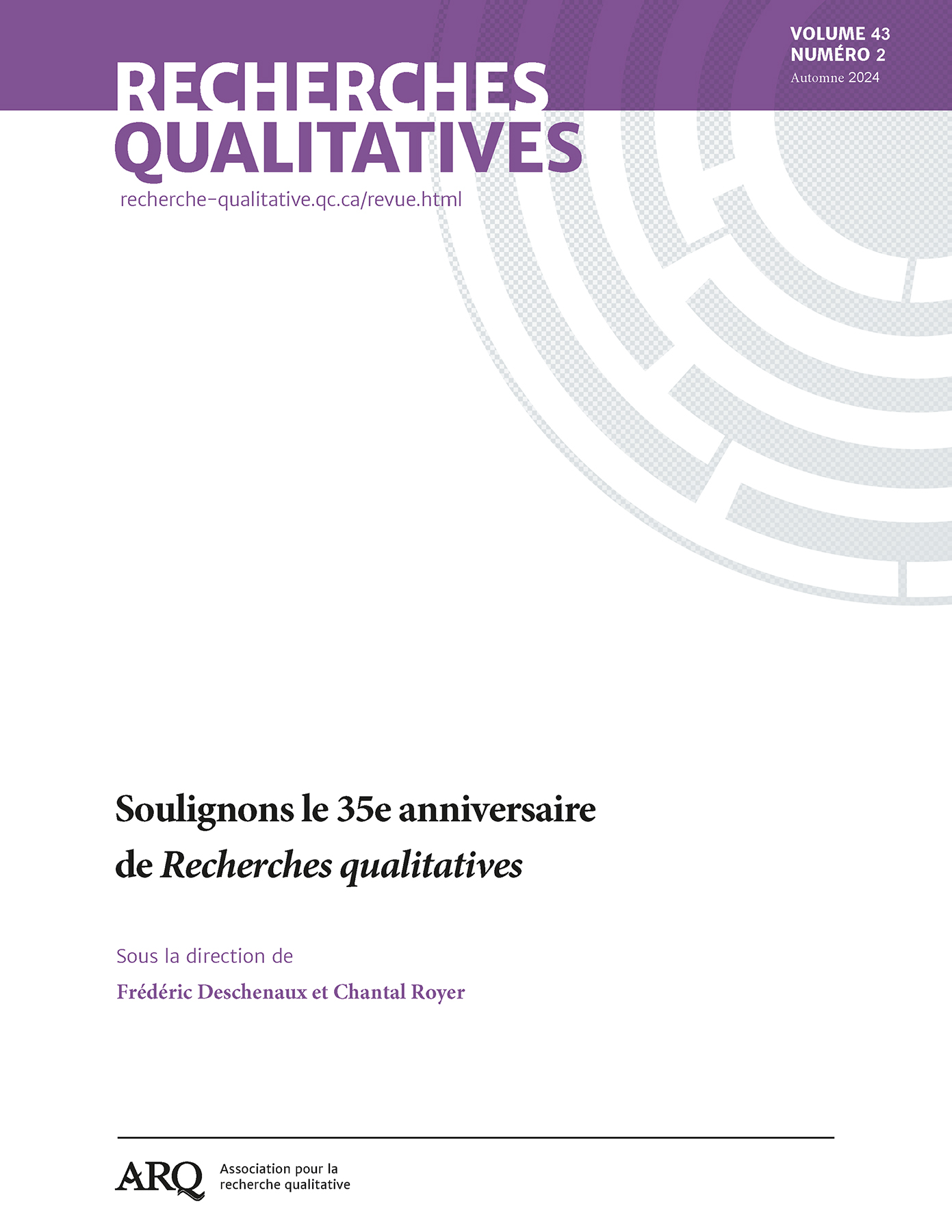Dans cet article, l’auteur présente un regard renouvelé sur un article qu’il a publié dans la revue : Paillé, P. (2007). La méthodologie de recherche dans un contexte de recherche professionnalisante : douze devis méthodologiques exemplaires. Recherches qualitatives, 27(2), 133-151. https://doi.org/10.7202/1086789ar C’est avec plaisir que j’ai accepté de faire quelques brefs commentaires à propos de mon texte publié il y a plusieurs années dans cette revue et présentant douze devis méthodologiques exemplaires dans un contexte de recherche professionnalisante. À la différence de nombreux articles publiés dans la revue au fil des années, ce texte est d’un format plutôt factuel, passant en revue des devis méthodologiques, pour certains inédits, et détaillant les diverses étapes de leur déroulement. D’une certaine manière, il y a peu à redire sur ces devis, car ils ont été repris, adaptés et enrichis de diverses manières. Toutefois, je vais saisir cette occasion pour mettre l’accent sur ce qui est peut-être le plus important à leur sujet, à savoir le souci épistémologique qui m’a habité tout au long de leur adoption ou conception et qui les sous-tend de manière fondamentale. Lorsque j’ai entrepris des études universitaires au début des années 80, je me suis vite découvert un appétit pour les idées abstraites, complexes. Dans mon cursus en anthropologie, le cours d’épistémologie était l’un de mes préférés et j’ai conservé tout au long de ma carrière cet intérêt pour ce qui m’apparaît être la pierre angulaire de l’entreprise scientifique. L’épistémologie est une notion qui peut avoir quelque chose de rebutant au premier abord, mais pour moi elle est devenue très concrète. Le concept clé qui y est associé est celui de « connaissance » (qui est l’une des traductions possibles du terme grec épistémè). Il y a plusieurs manières de connaître dans l’activité humaine, toutefois il est important de mettre en oeuvre des manières de connaître qui sont le mieux possible adaptées aux activités concernées : voilà, pourrait-on dire, la tâche mais aussi le défi de l’épistémologie, prise au sens large. Faire passer des tests de psychométrie à une personne n’est pas la meilleure approche pour la connaître dans le cadre d’un rendez-vous galant, et sonder son propre senti corporel n’est d’aucune utilité dans le contexte de l’étude de la séquence d’un gène d’ARN. Connaître, c’est connaître, mais il y a beaucoup de nuances à considérer et à apporter. Cela semble aller de soi; pourtant, dans le contexte des sciences humaines et sociales, l’ajustement de l’angle épistémologique à l’objet et au contexte de l’étude (donc le fait de mobiliser une approche de connaissance appropriée) pose de nombreux défis que plusieurs décennies de réflexions et d’expérimentations ont permis de relever. Cela ne s’est pas fait sans reculs (j’y reviens plus loin) ni sans difficultés. En réalité, tout se passe relativement bien tant que l’on adhère à une vision classique de la science. En effet, définir l’entreprise scientifique sous l’angle de l’objectivité, de l’abstraction et de la distanciation va en quelque sorte de soi tant du point de vue de la constitution historique de la science que de sa définition englobante (régissant avec les mêmes protocoles tant les sciences de la nature que les sciences humaines et sociales). Mais les choses se corsent lorsque l’on introduit les notions de subjectivité et de proximité. La conception conventionnelle d’épistémologie est mise au défi. Une dimension supplémentaire intervient en lien avec une situation de recherche particulière, à savoir celle ambitionnant de se situer au carrefour de la rigueur scientifique et de la pertinence professionnelle. Dans ces cas, on ne peut pas se limiter à une approche de la connaissance qui …
Douze devis exemplaires… épistémologiquement[Notice]
…plus d’informations
Pierre Paillé, Ph. D.
Université de Sherbrooke, Québec, Canada
Pierre.Paille@USherbrooke.ca