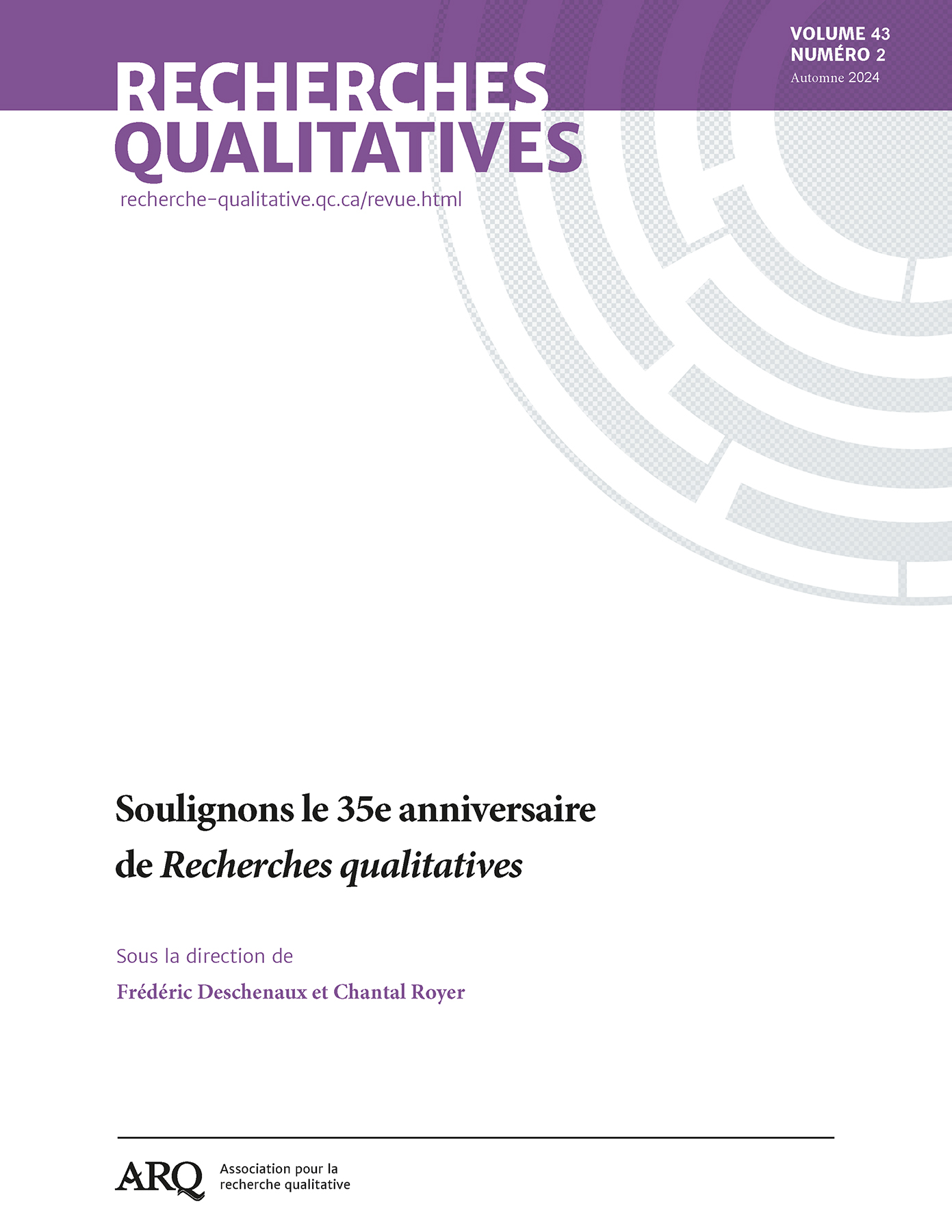Dans cet article, l’autrice présente un regard renouvelé sur un article qu’elle a publié dans la revue : Savoie-Zajc, L. (2007). Comment construire un échantillonnage scientifiquement valide? Recherches qualitatives, Hors-série « Les Actes », (5), 99-111. http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/hors_serie/hors_serie_v5/savoie_zajc.pdf Les rédacteurs en chef de la revue Recherches qualitatives m’ont invitée à commenter mon article sur le processus d’échantillonnage en recherche qualitative écrit et publié en 2007. Le passage de dix-huit années écoulées entre la publication de 2007 et 2025 met en lumière non seulement l’évolution des préoccupations en lien avec la démarche d’échantillonnage, mais aussi l’apparition de sensibilités nouvelles liées à cette question : je pense ici à l’émergence de pratiques de recherche inscrites dans un paradigme interprétatif que je qualifierai d’« élargi » de même qu’aux questions éthiques soulevées, notamment, par la grande accessibilité aux plateformes numériques et l’ouverture conséquente à de nouvelles problématiques de recherche. Je reprendrai finalement la notion d’échantillonnage, laquelle s’applique non seulement aux personnes, mais aussi aux espaces-temps et aux données. Ceci ne constitue pas une préoccupation nouvelle depuis 2007. J’avance toutefois qu’« un échantillonnage scientifiquement valide » vu comme un élément central d’une recherche rigoureuse est intimement lié à l’explicitation des stratégies mises en place pour le constituer et à leur communication lors de la diffusion de la recherche. Ma réaction s’organisera alors autour de ces dimensions. Avant de les aborder toutefois, je souhaite revenir sur le titre proposé en 2007. J’avais choisi d’utiliser l’expression scientifiquement valide. Une telle appellation, déjà très lourdement connotée, avait alors été clarifiée, dès les premiers paragraphes. Je ressens toutefois maintenant le besoin de qualifier davantage cette expression. Toute pratique de recherche (l’étape de l’échantillonnage ici) est étroitement liée aux façons de faire admises par une communauté scientifique. Dans la tradition des écrits de Kuhn (1983), Dubois (1999) écrit qu’être membre d’une communauté scientifique c’est : 1) faire partie d’un système social, c’est-à-dire d’une institution qui a ses propres limites, distinctes de celles d’autres institutions sociales; 2) être choisi et intégré dans un système dont les acteurs entretiennent des relations d’interdépendance selon des modalités conformes à des principes normatifs spécifiques; 3) faire l’objet d’un contrôle social. Dubois poursuit sa pensée et circonscrit la notion de communauté scientifique lorsqu’il emprunte à Kuhn la notion de paradigme. Dans une telle perspective, la communauté scientifique est vue comme étant locale et indissociable d’une discipline particulière, voire d’une tradition disciplinaire. Pour Dubois, citant Kuhn, il existe une relation circulaire entre « paradigme » et « communauté scientifique ». Une telle perspective sous-entend qu’une certaine régulation des comportements scientifiques existe et que les nombreuses sous-communautés scientifiques se différencient entre elles. Autrement dit, le paradigme fournit le cadre normatif pour encadrer les comportements scientifiques (entendons ici les pratiques) qui, à leur tour, renforcent le paradigme. Revenant à mes propos de 2007, je constate que j’avais pris soin de définir la notion « d’échantillonnage scientifiquement valide » à l’intérieur des normes définies à ce moment par la communauté de recherche qualitative/interprétative. Je le qualifiais d’intentionnel, de pertinent par rapport à l’objet et aux questions de la recherche, de balisé théoriquement et conceptuellement, d’accessible et conforme aux balises éthiques qui encadrent la recherche. J’endosse toujours de telles caractéristiques. Cependant, peut-on encore parler d’une communauté de recherche qualitative/interprétative ou est-il davantage question de diverses sous-communautés chapeautées par le large éventail de la perspective qualitative/interprétative teintées par plusieurs courants théoriques tels que le post-modernisme, la théorie critique et autres courants? Déjà en 2007, Anadón, dans un collectif sur les recherches participatives, soulignait l’éclatement des diverses formes de recherche et, dans un article publié en 2019 (Savoie-Zajc, 2019), je soulignais …
Parties annexes
Références
- Anadón, M. (Éd.). (2007). Recherches participatives : multiples regards. Presses de l’Université du Québec.
- Anadón, M. (2024). Quelques réflexions autour de l’évolution de la recherche dite « qualitative ». Recherches qualitatives, 43(2), 5-14.
- Deslauriers, J. M., Deslauriers, J. P., & LaFerrière-Simard, M. (2017). La méthode de l’incident critique et la recherche sur les pratiques des intervenants sociaux. Recherches qualitatives, 36(1), 94-112. https://id.erudit.org/iderudit/1084358ar
- Dionne, P., Baribeau, C., & Savoie-Zajc, L. (Éds). (2022). L’activité de recherche qualitative à un carrefour de visées transformatrices et émancipatrices. Recherches qualitatives, 41(1). https://www.erudit.org/fr/revues/rechqual/2022-v41-n1-rechqual06974/
- Dubois, M. (1999). Introduction à la sociologie des sciences. Presses universitaires de France.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory. Aldine Press.
- Gravel, C. (2022). Une démarche méthodologique ascendante pour l’échantillonnage d’une étude exploratoire sur la collaboration en milieu scolaire au primaire : quels impacts pour les entretiens individuels? Recherches qualitatives, 41(1), 266-288. https://doi.org/10.7202/1088804ar
- Guay, E. (2022). Les « ethnographies suffisamment bonnes » revisitées : analyse ethnographique des organisations, approche participative et liens entre les mondes sociaux. Recherches qualitatives, 41(1), 200-220. https://doi.org/10.7202/1088801ar
- Kuhn, T. S. (1983). La structure des révolutions scientifiques. Flammarion.
- Latzko-Toth, G., & Pastinelli, M. (2022). L’éthique de la recherche dans les espaces en ligne : clarification de quelques notions. Politique et sociétés, 41(3),221-230. https://doi.org/10.7202/1092344ar
- LeCompte, M. D., & Preissle, J. (1993). Ethnography and qualitative design in educational research. Academic Press.
- Mendelzweig, M. D. (2010). Méthode de recherche qualitative utilisant les sites de rencontre par Internet : expérimentation d’une recherche portant sur les sexualités entre hommes. Recherches qualitatives, 29(2), 245-269. https://doi.org/10.7202/1092344ar
- Pirès, A. (1997). Échantillonnage et recherche qualitative : essai théorique et méthodologique. Dans J. Poupart, J.-P. Deslauriers, L.-H. Groulx, A. Laperrière, P. Mayer, & A. P. Pirès (Éds), La recherche qualitative : enjeux épistémologiques et méthodologiques (pp. 113-172). Gaétan Morin.
- Savoie-Zajc, L. (2019). Les pratiques des chercheurs liées au soutien de la rigueur dans leur recherche : une analyse d’articles de Recherches qualitatives parus entre 2010 et 2017. Recherches qualitatives, 38(1), 32-52. https://doi.org/10.7202/1059646ar
- St. Pierre, E. A. (2019). Post qualitative inquiry in an ontology of immanence. Qualitative Inquiry, 25(1), 3-16.
- Yoro, B. M., & Guillemette, F. (Éds). (2012). Recherche qualitative en contexte africain. Recherches qualitatives, 31(1). https://www.erudit.org/fr/revues/rechqual/2012-v31-n1-rechqual06657/