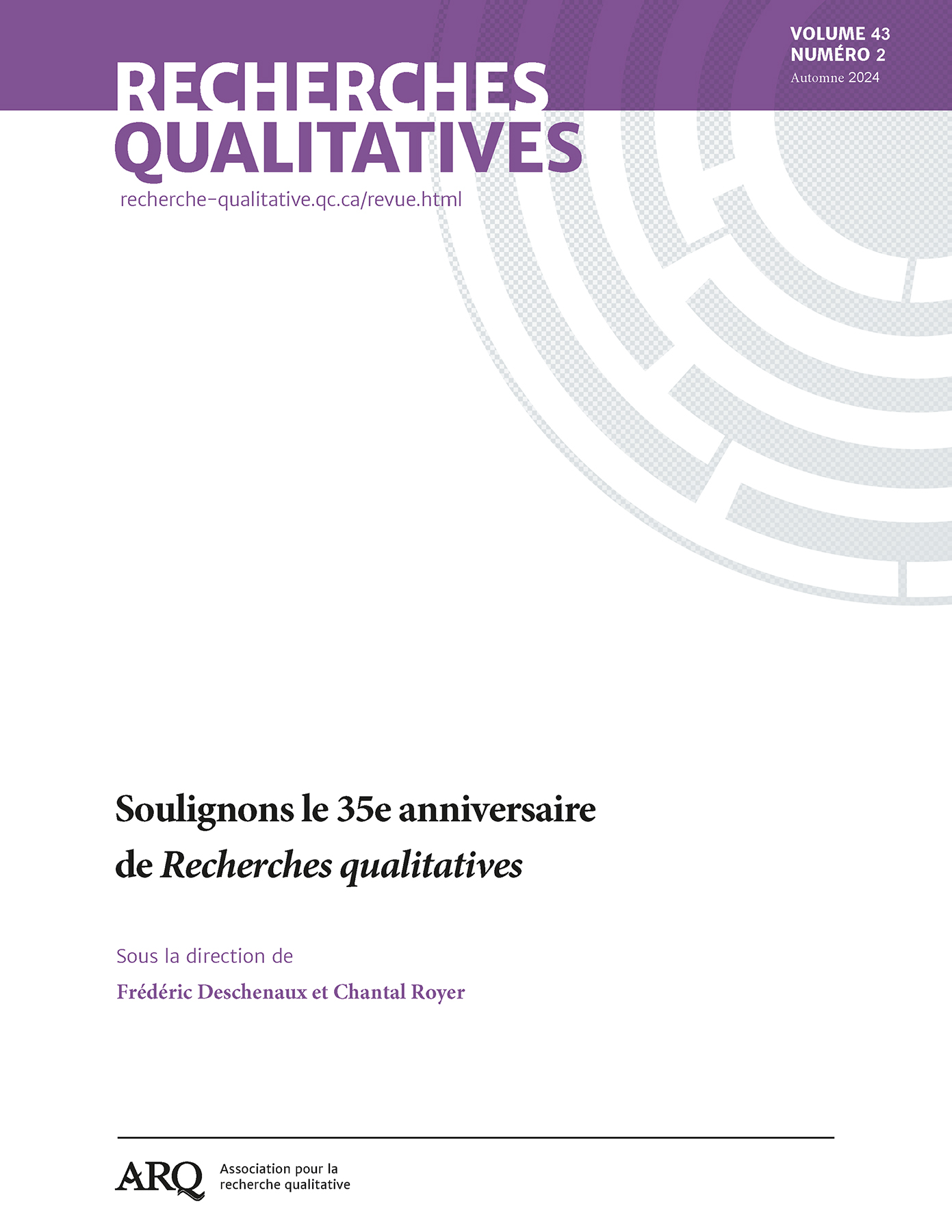Corps de l’article
Dans cet article, l’autrice présente un regard renouvelé sur un article qu’elle a publié dans la revue : Savoie-Zajc, L. (2007). Comment construire un échantillonnage scientifiquement valide? Recherches qualitatives, Hors-série « Les Actes », (5), 99-111. http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/hors_serie/hors_serie_v5/savoie_zajc.pdf
Introduction
Les rédacteurs en chef de la revue Recherches qualitatives m’ont invitée à commenter mon article sur le processus d’échantillonnage en recherche qualitative écrit et publié en 2007.
Le passage de dix-huit années écoulées entre la publication de 2007 et 2025 met en lumière non seulement l’évolution des préoccupations en lien avec la démarche d’échantillonnage, mais aussi l’apparition de sensibilités nouvelles liées à cette question : je pense ici à l’émergence de pratiques de recherche inscrites dans un paradigme interprétatif que je qualifierai d’« élargi » de même qu’aux questions éthiques soulevées, notamment, par la grande accessibilité aux plateformes numériques et l’ouverture conséquente à de nouvelles problématiques de recherche. Je reprendrai finalement la notion d’échantillonnage, laquelle s’applique non seulement aux personnes, mais aussi aux espaces-temps et aux données. Ceci ne constitue pas une préoccupation nouvelle depuis 2007. J’avance toutefois qu’« un échantillonnage scientifiquement valide » vu comme un élément central d’une recherche rigoureuse est intimement lié à l’explicitation des stratégies mises en place pour le constituer et à leur communication lors de la diffusion de la recherche.
Ma réaction s’organisera alors autour de ces dimensions. Avant de les aborder toutefois, je souhaite revenir sur le titre proposé en 2007.
Un échantillonnage scientifiquement valide : un besoin d’ancrer les perspectives
J’avais choisi d’utiliser l’expression scientifiquement valide. Une telle appellation, déjà très lourdement connotée, avait alors été clarifiée, dès les premiers paragraphes. Je ressens toutefois maintenant le besoin de qualifier davantage cette expression.
Toute pratique de recherche (l’étape de l’échantillonnage ici) est étroitement liée aux façons de faire admises par une communauté scientifique. Dans la tradition des écrits de Kuhn (1983), Dubois (1999) écrit qu’être membre d’une communauté scientifique c’est : 1) faire partie d’un système social, c’est-à-dire d’une institution qui a ses propres limites, distinctes de celles d’autres institutions sociales; 2) être choisi et intégré dans un système dont les acteurs entretiennent des relations d’interdépendance selon des modalités conformes à des principes normatifs spécifiques; 3) faire l’objet d’un contrôle social. Dubois poursuit sa pensée et circonscrit la notion de communauté scientifique lorsqu’il emprunte à Kuhn la notion de paradigme. Dans une telle perspective, la communauté scientifique est vue comme étant locale et indissociable d’une discipline particulière, voire d’une tradition disciplinaire. Pour Dubois, citant Kuhn, il existe une relation circulaire entre « paradigme » et « communauté scientifique ». Une telle perspective sous-entend qu’une certaine régulation des comportements scientifiques existe et que les nombreuses sous-communautés scientifiques se différencient entre elles. Autrement dit, le paradigme fournit le cadre normatif pour encadrer les comportements scientifiques (entendons ici les pratiques) qui, à leur tour, renforcent le paradigme.
Revenant à mes propos de 2007, je constate que j’avais pris soin de définir la notion « d’échantillonnage scientifiquement valide » à l’intérieur des normes définies à ce moment par la communauté de recherche qualitative/interprétative. Je le qualifiais d’intentionnel, de pertinent par rapport à l’objet et aux questions de la recherche, de balisé théoriquement et conceptuellement, d’accessible et conforme aux balises éthiques qui encadrent la recherche. J’endosse toujours de telles caractéristiques. Cependant, peut-on encore parler d’une communauté de recherche qualitative/interprétative ou est-il davantage question de diverses sous-communautés chapeautées par le large éventail de la perspective qualitative/interprétative teintées par plusieurs courants théoriques tels que le post-modernisme, la théorie critique et autres courants[1]? Déjà en 2007, Anadón, dans un collectif sur les recherches participatives, soulignait l’éclatement des diverses formes de recherche et, dans un article publié en 2019 (Savoie-Zajc, 2019), je soulignais l’ouverture de la revue Recherches qualitatives à publier des articles diffusant les résultats de recherches-actions, de recherches-développements, de recherches collaboratives et d’autres formes de recherche inscrites dans ce que je nommerai un paradigme interprétatif « élargi ». Sans entrer dans le détail de chacune de ces formes de recherche et leurs courants théoriques, on peut toutefois se demander comment la notion d’échantillonnage a évolué[2] compte tenu de cette diversité de perspectives.
Émergence de pratiques de recherche inscrites dans un paradigme interprétatif « élargi » et le processus d’échantillonnage
Je reprends ici les critères utilisés en 2007 pour circonscrire la notion d’échantillon. C’est à partir de ceux-ci qu’une relecture s’effectuera.
Le processus d’échantillonnage est-il toujours intentionnel?
Plusieurs chercheurs choisissent de qualifier leur pratique de recherche qualitative comme ayant des visées émancipatrices, transformatrices, engagées, militantes, collaboratives[3]. Dans ces formes de recherche, le processus d’échantillonnage n’est souvent toutefois plus vu comme étant intentionnel. Il acquiert d’autres caractéristiques, davantage cohérentes avec ces visées. Il est négocié, débattu avec les personnes qui acceptent d’en faire partie. De plus, les rôles joués par l’ensemble des participants à la recherche (dont le chercheur) sont discutés et évolutifs. Je prends pour exemple E. Guay (2022), lequel qualifie sa recherche d’« ethnographie suffisamment bonne ». Le chercheur décrit très clairement comment il a été amené à repenser, non seulement le processus d’échantillonnage (qui approcher?), mais aussi son rôle auprès d’organismes qui accompagnent des citoyens aux prises avec des problèmes de logement. Il devient une ressource pour le milieu, car il collabore, avec les participants, à l’atteinte des objectifs de développement et de changement visés. Il souligne aussi comment son autorité de chercheur ethnographe est contestée par « son échantillon » : celle-ci n’est plus vue comme reposant sur une expertise unidirectionnelle (du chercheur aux participants), mais elle est négociée tout au long de la recherche, quitte à influencer son orientation même. Processus d’échantillonnage, orientation de la recherche et autorité du chercheur sont vus comme étant interreliés alors que la dynamique même de la recherche suppose une interaction constante entre ces dimensions. Des finalités différentes, quoique réconciliables, sont à l’oeuvre : les participants visent un objectif de changement alors que le chercheur souhaite développer une meilleure compréhension du phénomène étudié tout en étant une ressource pour supporter le changement visé.
Qu’en est-il de la pertinence de l’échantillonnage par rapport à l’objet et aux questions de la recherche et de ses balises théoriques et conceptuelles?
Le processus d’échantillonnage introduit des biais dans la recherche non pas parce que celui-ci manque de pertinence et de cohérence avec les objectifs et le cadre théorique de la recherche, mais parce que la méfiance et/ou le halo social du chercheur freinent les échanges entre les participants et les chercheurs. Un excellent numéro de Recherches qualitatives, intitulé « la recherche qualitative en contexte africain » (Yoro & Guillemette, 2012) expose d’ailleurs un éventail de problèmes rencontrés dans des situations où les liens entre les chercheurs et les participants n’arrivent pas à se créer. Il est question de méfiance éprouvée par les participants à l’égard du chercheur ou de la situation de recherche; de la barrière créée par le halo social du chercheur, source de biais de la relation avec les participants; des freins posés par des membres de la communauté qui accordent ou non une permission tacite de participer à la recherche; de la position d’autorité de certains participants à la recherche et la conséquente limitation ou la pression pour une conformité de parole des autres participants. La prise en compte de la nature des liens sociaux et culturels dans les milieux où se déroule la recherche est ainsi préalable à toutes décisions en lien avec le processus d’échantillonnage. Ainsi, un échantillonnage « scientifiquement valide » peut paraître très acceptable en théorie parce que cohérent avec l’objet et les questions de recherche ainsi que clairement balisé théoriquement et conceptuellement. Il n’y a cependant pas d’assurance que celui-ci donnera un accès à des discours crédibles compte tenu des contextes sociaux et culturels où la recherche se déroule. Cette problématique n’est certainement pas nouvelle. Il importe toutefois de garder une vigilance méthodologique et de rester critique en regard des discours recueillis.
La disponibilité des outils technologiques et considérations éthiques
L’accessibilité aux outils technologiques[4] a fortement impacté le domaine de la recherche que ce soit en ce qui a trait aux pratiques, aux problématiques et à l’accès aux données. Cette innovation technologique génère des questionnements éthiques.
Certaines pratiques de recherche ont été modifiées afin de tenir compte de la puissance des outils technologiques (développement de stratégies d’échantillonnage spécifiques, approches nouvelles pour des collectes de données à distance; analyse de données au moyen de logiciels dédiés) et des critiques par rapport à leurs limites ont émergé. Ainsi, des problématiques nouvelles de recherche sont apparues (que l’on pense par exemple à l’organisation du travail à distance, à la pratique de la télémédecine et la qualité des relations patient-personnel médical, aux situations de cyberharcèlement, entre autres). Les nombreux sites internet disponibles donnent aussi accès à une diversité de traces de l’expérience humaine (visuelles, sonores, écrites) parmi lesquelles le chercheur apprend à naviguer selon les objectifs de sa recherche. Comment s’engager dans un processus d’échantillonnage dans un tel foisonnement de traces, de témoignages? Comment vérifier leur crédibilité par rapport à la mise en scène possible d’expériences? Quels critères établir pour assurer la cohérence avec les objectifs de la recherche? Toutes ces questions sont nouvelles, car un tel univers technologique se déploie avec toute sa puissance de diffusion d’une panoplie d’informations. La montée en puissance de l’intelligence artificielle constitue aussi un développement technologique majeur susceptible de laisser des empreintes importantes sur la recherche en général et le processus d’échantillonnage en particulier (pensons aux dialogues générés par l’IA, aux montages-photos virtuels, aux métavers). Là encore, le chercheur doit innover pour définir des critères pertinents afin de cheminer dans un processus d’échantillonnage (incluant des discours, des traces d’expérience par des visuels) de témoignages liés à un phénomène qu’il cherche à comprendre.
Arrêtons-nous aux sites internet qui constituent des plateformes regroupant des personnes dont les intérêts sont communs. Il devient alors possible de rejoindre ces sous-groupes, proches ou non géographiquement du chercheur et autrement difficilement accessibles sans de telles plateformes, pour des fins de recherche. Une telle accessibilité n’est toutefois pas exempte d’embûches et des considérations éthiques en découlent. En guise d’exemple, prenons la recherche menée en ligne par Mendelzweig en 2010 auprès de sites de rencontres dont l’objet central était la sexualité entre hommes. De l’aveu même de la chercheuse, le recours au site internet comporte des avantages importants pour faire une recherche auprès de groupes qui jouissent, selon elle, « d’invisibilité sociale » (p. 258). Se pose alors la question de la démarche d’échantillonnage dans un tel contexte et elle souligne les inconvénients et les dérives éthiques liés à une telle situation. Son article énumère plusieurs problèmes qui touchent notamment à la qualité des liens entre elle, la chercheuse, et les participants et à la dimension éthique. Elle nomme d’abord sa place dans l’activité d’un tel site comme étant forcément intrusive, car les buts poursuivis par les membres du site et les siens sont différents. Elle souligne aussi l’enjeu important de savoir qui se cache véritablement sous les répondants : les profils peuvent être « retouchés » et la tromperie facile à mettre en oeuvre. Elle écrit : « La dissociation introduite entre identité corporelle et identité virtuellement exprimée autorise en effet l’acteur social à développer un jeu relationnel créatif et lui offre des options d’interactions inédites jusque là » (Mendelzweig, 2010, p. 254).
Il y a là un problème central par rapport au processus d’échantillonnage : qui fait véritablement partie de la recherche? De même, les enjeux éthiques d’anonymat et de confidentialité sont peu applicables dans la mesure où des participants qui ont volontairement accepté de participer à la recherche peuvent mettre en scène un discours et des pratiques « idéales », lesquels ne reflètent pas leur expérience réelle[5]. Un tel écart entre discours idéal et réel n’est certainement pas nouveau. Disons cependant que le contexte de la recherche en ligne, sans contact direct avec les participants, l’exacerbe, car la corroboration par l’usage de plusieurs sources de données n’est pas spontanément envisageable, selon les objets de recherche poursuivis.
Le processus d’échantillonnage s’applique non seulement aux personnes, mais aussi aux espaces-temps et aux données
L’article de 2007 développait la notion d’échantillon et d’échantillonnage à la lumière de différents cadres méthodologiques qui induisent une façon spécifique de planifier et d’orienter le processus d’échantillonnage. Les caractéristiques générales identifiées pour la constitution d’un échantillon d’une ethnographie, d’une ethnométhodologie, d’une phénoménologie ou d’une théorie ancrée demeurent. Le texte accordait aussi une brève place à la notion d’échantillonnage appliquée aux espaces-temps, comme le recours à l’échantillonnage en palier selon des intervalles déterminés ou par réseau. Le texte désignait aussi le processus d’échantillonnage qui s’applique aux données recueillies en cours de recherche comme les données contrastées et la notion de comparaison constante au coeur de la théorie ancrée (Glaser & Strauss, 1967) et la recherche d’incidents critiques ou de pratiques exemplaires (Deslauriers et al., 2017). Mon intention n’est pas de reprendre ces formes d’échantillon, car elles sont bien documentées dans la littérature[6]. Ce que je souhaite toutefois faire ressortir c’est que dans une perspective de planification « d’un échantillon scientifiquement valide », il importe que le chercheur rende explicites ses stratégies de constitution de son échantillon et les communique à ses lecteurs.
Le processus d’échantillonnage étalé sur une longue période : les stratégies d’échantillonnage par palier, par réseau
Le recrutement de participants éventuels à une recherche n’est pas toujours simple et il peut s’étaler sur une longue période. Diverses raisons sont identifiées : difficultés d’accès aux personnes car le chercheur ne peut faire connaître les objectifs de sa recherche directement auprès du public cible. Pensons aux recherches auprès d’enfants d’âge scolaire par exemple, car il faut d’abord informer les directions d’école, les enseignants, les parents et ultimement les enfants. Le but est d’obtenir l’autorisation de toutes ces personnes avant d’amorcer une collecte de données auprès des enfants. Les difficultés d’accès touchent aussi aux personnes dont l’emploi du temps est atypique (comme les travailleurs de nuit) ou chargé (des dirigeants d’entreprise ou du personnel hospitalier), ou à celles qui ont un statut particulier (des personnes sous traitement médical, des membres de congrégations religieuses ou de partis politiques).
Les notions d’échantillonnage par réseau, par palier ou en boule de neige sont alors fort intéressantes. Elles soulignent la nécessité de devoir franchir divers niveaux d’accès et l’importance de documenter ces différents niveaux pour que le lecteur de la recherche développe une bonne compréhension de la trajectoire suivie par le chercheur. Par exemple, Gravel (2022) documente très explicitement les divers paliers franchis pour avoir l’autorisation de travailler avec du personnel scolaire qui ont établi une collaboration au travail. Pour effectuer son étude de cas multiples, cinq stratégies d’échantillonnage ont été développées : 1) la création d’un outil didactique; 2) des consultations préalables auprès d’orthopédagogues; 3) des rencontres avec des enseignants des écoles retenues; 4) le consentement à participer et l’inclusion d’autres intervenants scolaires dans la recherche; 5) l’engagement à présenter les résultats préliminaires de l’étude sur la dynamique de collaboration. Elle qualifie sa démarche « d’échantillonnage ascendant ».
Un processus d’échantillonnage sur les données recueillies en cours de recherche
La notion d’échantillonnage peut aussi être étendue aux données : les données contrastées, les incidents critiques. En ce qui concerne les données contrastées, on pense bien sûr aux écrits de Glaser et Strauss (1967) qui ont développé la notion de comparaison constante vue comme le moteur au coeur de la réalisation d’une théorie enracinée.
Une autre perspective intéressante est celle de l’incident critique. Au cours de la collecte de données, le chercheur porte attention aux situations difficiles, aux incidents tels que communiqués par un ou des participants à la recherche. Ce qu’ils nomment « incidents critiques » devient alors le foyer central de la recherche. Deslauriers et al. (2017) proposent d’ailleurs des critères pour cerner les épisodes d’incidents critiques. Ici encore, cette notion constitue une instance d’échantillonnage de données. Le processus d’échantillonnage initial, d’abord effectué auprès de personnes qui possèdent une expertise spécifique, est suivi d’un deuxième palier d’échantillonnage qui porte lui sur les données.
Ce que j’ai voulu souligner dans cette section ne constitue pas une préoccupation nouvelle depuis 2007. J’avance toutefois l’argument que pour soutenir la rigueur d’une recherche, il importe pour le chercheur de clairement documenter les stratégies mises en place dans le processus d’échantillonnage et de communiquer celles-ci lors de la diffusion de la recherche. C’est par une telle clarification que le lecteur sera non seulement en mesure d’apprécier la cohérence de la démarche, mais aussi que l’interprétation des résultats, ultimement proposée, sera liée aux caractéristiques de l’échantillon. Il importe donc que le processus d’échantillonnage soit clairement documenté. Je propose aussi que par la communication des diverses stratégies d’échantillonnage, un répertoire de pratiques se constitue. Celui-ci pourrait jouer un rôle pédagogique dans la mesure où d’autres chercheurs seraient susceptibles de s’en inspirer. Les recherches citées précédemment constituent de bons exemples.
Conclusion
La relecture de l’article écrit en 2007 et la consultation d’écrits subséquents me permettent de constater que le paradigme qualitatif/interprétatif appliqué à la recherche s’est élargi. Je constate qu’une ouverture s’est créée alors que plusieurs chercheurs s’appuient sur des approches théoriques qui placent la recherche comme un catalyseur de changement et d’émancipation. Ces perspectives teintent différemment les rôles du chercheur dans sa recherche. De même, son autorité est vue comme étant partagée et discutée. Ceci entraîne des conséquences sur le processus d’échantillonnage. Qualifié d’intentionnel dans l’article de 2007, il est maintenant vu comme pouvant être évolutif.
De plus, l’accessibilité aux outils technologiques et aux plateformes numériques ouvre non seulement la porte à de nouvelles problématiques, mais aussi à des pratiques de recherche inédites en 2007. Ceci vient toutefois avec des considérations éthiques spécifiques et des embûches, dont celles affectant le processus d’échantillonnage. Pensons par exemple à diverses mises en scène susceptibles d’entraîner des problèmes éthiques de tromperie et de déception, aux stratégies utilisées pour s’infiltrer dans des groupes en ligne ou, inversement, créer un personnage dans le but d’attirer l’attention. Les stratégies mises en place par le chercheur pour constituer un échantillon pertinent doivent, dès lors, inclure des réflexions de la part de celui-ci sur la crédibilité des données recueillies dans un contexte où le lien entre le chercheur et les participants reste virtuel, où les corroborations peuvent être difficiles à effectuer et ainsi limiter les interprétations proposées.
Finalement, il importe de souligner à grands traits que la rigueur de la recherche du paradigme qualitatif/interprétatif « élargi » est intimement liée à la communication claire et explicite de la démarche du chercheur de l’ensemble de sa trajectoire de recherche, le processus d’échantillonnage représentant une étape. C’est dans une telle communication que la cohérence des décisions du chercheur avec ses objectifs de recherche pourra être appréciée par les membres de la communauté scientifique.
Je constate finalement que l’ensemble des propos tenus dans ce texte s’inscrivent sous ce que St. Pierre (2019) nomme l’approche conventionnelle humaniste de la recherche qualitative qu’elle reconnaît, critique et rejette tout à la fois. Il est vrai que les différentes perspectives adoptées dans ce texte, en lien avec le processus d’échantillonnage, visent à éclairer les pratiques des chercheurs pour réaliser des recherches rigoureuses et crédibles qui s’inscrivent dans ce que j’ai nommé le « paradigme interprétatif élargi ».
Parties annexes
Note biographique
Lorraine Savoie-Zajc est professeure émérite de l’Université du Québec en Outaouais. Elle a enseigné durant plusieurs années au Département des sciences de l’éducation des cours liés à la méthodologie de la recherche qualitative et de la recherche-action. Elle a écrit plusieurs articles et chapitres de livres traitant de questions méthodologiques en lien avec certains modes de collecte de données ainsi que sur les critères de rigueur de recherches de type qualitatif et action.
Notes
-
[1]
Voir le texte de M. Anadón dans ce numéro « Quelques réflexions autour de l’évolution de la recherche dite “qualitative” ».
-
[2]
La notion d’échantillonnage est contestée et disparaît même dans certaines formes de recherche (readymade methodology, recherche post-qualitative). Mes propos n’aborderont pas ces postures.
-
[3]
Voir Dionne et al. (2022), le numéro de Recherches qualitatives sur l’activité de recherche qualitative à un carrefour de visées transformatrices et émancipatrices.
-
[4]
J’inclus dans les outils technologiques non seulement les logiciels dédiés (comme NVivo), mais aussi la diversité de plateformes de communication (comme Zoom), les sites internet (comme Facebook), l’intelligence artificielle (comme CHAT GPT avec ses possibilités de dialogues ou les métavers).
-
[5]
Latzko-Toth et Pastinelli (2022) proposent un excellent texte sur les considérations éthiques liées à l’utilisation de données en ligne. Ils offrent une distinction utile entre informations privées et publiques retrouvées sur le Web ainsi que sur la question du consentement nécessaire ou non de la source des données. Ils offrent des clés pour aider le chercheur à naviguer dans ces distinctions importantes et afficher un comportement respectueux et éthique.
-
[6]
Plusieurs textes, dont celui de LeCompte et Preissle (1993) ou celui de Pirès (1997), proposent une excellente énumération de différents types d’échantillon.
Références
- Anadón, M. (Éd.). (2007). Recherches participatives : multiples regards. Presses de l’Université du Québec.
- Anadón, M. (2024). Quelques réflexions autour de l’évolution de la recherche dite « qualitative ». Recherches qualitatives, 43(2), 5-14.
- Deslauriers, J. M., Deslauriers, J. P., & LaFerrière-Simard, M. (2017). La méthode de l’incident critique et la recherche sur les pratiques des intervenants sociaux. Recherches qualitatives, 36(1), 94-112. https://id.erudit.org/iderudit/1084358ar
- Dionne, P., Baribeau, C., & Savoie-Zajc, L. (Éds). (2022). L’activité de recherche qualitative à un carrefour de visées transformatrices et émancipatrices. Recherches qualitatives, 41(1). https://www.erudit.org/fr/revues/rechqual/2022-v41-n1-rechqual06974/
- Dubois, M. (1999). Introduction à la sociologie des sciences. Presses universitaires de France.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory. Aldine Press.
- Gravel, C. (2022). Une démarche méthodologique ascendante pour l’échantillonnage d’une étude exploratoire sur la collaboration en milieu scolaire au primaire : quels impacts pour les entretiens individuels? Recherches qualitatives, 41(1), 266-288. https://doi.org/10.7202/1088804ar
- Guay, E. (2022). Les « ethnographies suffisamment bonnes » revisitées : analyse ethnographique des organisations, approche participative et liens entre les mondes sociaux. Recherches qualitatives, 41(1), 200-220. https://doi.org/10.7202/1088801ar
- Kuhn, T. S. (1983). La structure des révolutions scientifiques. Flammarion.
- Latzko-Toth, G., & Pastinelli, M. (2022). L’éthique de la recherche dans les espaces en ligne : clarification de quelques notions. Politique et sociétés, 41(3),221-230. https://doi.org/10.7202/1092344ar
- LeCompte, M. D., & Preissle, J. (1993). Ethnography and qualitative design in educational research. Academic Press.
- Mendelzweig, M. D. (2010). Méthode de recherche qualitative utilisant les sites de rencontre par Internet : expérimentation d’une recherche portant sur les sexualités entre hommes. Recherches qualitatives, 29(2), 245-269. https://doi.org/10.7202/1092344ar
- Pirès, A. (1997). Échantillonnage et recherche qualitative : essai théorique et méthodologique. Dans J. Poupart, J.-P. Deslauriers, L.-H. Groulx, A. Laperrière, P. Mayer, & A. P. Pirès (Éds), La recherche qualitative : enjeux épistémologiques et méthodologiques (pp. 113-172). Gaétan Morin.
- Savoie-Zajc, L. (2019). Les pratiques des chercheurs liées au soutien de la rigueur dans leur recherche : une analyse d’articles de Recherches qualitatives parus entre 2010 et 2017. Recherches qualitatives, 38(1), 32-52. https://doi.org/10.7202/1059646ar
- St. Pierre, E. A. (2019). Post qualitative inquiry in an ontology of immanence. Qualitative Inquiry, 25(1), 3-16.
- Yoro, B. M., & Guillemette, F. (Éds). (2012). Recherche qualitative en contexte africain. Recherches qualitatives, 31(1). https://www.erudit.org/fr/revues/rechqual/2012-v31-n1-rechqual06657/