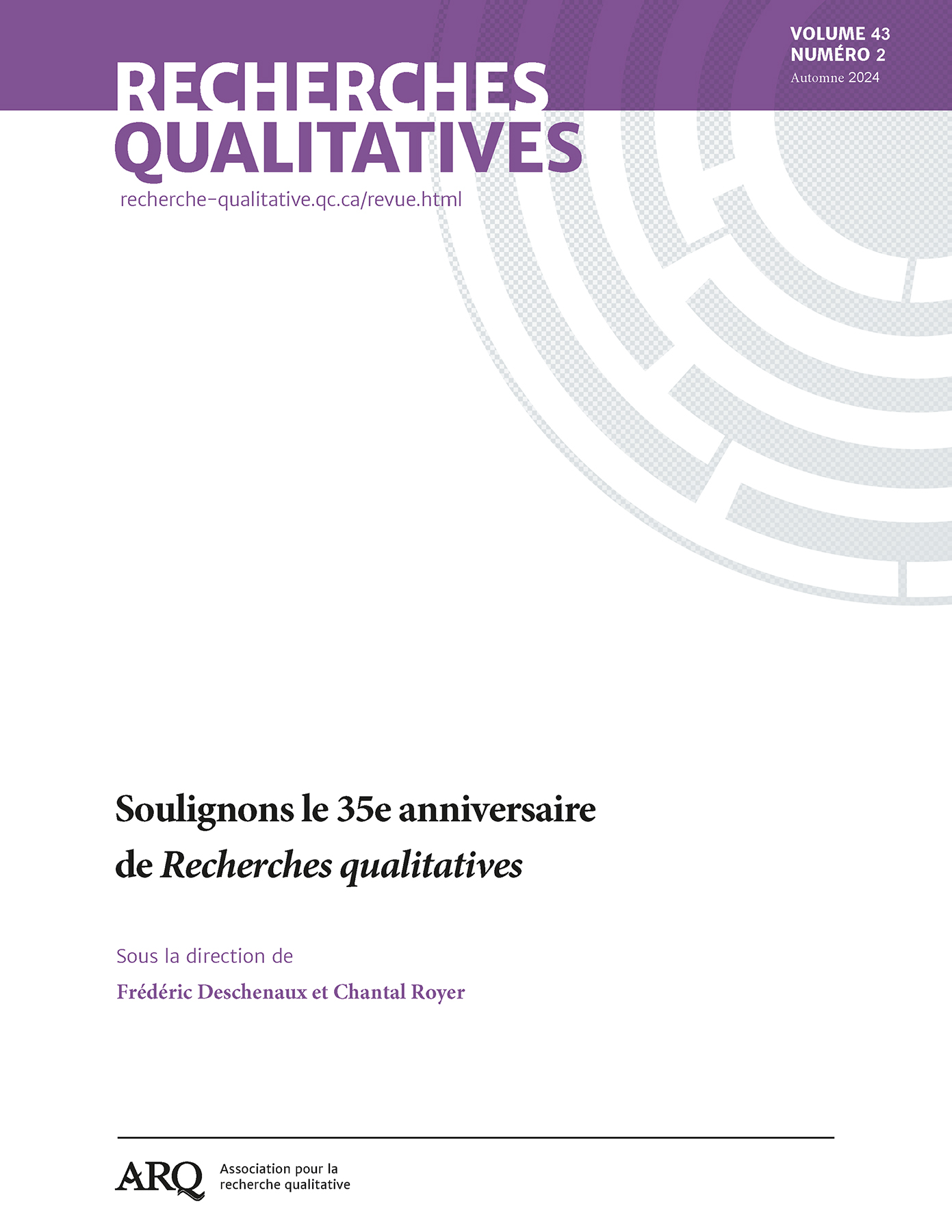Dans cet article, l’autrice présente un regard renouvelé sur un article qu’elle a publié dans la revue : Anadón, M. (2006). La recherche dite « qualitative » : de la dynamique de son évolution aux acquis indéniables et aux questionnements présents. Recherches qualitatives, 26(1), 5-31. https://doi.org/10.7202/1085396ar Le texte face auquel je tenterai de me (re)positionner a été écrit en 2005. Le contexte de l’époque demandait une lecture évolutive de la recherche qualitative. En effet, à ma connaissance, il n’y avait pas d’écrits francophones qui abordaient le long et complexe développement de ce type de recherche. Dans ce contexte, j’ai choisi de faire une lecture historique de la recherche dite « qualitative », avec l’objectif de reconstituer son devenir et de montrer qu’elle avait non seulement connu un essor remarquable, mais qu’elle avait aussi consolidé sa dimension épistémologique et sa légitimité scientifique. J’utiliserai ici, comme en 2006, l’expression recherche dite « qualitative » pour référer aux multiples recherches parfois qualifiées de qualitatives-interprétatives (Savoie Zajc, 2018) qui s’inscrivent dans le paradigme interprétatif et privilégient par conséquent l’expérience et les points de vue des participants. En effet, le paradigme interprétatif s’est développé sur la base de plusieurs dualismes, objectivité / subjectivité, catégories fixes / catégories émergentes, réalité statique / réalité fluide, etc., qui lui ont permis d’attester son incompatibilité au regard du modèle positiviste. Cette incompatibilité est la base de l’opposition explication versus compréhension, recherche en sciences de la nature versus recherche en sciences sociales. La recherche dite « qualitative » a connu un essor important dans plusieurs domaines des sciences sociales et humaines et s’est constituée comme un espace de pensée proposant de riches référents théoriques et méthodologiques. Ses acquis sont évidents et largement utilisés aujourd’hui par les chercheurs (phénoménologie, ethnographie, herméneutique, structuralisme, analyse narrative, sémiotique, etc.). Afin d’établir son évolution, la périodisation composée par Denzin et Lincoln (1994, 2000, 2023) m’est apparue intéressante, car elle permettait d’observer les différents changements de la recherche dite « qualitative » à la fois sur les plans épistémologiques, théoriques et méthodologiques. Ainsi, sept moments caractérisaient son évolution : le moment traditionnel; le modernisme; les perspectives composites; la crise de représentation; le postmodernisme, la période des nouvelles ethnographies; la recherche postexpérimentale; l’éclatement de la recherche qualitative. Depuis ce dernier moment, la recherche dite « qualitative » a poursuivi son évolution, notamment en ce qui a trait à l’accroissement des exigences de résultats à son égard. Aujourd’hui, elle est invitée à fournir des données probantes afin que les pratiques et les politiques soient développées sur la base de résultats scientifiques. Cela exige une « méthodologie rigoureuse, systématique et objective », qui doit contribuer à la construction d’une base de connaissances « de qualité, fiables et valides » (Saussez & Lessard, 2009 cités dans Anadón, 2018, p. 39). Ces demandes caractérisent le huitième moment, que Denzin et Lincoln (2005, p. 3) nomment le « futur fracturé » et que j’ai appelé « la dérive pragmatique » (Anadón, 2018, p. 36), à travers lequel la recherche qualitative est contestée et confrontée à un recul méthodologique important. Ces huit moments sont traversés par différentes perspectives épistémologiques. Par exemple, le positivisme dans la période traditionnelle; le postpositivisme dans les moments du modernisme et des perspectives composites où plusieurs perspectives interprétatives ont été développées en critique au premier modèle et utilisées simultanément : herméneutique, sémiotique, phénoménologie, théorie critique, etc. Par la suite, la recherche qualitative se décloisonne, elle devient interdisciplinaire, transdisciplinaire, en mettant en cause les notions de réalité, de vérité, d’universalité qui exigent de repenser les bases ontologiques, épistémologiques et méthodologiques par le biais du postmodernisme. Plus récemment, la période …
Parties annexes
Références
- Anadón, M. (2006). La recherche dite « qualitative » : de la dynamique de son évolution aux acquis indéniables et aux questionnements présents. Recherches qualitatives, 26(1), 5-31. https://doi.org/10.7202/1085396ar
- Anadón, M. (2018). Quelques repères sociaux et épistémologiques de la recherche en éducation au Québec. Dans T. Karsenti, & L. Savoie-Zajc (Éds), La recherche en éducation : étapes et approches (4e éd., pp. 17-50). Presses de l’Université de Montréal.
- Anadón, M. (2019). Les méthodes mixtes : implications pour la recherche « dite » qualitative. Recherches qualitatives, 38(1), 105-123. https://doi.org/10.7202/1059650ar
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994). The art of interpretation, evaluation, and presentation. Dans N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Éds), Handbook of qualitative research (pp. 479-483). Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Éds). (2000). Handbook of qualitative research (2e éd.). Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). Introduction. The discipline and practice of qualitative research. Dans N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Éds), The SAGE handbook of qualitative research (3e éd., pp. 1-29). Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Éds). (2005). The SAGE handbook of qualitative research (3e éd.). Sage Publications.
- Denzin, N. K., Lincoln, Y. S., Giardina, M. D., & Cannella, G. S. (Éds). (2023). The SAGE handbook of qualitative research (6e éd.). Sage Publications.
- Flick, U. (2002). An introduction to qualitative research (2e éd.). Sage Publications.
- Gohier, C. (2004). De la démarcation entre critères d’ordre scientifique et d’ordre éthique en recherche interprétative. Recherches qualitatives, 24, 3-17. https://doi.org/10.7202/1085561ar
- Guba, E. G. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. Educational Technology Research and Development, 29, 75-91.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. Educational Technology Research and Development, 30, 233-252.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1985). Naturalistic inquiry. Sage Publications.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1986). But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New Directions for Program Evaluation, (30), 73-84.
- Haraway, D. (2013). Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial perspective 1. Dans M. Wyer, M. Barbercheck, D. Cookmeyer, H. Ozturk, & M. Wayne (Éds), Women, science, and technology (pp. 455-472). Routledge.
- Holmes, A. G. D. (2020). Researcher positionality. A consideration of its influence and place in qualitative research. A new researcher guide. Shanlax International Journal of Education, 8(4), 1-10.
- Hurley, E. S., & Jackson, M. (2020). Msit No’kmaq: An exploration of positionality and identity in indigenous research. Witness: The Canadian Journal of Critical Nursing Discourse, 2(1), 39-50.
- Lincoln, Y. S. (1995). Emerging criteria for quality in qualitative and interpretive research. Qualitative inquiry, 1(3), 275-289.
- Lincoln, Y., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage Publications.
- Manning, K. (1997). Authenticity in constructivist inquiry: Methodological considerations without prescription. Qualitative Inquiry, 3(1), 93-115.
- Proulx, J. (2019). Recherches qualitatives et validités scientifiques. Recherches qualitatives, 38(1), 53-70. https://doi.org/10.7202/1059647ar
- Richardson, L., & St. Pierre, E. (2008). A method of inquiry. Collecting and interpreting qualitative materials, 3(4), 473.
- Saussez, F., & Lessard, C. (2009). Entre orthodoxie et pluralisme, les enjeux de l’éducation basée sur la preuve. Revue française de pédagogie. Recherches en éducation, (168), 111-136. https://doi.org/10.4000/rfp.1804
- Savoie-Zajc, L. (2018). La recherche qualitative/interprétative en éducation. Dans T. Karsenti, & L. Savoie-Zajc (Éds), Introduction à la recherche en éducation étapes et approches (4e éd., pp. 171-198). Éditions du CRP.
- Savoie-Zajc, L. (2019). Les pratiques des chercheurs liées au soutien de la rigueur dans leur recherche : une analyse d’articles de Recherches qualitatives parus entre 2010 et 2017. Recherches qualitatives, 38(1), 32-52. https://doi.org/10.7202/1059646ar
- Schwandt, T. A., Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2007). Judging interpretations: But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New Directions for Evaluation, (114), 11-25.
- St. Pierre, E. A. (2011). Post qualitative research: The critique and the coming after. Dans N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Éds), The SAGE handbook of qualitative research (4e éd., pp. 611-626). Sage Publications.