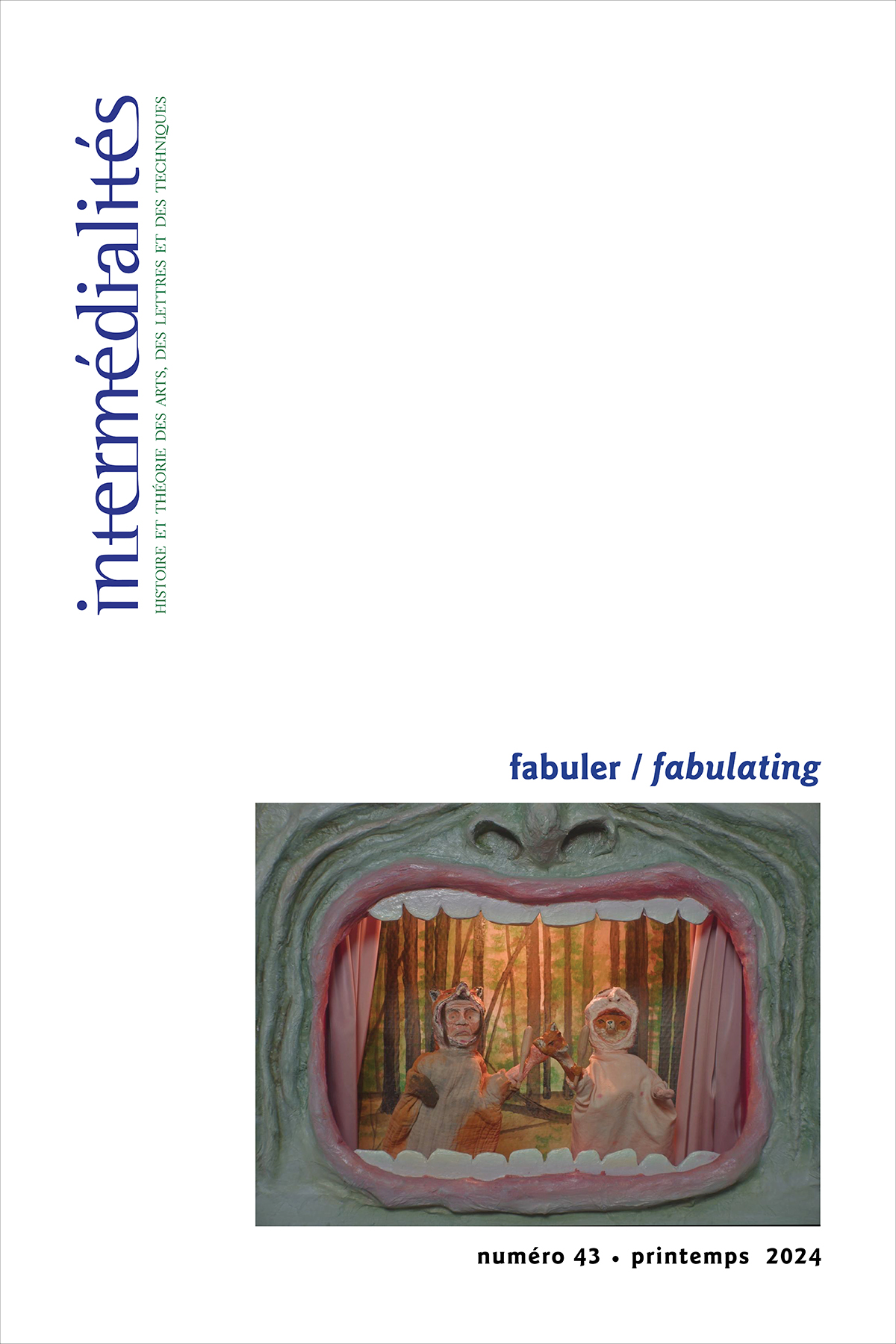Corps de l’article
Jusqu’ici les premiers hommes ont donné naissance aux fables, sans qu’il y ait, pour ainsi dire, de leur faute. On est ignorant, et on voit par conséquent bien des prodiges : on exagère naturellement les choses surprenantes en les racontant ; elles se chargent encore de diverses faussetés en passant par plusieurs bouches; il s’établit des systèmes de philosophie fort grossiers et fort absurdes[1].
À quoi tient la fable ? En quels lieux advient-elle ? Que produit-elle ? Associée à l’ignorance, à l’exagération, à l’absurdité ou à la fausseté, la fable a de toute évidence bien mauvaise presse ! En réalité, la fabulation peut advenir au sein de véritables Fables — avec une majuscule initiale —, aussi bien qu’ailleurs. Bien loin de s’arrêter aux formes concises et ciselées ainsi décrites par La Fontaine :
Les fables ne sont pas ce qu'elles semblent être :
Le plus simple animal nous y tient lieu de maître.
Une morale nue apporte de l'ennui;
Le conte fait passer le précepte avec lui.
En ces sortes de feinte il faut instruire et plaire[2],
l’acte de fabuler traverse des textes de diverse nature, imprègne autant de discours, déploie des puissances complexes. C’est que la fabulation concerne en droit tous les médiums, jouant de surcroît sur tous les plans : théâtre anthropologique (Zoo ou l’assassin philanthrope de Vercors, 1959), galante philosophie de l’astronomie (Entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle, 1686), création littéraire en vers (Fables de La Fontaine, 1668–1694) ou en prose (Décaméron de Boccace, 1349–1353), peinture allégorique (Effets du bon et du mauvais gouvernement d’Ambrogio Lorenzetti, vers 1338), cinéma « direct » ou « vérité » (Le Jaguar de Jean Rouch, 1967; La Bête lumineuse de Pierre Perrault, 1982) — et jusqu’aux fables juridiques dont, d’après Bernard Edelman, « on n’en finirait pas d’énumérer les ‘‘fictions’’ [3]». Il s’agit sans conteste d’un acte primordial : vital, même.
Il ne faudrait pas réduire la fable à l’enseignement qui l’achève, ou plutôt, vers lequel elle tend car sa morale, son ironique leçon ne peut être dissociée des excès et exagérations qui précèdent — une grenouille grosse comme un boeuf ! Toutefois, si fabuler permet à coup sûr d’extravaguer, l’acte de fabulation n’en constitue pas moins, en même temps qu’une forme critique, une puissance de juridiction — on y revient plus loin. Une telle puissance a été parfaitement suggérée par Louis Marin, qui décrit notamment le fabuliste en critique subtil :
Ce narrateur léger et habile racontera des histoires et non l'Histoire; il ne tiendra pas de discours critique sur le Récit, mais il dira des récits dont toute l'efficace tiendra à ce que — pour un moment — il conte au pouvoir la façon dont le pouvoir se raconte et, du même coup, le piégera à son propre piège par le plaisir que le pouvoir y prend. Ainsi La Fontaine, Retz ou Perrault[4].
La fable est cachottière — c’est là son moindre défaut ! —, mais il le faut bien dès lors qu’elle s’adresse au pouvoir. En hissant l’art rhétorique de la fabulation à côté de celui de la diplomatie et en osant les mettre en concurrence, La Fontaine, dans « Le pouvoir des fables » (1678), ferait-il preuve de trop de témérité ? En faisant revêtir à sa fable les habits de conseillère du pouvoir, le fabuliste jouerait-il ici un jeu dangereux ? Dans son texte, « Fabuleux diplomate : “Le pouvoir des fables” de Jean de La Fontaine », Éric Méchoulan met au jour l’habileté et la légèreté du fabuliste dans un exercice de diplomatie au sein duquel la fabulation, séductrice et divertissante comme l’exige son art, n’en recèle pas moins des visées politiques.
Si la fable animalière peut se faire diplomate dans le contexte du Grand Siècle, elle pourra aussi, dans celui de la Belle Époque en pleine mutation industrielle et médiatique, servir des intérêts tout autant mercantiles qu’édifiants. Dans « Les déclinaisons des fables animalières de Benjamin Rabier, symbole des prémices d’un nouveau système médiatique », Myriam Bahuaud et Jessica de Bideran font ressortir la souplesse d’adaptation de la fable, toujours dans l’air du temps et, même, opportuniste de bon aloi ! En adoptant différents supports tout en servant plusieurs desseins (dont le marketing publicitaire), la fable de Rabier ne cesse de se redessiner et, par là, se compose autrement, diversifiant ses marchés comme ses publics. La force du « fabuler » découle d’une telle aptitude : toujours, la fable s’adapte, qui peut s’énoncer par la voie de n’importe quel médium, passant par des matérialités et des traditions expressives multiples. Passeuse, « outrepasseuse » (osons ce néologisme), la fable n’a cure des frontières entre les règnes (animal, humain, végétal), entre les types de discours, entre les genres et les médias. La fabulation fait fi de toute spécificité — tous les moyens sont bons! —, et c’est pourquoi la fable n’est pas seulement labile ou changeante, mais encore composite. Entre autres exemples, la trame filmique de 28 jours plus tard (Danny Boyle, 2002) use notamment de la refonte de fragments littéraires (Boccace) ainsi que picturaux (Lorenzetti) pour composer sa grande fable sur la Tyrannie[5].
Si les enquêtes intermédiales de ce numéro mettent de l’avant diverses acceptions attestées de la fable, ce qu’elles auront surtout permis d’explorer, c’est le sens même qu’il y a à fabuler. L’accentuation sur le verbe opère un léger déplacement de la perspective, recentrant la fable sur son agir. Car enfin, pourquoi fabuler ? On ne peut répondre sans convoquer un certain nombre d’expériences instigatrices sur lesquelles reposent et se composent ces représentations primordiales et obliques que sont les fables. Chez Samuel Beckett, on s’en doute, cette expérience est à la fois la plus universelle et la plus inexorable : « jusqu’à n’y voir qu’une de ces histoires que tu allais inventant pour contenir le vide qu’encore une de ces vieilles fables pour ne pas que vienne le vide t’ensevelir le suaire[6] ».
Maintenir vivant le désir, telle pourrait être la réponse du cinéaste espagnol Pedro Almodovar à travers les personnages fabulateurs de sa filmographie. Contrairement à l’affabulation, où l’on se protège du réel par le mensonge, la fabulation, pour sa part, expose les sujets au réel et, chez Almodovar, à la réalité de leur désir. C’est ce qu’explore Nathalie Mauffrey dans son texte « Les personnages fabulateurs dans l’oeuvre de Pedro Almodovar. Une poétique du désir », la poétique en question étant intimement liée à la fonction de fabulation.
« Fabuler, raconter autrement, n’est pas rompre avec la “réalité” », écrit Isabelle Stengers, « mais chercher à rendre perceptible [sic], à faire penser et sentir des aspects de cette réalité qui, usuellement, sont pris comme accessoire [7]». Il s’agit là, sans conteste, de l’un des signes distinctifs de la fabulation. Dans « Animalités augmentées : leçons filmiques contemporaines », Alice Letoulat se penche sur certaines technologies du cinéma qui favorisent de nouvelles représentations animales, et sur les fables associées à ces animalités machinées, resserrant peu à peu son questionnement sur la « possibilité de faire droit à un authentique regard animal » dans le cadre d’une énonciation proprement humaine. La réflexion conduite par l’autrice, en rendant sensible la non indifférente altérité de la perception animale, ne peut que nous entraîner dans un raconter autrement, au sein de la longue histoire des fables animalières au cinéma.
On le disait d’entrée de jeu : si la fable exagère et aime à côtoyer les figures de style de l’amplification, cette grande opération de la fabulation n’est pas incompatible avec l’élaboration d’un savoir, quand bien même différent du type de connaissance que nous associons d’ordinaire au savoir. La réception de sa propre oeuvre cinématographique par le cinéaste-poète Pierre Perrault dans des livres-témoins (trop mal connus et, jusqu’ici, trop peu étudiés) est portée par un « élan de fabulation » qui confère au bestiaire de ses films une nouvelle puissance de signification. Comme le montre Johanne Charest dans « L’élan de fabulation à l’oeuvre chez Pierre Perrault », la rhétorique fabuleuse[8] de ce dernier à partir des « enseignements voilés[9] » que recèlent les grands cycles de son oeuvre cinématographique ne va pas sans leçons, ou « grandes vérités » sur le Nouveau Monde. Cet élan de fabulation qui gagne l’écriture de Pierre Perrault lorsqu’il réfléchit sur ses propres films n’est pas sans lien avec la pratique particulière de l’analyse de films à laquelle s’attache Fabienne Costa dans son texte « Détours fabuleux de l’analyse de films ». Ce qui ouvre — et oeuvre — ici à la fabulation, c’est une expérience filmique qui transite par l’écriture. D’un médium à l’autre, par élan ou écart (fabuleux), le travail d’écriture qui prolonge l’accueil de l’oeuvre filmique « participe d’une interprétation par détours occasionnant une métamorphose des oeuvres dans l’optique de les comprendre autrement — de biais ».
Reste qu’il n’est pas possible de circonscrire la fabulation, pas même d’esquisser les contours d’une définition. Tant la fable — avec une minuscule initiale : tout produit du fabuler — éclate en gestes multiples et agrège les contraires, au point que la contradiction n’en est plus une. Ainsi, dans L’Utopie de Thomas More (1516), l’acte de fabuler joue simultanément de la dissimulation et du dévoilement, selon une intrication savante de l’imagination authentique (l’île d’Utopie, sa carte, son peuple) et du réel de l’histoire (l’Angleterre d’Henri VIII). Réel ? Imaginaire ? Fiction ? Un tel partage a-t-il un sens au regard du fabulaire ? Le grand imagier du cinéma, tel Martin Scorsese dans Shutter Island (2010), a plus d’un tour dans son sac pour contrarier la fable et rendre indécidable son rapport à la vérité. Voilà un autre des signes attestant la présence de la fabulation quand elle opère dans un récit : la fable admet, voire engage, la coexistence de récits irréductibles entre eux, relevant de régimes de vérité différents. Dans son texte « Shutter Island : ombre et lumière de la fable cinématographique », Jean-Albert Bron montre comment, en regard de son modèle littéraire, l’invention propre de la fable cinématographique est travail d’opacification. Ici, le pouvoir plénier de la fabulation, adossé aux puissances propres au médium, comme à ses opérations spécifiques, aura définitivement subverti l’articulation — en abyme — entre réalité et fiction.
L’acte de fabuler a permis (et permet encore) de méditer ou, pour le dire mieux, d’instruire de très sérieux litiges : hier, démêlés autour des origines de l’homme (Vercors), de la meilleure forme de gouvernement (More, Lorenzetti) ou du mouvement des planètes (Fontenelle), aujourd’hui, controverses afférentes au ou aux destin(s) de mondes autochtones réprimés, comme dans la fable Qu’as-tu fait de mon pays ? de l’autrice innue An Antane Kapesh (1979)[10], et autres fables critiques écoféministes. De tous temps, les peuples avisés ont su que la fabulation forme l’étoffe du réel — et réciproquement. Dans la fable Wild Blue Yonder (2005) de Werner Herzog, c’est aux Terriens que nous sommes que s’adresse l’extraterrestre échoué sur notre planète, sorte de réfugié interspatial. Telle est la prémisse du film qui déploie au coeur de son dispositif fabulatoire un jeu complexe de référence, de brouillage et de réfutation(s), la colonisation de l’espace formant, en l’occurrence, l’objet privilégié du litige. La fabulation comme doublement du réel, ce procédé consistant à faire passer des enjeux et des évènements politiques dans la fiction, est pour lors mis en évidence par Guillaume Bourgois dans son texte « Herzog, Nietzsche et Deleuze vont en vaisseau ». Comme tant d’autres exemples, la fable cinématographique d’Herzog « peut permettre de lire les signes du réel et être elle-même ce signe qui va autrement que ceux-ci[11] ». Ainsi va la fable: une autre réalité que la nôtre mais qui, tout en jouant des écarts, tout en masquant ou en « projetant » ses vues, n’en vise pas moins le réel et ses engrenages historiques. Autrement dit, dans l’univers de la fable, nous sommes dans un monde qui n’est ni tout à fait le nôtre ni tout à fait un autre — plutôt un hybride des deux —, mais où il est néanmoins impossible de ne pas se reconnaître. Edelman explicite cette ambivalence essentielle de la fable, à la fois ici et ailleurs, lorsqu’il écrit qu’elle est « une façon de reconstruire le réel […] par une représentation dont la fonction est d’incorporer l’imaginaire dans sa réalité[12] ».
L’ambition de ce numéro, pour la résumer, est d’approcher l’acte de fabuler en interrogeant à nouveaux frais, et dans le même temps, sa présence, ses raisons et son action dans l’espace médiatique contemporain. Dans une perspective résolument ouverte sur la fable (à ses acceptions comme à ses pouvoirs multiples ; à ses modes d’insertion comme à ses défis herméneutiques singuliers), sur l’acte de fabuler (à ses raisons politiques, anthropologiques, philosophiques, poétiques, historiques, etc., aux différents nouages transdisciplinaires et [inter]médiatiques mobilisés à ses fins), à la fonction de fabulation (aux contextes divers où sa puissance trouve à s’exercer), ce numéro voudrait contribuer à cerner ce qui se joue en amont de la fabulation (pourquoi les fables), c’est-à-dire à ressaisir la nécessité de fabuler qui traverse l’histoire.
Parties annexes
Notes biographiques
Michèle Garneau est professeure à l’Université de Montréal au Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques depuis 2001. Elle a publié de nombreux articles et ouvrages sur le cinéma québécois, dont les plus récents sont : « De la voix et du tambour dans les vidéos du Wapikoni Mobile : agencements, résonance, affects », Créativités autochtones actuelles au Québec, Arts visuels et performatifs, musique, vidéo (dir. Louise Vigneault), Presses de l’Université de Montréal, 2023; « Le Son des Français d’Amérique : une immersion cinématographique dans la tradition orale musicale », L’écho du son des Français d’Amérique, Cinémathèque québécoise, mars 2023 (en ligne); « Les promesses du médium. Hospitalité autochtone dans les vidéos du projet Wapikoni Mobile », Intermédialités, n° 40, automne 2022 (en ligne).
Barbara Le Maître est professeure en études cinématographiques à l’Université Paris Nanterre. Elle a écrit : Entre film et photographie. Essai sur l’empreinte (2004), Zombie, une fable anthropologique (2015), Image versus médium featuring Mark Lewis (2022), et coédité une dizaine d'ouvrages collectifs, dont récemment : Moments d’histoire naturelle au cinéma, avec Jennifer Verraes, Bruno Nassim Aboudrar et Jean-Sébastien Steyer (dir.), Presses universitaires de Paris Nanterre, 2024. Pour l’essentiel, son travail porte sur les relations entre le film et le musée, les empreintes et les formes fossiles au cinéma, le principe d’une archéologie des figurations, l’analyse filmique et le discours de la fable.
Notes
-
[1]
Bernard de Fontenelle, « De l’origine des fables » dans Œuvres de Fontenelle. Tome Quatrième, Paris, Salmon, 1825, p. 299–300.
-
[2]
La Fontaine, « Le Pâtre et le Lion » dans Fables, Livre VI, Fable 1, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2021, p. 371.
-
[3]
Bernard Edelman, Quand les juristes inventent le réel. La fabulation juridique, Paris, Hermann, coll. « Le Bel Aujourd’hui », 2007, p. 16.
-
[4]
Louis Marin, Le Récit est un piège, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1978, p. 10.
-
[5]
Barbara Le Maître, Zombie, une fable anthropologique, Paris, Presses universitaires de Paris Ouest, coll. « L’oeil du cinéma », 2015, p. 169–175.
-
[6]
Samuel Beckett, « Cette fois », Catastrophe et autres dramaticules, Paris, Les Éditions de Minuit, 1986, p. 14.
-
[7]
Isabelle Stengers, Apprendre à bien parler des sciences. La vierge et le neutrino, Paris, Éditions La Découverte, 2023, p. 169.
-
[8]
Nous empruntons ce syntagme à André Dhôte : Rhétorique fabuleuse, Cognac, Le temps qu’il fait, 1990.
-
[9]
L’expression est empruntée à Aurélia Gaillard, Fables, mythes, contes. L’esthétique de la fable et du fabuleux (1660–1724), Paris, Honoré Champion, 1996, p. 14.
-
[10]
An Antane Kapesh, Tanite Nene Etutamin Nitassi, Montréal, Les éditions Mémoire d’encrier, 2020.
-
[11]
Jean Bessière, « De Bergson à Deleuze. Fabulation, image, mémoire – De quelques catégorisations littéraires », Neohelicon, vol. 24, no 2, 1997, p. 151.
-
[12]
Bernard Edelman, Quand les juristes inventent le réel. La fabulation juridique, op. cit., p. 13.