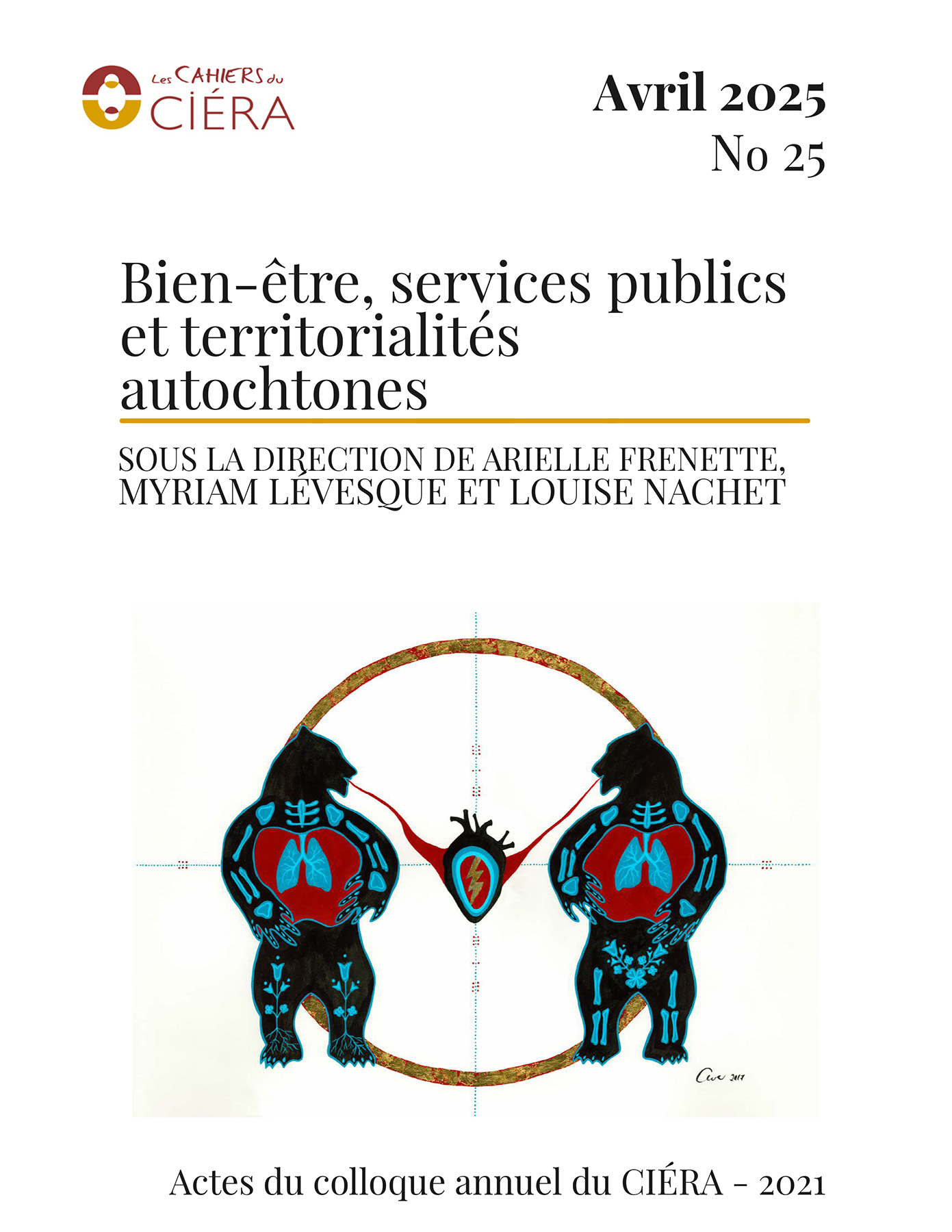Résumés
Résumé
Cet article se penche sur le processus de recherche ethnographique de la première auteure qui, dans le cadre de son doctorat en travail social, s’est intéressée aux conceptualisations et expériences au Nunavik des phénomènes dits « psychotiques » dans le paradigme dominant de la santé mentale. Les résultats présentés dans l’article, basés sur plusieurs mois d’entrevues et d’observations participantes avec des Inuit, invitent à une réflexion concernant les pratiques et les attitudes qui constituent encore à ce jour des manifestations d’une posture coloniale en intervention dans le domaine de la santé mentale. Nous proposons d’élargir nos manières d’appréhender les phénomènes psychotiques dans le but d’aller vers une intervention collaborative avec les Inuit, tant avec les personnes qui composent avec les phénomènes dits psychotiques, que leurs proches et les personnes qui travaillent auprès d’elles.
Mots-clés :
- santé mentale,
- phénomènes psychotiques,
- Nunavik,
- Inuit,
- approche collaborative
Abstract
This article looks at the ethnographic research process of the first author, who, as part of her doctorate in social work, focused on Nunavik's conceptualizations and experiences of so-called "psychotic" phenomena within the dominant mental health paradigm. The results presented in the article, based on several months of interviews and participant observations with Inuit, invite reflection on practices and attitudes that to this day still constitute manifestations of a colonial posture in mental health intervention. We propose to broaden our ways of understanding psychotic phenomena, to move towards collaborative intervention with the Inuit, with the people dealing with so-called psychotic phenomena, their families and the people who work with them.
Keywords:
- Mental Health,
- Psychotic Phenomena,
- Nunavik,
- Inuit,
- Collaborative Approach
Corps de l’article
Introduction
Le Nunavik[1], situé au Nord-du-Québec, est un territoire occupé par environ 14 000 habitants répartis en 14 villages accessibles uniquement à l’année par voie aérienne[2]. Vers la moitié du XXe siècle, il y a eu un tournant dans la colonisation du nord par les Qallunaat[3] puisque le Nunavik est devenu notamment l’objet d’une myriade d’enjeux militaires. En pareil cas, l’intervention de l’État a profondément modifié le mode de vie traditionnel des Inuit[4], qui vivaient alors de manière semi-nomade (Qumaq 1992), en encourageant le processus de sédentarisation et leur établissement dans des villages permanents. Cet interventionnisme a d’ailleurs contribué à consolider l’imposition d’un système exogène aux Nunavimmiut[5] en matière politique, juridique, économique et sociale. Dans ce contexte, les modèles occidentaux de structuration étatiques du réseau de l’éducation et des services sanitaires et sociaux ont été implantés par le gouvernement fédéral autour des années 1950 ; puis, à la suite à de revirements politiques, la responsabilité de l’éducation, de la santé et des services sociaux des Inuit a été, en partie, transférée au gouvernement du Québec entre les années 1960 et 1970 (Qumaq 1992). Depuis, le tout a été revisité à la suite de la signature du traité moderne de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois en 1975. Désormais, les services de santé et de services sociaux relèvent principalement de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN), un organisme public chargé par le gouvernement provincial et qui chapeaute les différents établissements de santé et de services sociaux. À cet effet, les services sociaux et de santé sont largement coordonnés et mis en oeuvre par des non-Inuit qui adhèrent principalement à des approches biomédicales, incluses dans le paradigme dominant de la santé mentale et qui s'appuient sur les lois de « protection » du Québec. Par l’imposition des pratiques et des modes de pensées du groupe dominant, les établissements de santé et de services sociaux, sous le parapluie de la RRSSSN, constituent aujourd’hui une structure matérialisée dans la colonialité (Perreault-Sullivan et Vrakas 2019 ; Fraser, Gaulin et Fraser 2021). Un groupe largement affecté par ces systèmes sémantiques est les Nunavimmiut qui entendent des voix ou qui voient des images, des personnes ou encore des formes qui ne sont pas apparentes pour leur entourage, et, qui selon le paradigme dominant de la santé mentale, peuvent être considérées comme étant « psychotiques ». C'est ce groupe qui est au centre du présent article[6].
Plusieurs chercheurs et chercheuses questionnent les tentatives d’objectiver les conceptualisations et les catégories psychiatriques développées par les groupes dominants (voir, entre autres, Jenkins 2004 ; Biehl, Good et Kleinman 2007 ; Corin 2009 ; Adeponle 2010). En effet, les expériences de la psychose et ses manifestations sont ressenties, vécues et interprétées différemment selon le contexte socioculturel de l’individu qui les expérimente (Jarvis et Kirmayer 2021). La culture est donc un élément essentiel à considérer afin de déterminer si des symptômes dits psychotiques sont considérés comme normaux ou anormaux par une population donnée, et aussi s’ils vont être compris comme passagers ou chroniques (Castillo 2004). Bien que le modèle biomédical, c’est-à-dire ancré dans une description médicale et positiviste de la santé mentale, soit celui qui prévale généralement au sein de nos institutions nord-américaines (Jarvis 2007 ; Corin, Poirel et Rodriguez 2011 ; RRASMQ 2018), il y a remise en question de la place de cette approche, notamment dans le domaine de la santé mentale et du bien-être autochtone (Kirmayer, Corin, Corriveau et Fletcher 1993 ; Duran et Duran 1995 ; Adelson 2005 ; Kirmayer, Rousseau, Jarvis et Guzder 2008).
Le choix de mobiliser le concept de « phénomène psychotique » dans ce texte renvoie à la phénoménologie et donc au caractère interprétatif et subjectif (Geertz 1973 ; Bordeleau 2005) des expériences psychotiques. Le phénomène psychotique est un concept mouvant et construit, qui revêt diverses définitions selon la culture (Kleinman 1987 ; Corin et al. 1990 ; Jenkins et Barrett 1993 ; Deegan 1997). Les phénomènes psychotiques sont actuellement compris dans le paradigme dominant de la santé mentale comme une perte de contact avec la réalité, une incapacité à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas (SQC s.d.). Les phénomènes psychotiques englobent notamment le trouble psychotique bref, le diagnostic de psychose toxique et le diagnostic de schizophrénie (SQS s.d.). Selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux dont la dernière version (DSM-5) date de 2013, les symptômes ou les manifestations de la psychose comprennent notamment les idées délirantes, les hallucinations, les discours et comportements désorganisés, les comportements catatoniques et autres symptômes négatifs.
Cet article est écrit par trois auteures allochtones eurodescendantes, vivant et travaillant dans divers contextes au Québec. Il est basé sur les résultats du doctorat de la première auteure, qui travaille dans le domaine de la santé mentale au Nunavik depuis 8 ans. Elle est également travailleuse sociale et enseignante à l'université. Elle a recueilli les données entre 2021 et 2023 et a effectué leur analyse de manière continue. La deuxième auteure est professeure en travail social et psychothérapeute de formation. Ses projets de recherche portent notamment sur les pratiques de soutien au deuil au Nunavik et sur le soutien aux intervenants inuit en matière de deuil et de santé mentale. La troisième auteure est pédopsychiatre et chercheuse en psychiatrie transculturelle. Elle travaille au Nunavik depuis plus d’une décennie et ses recherches portent entre autres sur les soins en collaboration.
Nous débuterons en exposant les fondements théoriques et épistémologiques du projet. Nous présenterons ensuite le contexte dans lequel s'inscrit la recherche puis détaillerons la méthodologie employée. Sur la base des résultats et de la discussion, nous invitons à une réflexion sur les manières plurielles d’appréhender les phénomènes dits psychotiques au Nunavik et aux postures qui limitent parfois la reconnaissance des savoirs inuit dans ce domaine. Nous proposons ensuite d'élargir la réflexion sur l'intervention dans le but d'inviter les personnes touchées par ces phénomènes, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel, à participer à la cocréation d'une réponse pertinente et décoloniale.
Culture et santé mentale : choc ontologique
Dans le domaine de la santé mentale, en plus d’être souvent stéréotypée, la culture sert souvent à invoquer les échecs de la communication, la non-observance du traitement et l’incompréhension mutuelle entre la personne clinicienne et l’individu qui cherche des services (Kirmayer et Bennegadi 2011 : 21). « La culture, dans ce cas, devient quelque chose qui appartient seulement à la personne qui cherche de l’aide et se transforme en fardeau ou en obstacle à la communication et à la coopération » Kirmayer et Bennegadi 2011 : 21). Afin d’éviter d’essentialiser et de stéréotyper la culture des Nunavimmiut, elle est abordée dans ce texte selon la vision interprétative de l’anthropologue Clifford Geertz qui propose de voir la culture comme un réseau complexe de significations et de sens. Il définit le concept comme suit : « a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward life » (Geertz 1973 : 94). Plutôt qu’un ensemble de coutumes et d’institutions, la culture reflète les interprétations que les membres d’une société donnent de leur expérience, il ne s’agit pas seulement de comprendre comment les gens se comportent, mais comment ils interprètent les événements, les phénomènes. Enfin, il est important de considérer que les individus se retrouvent souvent au carrefour de plusieurs cultures et que les processus sociosymboliques sont en interaction constante avec d’autres forces sociales, ce qui rend impossible de considérer la culture comme un phénomène isolé ou statique (Johnson-Lafleur 2021 : 31).
Santé mentale, colonialisme et normativité
Il existe au sein du processus de colonisation une domination discursive qui positionne le colonisateur comme intellectuellement et culturellement supérieur au colonisé (Young 2001). Cette domination discursive se pratique entre autres via le domaine de la psychiatrie, qui a longtemps été considéré comme un instrument de contrôle sur les groupes marginalisés socialement, par l’utilisation de diagnostics et de traitements biomédicaux qui permettaient la médicalisation de la « déviance », des comportements jugés hors normes (Yellow Bird 2004 ; Roman et al. 2009 ; Joseph 2013). Les méthodes coloniales de classifications reproduisent des inégalités au sein des disciplines (par exemple, la psychiatrie) en privilégiant le savoir du groupe dominant et organisant les connaissances produites d'une manière qui réduit au silence et exclut l'histoire, la voix et les savoirs des peuples colonisés (Tuhiwai-Smith 1999). Les conceptions coloniales de la santé / maladie mentale impliquent entre autres la médicalisation de la différence, ou la création de diagnostics basés sur l’écart par rapport à la norme du groupe colonisateur (Fanon 1952 ; Joseph 2013 ; Nelson 2013). Cette façon de définir la santé / maladie mentale n’est pas problématique en soi, mais elle peut conduire à des erreurs de diagnostic ou des tensions dans la relation d’aide lorsque différents groupes de personnes ont des normes ou des standards différents, des façons différentes de définir la maladie et la santé (Nelson 2013).
En effet, le concept de santé mentale possède un caractère normatif, celui-ci se traduisant différemment en fonction des valeurs et normes propres à une société donnée (Otero 2005). C’est entre autres pour cela que Michel Foucault affirme que les « fous » n’existent qu’en société (Foucault 2001). Pour Otero (2015), il existe deux dimensions à la folie : ontologique et sociale. La dimension ontologique réfère aux expériences subjectives des individus face à la réalité et l’être-au-monde. La dimension sociale renvoie aux réactions et perceptions de l’entourage, de la société, face aux comportements des personnes qui composent avec « la folie ». Il s’agit donc de déterminer ce que devrait être le comportement « normal », approprié, acceptable et attendu d’un individu. Impossible donc de dissocier la maladie de son contexte social. Certains diront que la maladie mentale est un fait de civilisation, c’est-à-dire qu’elle n’aurait sa réalité qu’à l’intérieur d’une culture qui la reconnaîtrait comme telle. La réalité qui serait exprimée par la pathologie ne serait dès lors pas de l’ordre de l’objectivité, mais de l’intersubjectivité (Foucault 1954).
En lien avec le caractère subjectif et culturel de la maladie, l’anthropologue médical Arthur Kleinman a introduit le concept de « modèles explicatifs » de la maladie, qui stipule que les systèmes culturels y compris des connaissances, les croyances et les attentes de l'individu en ce qui concerne la cause, les symptômes et les traitements possibles d'une maladie varient d’une personne à l’autre (Kleinman 1980). En posant ses huit questions, la personne qui intervient peut mieux comprendre les facteurs culturels, y compris des éléments politiques, économiques, sociaux, historiques et environnementaux qui contribuent à la compréhension d’un phénomène physique et psychique (Kleinman 1987 ; Lewis-Fernández, Aggarwal, Bäärnhielm et al. 2014) :
-
Comment appelles-tu le problème ?
-
Qu'est-ce qui, selon toi, a causé le problème ?
-
Pourquoi penses-tu qu'il a commencé quand il a commencé ?
-
Qu'est-ce que la maladie fait, d'après toi ? Comment fonctionne-t-elle ?
-
Quelle est la gravité de la maladie ?
-
Quel type de traitement penses-tu que le patient devrait recevoir ?
-
Quels sont les principaux problèmes que la maladie a causés ?
-
Qu'est-ce que tu crains le plus à propos de la maladie ?
Lorsqu’une personne intervenante ou chercheuse interprète les symptômes exclusivement à l'aide de son propre cadre culturel, à l’aide de ses outils standardisés et des catégories qui en découlent, cela l’empêche de bien appréhender les façons locales de caractériser, vivre et exprimer la détresse (Jarvis et Kirmayer 2021) et donc, d’accompagner les individus et leurs familles.
En contexte autochtone, le colonialisme et ses fondements continuent de façonner les services et les normes des professions de la santé et des services sociaux. Dans l’ouvrage Decolonizing Trauma Work : Indigenous Stories and Strategies (2020), Renee Linklater, soutient que les travailleurs sociaux et travailleuse sociales, tout comme plusieurs autres professions de la santé et des services sociaux, en imposant leurs conceptualisations dominantes de la santé mentale, notamment des expériences dites « psychotiques », marginalisent encore davantage les personnes qu’ils et elles doivent aider. Plusieurs auteurs et autrices autochtones rappellent également le rôle du travail social dans l’agenda colonial, notamment via le placement d’enfants dans les pensionnats pour autochtones ou en familles d'accueil (Bennett et al. 2005 ; Sinclair 2009 ; Baskin 2016). Ces actions ont eu et continuent d’avoir, d’importants impacts sur la santé mentale des personnes affectées.
Santé mentale et bien-être chez les Inuit
Le terme « santé mentale » est utilisé depuis peu chez les Inuit, principalement en raison de la venue d’Allochtones qui ont imposé leurs concepts, face à l’absence de mot spécifique en inuktitut pour nommer le terme « santé mentale »[7], au sens entendu par le groupe dominant (Kirmayer, Fletcher et Boothroyd 1997 ; Nelson 2011). En effet, chez les Inuit, la santé est comprise d’une manière holistique (Inuit Tapiriit Kanatami 2018 ; Baron et coll. 2021) où les sphères spirituelle, historique, sociétale, physique, émotionnelle et sociale se rencontrent (ITK 2018 ; Baron et al. 2021 ; Gagnon-Dion et al. 2021). Cette conception permet de prendre en compte l’environnement dans lequel évoluent les individus ainsi que les impacts de la colonisation, des traumatismes et des déterminants sociaux sur la santé mentale. Certains parlent également du concept d’« une seule santé » (One Heath concept), qui fait référence aux relations et aux interdépendances entre la santé animale, la santé humaine et la santé environnementale (Riley, Anderson, Lovett et al. 2021 ; Berner, Jore, Abass et Rautio 2024).
En ce qui concerne l’organisation des services en santé mentale au Nunavik, chaque communauté abrite un centre local de santé et de services sociaux qui offre des services médicaux et sociaux de première ligne. Ces services sont enracinés dans la colonisation et ont délégitimisé, ou du moins relégué en arrière-plan, les méthodes locales et approches traditionnelles d’appréhender la santé mentale et le bien-être (Nelson 2011). Cela dit, les Inuit continuent tout autant de valoriser la famille et la communauté pour répondre aux besoins des leurs (Waddell, Robinson et Crawford 2017). En cas de détresse psychologique, la plupart des Nunavimmiut consultent leurs proches, avant les prestataires de services (Kirmayer et Paul 2007 ; Baron et al. 2021).
En ce qui concerne les phénomènes psychotiques, plus particulièrement, les études dans le domaine de la psychiatrie transculturelle et de l’anthropologie médicale se sont intéressées principalement aux expériences de la santé mentale et de la psychose au Nunavik (Vallee 1966 ; Kirmayer et al. 1993 ; Kirmayer et al. 1997). Néanmoins, ces études datent de plusieurs années, et leurs analyses montrent qu’il existe très peu d’informations relatives aux expériences psychotiques chez les Inuit au Nunavik et ailleurs dans l’Inuit Nunangat. Cela étant dit, on sait que les Autochtones peuvent présenter des symptômes reliés aux traumatismes, aux enjeux émotionnels ou à la consommation (incluant l'automédication éthylique ou autres) (Perreault-Sullivan et Vrakas 2019), qui s’apparentent à des symptômes de la psychose tels que la dissociation, le mutisme, le retrait, soliloquer, l’hypervigilance, et la méfiance (Read, Perry, Moskowitz et Connolly 2001 ; Morgan et Hutschinson 2010 ; Castillo 2014 ; Caldéron 2018). Les expressions de cette souffrance sont souvent liées à l’impact du colonialisme et l’héritage des traumas historiques et intergénérationnels (Yellow House 2003 ; Wesley-Esquimaux et Smolewksi 2004 ; Perreault-Sullivan et Vrakas 2019), aux nombreux traumatismes et deuils auxquels les Inuit ont fait et continuent de faire face (ITK, 2016 ; Perreault-Sullivan et Vrakas, 2019), à la grande détresse émotionnelle (Kirmayer, Simpson et Cargo 2003) et aux importants enjeux sur le plan de la consommation d’alcool et de cannabis (Brunelle, Plourde, Landry et Gendron 2009 ; Hunter 2012 ; Perreault-Sullivan et Vrakas 2019) qui affligent plusieurs Nunavimmiut. Ainsi, l’expression de leurs traumatismes et de leur détresse peut facilement être interprétée pour des symptômes de la psychose. À cela s’ajoutent l’interrelation et l’interconnexion entre le racisme, la colonisation et les inégalités sociales (logements, accès à l’éducation et à l’emploi, pauvreté, etc.) qui continuent d’être les déterminants fondamentaux de la santé autochtone (Reading et Wien 2009 ; Nelson 2012 ; Baron, Riva et Fletcher 2019). Ainsi, les conséquences de la discrimination et du racisme, en raison de l’importante source de stress et des traumatismes que ces expériences occasionnent, sont intimement liés au phénomène de la psychose (Anglin 2023).
La recherche en contextes autochtones : l’autodétermination
Frantz Fanon (1952), figure importante du mouvement postcolonial en psychiatrie, nous invite à reconnaître que dans le cadre des pratiques en santé mentale, les regards portés de manière (in)consciente sur les expériences des individus et les interprétations imposées à ces expériences limitent l’autodétermination des personnes affectées par la colonisation ainsi que leur capacité de faire sens de leurs expériences et d’exprimer leurs savoirs et leurs épistémologies. Dans l’ouvrage Epistemic Injustice : Power and the Ethics of Knowing (2007), Miranda Fricker, distingue deux types d’injustices épistémiques. L’« injustice testimoniale » survient lorsqu’il existe un déficit de crédibilité causé par des préjugés sur le locuteur. L’« injustice herméneutique » se produit quand l’individu est privé des ressources épistémiques nécessaires pour comprendre et exprimer son expérience ou sa façon d’exprimer son expérience ne peut être entendue et comprise par la majorité épistémique. Une dimension significative de son expérience sociale est ainsi occultée de la compréhension collective (Fricker 2007 ; Medina 2017).
Cette idée d’effacement des savoirs est également soutenue par Gayatri Spivak, qui pour sa part utilise le terme de « violence épistémique » (Spivak 2005). Il s'agit du processus par lequel certaines personnes et certains groupes voient leurs savoirs disqualifiés par diverses pratiques et processus institutionnels, notamment dans le domaine de la santé mentale (Liegghio 2013). En contexte autochtone, la violence épistémique fait référence aux pratiques institutionnelles qui nient les visions du monde autochtones, les connaissances et les modes de savoir et qui, par conséquent, effacent leurs manières d'être (Marker, 2003, dans Liegghio, 2013). Il existe un rapport de force inégal entre l’approche dite scientifique issue du paradigme dominant et les savoirs considérés « subalternes » (Battiste 2000 ; Browne, Smye et Varcoe 2005 ; Wilson 2008). Les savoirs autochtones, tant dans la pratique que la recherche sont effacés aux profits des savoirs du groupe dominant (Kovach 2005 ; Tuck et Yang 2014). Pour décrire cette injustice, certains utilisent également le concept de racisme épistémique et en appellent en ce sens à une « décolonisation épistémique » (Fanon 1952, cité dans Grosfoguel et Cohen 2012 ; Grosfoguel 2010 ; Mignolo 2013).
Ancrages méthodologiques du projet de thèse et posture de la chercheuse
En 2019,[8] la première auteure a débuté un projet de thèse avec la question, « quelles sont les expériences des Nunavimmiut en lien avec les différentes dimensions des phénomènes psychotiques et quel sens accordent-ils et accordent-elles à leurs expériences ? ». Ayant travaillé au Nunavik pendant huit ans comme travailleuse sociale et formatrice dans le domaine de santé mentale et de la prévention du suicide, auprès et en collaboration avec des personnes intervenantes non-inuit et inuit, elle a posé deux objectifs : a) documenter les réalités structurelles, historiques et politiques qui influencent les expériences et la conceptualisation de la psychose et du rétablissement dans des communautés du Nunavik et b) décrire les différentes dimensions de l’expérience des phénomènes psychotiques et du rétablissement en intégrant des épistémologies inuit.
Le devis de recherche pour ce projet doctoral s’inspirait de l’ethnographie focalisée (EF) (Knoblauch 2005), une méthodologie éprouvée et appliquée dans la pratique des soins de santé communautaires ou hospitaliers (Knoblauch 2005 ; Higginbottom et al. 2013). L’EF exige une proximité avec les participants et participantes, avec le terrain, ce qui, en plus de faciliter l’établissement d’un lien de confiance avec les personnes participantes, permet d’analyser les pratiques prises pour acquises, par les personnes participantes et le chercheur ou la chercheuse (Knoblauch 2005). Tout en mettant l'accent sur les cultures, l’EF s’intéresse à des phénomènes précis, situés dans un contexte en particulier, où les participants ont des connaissances spécifiques sur un phénomène identifié (Higginbottom, Boadu et Pillay 2013). L’un des objectifs de cette approche est d’aborder la perspective émique du point de vue des personnes concernées. Elle ne prétend pas pouvoir « expliquer une culture » et ne vise que certains éléments de la connaissance pertinents pour le sujet sur lequel l'étude se concentre (Knoblauch 2005).
Les données ont été récoltées dans un village au Nunavik entre juillet 2021 et juin 2022. Le recrutement a été fait au moyen d’affiches et de la méthode boule-de-neige. Les entrevues couvraient trois principaux thèmes, soit les compréhensions des expériences psychotiques (les expériences, les modèles explicatifs, mots et phrases utilisés en inuktitut), les visions du rétablissement en lien avec une expérience psychotique (qu’est-ce que le rétablissement, l’accompagnement, et quels sont les processus facilitants ou faisant obstacle au rétablissement) et enfin, les rapports aux services communautaires et institutionnels. Initialement, 31 personnes majeures ont été rencontrées (de manière individuelle ou en dyade) : 6 vivaient ou avaient vécu des phénomènes psychotiques, 9 étaient des intervenants allochtones travaillant dans le domaine de la santé mentale au Nunavik (infirmiers, travailleurs sociaux et médecins) et 16 des acteurs communautaires vivant ou ayant vécu au Nunavik (travailleurs communautaires, Liaison Wellness Workers, Natural Helpers, leader religieux, aînés, familles de personnes vivant avec des phénomènes psychotiques et interprètes). Cinq entrevues individuelles supplémentaires ont ensuite été réalisées avec des acteurs et actrices communautaires inuit reconnus dans le domaine. Parmi ces personnes, 2 n’avaient pas participé aux entrevues initiales. Les observations terrain ont été réalisées au Centre hospitalier, au CLSC, au Centre de Crise et dans la communauté. Des notes de terrain ont été consignées tout au long du projet, permettant à la première auteure de jeter un regard critique et réflexif sur sa posture à titre de chercheuse et clinicienne, ses pensées, émotions et actions en lien avec son sujet de recherche.
Enfin, une analyse thématique du matériel a été réalisée à l'aide du logiciel d'analyse NVivo. Cette analyse est le fruit d'un processus itératif entre les données, les codes préexistants et les codes émergents. La collecte et l'analyse des données ont été simultanées. Toutes les notes de terrain, les observations, les pensées, les émotions, et les entretiens ont été retranscrits et organisés au fur et à mesure et discutés avec les superviseures de recherche. Cette méthode a permis à la chercheuse d’adapter ses guides d’entrevues afin qu’ils soient cohérents avec ce qui ressortait du terrain et fassent sens pour les participants. L’analyse non linéaire a permis de reconnaître que la question initiale devait être modifiée pour répondre à la réalité du terrain. Plutôt que de tenter d’« expliquer » des phénomènes en détail, la recherche s’est orientée vers la mise en lumière des différentes épistémologies et ontologies qui influencent le rapport aux phénomènes psychotiques ainsi qu’aux facteurs sociaux, historiques et politiques qui jouent sur les interprétations des phénomènes et les rapports avec les services. L’analyse continue a permis d'être flexible, d'élargir la portée de la recherche et de changer légèrement d'orientation à la lumière de ce qui était découvert sur le terrain. L’analyse a permis à la fois de faire l’examen phénoménologique des données qui consiste à analyser les récits « du point de vue de ce qui a été vécu, tel que cela a été vécu, comme cela a été vécu » (Paillé 1994 : 192), pour ensuite avancer vers une analyse dite « psychosociologique », c’est-à-dire la création de catégories conceptuelles.
Présentation des données
Ce projet s’est inscrit dans une volonté de questionner les pratiques prises pour acquises, provenant des savoirs et des institutions dominantes et d’ouvrir la voie à des manières inuit de comprendre et de voir le monde, notamment en santé mentale. Pour cela, nous commençons par une contextualisation des services, suivie par les témoignages des participants qui nomment les rapports de pouvoir et la professionnalisation en contexte de santé mentale comme pistes de réflexion.
Organisations des services de santé et des services : enjeux et perspectives
Les services en santé mentale sont fournis par des intervenants et intervenantes qui viennent généralement du sud du Québec, qui sont non-Inuit et qui ne maîtrisent pas l’inuktitut. Peu d’Inuit ont des postes « cliniques », puisque ceci requiert d’être sous des ordres professionnels (PL n° 21)[9] et d’avoir fait certaines études qui sont principalement accessibles dans le sud de la province (Fraser, Gaulin et Fraser 2021). Les suivis pour les membres des communautés qui semblent composer avec des phénomènes dits psychotiques sont majoritairement dispensés par des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales, ainsi que des infirmiers et infirmières, en collaboration avec des médecins et des psychiatres consultants et consultantes. Si certains intervenants et intervenantes non-inuit exercent depuis de nombreuses années au Nunavik et ont développé une connaissance approfondie de la culture locale, la majorité a souvent peu ou pas d’expérience en santé mentale, ou est en début de carrière. De plus, en raison du fort roulement de personnes venues de l’extérieur du Nunavik, du fait que ces dernières passent souvent très peu de temps sur le territoire, leurs connaissances des réalités culturelles inuit, des communautés et de l’histoire du Nunavik peuvent être limitées.
Les intervenants et intervenantes locaux quant à eux portent principalement les titres de Natural Helpers, Community Liaison Workers, Wellness Workers et de travailleurs communautaires. Ils et elles interviennent régulièrement dans des situations traumatiques ou de crise, et participent à des suivis. Les communautés de Puvirnituq et Kuujjuaq disposent d’un hôpital où les personnes des autres communautés sont transportées par avion pour accéder à certains soins plus poussés et de plus longue durée. Des psychiatres et pédopsychiatres se rendent périodiquement dans certaines communautés. Des psychologues travaillent également dans certaines communautés. Dans les situations où les individus montrent une symptomatologie qui est considérée trop grave ou trop persistante pour être traitée au Nunavik, ou des comportements trop dangereux pour la personne ou pour autrui, ils et elles sont transportés par avion dans des centres hospitaliers à Montréal. Ces transferts sont souvent rapportés comme étant traumatiques, honteux et difficiles pour les individus qui se retrouvent loin de leur communauté.
Nos expériences au Nunavik, qu’elles soient à titre de cliniciennes ou de chercheuses, nous ont démontré que les relations thérapeutiques ou de confiances en recherche se bâtissent souvent sur les bases informelles : des rencontres à l'aéroport, à la pêche, à l'épicerie, autour d'un repas, en réparant un « Honda »[10], etc. Ainsi, c’est l'aspect relationnel de la rencontre qui est privilégié, ce qui peut parfois être en tension avec les exigences institutionnelles et professionnelles qui demandent plus de formalités, de neutralité et qui sont souvent circonscrites dans un temps plutôt limité.
I have schizophrenia. That is what the doctor told me.
L’un des premiers objectifs de la recherche était de décrire les phénomènes psychotiques tels qu'ils sont perçus par les Nunavimmiut. Selon les résultats, les termes « psychoses » ou encore « schizophrénie » ne trouvent pas de traduction en inuktitut. Les Inuit font référence aux gens qui entendent, voient ou sentent des personnes, des sons ou des esprits qui ne sont pas physiquement présents dans la pièce, plutôt que de chercher à nommer une « maladie ». Par exemple, en inuktitut, les mots takunnaralik et sutaaralik signifient respectivement de voir et d’entendre quelque chose qui n’est pas vu ou entendu par d’autres personnes qui partagent le même espace.
Lorsque questionnés sur l’usage de ces termes dans la communauté, on comprend que les mots empruntés à la psychiatrie ne sont pas nécessairement ceux qui font sens pour les Inuit, mais face à la chercheuse non-inuk, les terminologies psychiatriques ont été rapidement empruntées, comme dans l’entrevue avec ce travailleur communautaire :
- How would you call someone who ears, see or feel people who are not physically present in the room?
Personne participante, Échanges, 2021
- Schizophrenic?
- Is it the way you call them in Inuktitut?
- No, not really.
L’utilisation des termes psychiatriques était aussi présente dans les entrevues avec les personnes qui expérimentent les phénomènes psychotiques, la majorité d’entre elles se présentant d’emblée par leur diagnostic. Voici un exemple :
My name is Mark[11] and I am 21 [years old]. I am from _______________ and I’m schizophrenic. ».
Personne participante, Échanges, 2021
Pour plusieurs, même si le diagnostic psychiatrique est utilisé, lorsqu’on creuse un peu plus, on réalise que ces diagnostics ne font pas nécessairement sens. Voici des extraits d’une autre personne avec une diagnostic :
- I have schizophrenia. That is what the doctor told me
Personne participante, Échanges, 2021
- How does it feel for you to have that?
- I don’t mind, I don’t think I have it. I think that I was not feeling well when I saw the doctor, I was being suicidal. I was even afraid of myself.
- And now, how do you feel?
- Good.
D’autres n’y croient pas, mais utilisent tout de même les termes :
- I am here because they say I have schizophrenia. The DYP saw me talking to myself and they said my house was not clean […] The hospital told me that I have schizophrenia or maybe psychosis I am not sure. They don’t understand.
Personne participante, Échanges, 2022
- What is it they don’t understand?
- I always have been talking to spirit. It’s not mental illness, I am not crazy.
Maintes fois, surtout lorsqu’il était question d’explications religieuses en lien avec les phénomènes psychotiques, il y a eu un réflexe de la doctorante de penser que la personne n’avait pas bien saisi le propos de la recherche et de vouloir mettre de côté certaines données. Par exemple, lorsque des personnes participantes abordent leurs pratiques religieuses, notamment leurs conversations avec le Saint-Esprit[12] tel que présenté dans la prochaine citation, il y avait un doute que la personne s’éloignait trop du sujet du projet et que les données ne seraient donc pas pertinentes :
Sometimes I heard directly from the Holy Spirit, he was talking inside my spirit. I was not crazy, I was not scared, I was listening to the voice inside of me. It was a good message […] Once I talked about it with the nurse, a long time ago, she asked me if I wanted to see the doctor [laughs].
Personne participante, Échanges, 2022
Les discours des participants soulignent l'existence de modèles explicatifs souvent complexes et variés au sein desquels les explications biologiques, psychocomportementales et culturalistes ont leur place, mais ce ne sont pas les seules. Les propos recueillis dans le cadre de cette recherche s’inscrivent dans un contexte bien spécifique où des Inuit s’adressent à une travailleuse sociale, employée de l’hôpital, chercheuse et non-inuit, pour qui le fait d’entendre des voix ou de voir des personnes qui ne sont pas physiquement présentes dans la pièce, même lorsqu’on parle de religion, est souvent considéré comme anormal. Le concept de « phénomènes psychotiques » appartient au monde biomédical et n’existe pas à proprement parler dans la culture des Nunavimmiut. À travers leurs propos, les Inuit exposent la chercheuse à leur « normalité ». Il s’agit d’une invitation à l’ouverture, au dialogue. La mère d’une personne qui compose avec des phénomènes psychotiques ouvre à cette complexité : « don’t we all have voices in our head ? ». Or, ce partage d’informations, très important et lourd de sens, nous emmène à poursuivre nos réflexions sur la compréhension interculturelle. Dans la prochaine section, nous voyons les tensions face auxquelles les intervenants et intervenantes inuit sont confrontés, alors qu’ils naviguent entre plusieurs mondes.
For doctors, they want to say a specific word
Pour les intervenants et intervenantes inuit, il peut être ardu lorsqu’elles travaillent avec des chercheurs et chercheuses ou du personnel hospitalier de trouver les mots justes. Comme un Natural Helper a expliqué : « you know it’s colonization. It brought a lot of words that we don't use, for example, in mental health, you have a word for everything, we don’t have a word for everything. » (Personne participante, Échanges, 2021).
Cette situation peut poser un défi pour les interprètes. L’une d’entre elles explique qu’elle doit faire une interprétation ou une traduction pour un terme dans ces propres mots, une expérience qui n’est pas toujours évidente :
For doctors they want to say a specific word, you know like schizophrenia or depression. So there is always that “defi” where I'm with the doctor or the nurse and they talk and me, I have to translate. But it’s not easy because we don’t have all the words in Inuktitut. So you have to explain in a certain way, like if you're going to say something specific in English, yeah, I have to find a way to generalize it together to make it understandable.
Personne participante, Échanges, 2022
Dans un même ordre d’idées, certaines personnes ont confié parfois craindre de partager leurs interprétations d’une situation où elles se sont montrées hésitantes, lorsqu’interviewées dans le cadre de ce projet, par crainte d’outrepasser leurs champs de compétences ou de ne pas être perçues comme étant pertinentes. Plusieurs ont ainsi le sentiment de vivre un échec professionnel et personnel. Une travailleuse communautaire, qui n’est ni interprète ni traductrice, mais qui se voit souvent confié ce rôle à l’instar de plusieurs de ses collègues inuit, a partagé se sentir parfois incompétente puisqu’elle ne trouve pas toujours les mots justes : « sometimes, I feel like I am not a good translator because I don’t have the exact words. » (Personne participante, Échanges, 2021).
D’autres Inuit reconnaissent que les tensions vécues et ressenties en lien avec leur travail et les concepts et mots employés reposent sur des explications structurelles et systémiques. Au lieu de mettre leurs compétences en question, ils et elles nous invitent à considérer le manque des ressources. Un Natural Helper souligne :
The hospital does not see our job as true work. Why doesn’t our boss see that? […] Why don't the government present this money to the local people who will train natural helpers who will help other people? Natural helper is not a regular job yet. Unfortunately, we only go when someone has died by suicide, when we are asked by social services. Tragic death, murder, we go, but that’s it.
Personne participante, Échanges, 2021
Ces enjeux de reconnaissances sont aussi présents chez les personnes qui recherchent des services en santé mentale et qui se voient parfois contraintes d’utiliser les termes du paradigme dominant lorsqu’elle recherche de l’aide :
Sometimes, when [my son] becomes scary and we want the hospital or social services to help, we have to say ‘’schizophrenia’’ to receive help. If I talk about spirit, even if it is bad spirit […] they will say I am the crazy one [rire].
Personne participante, Échanges, 2021
Une participante inuk qui étudie dans le domaine de la santé et des services sociaux au sud de la province ajoute qu’adopter le langage médical facilite la navigation au sein des services. Elle explique avoir changé sa compréhension de la santé mentale, son langage, au contact de l’école et de ses stages et avoir adopté le langage du groupe dominant, qu’elle qualifie de plus « spécifique ». Elle souligne toutefois avoir parfois l’impression de s’« être fait coloniser », puisqu’elle est obligée d’utiliser le langage biomédical au profit de ce qui peut faire plus de sens pour sa communauté.
Cela soulève la question à savoir s’il est possible pour les Inuit qui travaillent dans les institutions (hôpital, CLSC[13], DPJ[14]) de mettre de l’avant leurs conceptualisations de la santé mentale, s’ils ont l’espace de le faire, considérant que les échanges se déroulent principalement en anglais. Les enjeux d’interprétations dépassent les simples défis liés au fait de parler deux langages différents, ils sont ancrés dans des modèles ontologiques et épistémologiques différents.
They should learn how to listen
Les Inuit, peu importe leurs rôles au sein des services ou de la communauté, qui n’ont pas eu d'expérience personnelle avec le sujet des phénomènes psychotiques, vont avoir tendance à ne pas émettre de théories, mais vont plutôt simplement répondre à une question directe, comme le mentionne cette aînée et travailleuse communautaire, « I don’t know. I don’t have a personal experience. » (Personne participante, Échanges, 2021).
Dans le cadre des entrevues, l’expression « I don’t know » est régulièrement revenue chez les participants et participantes inuit. Au fil du temps, il a été possible de constater que dans bien des cas, même si le réflexe était de répondre « I don’t know », les discussions et les histoires racontées étaient remplies de savoirs, de connaissances, mais qui n’avaient pas nécessairement été intégrées comme étant des « connaissances valables » ou les « connaissances justes » par les participants et participantes.
Les moments de silence ont également transcendé ce projet de recherche. Il est courant d’entendre que les silences sont importants lorsqu’on travaille en contextes autochtones. Le silence n'est pas simplement une absence de parole, de bruit, mais plutôt un moyen de communication. Il est ancré dans la croyance que certaines émotions et expériences ne peuvent pas être pleinement exprimées par des mots. Ainsi, le silence est un langage alternatif, permettant aux individus de partager leurs pensées, préoccupations, et émotions de manière plus subtile et intuitive. Une personne particiante mentionnait à ce sujet : « Social workers, they should learn how to listen » (Personne participante, Échanges, 2021).
Dans le domaine de la santé mentale, les Inuit considèrent souvent que le processus de guérison mentale implique non seulement l'expression verbale des souffrances intérieures, mais aussi le recours au silence pour explorer les aspects plus profonds de l'esprit. Le silence devient un espace sûr où les individus peuvent réfléchir, se reconnecter avec eux-mêmes, et trouver des réponses aux défis auxquels ils font face, tel que le mentionne cette personne participante :
Juste de se voir, sans parler ça, ça guérit tellement ça, tellement. J'ai beaucoup d'expérience et je le fais encore, mais à l'hôpital il faut tout le temps parler, avec les services sociaux et psychologists aussi. Il faut parler, tout le temps.
Personne participante, Échanges, 2021
Ce ne sont pas seulement les personnes souffrantes, mais les personnes qui donnent les interprétations qui demandent le silence. Une personne participante mentionne notamment avoir besoin d’un moment pour réfléchir, afin de trouver une phrase, ou une histoire qui traduit bien le phénomène étudié :
To find a good way to talk about it [psychotic phenomena], or a good story, I need time. It’s difficult to find right away, I need to think about it, do you mind?
Personne participante, Échanges, 2021
Cela dit, il arrive aussi malheureusement que le silence constitue une manière d’éviter de se faire juger lorsque les personnes ont l’impression que leurs savoirs et leurs croyances ne sont pas respectés ou sont mal compris au sein de système ou auprès de certaines personnes qui ne partagent pas le même langage, la même culture. Certains professionnels et professionnelles allochtones peuvent percevoir cela comme un manque de collaboration ou de l’ignorance. Cette personne participante nous invite à la nuance dans nos réflexions et mentionne que :
Sometimes, we stay silent. We don’t talk in meetings, but it is not because we don’t know or we don’t care, it’s just the way we are. C’est comme, on ne pense pas que les gens vont comprendre, mais peut-être que ce n’est pas vrai non plus, like when I told you about the spirits. We don’t mention it, but maybe we should.
Personne participante, Échanges, 2021
Apprendre à écouter renvoie à adopter une posture d’intervention différente, où on laisse de l’espace aux silences, aux interstices, parfois même aux inconforts qui sont inévitables dans un contexte de choc ontologique. Cependant, au cours des séjours dans la communauté, nous avons constaté que les moments pour prendre le temps de discuter, de prendre un café et de s'installer dans une position égalitaire plutôt que hiérarchique sont rares, voire inexistants. Les CLSC, les hôpitaux, les services sociaux, la protection de la jeunesse (DPJ) et le Centre de crise sont construits selon une vision de la personne professionnelle experte et de la personne malade. Les travailleurs sociaux et travailleuses sociales sont mandatés pour travailler dans ces institutions. Ils et elles auront souvent une tendance à adopter cette posture d’experts et expertes qui vient avec leur titre et à évacuer l’aspect plus relationnel qui est primé par les Inuit en contexte de relation d’aide. Une conseillère inuk nous invite à repartir avec une vision complètement différente :
To take care of people, to help people, we need love, we need laugh. Instead of building a CLSC that is very modern, we need to have it more human, more welcoming. First, we need to change the wording (hospital, is a place for sick people, Aniaviaq.. a place to be sick), we need to change it to “A place to get well”, Qanuigunnaivik. It is much more welcoming, for everyone so people can be comfortable and heal. People will know it is a place safe and caring.
Personne participante, Échanges, 2022
Discussion et conclusion
Cet article espère contribuer au développement d’une posture réflexive et critique chez les personnes qui gravitent dans le domaine de la santé mentale et du bien-être et mettent en relief les défis et les enjeux épistémologiques et ontologiques de la rencontre en contexte inuit. Nos résultats permettent de constater que la professionnalisation des soins et les rapports de pouvoir, qui s’inscrivent dans la colonialité (Quijano 2007), constituent d’importantes barrières à la mise en lumières des savoirs inuit. Ces barrières, voire ces enjeux, s’incarnent dans l’intériorisation ou l’utilisation du langage, les étiquettes et les approches dominantes sans comprendre ce que ça représente ou implique. Si l'on veut saisir correctement les besoins des Nunavimmiut qui composent avec des phénomènes psychotiques et fournir des services efficaces, exempts de violence et qui ne reproduisent pas des schèmes coloniaux, il apparaît important de s’intéresser et de reconnaître les différentes conceptualisations et idées qu’ont les Inuit des phénomènes psychotiques et du rétablissement. Cela requiert une prise de conscience du contexte historique, politique et social dans lequel ces expériences ont lieu et la co-construction d'espaces de collaboration, à la fois physiques et théoriques, basés sur les souhaits des individus, des familles et des communautés du Nunavik.
Enfin, cet article s’inscrit dans une volonté de questionner les pratiques prises pour acquis et d’ouvrir la voie à des manières plurielles de comprendre la santé mentale, notamment les phénomènes dits psychotiques. Loin de vouloir essentialiser les expériences, les résultats de l’article mettent en lumière que la manière d’appréhender les phénomènes psychotiques et la santé mentale en général varient d’une culture à l’autre et d’une personne à l’autre. Les résultats soulignent également les dynamiques qui sous-tendent les situations de violence systémiques et épistémiques. À partir de deux principaux thèmes qui émergent de ces résultats, soit « l’aliénation du colonisé » et « créer ou prendre l’espace », nous invitons dans la discussion à une prise en compte réflexive et critique de nos postures en intervention, ainsi qu’à une réflexion autour de la création d’espaces de dialogues ouverts et respectueux des différentes cultures dans le domaine de la santé mentale.
L’aliénation du colonisé
Frantz Fanon posait en 1952 un regard précurseur sur les effets psychiques négatifs de la colonisation et sur l’usage de la psychiatrie pour justifier la colonisation (Fanon 1952). Est-ce que ses mises en garde sont toujours pertinentes pour nous ? Fanon parle notamment de la « névrose du colonisé » ou de « l’aliénation » du colonisé, qui traduisent la manière dont les personnes qui ont vécu ou qui vivent la colonisation peuvent intégrer les discours de stigmatisation qui leur ont été tant de fois répétées, à intégrer le sentiment d’infériorité qui leur est accolé, finissant par dévaloriser leur culture, leur langue, et tenter de s’adapter au colonisateur (Fanon 1952 ; Vergès 2005). Ce phénomène est exemplifié par la travailleuse communautaire qui raconte que parfois les Inuit préfèrent se taire durant les rencontres de peur de ne pas être compris, qu'ils hésitent à partager leurs traductions et leurs interprétations par crainte d’être jugés. Le phénomène est également démontré par cette autre travailleuse communautaire qui dit avoir l’impression de ne pas être « une bonne traductrice-interprète » parce qu’elle ne trouve pas les mots exacts. Notre article soulève d’importants enjeux face à l’importance d’être sensibles au fait que les mots et les concepts peuvent ne pas avoir de résonance ou de sens dans leur culture. Cela ne signifie pas que l’inuktitut soit une langue trop « simple » pour saisir les nuances des diagnostics biomédicaux, mais plutôt que les Inuit peuvent avoir des manières différentes et multiples d’appréhender, imager et expliquer la maladie et la santé mentale.
Ainsi donc, les Inuit qui participent aux services naviguent entre les langues, les dialectes et les cultures — les nuances des langues et des pratiques inuit au Nunavik, au Québec francophone, au Québec anglophone et au Canada, la culture institutionnelle de la santé, la politique, la famille, la communauté, l'éducation — pour n'en citer que quelques-unes. La traduction des mots « schizophrène » ou « psychotique » peut changer en fonction de la position sociale et culturelle de la personne, et ce, même à l'intérieur d'une communauté et d’une institution. Ne pas en être conscient risque d’occulter les questions de langues, de cultures et de modèles explicatifs des interventions. On risque alors de passer à côté de notre objectif d’accompagner et de supporter les personnes vers ce qu’elles considèrent comme une vie satisfaisante, vers le bien-être.
En 2008, Richard Ingram de l’Université de Ryerson, a développé le terme « mad studies » dans sa critique de l’approche biomédicale en santé mentale favorisée par les établissements qui dispensent des services en santé mentale. Ce terme a été adopté par des universitaires et des praticiens et praticiennes de diverses disciplines, y compris le travail social, où la plupart des discussions sur la détresse mentale continuent d'être formulées en termes biomédicaux de « maladie mentale » ou de « trouble » en raison de l’hégémonie du langage biomédical au sein des services de santé et services sociaux, mais également dans les médias (LeFrancois, Menzies et Reaume 2013). Cette réalité fait écho au principe de la colonialité du pouvoir (Quijano 2007) ou encore de « colonialisme interne » (Hetcher 2017), qui traduisent les barrières auxquelles font face les Autochtones par rapport à leur capacité d’agir, d’être et d’expérimenter leurs mondes, y compris leur santé et leur bien-être (Trout et al. 2018 : 398). Le fait que les services sont principalement développés, pensés et dispensés par des acteurs allochtones, est un facteur qui peut perpétuer le colonialisme au sein des services en santé mentale et contribue à mettre en marge les savoirs autochtones dans ce domaine, limitant leur capacité à faire sens de leurs expériences. Cela s’observe lorsque les personnes rencontrées empruntent des concepts psychiatriques pour nommer les phénomènes vécus ou observés dans la communauté, même s’ils ne font pas sens avec leurs expériences et leurs savoirs.
Selon Berseford et Rose (2023), une implémentation des fondements théoriques et pratiques du mouvement mad studies permettrait de contribuer à réduire l'écart d'intervention entre les différentes approches, les différentes visions du monde, en plus de permettre l’avancée vers la décolonisation des pratiques en santé mentale (Tam 2013). Selon ces auteurs et autrices, l'approche globale de la santé mentale est basée sur des croyances hégémoniques coloniales européennes et par conséquent, est basée sur la domination dite occidentale et l'effacement et l'appropriation des valeurs traditionnelles (autochtones), ce qui contribue aux pratiques discriminatoires. En contraste, le mad studies priorise les savoirs des experts de vécu et les approches collectivistes afin de nommer ce qui pose problème et de provoquer des changements au sein des institutions.
Créer ou prendre l’espace ?
Margaret Kovach invite à une posture réflexive et suggère aux personnes qui font de la recherche en contexte autochtone à se poser la question suivante : « Am I creating space or taking space? » (Kovach 2015 : 52). Cette invitation est tout aussi pertinente pour les intervenants et intervenantes qui pratiquent au Nunavik. En effet, les enjeux en lien avec les phénomènes dits psychotiques sont complexes, subjectifs et tel que nous l’avons vu, ancrés dans des contextes. En ce sens, le but de cette étude n’est pas de créer un débat avec l’approche médicale, mais d’élargir le terrain de réflexion sur ce que constitue un phénomène ou une expérience dite psychotique. Face au caractère subjectif de ces expériences, il semble nécessaire de reconnaître que, sans une approche inuit, basée sur la culture des Nunavimmiut et la langue inuktitute, il y aura toujours des informations manquantes et des interprétations incomplètes. En outre, lorsque les rencontres se font principalement à l’intérieur de l’hôpital ou des CLSC, lieux où les rapports de pouvoirs et de savoirs sont historiquement inégaux et où les savoirs du groupe dominant prennent le plus d’espace, il peut être difficile pour les Nunavimmiut de faire valoir leurs savoirs, notamment parce qu’ils et elles ne peuvent que rarement s’exprimer dans leur langue maternelle qu’est l’inuktitut, peuvent penser que l’intervenant ou l’intervenante ne les comprendra pas, ou parce qu’ils et elles ont intériorisé que leurs voix valent moins.
L’invitation des intervenants et intervenantes inuit de reconstruire notre façon d’aborder les souffrances en lien avec les symptômes dits psychotiques peut être mieux comprise à partir de certains termes en inuktitut. Au Nunavik, dans le cadre du projet Qanuilirpitaa?[15] Christopher Baron et collègues (Baron et al. 2021) ont identifié trois concepts clés de la santé et du bien-être des Nunavimmiut. [1] Ilusirsusiarniq renvoie à la santé du corps et à l’importance de la nourriture traditionnelle, de la famille et de la communauté pour être et demeurer en santé. [2] Qanuinngisiarniq englobe de manière large les sentiments de confort, de satisfaction et d'absence de soucis ou de douleur. [3] Inuuqatigiitsianiq réfère au vivre-ensemble, qui est une dimension clé du bien-être. Ces concepts s'appuient sur les fondements de la langue (uqausiq) et de la culture (iluqiutiq/piusiq) pour constituer le modèle IQI de la santé et du bien-être au Nunavik. IQI sert de raccourci et de substitut aux termes plus typiques de « santé et bien-être » que l'on trouve en anglais (Baron et al. 2021). La religion et la spiritualité jouent aussi un rôle important dans le bien-être des Inuit (Laugrand et Oosten 2010).
La culture et les pratiques traditionnelles sont des éléments clés du bien-être et de la guérison (Baron et al. 2021 ; Gagnon et al. 2021). À ce propos, les participants nous demandent d'écouter davantage, d'accepter le silence, de prendre le temps de parler des problèmes de santé mentale qui constituent des thèmes complexes et délicats en contextes interculturels. Les observations sur le terrain montrent à quel point les activités quotidiennes, les rassemblements et les célébrations, planifiés ou non, sont des facteurs de protection, voire des lieux de guérison. Ces résultats ont été mis en exergue par une participante qui nous invitait à créer des espaces de rencontres plus accueillants et moins institutionnels, à mettre l'accent sur la guérison plutôt que sur la « maladie » dans la nomenclature, ainsi que par cet autre participant inuk qui nous demande de revoir notre système de « professionnalisation » et de reconnaître les personnes qui possèdent une « expertise » en santé mentale en contexte autochtone. Cette étude a nous a donc amenées à repenser comment l’éducation peut être un facteur d’oppression ou de libération dans le contexte de souffrance mentale, à examiner nos postures d’« autorité », d’« experts » et « expertes », à accepter de ne pas savoir et de ne pas toujours comprendre. Comme Frédéric Laugrand et Jarich Gerlof Oosten l'ont identifié, « les Inuit pratiquent le counseling depuis longtemps » (Laugrand et Oosten 2010 : 59). Au travers de nos expériences au Nunavik, nous avons constaté l’importance de mettre l’accent sur l’expertise inuit, de créer l’espace pour les incertitudes (à l’absence de certitudes), et de rester à l’écoute avant d’agir. Cette posture se traduit par l’humilité culturelle (Tervalon et Murray-Garcia 1998), qui représente un engagement à long terme d’autoréflexion et d’autocritique face à nos propres systèmes de connaissances.
Parties annexes
Remerciements
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont partagé leurs expériences et leurs savoirs avec nous. Merci tout particulièrement à Céline Tukalak, pour ses précieux conseils, sa disponibilité et ses réponses à nos innombrables questions. Merci aux Fonds de recherche du Québec (FRQ) pour le soutien financier. Merci à Sarah Fraser pour ses commentaires et sa relecture.
Notes biographiques
Dominique Gaulin
Je suis chercheuse postdoctorale au département de psychiatrie de l’Université McGill. Durant ma thèse de doctorat, je me suis intéressée expériences des Inuit dans le domaine des phénomènes dits psychotiques et du rétablissement à partir d’une lunette postcoloniale et post-structurelle. Je suis également travailleuse sociale et formatrice en prévention du suicide au Nunavik. Mes intérêts de recherche portent sur les questions de santé mentale et de prévention du suicide en contexte transculturel et postcolonial, en portant une attention particulière aux expériences subjectives et à la construction des savoirs dans ce domaine. Je m’intéresse aux enjeux de pouvoir présent dans l’intervention, la recherche et les discours.
Shawn-Renée Hordyk
Professeure à l’École de travail sociale de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Mes projets de recherches collaboratives portent entre autres sur le soutien des initiatives communautaires liées au deuil des jeunes et des familles au Nunavik, y compris les interventions sociales « on the land ». Je suis également travailleuse sociale et psychothérapeute de formation.
Lucie Nadeau
Je suis professeure agrégée au Département de Psychiatrie à l’Université McGill dans les divisions de psychiatrie sociale et culturelle et de pédopsychiatrie. En tant que pédopsychiatre, je travaille à l’Hôpital de Montréal pour enfants (Centre universitaire de santé McGill) et je suis consultante en pédopsychiatrie au Nunavik depuis 2008. Mon principal domaine de recherche actuel concerne la santé mentale jeunesse et les soins en collaboration dans les communautés autochtones éloignées et dans les milieux urbains culturellement et socioéconomiquement diversifiés. Je détiens un certificat en langue et culture inuite et poursuis avec plaisir mon apprentissage de l’inuktitut.
Notes
-
[1]
Situé au nord du 55e parallèle, le Nunavik fait politiquement partie de la région du Nord-du-Québec et géographiquement partie de l’Inuit Nunangat (la patrie des Inuit).
-
[2]
Les villages sont accessibles par les routes hivernales (motoneige ou traîneau à chiens) ou encore par les voies maritimes durant la période estivale.
-
[3]
Ce mot désigne les « Blancs », en inuktitut.
-
[4]
Il existe essentiellement deux façons de voir les choses concernant l’emploi des noms Inuit et Inuk, ce qui fait que deux graphies cohabitent dans l’usage, tant dans les écrits de source autochtone que non autochtone (Gouvernement du Canada 2023). La première perspective privilégie l’intégration des emprunts au français et donc opte pour l’accord en genre et en nombre du nom Inuit, conformément à la grammaire française (un Inuit, une Inuite, des Inuits, des Inuites). La deuxième perspective, adopte les règles propres à la langue d’emprunt et emploie les formes invariables des noms Inuit (des Inuit) et Inuk (une Inuk). C’est cette dernière perspective que nous employons.
-
[5]
« Habitants du Nunavik », en inuktitut.
-
[6]
Les personnes qui apparaissent dans cet article ou dont les expériences sont présentées ont toutes donné leur consentement, écrit ou verbal, à la première auteure. La confidentialité, le consentement libre et éclairé ainsi que le respect de l’intégrité des personnes participantes sont au coeur de ce projet. Tous les outils ont été disponibles en français, anglais et inuktitut.
-
[7]
Il existe plus qu’un terme pour traduire la « santé mentale » en inuktitut, cela peut s’expliquer en partie puisqu’il s’agit d’une langue imagée et que la traduction varie en fonction de l’interprétation qu’a la personne locutrice du concept en tant que tel.
-
[8]
Ce projet a obtenu en juin 2021 l’approbation éthique du Centre hospitalier Inuulitsivik, ainsi que de l’Université de Montréal.
-
[9]
Il s’agit de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (PL n° 21). Pour plus de détails, veuillez consulter le lien URL suivant : https://www.opq.gouv.qc.ca/santementalerelationshumaines/domaine-de-la-sante-mentale-et-des-relations-humaines-projet-de-loi-21/guide-explicatif.
-
[10]
Expression locale pour un véhicule tout-terrain.
-
[11]
Nom fictif.
-
[12]
Dans la tradition spirituelle des religions abrahamiques, le Saint-Esprit est perçu comme un agent de Dieu qui communique avec les humains, ou agit sur eux.
-
[13]
Au Québec, en tant qu’organisme public, un centre local de services communautaires (CLSC) offre des services de première ligne en matière de santé et d'assistance.
-
[14]
La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est un organisme québécois qui intervient auprès d’un enfant et sa famille en cas de situation qui compromet la sécurité ou le développement d’un enfant.
-
[15]
« Comment allons-nous ? », en inuktitut.
Bibliographie
- ADELSON, Naomi, 2005, « The embodiment of inequity: Health disparities in Aboriginal Canada », Canadian Journal of Public Health, 96(2): S45-S61.
- ADEPONLE, Ademola B., 2010, Use of Cultural Consultation to Resolve Uncertainty of Psychosis Diagnosis in Ethno-Cultural Minority and Immigrant Patients (Doctorate Thesis), McGill University.
- BARON, Marie, RIVA, Mylène, FLETCHER, Christopher, LYNCH, Melody, LYONNAIS, Marie-Claude and Elhadji A. LAOUAN SIDI, 2021, « Conceptualisation and operationalisation of a holistic indicator of health for older inuit: Results of a sequential mixed-methods project », Social Indicators Research, 155(1) : 47-72. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/s11205-020-02592-5.
- BATTISTE, Marie, 2000, Reclaiming Indigenous Voice and Vision, Vancouver : UBC Press.
- BERESFORD, Peter and Diana ROSE, 2023, « Decolonising global mental health: The role of Mad Studies », Cambridge Prisms: Global Mental Health, 10 : e30.
- BERNER, Jim, JORE, Solveig, Khaled ABASS and Arja RAUTIO, 2024, « One health in the Arctic–connections and actions », International Journal of Circumpolar Health, 83(1). Retrieved from: https://doi.org/10.1080/22423982.2024.2361544.
- BIEHL, João, GOOD, Byron and Arthur KLEINMAN (eds.), 2007, Subjectivity: ethnographic investigations, Berkeley : University of California Press.
- BIRD, Michael Yellow, 2013, « Neurodecolonization: Applying mindfulness research to decolonizing social work », in GRAY, Mel, COATES, John, BIRD, Michael Yellow and Tiani HETHERINGTON, Decolonizing Social Work (pp. 293--310), London : Routledge.
- BROWNE, Annette J., SMYE, Victoria L. and Colleen VARCOE, 2005, « The relevance of postcolonial theoretical perspectives to research in Aboriginal health », Canadian Journal of Nursing Research Archive, 37(4) : 16-37.
- BRUNELLE, Natacha, PLOURDE, Chantal, LANDRY, Michel et Annie GENDRON, 2009, « Regards de Nunavimmiuts sur les raisons de la consommation et ses effets », Criminologie, 42(2) : 9-29.
- CALDERÓN, Alejandra Carreño, 2018, « Le silence indigène dans l’espace biomédical : pratiques de (des) obéissance et autonomie », Connexions, 109(1) : 71-83.
- CASTILLO, Richard J., 2003, « Trance, functional psychosis, and culture », Psychiatry, 66(1) : 9-21.
- Commission d'enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics — Commission Viens, 2019, Rapport final - Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès. Québec : Gouvernement du Québec. En ligne : https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Rapport/Rapport_final.pdf.
- CORIN, Ellen, 2009, « L’échappée de l’expérience dans la psychose », Sociologie et sociétés, 41(1) : 99-124.
- CORIN, Ellen, POIREL, Marie-Laurence et Lourdes RODRIGUEZ, 2011, Le mouvement de l'être : paramètres pour une approche alternative du traitement en santé mentale, Québec : PUQ.
- DEEGAN, Patricia, 1997, « Recovery and Empowerment for People with Psychiatric Disabilities », Social Work in Health Care, 25(3) : 11-24.
- DURAN, Eduardo and Bonnie DURAN, 1995, Native American postcolonial psychology, Albany : SUNY Press.
- FANON, Frantz, 1952, Peau noire. Masques blancs, Paris : Éditions du Seuil.
- FRICKER, Miranda, 2007, Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing, Oxford : Oxford University Press.
- FRASER, Sarah Louise, GAULIN, Dominique and William Daibhid FRASER, 2021, « Dissecting systemic racism: policies, practices and epistemologies creating racialized systems of care for Indigenous peoples », International Journal for Equity in Health, 20(1) : 1-5.
- GAGNON-DION, Marie-Helene, FRASER, Sarah Louise and Louisa COOKIE-BROWN, 2021, « Inuit wellness: A better understanding of the principles that guide actions and an overview of practices », Transcultural Psychiatry, Retrived from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34879771/.
- GROSFOGUEL, Ramón, 2010, « Vers une décolonisation des « uni-versalismes » occidentaux : le « pluri-versalisme décolonial », d’Aimé Césaire aux zapatistes », dans BANCEL, Nicolas, BERNAULT, Florence, BOUBEKER, Ahmed, MBEMBE, Achille et Françoise VERGÈS (eds.), Ruptures postcoloniales : Les nouveaux visages de la société française (pp. 119–138). Paris : La Découverte.
- HETCHER, Michael, 2017, Internal colonialism: the Celtic fringe in British national development, London : Routledge.
- HUNTER, Ernest M., 2013, « Indicators of psychoses or psychoses as indicators: The relationship between Indigenous social disadvantage and serious mental illness », Australasian Psychiatry, 21(1) : 22-26.
- HIGGINBOTTOM, Gina M. A., PILLAY, Jennifer J. and Nana Y. BOADU, 2013, « Guidance on performing focused ethnographies with an emphasis on healthcare research », The Qualitative Report, 18(17): 1-16.
- INGRAM, Richard, A., 2008, « Mapping ‘Mad Studies’: The Birth of an In / discipline », Disability Studies Student Conference, Syracuse University, Syracuse, NY.
- Inuit Tapiriit Kanatami — ITK, 2014, Social Determinants of Inuit Health in Canada, Ottawa : ITK.Retrieved from: https://doi.org/10.1097/01.aog.0000453605.35883.a0.
- Inuit Tapiriit Kanatami — ITK, 2018, National Inuit strategy on Research, Ottawa : ITK.Retrieved from: https://www.itk.ca/wp-content/uploads/2018/04/ITK_NISR-Report_English_low_res.pdf.
- JARVIS, G. Eric, 2007, « The social causes of psychosis in North American psychiatry: a review of a disappearing literature », The Canadian Journal of Psychiatry, 52(5) : 287-294.
- JARVIS, G. Eric and Laurence J. KIRMAYER, 2021, « Situating Mental Disorders in Cultural Frames », Oxford Research Encyclopedia of Psychology. Retrieved from: https://oxfordre.com/psychology/display/10.1093/acrefore/9780190236557.001.0001/acrefore-9780190236557-e-627.
- JENKINS, Janis D, 2004, Schizophrenia, culture, and subjectivity: The edge of experience, London : Cambridge University Press.
- JOHNSON‐LAFLEUR, Janique, 2022, Multiple ways of looking: Learning from the experience of Montréal's transcultural seminars to foster cultural safety in youth mental health services, (Doctorate Thesis), McGill University.
- JOSEPH, Ameil J. A., 2014, « A prescription for violence: The legacy of colonization in contemporary forensic mental health and the production of difference », Critical criminology, 22(2) : 273-292.
- KIRMAYER, Laurence J. et Rachid BENNEGADI, 2011, « Les politiques de l'altérité dans la rencontre clinique », L'autre, 12(1) : 16-29.
- KIRMAYER, Laurence, Ellen CORIN, Andre CORRIVEAU et Christopher FLETCHER, 1993, « Culture et maladie mentale chez les Inuit du Nunavik », Santé mentale au Québec, 18(1) : 53-70.
- KIRMAYER, Laurence J., FLETCHER, Christopher M. and Lucy J. BOOTHROYD, 1997, « Inuit attitudes toward deviant behavior: a vignette study », The Journal of Nervous and Mental Disease, 185(2) : 78-86.
- KIRMAYER, Laurence J., ROUSSEAU, Cecile, JARVIS, Eric G. and Jazmine GUZDER, 2008, « The cultural context of clinical assessment », Psychiatry, 3, 54-66.
- KIRMAYER, Laurence, SIMPSON, Cori and Margaret CARGO, 2003, « Healing traditions: Culture, community and mental health promotion with Canadian Aboriginal peoples », Australasian Psychiatry, 11(1_suppl) : S15-S23.
- KNOBLAUCH, Hubert, 2005, « Focused ethnography », Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 6 (3) : art.44.
- KLEINMAN, Arthur, 1987, « Anthropology and psychiatry: The role of culture in cross-cultural research on illness », The British Journal of Psychiatry, 151(4) : 447-454.
- KLEINMAN, Arthur, 1980, Patients and healers in the context of culture: An exploration of the borderland between anthropology, medicine, and psychiatry, vol. III, Berkeley : University of California Press.
- KOVACH, Margaret, 2010, « Conversation Method in Indigenous Research », First Peoples Child & Family Review, 5(1) : 40-48.
- KOVACH, Margaret, 2015, « Emerging from the margins: Indigenous methodologies », in STREGA, Susan and Leslie BROWN (eds.), Research as resistance: Revisiting critical, Indigenous, and anti-oppressive approaches (pp. 43-64), Toronto : Canadian Scholars Press.
- LAUGRAND, Frédéric et Jarich G. OOSTEN 2008, « Cercles de guérison, pratiques d’inspiration chamanique et néo-chamanisme chez les Inuits du Nunavik et du Nunavut », Recherches amérindiennes au Québec, 38(2) : 55-67.
- LEFRANÇOIS, Bren A., MENZIES, Robert and Geoffrey REAUME (eds.), Mad matters: A critical reader in Canadian Mad Studies (pp. 122-129), Toronto : Canadian Scholars Press.
- LEWIS-FERNÁNDEZ, Roberto, AGGARWAL, Neil Krishan, BÄÄRNHIELM, Sofie, ROHLOF, Hans, KIRMAYER, Laurence J., WEISS Mitchell G., JADHAV, Sushrut, HINTON, Ladson, ALARCÓN Rrenato D., BHUGRA Dinesh, GROEN, Simon, VAN DIJK Rob, QURESHI, Adil, COLLAZOS, Francisco, ROUSSEAU, Cécile, CABALLERO, Luis, RAMOS, Mar and Francis LU, 2014, « Culture and psychiatric evaluation: operationalizing cultural formulation for DSM-5 », Psychiatry, 77(2) : 130-154.
- LIEGGHIO, Maria, 2013, « A denial of being: Psychiatrization as epistemic violence », in LEFRANÇOIS, Bren A., MENZIES, Robert and Geoffrey REAUME (eds.), Mad matters: A critical reader in Canadian Mad Studies (pp. 122-129), Toronto : Canadian Scholars Press.
- MEDINA, José, 2017, « Epistemic injustice and epistemologies of ignorance », in TAYLOR, Paul, ALCOFF, Linda and Luvell ANDERSION (eds.), The Routledge Companion to the Philosophy of Race (pp. 247-260), London : Taylor and Francis.
- MIGNOLO, Walter, 2013, « Géopolitique de la sensibilité et du savoir. (Dé)colonialité, pensée frontalière et désobéissance épistémologique », Mouvements, (1) : 181-190.
- MORGAN, Craig and Gerard HUTCHINSON, 2010, « The social determinants of psychosis in migrant and ethnic minority populations: a public health tragedy », Psychological Medicine, 40(5) : 705-709.
- NELSON, Sarah, 2011, Remise en question des hypothèses cachées, Prince George : Centre de collaboration nationale de la santé autochtone. En ligne : https://www.ccnsa-nccah.ca/docs/determinants/FS-ColonialNorms-Nelson-fr.pdf.
- OTERO, Marcelo, 2015, Les fous dans la cité : sociologie de la folie ordinaire contemporaine, Montréal : Boréal.
- PERRAULT-SULLIVAN, Gentiane et Georgia VRAKAS, 2019, « Étude qualitative de la vision et des besoins des jeunes du Nunavik en matière de santé mentale et aperçu de la réponse fournie par les organismes du milieu », Canadian Journal of Community Mental Health, 38(3) : 1-17.
- QUIJANO, Aníbal, 2007, « Coloniality and modernity / rationality », Cultural Studies, 21(2-3) : 168-178.
- QUMAQ, Taamusi, 1992, « The land - The region of Nunavik », Avataq Cultural Insitute. Retrieved from: https://www.avataq.qc.ca/en/Nunavimmiuts/The-land/The-Region-of-Nunavik.
- READ, John, PERRY, Bruce, MOSKOWITZ, Andrew and Jan CONNOLLY, 2001, « The contribution of early traumatic events to schizophrenia in some patients: a traumagenic neurodevelopmental model », Psychiatry, 64(4) : 319-345.
- READING, Charlotte Loppie et Fred WIEN 2009, Inégalités en matière de santé et déterminants sociaux de la santé des peuples autochtones, Prince George : Centre de collaboration nationale de la santé autochtone. En ligne : http://www.nccah-ccnsa.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/46/Health%20Inequalities%20&%20Social%20Determinants%20of%20Aboriginal%20Peoples'%20Health%20(French).pdf.
- RILEY, Tamara, ANDERSON, Neil E., LOVETT, Raymond, MEREDITH, Anna, CUMMING, Bonny and Joanne THANDRAYEN, 2021, « One Health in Indigenous Communities: A Critical Review of the Evidence », International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(21) : 11303. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8583238/
- ROMAN, Leslie G., BROWN, Sheena, NOBLE, Steven, WAINER, Rafael and Alannah Earl YOUNG, 2009, « No time for nostalgia!: asylum‐making, medicalized colonialism in British Columbia (1859–97) and artistic praxis for social transformation », International Journal of Qualitative Studies in Education, 22(1) : 17-63.
- RRASMQ, 2018, « Un changement de paradigme nécessaire en santé mentale », Mémoire du RRASMQ sur le droit à la santé, remis au Rapporteur spécial de l’ONU, 13 novembre 2018.
- Société québécoise de la Schizophrénie — SQS, s.d., « Qu’est-ce que la schizophrénie », SQS. En ligne : https://www.schizophrenie.qc.ca/fr/schizophrenie.
- SPIVAK, Gayatri, 1988, « Can the Subaltern Speak? », in GROSSBERG, Larry and Cary NELSON (eds.), Marxism and the Interpretation of Culture (pp. 66– 111), Houndmills : Macmillan.
- Statistique Canada, 2016, Les Inuits : Feuillet d’information du Nunavik, Gouvernement du Canada. En ligne : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-656-x/89-656-x2016016-fra.htm
- TAM, Louise, 2013, « Whither Indigenizing the Mad Movement? Theorizing the Social Relations of Race and Madness through Conviviality », in LEFRANÇOIS, Bren A., MENZIES, Robert and Geoffrey REAUME (eds.), Mad matters: A critical reader in Canadian Mad Studies (pp. 281-297), Toronto : Canadian Scholars Press.
- TERVALON, Melanie and Jann MURRAY-GARCIA, 1998, « Cultural Humility Versus Cultural Competence: A Critical Distinction in Defining Physician Training Outcomes in Multicultural Education », Journal of Health Care for the Poor and Underserved, 9(2) : 117-125.
- TROUT, Lucas, MCEACHER, Diane, MULLANY, Anna, WHITE, Lauren and Lisa WEXLER, 2018, « Decoloniality as a Framework for Indigenous Youth Suicide Prevention Pedagogy: Promoting Community Conversations About Research to End Suicide », American Journal of Community Psychology, 62(3-4) : 396-405.
- VALLEE, Frank G, 1966, « Eskimo Theories of Mental Illness in the Hudson Bay Region », Anthropologica, 8(1) : 53-83.
- VERGÈS, Françoise, 2005, « Le N**** n'est pas. Pas plus que le Blanc », Actuel Marx, (2) : 45-63.
- WADDELL, Candice. M., RIBINSON, Renee and Allison CRAWFORD, 2017, « Decolonizing Approaches to Inuit Community Wellness: Conversations with Elders in a Nunavut Community », Canadian Journal of Community Mental Health, 36(1), 1-13.
- WILSON, Shawn, 2008, Research is ceremony: Indigenous research methods, Winnipeg : Fernwood Publishing.
- WESLEY-ESQUIMAUX, Cynthia C. and Magdalena SMOLEWSKI, 2004, « Historic Trauma and Aboriginal Healing », Journal of Palliative Care, 26(1): 6-14.
- YELLOW HOUSE, Brave Heart, M, 2003, « The historical trauma response among natives and its relationship with substance abuse: A Lakota illustration », Journal of Psychoactive Drugs, 35(1) : 7-13.