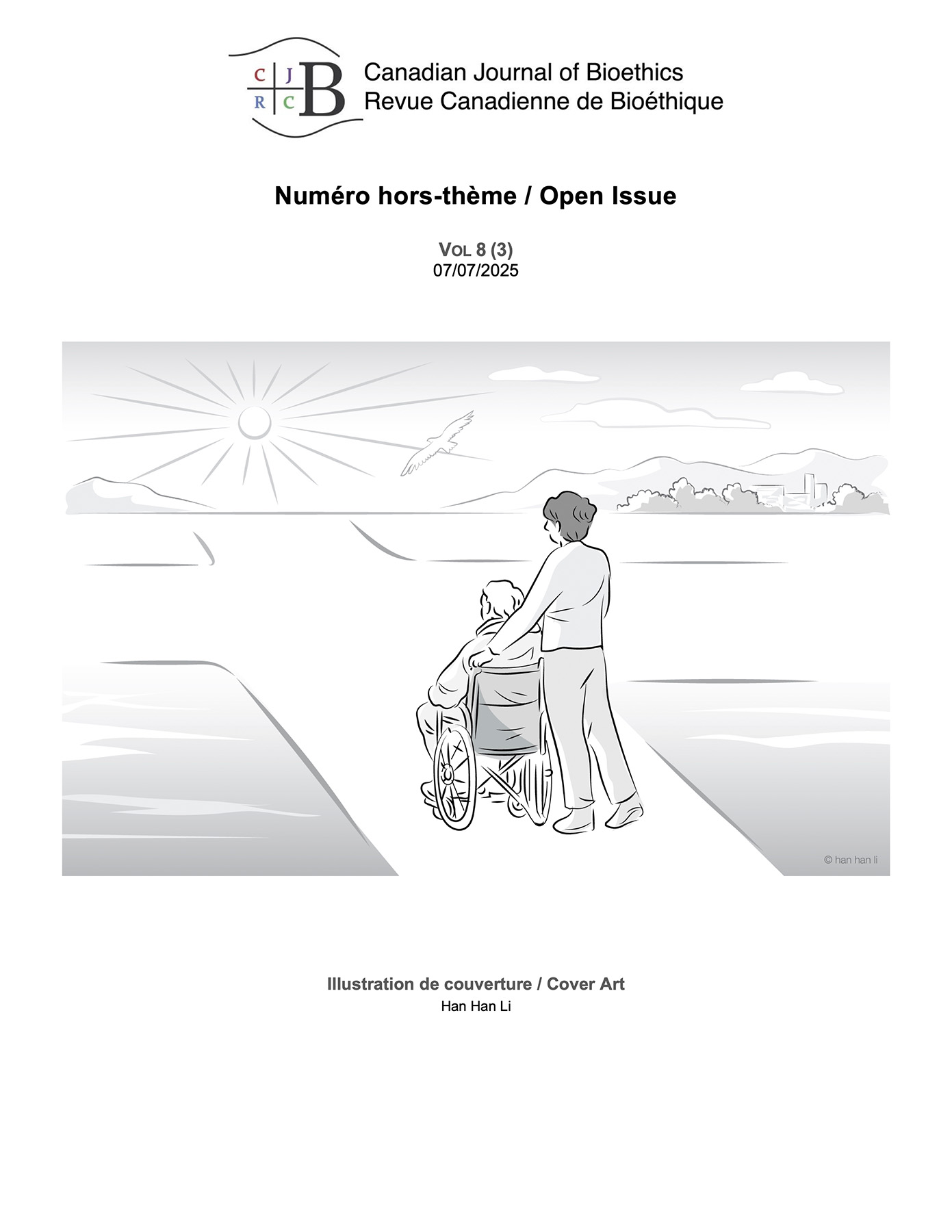Résumés
Résumé
Le film de Coralie Fargeat La substance (2024) met en scène les affres reliés au refus du vieillissement, surtout pour les femmes, dans un contexte social rempli d’injonction à demeurer jeune à tout prix. En plus de poser plusieurs questions existentielles, ce film présente une critique du monde social dans lequel nous vivons.
Mots-clés :
- corps,
- identité,
- éthique,
- transhumanisme,
- vieillissement
Abstract
Coralie Fargeat’s film The Substance (2024) portrays the torments of refusing to grow old, especially for women, in a social context filled with the injunction to stay young at all costs. As well as posing several existential questions, the film is a critique of the social world in which we live.
Keywords:
- body,
- identity,
- ethics,
- transhumanism,
- aging
Corps de l’article
La substance (The Substance) est un film produit par Coralie Fargeat, sorti en salle en 2024 (1). Le film raconte l’histoire d’Elizabeth Sparkle, jouée par Demi Moore, qui est une danseuse vedette de la télévision dans un programme de mise en forme pour les gens à la maison. Elle convainc les spectateurs que leur corps peut tout et les enjoint à mettre du brillant dans leur vie, à faire de leur vie quelque chose d’éclatant. Elle a sa propre étoile à Hollywood sur le plancher : Elizabeth Sparkle. Elle est reconnue; on la voit partout sur des affiches. Comme son nom l’indique, elle brille de toutes parts. Mais son bonheur prend fin abruptement lorsque le propriétaire de la chaîne de télévision souhaite la remplacer pour une autre fille beaucoup plus jeune : elle a le malheur d’avoir atteint l’âge de cinquante ans, l’âge qui signifie la fin de carrière pour plusieurs vedettes de cinéma. C’est toute sa vie qui s’écroule. Elle est frappée par le malheur.
À la suite de cette mauvaise nouvelle, elle sera victime d’un accident de la route qui exprime le tournant de sa vie. Elle s’en sortira sans conséquence. Mais nous retrouvons une femme devenue vulnérable qui n’existe plus dans le regard d’autrui. Elle a perdu une partie de son identité. Nous constatons qu’elle craint d’être seule.
Elle recevra une offre qu’elle finira, après une brève hésitation, par accepter : utiliser une substance, produite par division cellulaire de son ADN, qui lui donnera une meilleure version d’elle-même. Nous sommes ici au coeur de la pensée du transhumanisme qui vante les mérites de la science et de la technologie en faveur d’une amélioration de la condition humaine en augmentant les capacités physiques et psychiques et en supprimant le processus du vieillissement. Il y a en arrière-fond le médecin fou comme on en voit beaucoup dans les films où il s’agit de transformer l’être humain (2). En ce sens, le film nous présente une critique du transhumanisme, du non-respect de la finitude humaine qui cache la peur de mourir, de n’être rien pour personne.
Ces séquences invitent le spectateur à se poser la question de son rapport au corps, à la place du corps dans son identité, surtout lorsque celui-ci commence à montrer des signes de vieillissement, les marques de la finitude humaine. Une dualité s’instaure dans la psyché humaine : la réalité du vieillissement en conflit avec le rêve d’une jeunesse immortelle. Si l’être humain est rattrapé par sa condition d’être mortel, il l’est aussi par ce fantasme de retrouver un corps idéal. Il y a la recherche du corps parfait.
Elizabeth rejoue la tragédie de Prométhée qui vole le feu pour finalement en payer le prix en étant dévoré par les rapaces. À vouloir le bien, elle finit par produire le mal, en l’occurrence par s’autodétruire. Élizabeth, comme Oedipe, a voulu fuir son destin, vieillir, pour finalement être rattrapée par ce qu’elle refusait. La vie et la mort ne sont jamais loin l’une de l’autre.
Pourtant, cela semblait simple au début : il suffisait de suivre les instructions et d’accepter de partager son temps entre deux versions de soi-même de manière équilibrée. Mais, la version plus jeune et belle, son double, Sue, finira par devenir victime de son propre succès. Elle cherchera en à abuser en outrepassant les limites. Elle ne respecte donc pas les règles. Pour elle, ce n’est que quelques accros, mais le film en montre les conséquences. Ce que Sue gagne d’un côté, Élizabeth le perd de l’autre côté, même si elles ne font qu’une. Elizabeth fait la démonstration combien il est impossible pour l’être humain dans ses choix de vie de prévoir toutes les conséquences possibles. De quoi être sceptique à propos de la notion de consentement libre et éclairé et du cadre théorique qu’est le conséquentialisme. L’éthique, l’art de choisir ce qui convient à notre vie, repose finalement sur un non-savoir. Au lieu de cultiver la certitude que nos choix sont les bons, l’éthique devrait consister à maintenir ouvert le doute. Élizabeth va à l’encontre du sens commun qui invite à la prudence devant l’incertitude de nos choix, surtout lorsque nos choix sont irréversibles.
Le corps d’Élizabeth se transforme au même rythme que les transgressions réalisées par Sue. C’est ici que l’horreur commence : son corps devient horrible pendant que Sue fait la fête et jouit de sa vanité. Le corps d’Élizabeth devient une sorte de cancrelat que nous retrouvons dans la Métamorphose de Kafka (3).
À la fin, ce sont leurs corps, le corps d’Élizabeth et de Sue, qui sont réunis en un seul corps. On croirait entendre la psychanalyste Joyce McDougall dans son livre Théâtre du corps qui montre comment « il n’y a qu’un corps pour deux » (4) lorsque la distinction entre soi et l’autre disparaît. Pour Élizabeth et Sue, ce n’est pas possible. Alors elles se font la lutte jusqu’à se vider de leur sang. Le sang rejaillit sur les spectateurs venus assister à la fête du Nouvel An, fête du renouvellement. Nous pouvons comprendre qu’il s’agit de montrer comment c’est toute la société qui a des mains de meurtrier.
Si nous assistons à un conflit psychique entre la part en nous qui veut la jeunesse et qui refuse de mourir, on voit que ce conflit est généré par les injonctions de la société, plus spécifiquement, ceux qui nous viennent d’Hollywood. Il y a une scène où l’on voit toute l’équipe technique composée uniquement d’hommes qui regarde en gros plan le fessier de Sue.
Il est intéressant de voir comment le décor met à contribution notre compréhension de son monde dans la mesure où presque toutes les scènes se déroulent dans des lieux fermés, souvent sous la forme de tunnel sans fenêtre sur le monde extérieur. Élizabeth et Sue vivent toutes les deux dans un imaginaire pauvre en sens. Elles n’ont aucune vie en dehors de leur apparence. Élizabeth et Sue vivent dans une bulle, pour ne pas dire une illusion ou une vision en tunnel qui les empêche de cultiver une compréhension de soi, d’autrui et du monde enrichie. Elles vivent comme des prisonnières dans un caverne éclairée par des images composées de paillettes et de brillants. Cet éclat est créé par les projecteurs de lumière qui, en raison de leur intensité, produit une cécité psychique. Nous sommes plongés dans le même univers que celui des prisonniers dans la caverne de Platon (5). On comprend que ce culte à la beauté, à la brillance et au succès est vécu comme l’adoration d’un veau d’or.
Le film illustre comment la psyché est divisée entre plusieurs voix. Le bien-être exige un certain équilibre qui consiste à donner à chaque version de soi une juste place en permettant l’alternance des voix dans un souci démocratique. On retrouve le souci de la juste mesure promu par Aristote (6). Le trouble ou le mal commence lorsqu’une voix prend le pouvoir et se met en position d’hégémonie. Élizabeth et Sue, en voulant vivre à perpétuité leur état paradisiaque, provoquent leur propre chute. Comme quoi dans chaque coin de Paradis se cache un élan de vie qui conduit aux enfers.
Il y a un refus de la finitude, c’est-à-dire de la temporalité. Pourtant, c’est la temporalité qui permet à l’être humain de vivre d’autres versions de lui-même. Nous sommes un, mais nous apparaissons toujours sous des traits différents, de sorte que nous ne sommes jamais seuls; nous sommes minimalement deux.
La substance magique se présente comme une promesse de bonheur, mais de remède miracle on passe au poison et ensuite à la trahison. Ce sont les deux faces ou les deux versions du pharmacon (7). Il n’y avait personne pour servir de tiers, de médiation, qui aurait permis à Élizabeth de réfléchir davantage en faveur d’une meilleure compréhension de la condition humaine, de la condition féminine et des injonctions sociales qui nous entourent.
Il y a plusieurs couches de sens dans ce film. Nous pouvons en donner plusieurs versions. Mais les questions éthiques de fond, interreliées entre elles, demeurent : quel sens pouvons-nous donner à notre vie? Que pouvons-nous faire de notre existence et de notre corps?
Parties annexes
Bibliographie
- 1. Allociné. La substance.
- 2. Quintin J, Plaat-Gasdoue N. Chronique du cinéma 4 : Pauvres créatures - la transformation humaine. Canadian Journal of Bioethics / Revue canadienne de bioéthique. 7(2-3):195-97.
- 3. Kafka F. La Métamorphose. Paris : Gallimard; 2015.
- 4. McDougall J. Théâtre du corps. Paris : Gallimard; 1989.
- 5. Platon. La République. Paris : Flammarion; 2018.
- 6. Aristote. Éthique à Nicomaque. Paris : Flammarion; 2004.
- 7. Derrida J. Dissémination. Paris : Seuil; 1972.