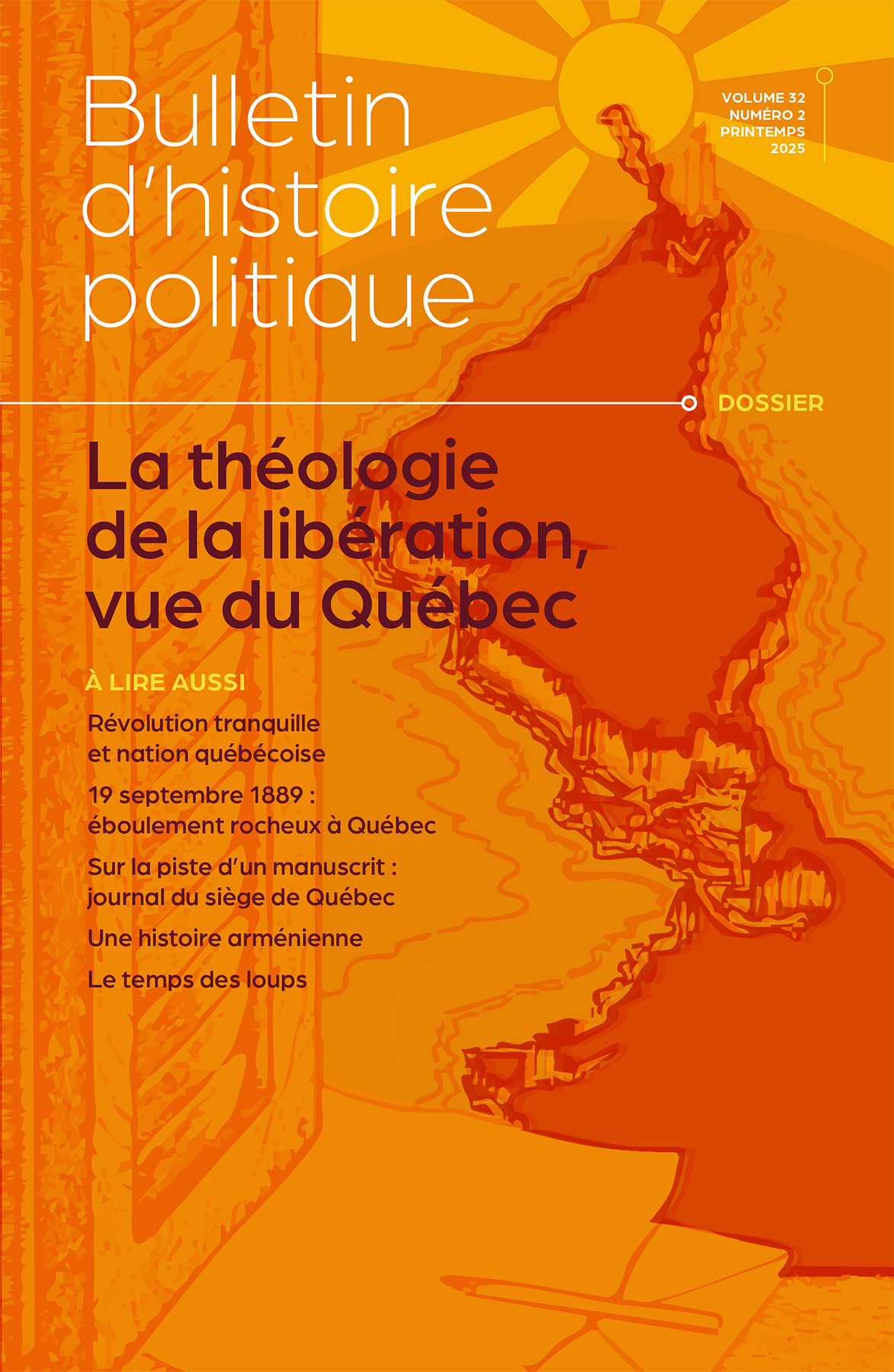Le juriste Otto Kirchheimer (1905-1965) demeure peu connu, mis à part pour sa théorisation des « catch-all parties » et, dans une moindre mesure, pour son ouvrage Political Justice (1961). Son oeuvre, écrite en allemand puis en anglais, n’a bénéficié d’aucune traduction dans le monde francophone, preuve de ce désintérêt. Le droit et son autre, du professeur en sciences politiques Augustin Simard (Université de Montréal), vient donc combler un vide, bien qu’il n’ait pas vocation à rendre compte de l’ensemble de la vie ou de la pensée de Kirchheimer. L’objectif de son essai est plutôt de confronter la notion d’État de droit, qui s’impose à partir du milieu du XXe siècle, au scepticisme de Kirchheimer. En suivant le développement de la primauté du droit à l’aune de la pensée critique du juriste allemand, l’auteur vise à « problématiser notre attachement au Droit et à son “règne”, et à gagner un peu de distance par rapport aux discours qui viennent immédiatement l’envelopper » (p. 37-38). Son pari est de nous montrer la fragilité de nos idéaux incarnés dans l’État de droit en regard de cette critique. Le livre, « à la jonction de la théorie politique et de l’histoire des idées » (p. 36), est un des premiers à tirer profit des Gesammelte Schriften de Kirchheimer. De fait, malgré son objet spécifique, il offre dès le chapitre initial une présentation minutieuse du fonctionnement de la pensée de Kirchheimer. Se fondant sur les théories (aux antipodes) de Karl Marx et de Carl Schmitt, le juriste offre une critique intransigeante du droit bourgeois weimarien, notamment grâce à l’étude historique des concepts légaux. Pourtant, il semble osciller entre le rejet du droit et une « option thérapeutique » pour celui-ci. Ce double mouvement est perceptible dans le travail historico-juridique qu’effectue Kirchheimer, par exemple au sujet de la notion d’expropriation, en revisitant son passé pour critiquer (et corriger) son application sous Weimar. Kirchheimer cherche, par-delà une attaque en règle contre le droit, à changer sa pratique. « Cette démarche critique singulière tient pour beaucoup d’un bricolage permanent, sans doute déconcertant, mais pas pour autant dépourvu d’efficacité. » (p. 67) Le deuxième chapitre poursuit en présentant les réflexions de Kirchheimer au moment de l’effondrement de la république (1930-1933), en particulier au sujet de l’état d’exception, « le symptôme d’une crise qui agite les tréfonds de l’État libéral » (p. 82). Pour répondre aux tensions sociales et politiques, les autorités gouvernementales sont tentées par l’autoritarisme, en adéquation avec les intérêts de la bourgeoisie. Dans ces circonstances, une fuite vers l’avant risque de détruire la démocratie libérale et d’entraîner une nouvelle forme de domination. Le pouvoir autonome de législation du gouvernement représente, pour Kirchheimer, le point de bascule vers les régimes nazi et vichyste. Face à ces dangers, il amenuise sa critique de l’État bourgeois, qui semble dorénavant un moindre mal, avant de reconnaître le continuum entre Weimar et le fascisme dans ses écrits des années 1930 et 1940. Les chapitres 3 et 4 traitent des réflexions de Kirchheimer et de celles de ses collègues Ernst Fraenkel (1898-1975) et Franz Neumann (1900-1954) à la suite de la prise du pouvoir par les nazis (janvier 1933). Les trois juristes abordent le droit national-socialiste dans une perspective matérialiste et holistique, sensible à son inscription dans le mode de production capitaliste : « Ils partagent tous l’idée que ce qui advient au droit sous le nazisme doit être analysé d’abord et avant tout à travers le prisme de sa structure économique, selon une perspective nettement redevable à Marx » (p. 118). Pour eux, le droit nazi s’avère la continuité …
Augustin Simard, Le droit et son autre. Otto Kirchheimer et la critique de l’État de droit, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2023, 308 p.
…plus d’informations
Alexis Lafleur-Paiement
Candidat au doctorat, Université de Montréal et Université de Lille
L’accès à cet article est réservé aux abonnés. Seuls les 600 premiers mots du texte seront affichés.
Options d’accès :
via un accès institutionnel. Si vous êtes membre de l’une des 1200 bibliothèques abonnées ou partenaires d’Érudit (bibliothèques universitaires et collégiales, bibliothèques publiques, centres de recherche, etc.), vous pouvez vous connecter au portail de ressources numériques de votre bibliothèque. Si votre institution n’est pas abonnée, vous pouvez lui faire part de votre intérêt pour Érudit et cette revue en cliquant sur le bouton “Options d’accès”.
via un accès individuel. Certaines revues proposent un abonnement individuel numérique. Connectez-vous si vous possédez déjà un abonnement, ou cliquez sur le bouton “Options d’accès” pour obtenir plus d’informations sur l’abonnement individuel.
Dans le cadre de l’engagement d’Érudit en faveur du libre accès, seuls les derniers numéros de cette revue sont sous restriction. L’ensemble des numéros antérieurs est consultable librement sur la plateforme.
Options d’accès