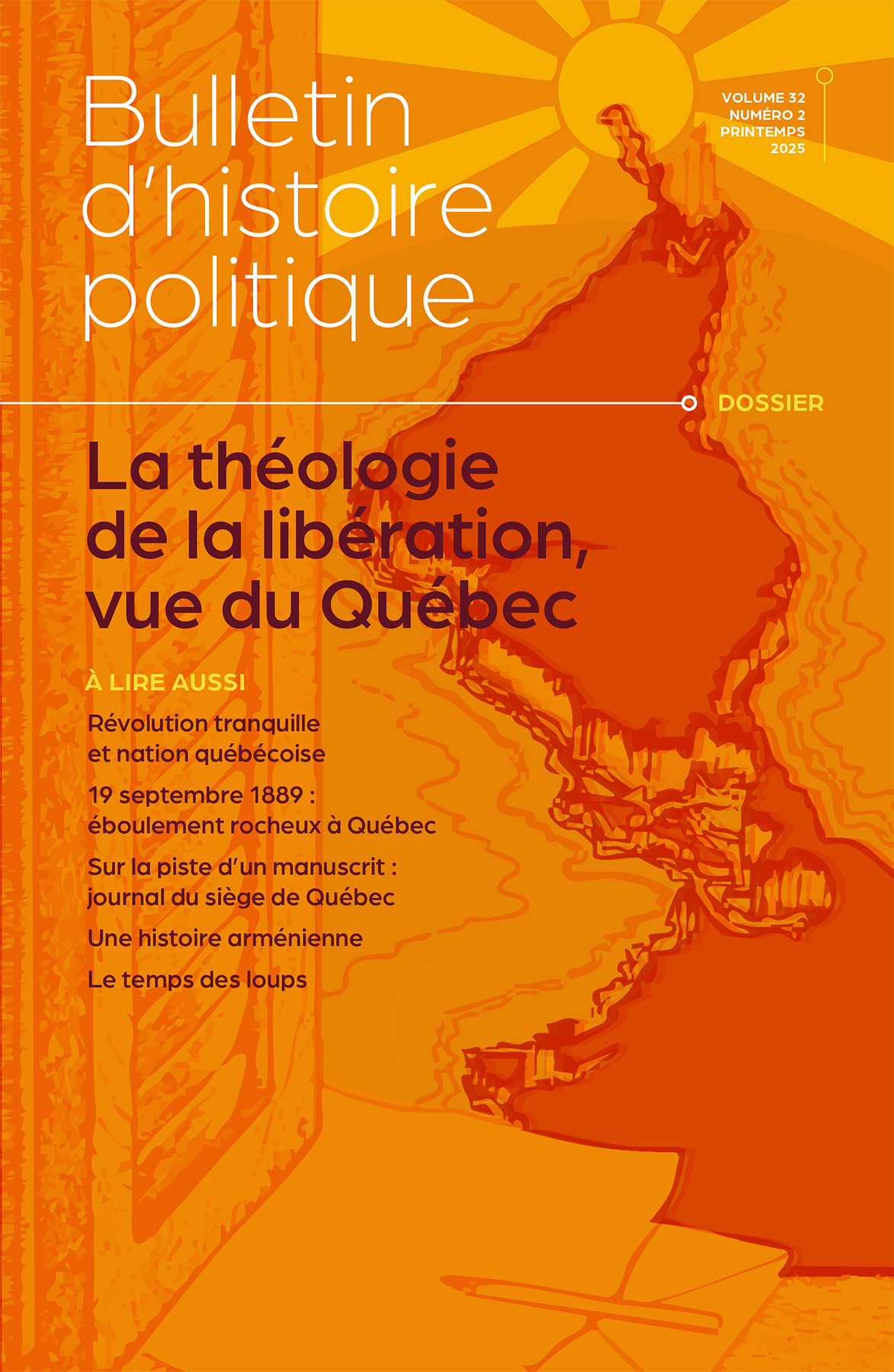S’inscrivant dans le prolongement du cycle de conférences intitulé « Regards croisés sur le débat linguistique au Québec : au-delà du projet de loi 96 », qui avait notamment pour objectif de « mettre en perspective les relations et les frontières culturelles, politiques et identitaires constitutives de l’enjeu linguistique au Québec », cet ouvrage collectif dirigé par Linda Cardinal, Bernard Gagnon, Virginie Hébert et François Rocher, présente divers points de vue, des réflexions ainsi qu’une perspective interdisciplinaire sur les enjeux entourant la situation du français au Québec et au Canada dans la mouvance des débats sur le dépôt du projet de loi 96 (ci-après PL 96) intitulé Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (devenu Loi 14 et sanctionné en juin 2022). Le livre comprend six chapitres, chacun composé de plusieurs contributions et portant pour titre l’une des thématiques de ce cycle de conférences. Il propose d’abord en introduction un sommaire des tenants et aboutissants du PL 96, de ses principales dispositions ainsi que des éléments clés du débat public qui a suivi son dépôt et qui mettait en lumière tant ses points positifs que ses lignes de faille. Le premier chapitre, intitulé « Langue, culture et citoyenneté », est sans doute celui qui traite le plus directement des enjeux et des défis entourant le PL 96. Il tente notamment de répondre à la question de savoir si le PL 96 s’inscrit ou non dans la continuité de la Loi 101, qui avait pour projet de jeter les bases d’une « communauté inclusive de langue française » (p. 21), et s’il ouvre de « nouveaux avenants pour une citoyenneté de langue française au Québec » (ibid.) dans un contexte de mondialisation et de grande diversité culturelle. Les auteurs et autrices abordent, entre autres, le rôle et la légitimité de l’État en matière d’intervention linguistique, les entraves, les défis et les enjeux de légitimité de « promulguer des lois à portée culturelle ou identitaire » (p. 25-26), le bilinguisme et les rapports majorité/minorités. Le deuxième chapitre, sur « Les droits linguistiques des minorités », aborde notamment l’enjeu du français comme langue minoritaire dans l’ensemble canadien et nord-américain, mais majoritaire au Québec, et des limitations perçues des droits linguistiques des minorités « au nom de la préservation du français comme langue minoritaire » (p. 51). On y traite notamment des droits linguistiques comme droits politiques − et non comme libertés fondamentales – qui requièrent une interprétation et une application asymétrique afin de tenir compte « du contexte menaçant dans lequel la langue française évolue au Canada et même au Québec » (p. 52) ainsi qu’une « véritable prise en compte de la situation sociolinguistique et sociodémographique prévalant au pays » (ibid.). Le troisième chapitre traite principalement des politiques linguistiques entourant les langues autochtones et pose la question de savoir si le PL 96 ne représente pas une occasion manquée de préciser le rôle de l’État québécois en matière de protection et de promotion des langues autochtones. Convenant de l’urgence d’agir pour protéger et promouvoir les langues autochtones dans un contexte où plusieurs d’entre elles sont menacées de disparition, l’un de ses auteurs pose néanmoins la question de savoir si l’on ne se trompe pas de cible en s’attaquant à la réforme de la Charte de la langue française, dont la protection des langues autochtones n’est pourtant pas la finalité, sous prétexte qu’elle ne contribue pas à assurer leur protection et leur vitalité. Le quatrième chapitre, qui porte quant à lui sur le Québec et la francophonie canadienne, pose notamment la question de savoir si …
Linda Cardinal et al. (dir.), Une langue, des voix. Débats autour de la Loi 96 au Québec, Québec, Presses de l’Université Laval, 2023, 216 p., coll. « Diversité et démocratie »[Notice]
…plus d’informations
Jean-Pierre Corbeil
Professeur associé, département de sociologie, Université Laval