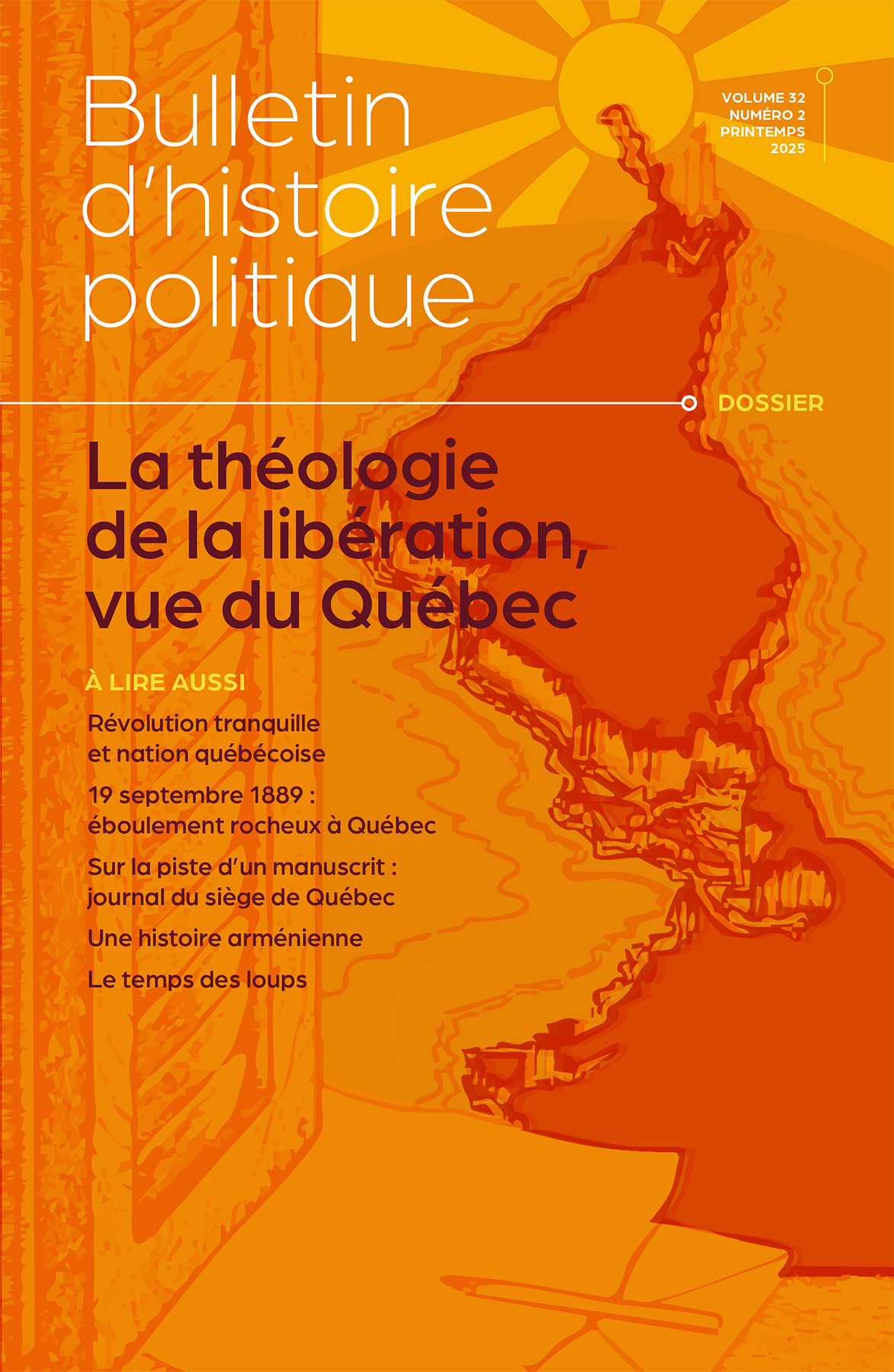Vivre pour un instant dans l’ébullition d’une société qui se remet sur ses pieds titubants entre les gravats d’un conflit majeur est l’enlevante odyssée à laquelle nous convie le journaliste et ancien directeur de la rubrique culturelle du Berliner Zeitung, Harald Jähner, avec son premier ouvrage Le temps des loups. L’Allemagne et les Allemands (1945-1955). Publié en langue allemande en 2019 et récemment traduit en français, l’excellent livre de Jähner nous transporte dans le contexte immédiat de l’après-guerre en Allemagne, posant comme trame narrative les conditions d’existence et les enjeux entourant la reconstruction d’une société à la suite d’intenses et profondes ruptures, destructions et dévastations. Car après que les armes se sont tues s’annonce l’obligation de refaire société, un retour à la vie collective qui sera vécu à la fois comme moments d’émerveillements, de liesses et de retrouvailles pour les uns, de désolation, de déchirements et de perditions pour les autres. Or, au-delà des conditions particulières s’amorce pour tous « le temps des loups », expression que le journaliste utilise pour qualifier cette lourde décennie 1945-1955. Ce qu’il décrit apparaît à nos yeux comme un « âge des ruines » — villes, bâtiments, communautés, familles, couples, individus, vies en ruine —, une époque où tous les chats sont gris, chacun tentant de tirer ce qu’il peut de ce qui lui tombe sous la main. En ce temps germinera une réconciliation « non-conflictuelle » à défaut d’être « harmonieuse », en raison, dit-il, de « l’attrait des modes de vie plus détendus, tels que les incarnaient les Alliés, […] la socialisation amère par le marché noir, les difficultés liées à l’intégration des expulsés, les querelles spectaculaires autour de l’art abstrait, le plaisir que procura le nouveau design » (p. 311). Liste à laquelle il ajoutera le « choc de l’effondrement », le conformisme de la société allemande, la prise de distance d’avec le passé favorisée par la promiscuité sexuelle entre les femmes allemandes et les membres des forces d’occupation. Paradoxale transition s’il en est une, Jähner nous la fera ressentir en terminant son récit avec une double conclusion marquant selon lui la conjoncture allemande jusqu’à sa critique acerbe par la génération des années 1960 : l’autovictimisation d’une majorité des Allemands et leur indifférence à l’égard des massacres causés en leur nom. Telle une fleur qui pousse entre les craques d’un pavé désuni, l’histoire de la reconstruction d’une société défaite est le récit des formes de vie qui émergent de ses ruines. C’est donc dans les décombres du « monde d’hier » que commence la palpitante aventure racontée par le journaliste allemand. En effet, Jähner entame son histoire en nous dressant un panorama des paysages décharnés que sont Berlin, Francfort-sur-le-Main, Mannheim, Cologne, Aix-la-Chapelle, Munich et autres métropoles d’Allemagne. Contrairement à l’image véhiculée dans les documentaires sur l’époque, l’auteur nous apprend que ces décors urbains aux allures apocalyptiques se révélèrent aux yeux des Allemands comme autant de sentiers d’excursion, de perspectives photographiques, d’oeuvres d’art vivantes, sujets de littératures, objets de gravures, sources d’inspiration pour les portraitistes et thèmes pour de populaires « films des ruines » (p. 38). C’est que l’horizon aplati laisse libre cours à ce que nous pouvons baptiser un « imaginaire de la reconstruction ». Parmi les amas de pierres, les tôles déchirées, les rues défoncées et les arbres desquamés, on arpente, on randonne, on s’arrête, on médite. Entre autres pour s’y prendre en photos, à l’exemple des « photos de mise en garde » publiées par les journaux et magazines (p. 39), à l’occasion d’un mariage ou encore pour les revues de mode (« les ruines lui …
Harald Jähner, Le temps des loups. L’Allemagne et les Allemands (1945-1955), Arles, Actes Sud, 2024, 355 p.
…plus d’informations
Benoît Coutu
Université du Québec à Montréal
L’accès à cet article est réservé aux abonnés. Seuls les 600 premiers mots du texte seront affichés.
Options d’accès :
via un accès institutionnel. Si vous êtes membre de l’une des 1200 bibliothèques abonnées ou partenaires d’Érudit (bibliothèques universitaires et collégiales, bibliothèques publiques, centres de recherche, etc.), vous pouvez vous connecter au portail de ressources numériques de votre bibliothèque. Si votre institution n’est pas abonnée, vous pouvez lui faire part de votre intérêt pour Érudit et cette revue en cliquant sur le bouton “Options d’accès”.
via un accès individuel. Certaines revues proposent un abonnement individuel numérique. Connectez-vous si vous possédez déjà un abonnement, ou cliquez sur le bouton “Options d’accès” pour obtenir plus d’informations sur l’abonnement individuel.
Dans le cadre de l’engagement d’Érudit en faveur du libre accès, seuls les derniers numéros de cette revue sont sous restriction. L’ensemble des numéros antérieurs est consultable librement sur la plateforme.
Options d’accès