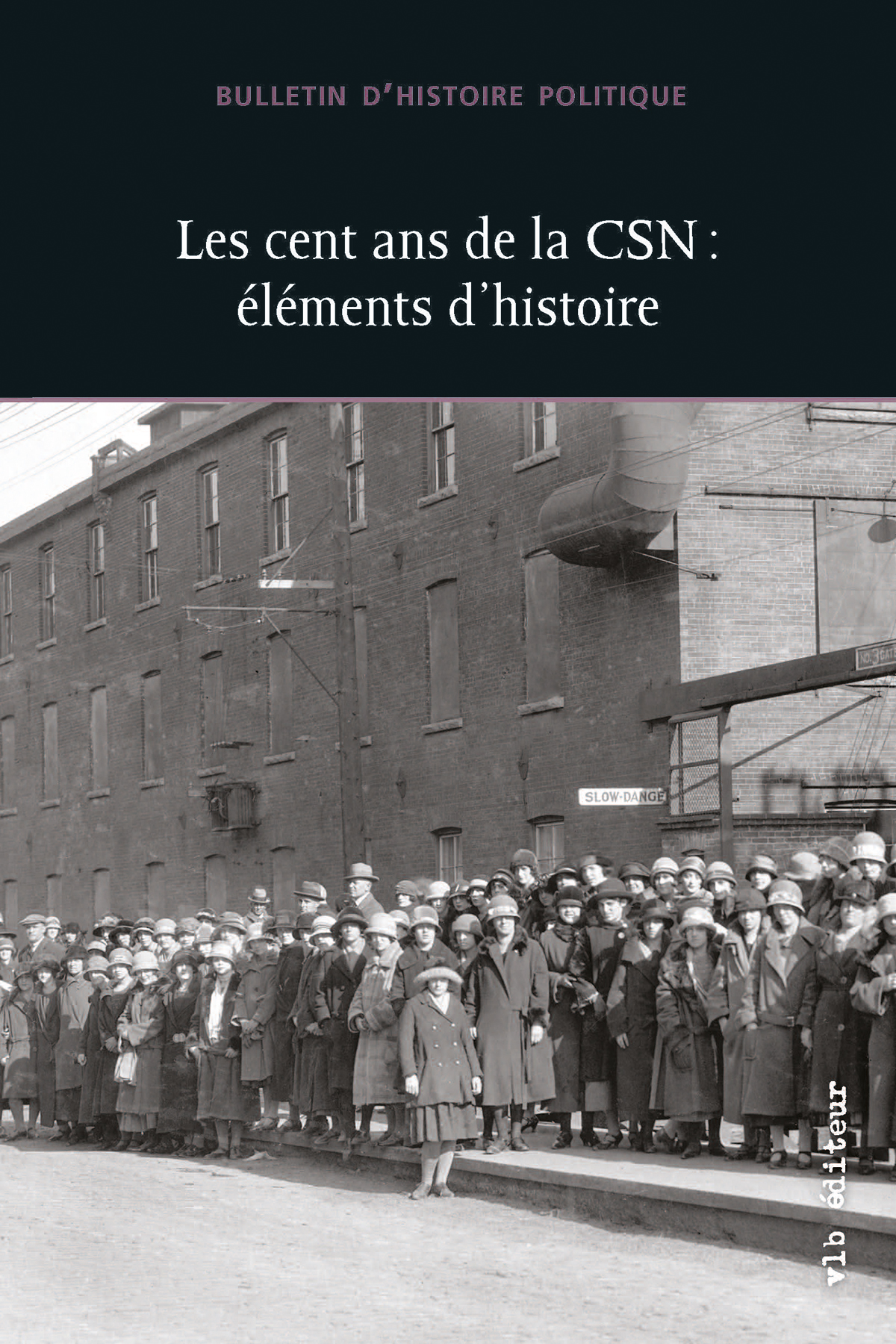On aurait pu appeler ce recueil « La pensée autonomiste de l’histoire récente au Québec » tellement c’est le courant réformiste qui intéresse les chercheurs ayant participé au colloque organisé par le doctorant Antoine Brousseau Desaulniers et l’historien uqamien Stéphane Savard. Tenu dans les jours qui suivent l’élection de la Coalition avenir Québec en octobre 2018, le colloque a lieu alors que la plupart des analystes parlent d’une rupture dans la culture politique québécoise mettant fin à cinq décennies d’alternance au pouvoir entre les Libéraux et le Parti québécois. Trois ans plus tard, on ne peut pas dire que le constat, fait à chaud lors de la soirée électorale, s’est révélé faux… Ce recueil souligne la richesse de la pensée qui avait jusqu’alors « suscité peu d’intérêt » d’acteurs qui ont adhéré, à l’écrit ou dans l’action, à « une forme ou une autre de fédéralisme » (p. 12-13). Les 19 chapitres, écrits par des politologues, historiens, juristes, philosophes et sociologues, consistent dans un premier temps en études de cas sur des mouvements intellectuels (L’École de Laval), ainsi que sur la pensée de femmes (dont Solange Chaput-Rolland), d’artistes (dont Richard Desjardins) et de politiciens (dont Benoît Pelletier), et dans un second temps, en textes thématiques sur la « doctrine Gérin-Lajoie », le « veto constitutionnel », le « statut particulier », la « troisième voie », l’« école de la diversité », le fédéralisme de l’habilitation, les conventions constitutionnelles et les garanties non écrites. Chacun à leur façon, les textes répondent à la question : « Et si le projet indépendantiste ne se réalise pas, quelles seraient les pistes de réforme pour aménager l’existence d’un État francophone au sein du fédéralisme canadien ? » Car, outre un texte sur le Parti égalité, « un parti trudeauiste à l’Assemblée nationale », les chapitres portent sur des formes d’aménagement politique qui se sont réalisées ou qui pourraient se réaliser. Que ce soit par l’étude des types de fédéralisme en Occident ou les interprétations divergentes de la Loi constitutionnelle de 1867, les réponses sont complexes et détaillées. Même les institutions fédérales, dont la Cour suprême du Canada, ont fini par agir comme « protectrice[s] du fédéralisme pluraliste pour le pays » (p. 498), argumente plus d’un auteur. L’ancien conseiller politique et philosophe André Burelle reçoit une place de choix en écrivant le premier chapitre et l’envoi, où il manifeste son profond souhait que le fédéralisme soit plus accommodant de la différence québécoise. S’il est fort probable qu’une prochaine renégociation constitutionnelle porte sur une réconciliation avec les peuples autochtones, le Québec et les francophones du Canada sauront-ils quoi proposer afin de s’arroger des mécanismes plus avantageux au développement de leur autonomie politique ? Aucun auteur ne se montre terriblement rassurant, car les acteurs comme Burelle ou Pelletier parlent de leurs échecs. On pointe quelques nouveautés de la décennie 2010, soit l’« École de la diversité » et la Politique d’affirmation du Québec et des relations canadiennes, qui cherchent à assurer « une conception foncièrement multinationale du fédéralisme », « la promotion d’une conception pluraliste et asymétrique du fédéralisme », ainsi que « l’aménagement de la diversité profonde » (p. 401-403). Si Brousseau Desaulniers et Savard déplorent l’absence d’ « une étude globalisante » de la pensée fédéraliste, le recueil n’a pas « la prétention d’offrir une compréhension unie et synthétique de ces thématiques » (p. 12). Les auteurs nous offrent effectivement une variété de contributions à différentes échelles, mais on peut compter au moins deux grands absents d’un ensemble de portraits sur « …
Antoine Brousseau Desaulniers et Stéphane Savard (dir.), La pensée fédéraliste contemporaine au Québec. Perspectives historiques, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2020, 537 p.[Notice]
…plus d’informations
Serge Dupuis
Historien, membre de la Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d’expression française en Amérique du Nord (CEFAN), Université Laval