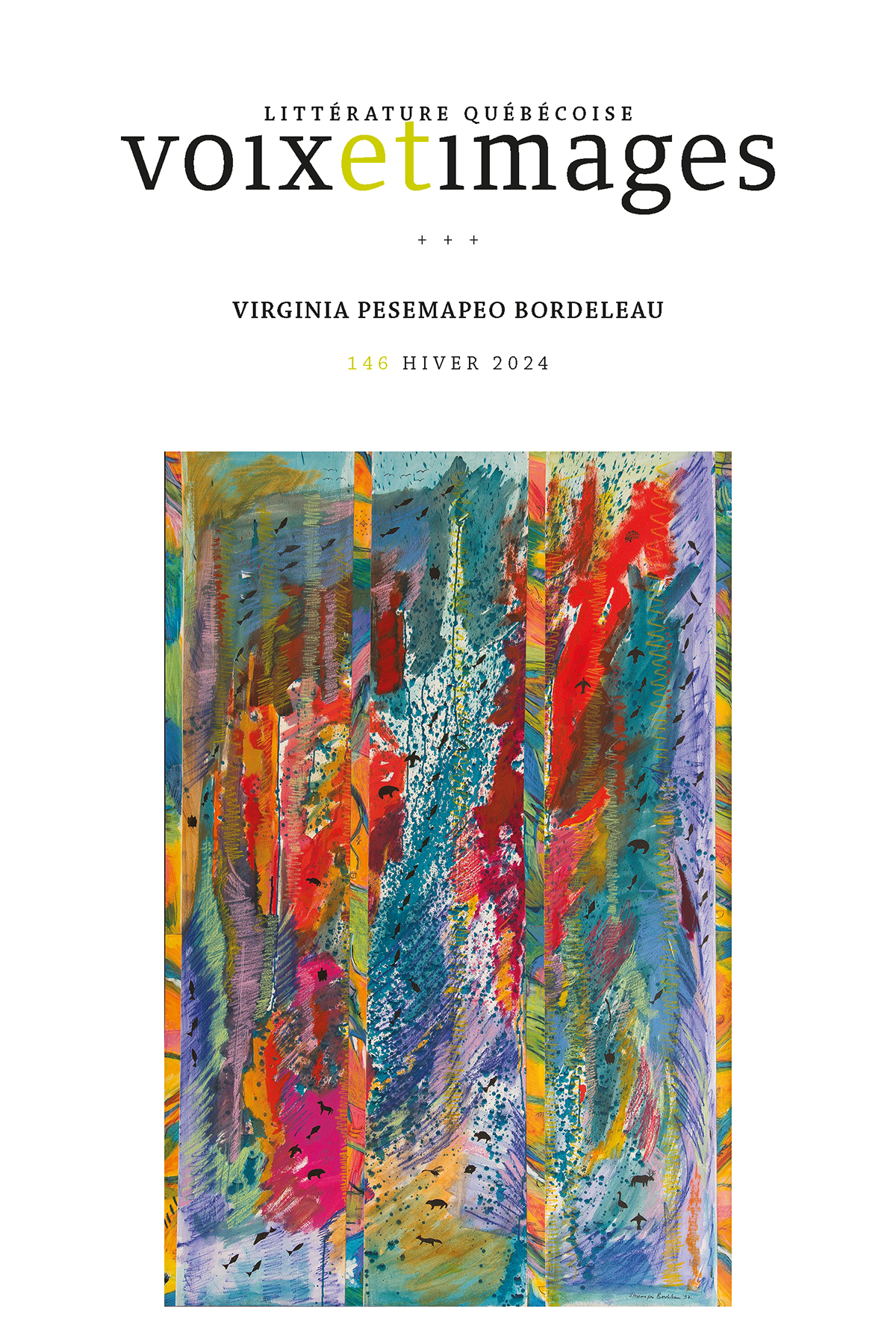Généralement, cette chronique porte une attention particulière aux études littéraires. Il s’agit à la fois du mandat premier de Voix et Images et de la formation de votre humble chroniqueur. Mes obsessions me mèneront toutefois un peu ailleurs. Certaines parutions récentes m’incitent à faire un pas de côté, à m’aventurer hors de mon champ de compétence principal, et à réfléchir à l’histoire des sciences, à l’histoire des universités, voire à un peu d’épistémologie. Cette parenthèse me semble opportune pour (au moins) trois raisons. La première est ce qu’on pourrait appeler « une crise dans les universités », qu’il convient d’historiciser pour percevoir avec plus de nuances ses causes et effets. La seconde est la quantité importante de travaux sur la découvrabilité des contenus savants en français, domaine de recherche à mon avis absolument central sur le plan politique, qui s’intéresse à la disponibilité et à la visibilité des résultats de recherche en français. Écrire un article savant en français est un geste politique à effet nul s’il n’est pas recensé. Finalement, il me semble utile de changer de matriochka – ou, plus près de nous, avec l’arbre est dans ses feuilles : les études littéraires sont dans les études québécoises sont dans l’université sont dans la société, marilon don dé. Commençons par saluer la parution de L’Université de Montréal. Une histoire urbaine et internationale par Micheline Cambron et Daniel Poitras. J’en ai fait un compte rendu pour la revue Mens et, si la curiosité vous tenaille, il est possible de le lire sur le web – ça, c’est pour la découvrabilité des contenus savants en français. Un mot d’abord pour souligner l’excellence de l’ouvrage : écriture limpide, présentation matérielle soignée. Mais ce qui frappe à la lecture de ce monumental pavé (ne pas lire dans le bain), ce sont les leçons méthodologiques que l’on peut en tirer. La multitude de savoirs requis pour écrire l’histoire de la vénérable université de la montagne est étourdissante : architecture, histoire urbaine, histoire religieuse, histoire des sciences et d’autres choses encore. Le livre se montre sensible à l’évolution du discours social, aux tensions entre groupes sociaux, aux évolutions technologiques – en bref, à tout ce qui fait bouger sans cesse l’université. Pour le dire candidement, je n’avais pas considéré l’ampleur de connaissances nécessaires pour étudier l’histoire d’une institution de savoir, j’aurais dû m’en douter. Et s’il faut tirer des leçons politiques de cette longue histoire de l’Université de Montréal, depuis son indépendance de l’Université Laval jusqu’à son internationalisation, c’est qu’il n’est pas d’âge d’or des universités où celles-ci seraient exemptes de toute pression exogène. Cambron et Poitras montrent différentes tensions et négociations entre l’université et son dehors qui entraînent, à chaque fois, une redéfinition de sa place dans l’espace social, tout comme les découpages disciplinaires, l’organisation des facultés, le financement de la recherche. Historiciser, disais-je. Deux parutions récentes viennent souligner le 100e anniversaire de l’Acfas (Association francophone pour le savoir, à l’origine Association canadienne-française pour l’avancement des sciences). Si cette organisation n’a pas la même centralité que l’Université de Montréal, la lecture des deux ouvrages anniversaires recèle d’indéniables vertus lorsque vient le temps, comme je l’ai dit en introduction, de tenter de saisir les mouvements des plaques tectoniques qui déstabilisent en ce moment les universités. Les éditions Cardinal ont donc fait paraître un beau livre sous la direction de Claude Corbo, historien, ancien recteur de l’UQAM, et de Sophie Montreuil, actuelle directrice générale de l’Acfas. Accompagné d’une postface de Catherine Mavrikakis, Faire connaissance. 100 ans de sciences en français est didactique et s’adresse au grand public. Il présente 50 portraits de …
Savoirs en français[Notice]
…plus d’informations
Julien Lefort-Favreau
Université Queen’s