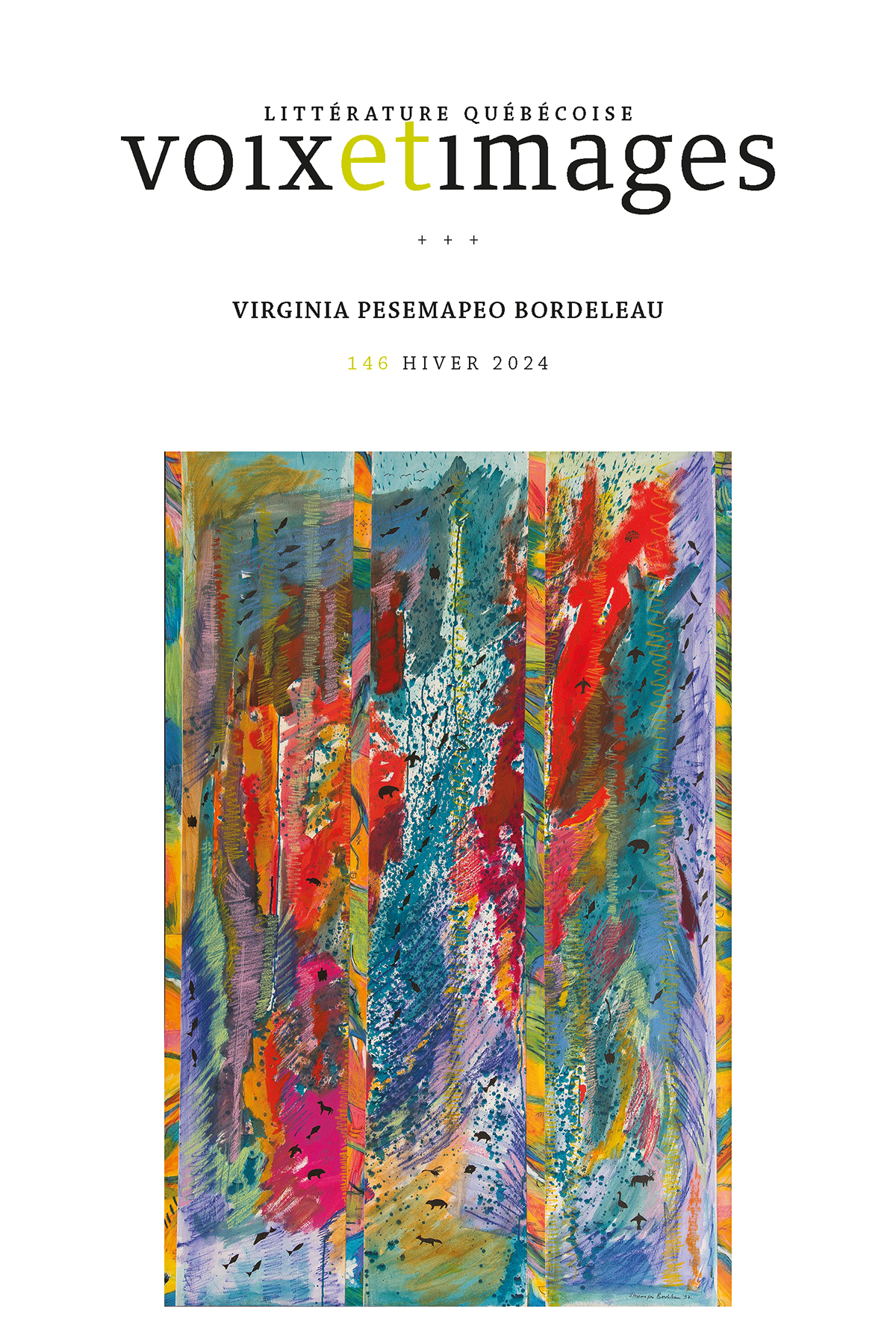Dans le récent ouvrage tiré des états généraux sur la recherche en littérature et en culture québécoise, intitulé Les études québécoises à venir, Lucie Robert relève le propre de la recherche contemporaine, confrontée à « l’hétérogène non synthétisé ». Les analyses des années 1960-1970 étaient toutes attachées à la constitution d’un corpus national, d’une historiographie érigeant dans le même geste un nombre important d’emblèmes qui, métonymiquement, signifiaient le groupe (homogène). Or, aujourd’hui, l’analyse est plutôt confrontée à l’atomisation : « [L]es oeuvres sont désormais prises une à une, et insérées dans des ensembles transversaux définis par des problématiques éclatées. » Ce constat pourrait sembler sentencieux et mener à diagnostiquer un cul-de-sac pour cet « à venir » des études québécoises, mais la chercheuse précise aussitôt : « Reproduire les modes anciens de la transmission, c’est vouer la culture québécoise à une sorte de marginalité postmoderne, non pas à la périphérie d’un centre fort, dont on souhaiterait explorer les marges, mais comme à un centre qui s’est dissous et qui n’intéresse personne. » Ce « centre » est effectivement en voie de péremption et en analyser la forme, avec les « modes d’argumentation narrative [d’]autrefois », consisterait à occuper une place d’arrière-garde tant l’homogénéité elle-même constitue le problème en études littéraires contemporaines – et j’ai le contemporain large, puisque ces constats se retrouvaient déjà dans L’écologie du réel (1988) de Pierre Nepveu. Les ouvrages dont je traiterai dans cette chronique parlent précisément de cette « marge » du groupe, avec des concepts assez parents rendant leur dialogue d’autant plus opératoire : les livres d’Isabelle Kirouac Massicotte et de Marie Pascal participent en effet, par leur analyse du trash, ou de l’exclusion et de l’abjection, à redire ce qui est à côté des centres – économiques, culturels, sociaux – et à penser l’écart engagé entre l’exclu et l’inclus. Ces démonstrations savantes s’arrimeront fort bien à la réflexion proposée dans un essai littéraire de Laurence Gagné, S’évincer, traitant précisément de la marge comme point de vue. Dans Trash.Une esthétique des marges dans les littératures francophones du Canada, Isabelle Kirouac Massicotte s’intéresse avant tout à cette prise en charge du « déchet », comme élément échappant à la norme dans la littérature franco-canadienne : des Premières Nations francophones aux Acadiens, en passant par quelques textes québécois, franco-ontariens et fransaskois, ses analyses abordent un vaste corpus, réuni par un « ensemble transversal » bien précis. Dès l’amorce, Kirouac Massicotte établit le lieu d’où elle parle, ébauchant un singulier récit d’errance universitaire : son projet sur le trash colle difficilement aux attentes, relève-t-elle, et s’il parvient à s’édifier de postdoctorat en postdoctorat, il révèle tout de même les impasses de l’institution savante. « [I]l s’agit effectivement de mon dernier livre à titre d’universitaire » (T, 8), mentionne Kirouac Massicotte au bout de son récit, comme si le projet du trash participait à marginaliser, à rendre trash, sa démarche intellectuelle. Or, qu’est-ce exactement que le trash ? « Mon hypothèse est que le trash est l’une des esthétiques possibles pour dépeindre les marges en littérature. » (T, 13) Cette esthétique est, comme le veut l’acception du terme dans la langue courante, associée à la « violence, [la] misère, [la] crudité, [l’]absence de raffinement et [la] pauvre qualité » (T, 13). L’ouvrage part donc de cette notion d’abord intuitive pour ensuite la définir au sein des « trash studies », avec les pensées de Zygmunt Bauman – qui reviendra également dans l’ouvrage de Marie Pascal –, Mary Douglas, Dominique Laporte, et du très fréquenté duo Agamben-Rancière, pour ne …
À la marge[Notice]
…plus d’informations
David Bélanger
Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec (CRILCQ)
Université du Québec à Trois-Rivières