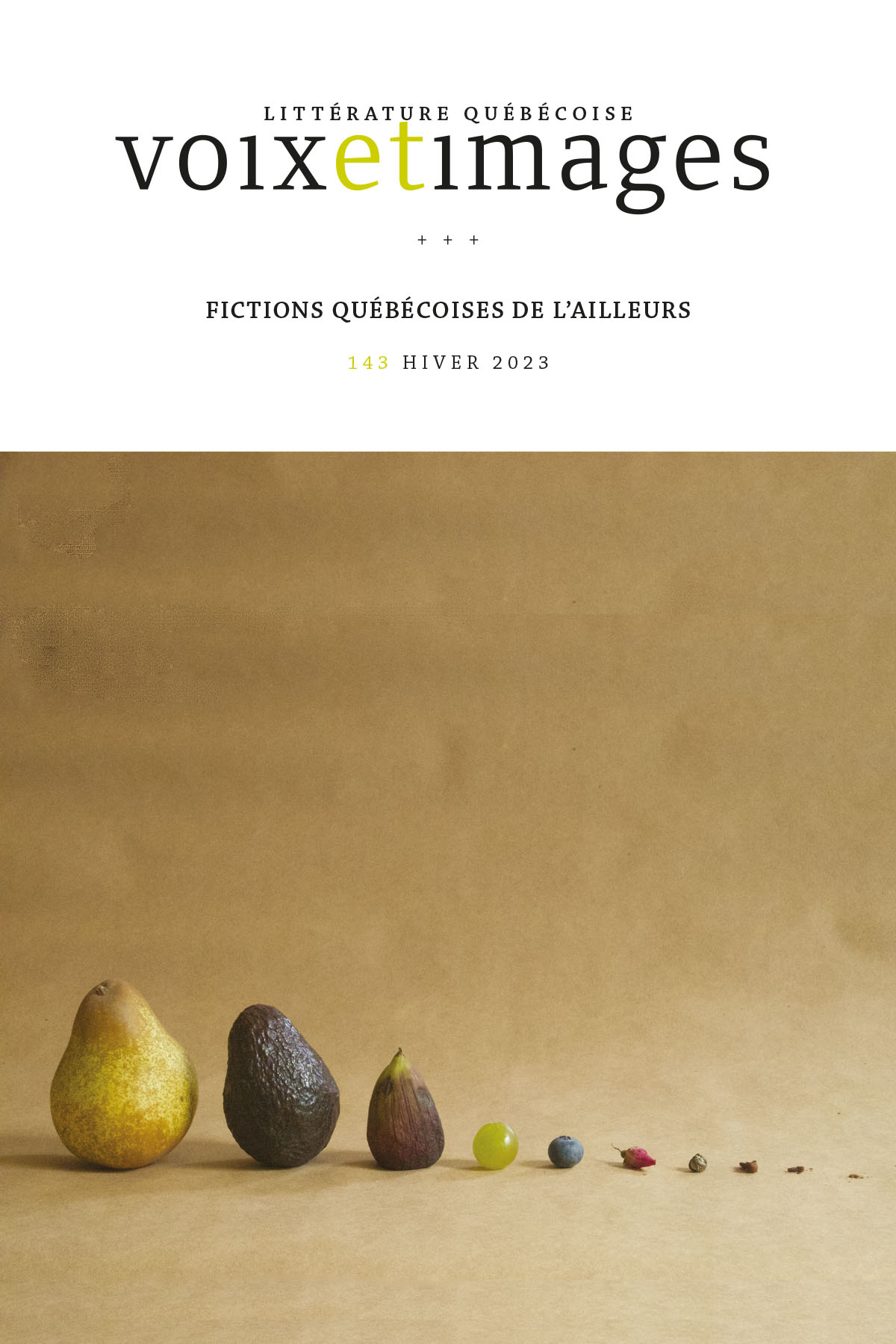Résumés
Résumé
Mavis Gallant est souvent étudiée comme une autrice expatriée dont l’écriture est centrée sur l’Ailleurs. Et pour cause, il n’y a qu’à jeter un bref regard aux titres de ses recueils de nouvelles – The Other Paris, In Transit, Paris Stories, Going Ashore – pour voir l’importance que le voyage prend dans son imaginaire. Cependant, l’écriture de Gallant porte également en elle un discours persistant et complexe sur le « chez-soi », lequel se présente parfois comme le Canada, parfois comme le Québec. Dans cet article, nous examinerons la relation entre le « chez-soi » et l’Ailleurs à la fois dans la fiction de Gallant, mais aussi dans les introductions, les préfaces et les entrevues dans lesquelles elle réfléchit à sa propre écriture. Dans ces dernières réflexions, Gallant a fréquemment recouru aux figures du voyage, lesquelles doivent être prises en considération dans toutes les analyses de son écriture. En travaillant à partir du recueil Home Truths, cet article aborde les nouvelles dans lesquelles les personnages, qui partent vers l’Europe, finissent par revenir au Canada. En même temps, il abordera aussi celles où on les voit revenir à Montréal après des années passées à New York. Si les histoires de Gallant sont rarement autobiographiques, elles offrent néanmoins des références indirectes à ses voyages personnels à travers une exploration continuelle de la délocalisation. Dans ce contexte, le « chez-soi » devient forcément une catégorie instable. Considérant que cette instabilité a déjà été étudiée en ce qui a trait à l’exil, notre article se concentrera plutôt sur les questions entourant la fiction et les figures du voyage présentes dans les oeuvres de Gallant.
Abstract
Mavis Gallant is often studied as an expatriate author whose work is centered on the Elsewhere, and for good reason. One glance at the titles of her short stories – The Other Paris, In Transit, Paris Stories, Going Ashore – reveals the important role that travelling plays in her imaginary. However, Gallant’s writing also carries within it a persistent and complex discourse concerning “home,” home presenting itself sometimes as Canada and sometimes as Québec. In this article, we examine the relationship between “home” and the Elsewhere, first in Gallant’s fiction itself, but also in the introductions, the prefaces and in interviews in which she reflects on her own writing. In these latter meditations, Gallant frequently employed travel figures which should be taken into consideration in all analyses of her work. Working with the Home Truths collection, this article focuses on the short stories in which characters who leave for Europe end up returning to Canada. At the same time, the article examines characters who are seen to return to Montreal after spending years in New York. If Gallant’s stories are rarely autobiographical, they offer, nonetheless, indirect references to her personal journeys through a continuous exploration of delocalization. In this context, “home” inevitably becomes an unstable category. Given that such instability has already been studied in relation to exile, our article focuses instead on questions surrounding fiction and travel figures found in Gallant’s work.
Resumen
A Mavis Gallant se la suele estudiar como una autora expatriada cuya escritura se centra en el Otro Lugar. Y con razón: basta con echar un breve vistazo a los títulos de sus colecciones de relatos cortos - The Other Paris, In Transit, Paris Stories, Going Ashore - para darse cuenta de la importancia que el viaje desempeña en su imaginario. Sin embargo, la escritura de Gallant también conlleva un discurso persistente y complejo sobre el «hogar», que a veces se presenta como Canadá, a veces como Quebec. En este artículo, examinaremos la relación entre el «hogar» y el Otro Lugar, tanto en la ficción de Gallant como en las introducciones, prefacios y entrevistas en las que reflexiona sobre su propia escritura. En estas últimas reflexiones, Gallant ha recurrido con frecuencia a las figuras del viaje, que deben tenerse en cuenta en todo análisis de su escritura. Partiendo de la colección Home Truths, este artículo examina los relatos en los que los personajes, que parten hacia Europa, acaban regresando a Canadá. Al mismo tiempo, también examinará aquellos en los que regresan a Montreal tras pasar años en Nueva York. Aunque los relatos de Gallant rara vez son autobiográficos, sí ofrecen referencias indirectas a sus viajes personales a través de una continua exploración del desplazamiento. En este contexto, «hogar» se convierte necesariamente en una categoría inestable. Dado que esta inestabilidad ya se ha explorado en relación con el exilio, nuestra ponencia se centrará más bien en las cuestiones que rodean la ficción y las figuras del viaje presentes en las obras de Gallant.
Corps de l’article
S’il est rare que les nouvelles de Mavis Gallant prennent la forme d’un récit complet de voyage, il n’en demeure pas moins que l’errance s’(en)ancre aux titres de ses recueils : The Other Paris, In Transit, Paris Stories et Going Ashore[2]. Ses nouvelles dépeignent des personnages tant à Paris que dans le sud de la France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Suisse, en Angleterre, en Europe de l’Est. Les raisons de leurs déplacements sont rarement touristiques : ils sont dépossédés et déplacés ; ils recherchent soit à trouver l’amour, soit à parfaire leur éducation. À destination, ils trouvent un endroit où vivre, une sorte d’arrangement temporaire, et leur séjour se trouve troublé, bien souvent écourté. Au sein de cet univers fictionnel, le motif du voyage permet à Gallant d’explorer, notamment, les modalités de la rencontre et l’expansion des paysages émotionnels qui accompagnent les déplacements et les délocalisations de ses personnages. Ce faisant, même si les voyages ne sont pas délimités par un début et une fin dans l’oeuvre de Gallant, l’analyse de leurs fragments et de leurs figures permet de (re)tracer la cartographie fictionnelle de son imaginaire de l’Ailleurs.
Née en 1922 de parents anglo-protestants dans le Montréal anglophone de la rue Sherbrooke, à la hauteur de l’Université McGill, Gallant apprend le français au contact de sa nounou avant d’être envoyée au Pensionnat Saint-Louis-de‑Gonzague. Elle n’a que dix ans lorsque son père meurt (elle n’en est d’ailleurs pas informée) et que sa mère se remarie. Dès lors, celle-ci l’amène avec elle à Toronto, puis à New York. Trimballée entre les membres de sa famille et de nombreux pensionnats, Gallant vivra dans l’instabilité jusqu’au début de sa vie adulte. En 1941, elle revient seule à Montréal pour y gagner sa vie. Elle désire alors écrire pour les journaux d’actualités. Or, ce n’est qu’en 1944 qu’elle sera finalement engagée comme journaliste par The Standard, après avoir travaillé pour le Canadien Pacifique et pour l’Office national du film. Parallèlement à son travail de journaliste, Gallant écrit plusieurs récits se déroulant à Montréal qu’elle réussit à faire publier localement. En 1950, elle décide de quitter la ville pour aller vers l’Europe, dans l’objectif de rejoindre un plus large lectorat anglophone. Dès lors, sa reconnaissance internationale lui vient principalement de l’écriture des nouvelles qu’elle publie sur une base régulière dans le New Yorker Magazine.
Gallant ayant vécu et écrit à Paris jusqu’à sa mort en 2014, ses écrits sont souvent associés à une littérature expatriée. Cette catégorisation a du sens dans la mesure où Gallant écrit à partir d’un ailleurs à propos de sujets européens, américains et canadiens[3], et qu’elle est, selon Mordecai Richler, « an astute, unsentimental observer of the expatriate life[4] ». De plus, l’écriture de Gallant porte un discours persistant et complexe sur le « chez-soi », qui est parfois présenté comme le Canada[5], parfois comme le Québec[6]. C’est d’ailleurs cette question qui nous amènera à examiner la relation entre l’idée du « chez-soi » et celle de l’Ailleurs, et ce, tant dans la fiction de Gallant que dans les introductions, les préfaces et les entrevues où elle réfléchit nommément à sa propre écriture. C’est que les dernières interventions, écrites et orales, de Gallant font fréquemment référence aux figures du voyage, figures qui, à notre sens, doivent être prises en considération dans l’analyse de ses fictions de voyage. Les nouvelles faisant l’objet de cet article proviennent du recueil Home Truths: Selected Canadian Stories et peuvent être divisées en deux catégories : celles où les personnages partant vers l’Europe finissent par revenir au Canada prématurément, et celles dans lesquelles se déroule un retour à Montréal à la suite d’années passées à New York. De plus, dans l’« Introduction » de Home Truths, Gallant traite de la relation entre le « chez-soi » et l’Ailleurs, entre la vie et les histoires, et entre la fiction et la non-fiction.
D’emblée, il faut admettre que de nombreux critiques littéraires ayant travaillé sur les oeuvres de Gallant ont réfléchi à la question de la tension douloureuse entre le « chez-soi » et l’Ailleurs à partir de la problématique de l’exil. Cependant, ces derniers ne se sont pas nécessairement intéressés à la question des fictions et des figures du voyage qui nous occupe ici. Cela dit, leur approche de l’exil n’en demeure pas moins importante. Pour Nicole Côté, par exemple, l’expérience de l’exil est ressentie tout autant par les lecteurs que par les personnages eux-mêmes, qui se trouvent dans la position ironique de l’Autre vivant en relation avec un monde qu’ils croient être le leur. En d’autres mots, « Gallant’s irony engages the reader in a paradoxical movement of exile that keeps the promise of reaching home by denying it[7] ». Danielle Schaub lit, quant à elle, la tonalité et le style des récits de Gallant à la lumière de l’éducation et des expériences de vie de l’autrice, dans lesquelles les cadres de référence rivalisent : « Forever an exile on home grounds, she perceives culture and language as double[8]. » Pour Pierre-Edmond Robert, qui a découvert les écrits de Gallant sur Paris alors qu’il était aux États-Unis, ces récits placent ce qui est familier à distance par l’utilisation d’une autre langue : l’anglais[9]. Ce que ce travail sur l’exil pointe dans notre lecture, c’est la production d’espaces – de décalages – qui structurent toute l’écriture de Gallant, et ce, que ses écrits dépeignent un déplacement ou non. En d’autres mots, l’écriture de Gallant est continuellement engagée dans la problématique du mouvement, du déplacement, parce que le personnage écrivant – ou le narrateur, dans le cas des fictions – est toujours, dans une certaine mesure, ailleurs.
Gallant elle-même semble avoir eu besoin d’établir une distance par rapport au « chez-soi », au familier, afin d’écrire. Si, en 1950, le départ de Montréal vers l’Europe est une question pratique, il est devenu pour elle un « voyage sans retour ». C’est d’ailleurs par la voix de son alter ego fictionnel – Linnet Muir – qu’elle explique cette impossibilité du retour en arrière (HT, 220-221). Cela dit, la relation à « l’écriture » du « chez-soi » est beaucoup plus complexe que le geste même de l’expatriation. Comme le raconte Gallant dans une entrevue avec Réjane Bougé, elle est souvent revenue au Canada, mais elle n’écrit pas quand elle y est. C’est seulement quand elle retourne à Paris qu’elle est capable d’écrire[10]. Or, même à Paris, il lui est nécessaire de prendre ses distances. Dans la même entrevue, Gallant explique qu’elle vit en français, écrit en anglais, ajoutant que, pendant plusieurs années, elle n’a pas ressenti le besoin que ses récits soient traduits[11] : « Je croyais que ça ne passerait pas dans une autre langue[12]. » C’est que Paris a permis à Gallant d’entretenir une relation bien particulière avec l’anglais. À Paris, elle pouvait être seule avec cette langue – langue qu’elle n’a d’ailleurs pas retrouvée dans les années quatre-vingt en séjournant à Toronto ou à Montréal – et, en même temps, cultiver « une vie sociale [qui] se pass[ait] entièrement en français[13] ». Chez Gallant, le processus d’écriture lui-même constitue une sorte de voyage qui permet une prise de distance tant de l’anglais de ses voyages au Canada que du français de sa quotidienneté parisienne. Pour ces raisons, elle craignait que la traduction altère la configuration de ses relations aux langues, et compromette, potentiellement, ce qu’elle appelait son « passeport d’écrivain[14] ».
L’AILLEURS DANS LA LITTÉRATURE ANGLO-QUÉBÉCOISE
Avant de nous pencher sur les fictions de voyage dans Home Truths, il importe de situer la question de l’Ailleurs dans la littérature anglo-québécoise, rarement abordée dans ce champ d’études plutôt préoccupé par des enjeux de territorialisation et par son propre ancrage dans le sol québécois[15]. Après tout, la littérature anglophone au Québec est toujours, dans une certaine mesure, écartée ou disloquée, toujours en mouvement entre les études canadiennes, les études québécoises, les travaux sur la traduction, la littérature comparée. Mais où sont transportés les lecteurs de cette littérature ? Dans quels lieux en dehors du Québec, en dehors du Canada ? À ce sujet, quelques exemples proéminents ressortent dans le domaine de la fiction. Le roman The Second Scroll d’A. M. Klein[16] fait référence à ses propres voyages en Israël, au Maroc et en Italie, en 1949, ainsi qu’à sa dévotion à l’endroit d’Ulysses de James Joyce tout au long de sa vie[17]. Richler, qui a quitté Montréal pour l’Europe la même année que Gallant, situe son premier roman, The Acrobats[18], en Espagne après la guerre civile et la Deuxième Guerre mondiale[19], un contexte auquel il revient dans Joshua Then and Now[20]. Enfin, My Paris[21] est la fictionnalisation du séjour de six mois de Gail Scott dans un studio parisien, un séjour rendu possible par le Conseil des arts du Québec. Chacune de ces fictions désidéalise le voyage : le retour à la terre promise est hanté par l’Holocauste et la diaspora chez Klein ; chez Richler, l’Espagne de Franco n’inspire plus la lutte des forces républicaines ; et chez Scott, Paris n’est plus la ville de lumière et de liberté qui avait tant séduit les générations précédentes d’écrivains, d’artistes et d’intellectuels.
L’Europe, en particulier la France, est un ailleurs qui revient fréquemment dans l’écriture anglo-québécoise[22]. Depuis les années 1980, plusieurs histoires se situent aux États-Unis[23] et dans d’autres régions du monde[24]. Cependant, à travers le vingtième siècle, l’Europe est une destination clé de cette littérature. Son importance est particulièrement mise en évidence dans Memoirs of Montparnasse[25], le récit fictionnel de la vie d’un expatrié à Paris dans les années 1920-1930 de John Glassco, de même que dans Getting Started : A Memoir of the 1950s de William Weintraub[26]. Écrit quatre décennies après ses années à Paris, Memoirs de Glassco est fictionnel dans le sens où il invente des conversations, réarrange des événements et change les noms des personnes encore en vie[27]. La description de ce récit comme étant « more a montage of those days than literal truth[28] » en fait un intertexte important du « fake Paris diary[29] » de Gail Scott. Getting Started de Weintraub est plus investi dans la documentation – c’est-à-dire la pratique de conserver les lettres reçues et les copies carbone des lettres envoyées[30] –, mais demeure un récit rétrospectif qui s’efforce de recréer l’esprit d’une époque. Et même s’il y a relativement peu de lettres envoyées et reçues par Gallant, celles de Getting Started la situent dans un réseau d’écrivaines et écrivains qui traversent l’Atlantique pour se déplacer à travers l’Europe.
Gallant et Richler, qui se sont rencontrés à Montréal[31], quittent – chacun de leur côté – la ville pour l’Europe en 1950. Une fois à Paris, Gallant écrit à Weintraub qu’elle est devenue particulièrement experte pour trouver « all the places one can eat under 300 francs (less than a dollar)[32] ». Lorsqu’il arrive à son tour, elle lui présente Richler. À ce sujet, Weintraub dit :
We were all writing, or pretending to write, but at the cocktail hour some of us would gather, for Pernods or fines à l’eau, with a growing tribe of expatriates. On prosperous days it would be the Deux Magots, on thin days it would be the Mabillon… It was the golden age of the Left Bank and in its watering holes we were on the alert to catch sight of Jean-Paul Sartre, Jacques Prévert, Albert Camus, Juliette Greco[33].
En revanche, cet enthousiasme et ce sentiment d’appartenance aux expatriés sont relativement absents des fictions de Gallant, où elle représente souvent les Nord-Américains anglophones comme étant naïfs et mal adaptés à la vie en Europe. De tels sentiments sont également absents de My Paris de Scott, où la narratrice décrit, de manière un peu auto-ironique, et du point de vue des années 1990, « [c]ertain expatriates still looking for the high times. Having heard in literature departments. Paris belonging to them[34] ». D’ailleurs, étant donné que Scott, tout comme Gallant, a travaillé comme journaliste avant de se consacrer à l’écriture[35], il serait à propos de lire My Paris aux côtés des oeuvres de Gallant telles que Paris Notebooks : Essays & Reviews[36] ou la nouvelle « The Other Paris[37] ».
À Paris, Gallant est allée à la recherche d’un endroit où vivre comme femme célibataire, un endroit où elle pouvait explorer une indépendance assumée sur laquelle elle met l’accent dans son introduction à Home Truths. Lorsqu’elle est questionnée sur son besoin d’une « personal autonomy [autonomie personnelle][38] » dans une entrevue donnée en 2007, elle évoque une interaction avec un supérieur au journal The Standard : au lieu d’accepter une affectation, elle a plutôt proposé d’interviewer Jean-Paul Sartre qui serait à Montréal la semaine suivante. Dans un premier temps, la réponse du supérieur est : « Who [qui] ? » À la suite de quoi, il l’avertit : « Listen, Mavis, I’m sick to death of these French-Canadian geniuses you’re always trying to cram down my throat[39]. » Richler raconte une autre anecdote marquante : « Once, I’m told, a naïve young Canadian reporter asked her “Why do you live in Paris?” To which Mavis replied, “Have you ever been to Paris?”[40] » À Paris, Gallant trouve un degré d’engagement, avec les artistes et penseurs, qui lui manquait dans le monde anglophone de Montréal des années 1940. D’ailleurs, contrairement aux autres auteurs anglo-québécois cités jusqu’ici – et contrairement à ses personnages expatriés –, elle n’est pas revenue en Amérique du Nord.
« LES CANADIENS À L’ÉTRANGER[41] »
Dans la section « Canadians Abroad » de Home Truths, les récits se construisent autour des rencontres que les personnages canadiens font avec les Européens, les expatriés britanniques et d’autres Canadiens provenant de régions et de milieux culturels divers. Les « Canadiens à l’étranger » de ces nouvelles narrées à la troisième personne deviennent dès lors un objet d’étude pour Gallant. Dans son introduction à Home Truths, elle admet :
I am puzzled by those Canadians one occasionally meets abroad who seem reluctant to say what they are. (This, most emphatically, does not apply to French Canadians.) Sometimes they try to pass for British, not too successfully, or for someone vaguely chic and transatlantic[42].
HT, xv
Ces observations, qui lui permettent de se situer dans l’Europe de l’après-guerre, sont aussi directement liées aux portraits d’expatriés que Gallant présente dans la section « Canadians Abroad ».
Trois des nouvelles de cette section – « The Ice Wagon Going Down the Street », « In the Tunnel » et « Virus X »[43] – mettent en scène des personnages qui voyagent en Europe, mais qui doivent écourter leur voyage et retourner au Canada. Dans l’univers fictionnel de Gallant, ce retour indique souvent un échec à se comprendre ou à saisir une occasion de vie, une possibilité qui n’est pas happée. Ainsi, dans « The Ice Wagon Going Down the Street », le personnage de Peter, qui se déplace d’un continent à un autre à la recherche d’un emploi convenant à son éducation aristocratique, aboutit finalement à Toronto, chez sa soeur. En un sens, dans ce contexte, le voyage se lit comme une tentative vaine d’obtenir la reconnaissance sociale et comme un étalage insignifiant de privilèges mondains. Cependant, il existe, dans la narration de cette nouvelle, une autre dimension du voyage, dont Peter ne parle pas : c’est celle de ses souvenirs. Ce qui compte dans ce texte n’est pas ce qui arrive à Toronto, dans le présent, mais plutôt ce dont Peter se souvient : à Genève, il avait travaillé avec une Canadienne, Agnes Brusen, qui l’aimait comme sa femme superficielle et frivole n’avait jamais pu le faire. Or, Peter n’a pas su reconnaître cet amour ; il ne peut, d’ailleurs, toujours pas « put a name to the look on her face[44] », surtout pas « after so many voyages, after Ceylon, and Hong Kong and Sheilah’s nearly leaving him, and all their difficulties—the money owed, the rows with hotel managers, the lost and found steamer trunk, the children throwing up the foreign food [45] » (HT, 131). Et même si le lecteur n’en sait que très peu à propos de ces nombreuses aventures, ce qui émerge alors, c’est l’écart entre ce qu’est Peter et ce que ces souvenirs suggèrent qu’il pourrait être. Cet écart existe également dans sa compréhension de qui est Agnes et de qui il est lui-même : lui est un presbytérien privilégié de l’Ontario, et elle une fille de la Saskatchewan qu’il se rappelle avoir trouvée de « poor quality, really[46] » (HT, 129). Parallèlement, la voix qui narre ses souvenirs laisse entendre qu’il aurait pu la considérer différemment. Or, le personnage ne semble pas être en mesure, lui, de faire cette autoréflexion qui lui permettrait de réaliser qu’elle aurait pu être beaucoup plus pour lui.
Si les histoires de la section « Canadians Abroad » ne mettent pas de l’avant le processus du voyage, au sens du périple, elles y réfèrent tout de même. Ainsi, la nouvelle « In the Tunnel » débute par une scène dans laquelle un veuf envoie sa fille, alors jeune femme, à Grenoble « to learn about French civilization—actually to get her away from a man he always pretended to think was called Professor Downcast[47] » (HT, 72-73). Ultimement, la jeune femme, Sarah Holmes, est reconduite à l’aéroport de Nice pour rentrer, selon toute vraisemblance, au Canada, là où se conclut la nouvelle. Comme l’indique Neil Besner, « In the Tunnel » développe « the familiar Gallant story of young North American women in Europe looking for love[48] ». En même temps, la nouvelle offre une critique de la petitesse d’esprit des exilés britanniques de la Côte d’Azur, notamment chez Roy – l’amoureux de Sarah, un Britannique, inspecteur de prisons en Asie à la retraite – et chez Sarah elle-même. Il y a, ici, une certaine ironie dans le fait qu’une Canadienne, envoyée en France pour des leçons sur la civilisation française, finisse par s’intéresser aux « [British] expatriates at first hand[49] » (HT, 85). Avoir une vision étroite, comme dans un tunnel, réfère dans ce cas à un éventail de pratiques coloniales dépassées, à l’échec de percevoir l’autre dans sa complexité et au fait d’être assujetti à des relations personnelles destructrices. Vers la fin de l’histoire, Sarah est suffisamment consciente de cet assujettissement pour quitter Roy, ce qui ne l’empêche cependant pas d’être à nouveau entraînée dans le « tunnel de l’amour ».
Pour Lottie Benz, personnage principal de « Virus X », qui voyage de Winnipeg vers la France grâce à une bourse de la Royal Society, le voyage est initialement compris comme une occasion de mener des recherches de terrain. À l’instar de Sarah Holmes qui, au début de « In the Tunnel », aide un professeur dans ses « Urban and Regional Studies of the Less Privileged in British Columbia[50] » (HT, 73), Lottie travaille à une thèse en sociologie qui porte sur « the integration of minority groups without loss of ethnic characteristics[51] » (HT, 178). Bien qu’aucune des deux femmes ne satisfasse aux attentes qu’on a de leurs travaux et qu’elles retournent toutes les deux au Canada, leur voyage donne néanmoins la chance aux narrateurs externes de conduire une recherche de terrain différente : ils accompagnent des Canadiennes dans leurs relations à l’étranger. Lorsque Lottie arrive à Paris, elle ne trouve ni la mode et le glamour qu’elle associe à la ville ni les traitements préférentiels auxquels elle s’attendait en tant que Canadienne. Tout au long de la nouvelle, elle passe une partie considérable de son temps avec Vera, une connaissance qui a été envoyée en Europe à l’âge de dix-sept ans parce qu’elle était enceinte. Quand Vera, dont la famille a changé son nom « to make it less specifically Ukrainian[52] » (HT, 176), défie Lottie en demandant si elle « even know[s] what a minority is[53] » (HT, 178), Lottie répond sur un ton plus ou moins affirmatif : « I ought to[54]. » (HT, 178) Cependant, Lottie n’explique pas à Vera que ses parents sont nés en Allemagne, ni qu’après 1939, la carrière de directeur d’école de son père a été bloquée à Winnipeg. En effet, vivre en Alsace rapproche Lottie de « the place she loathed and craved[55] » (HT, 195), un endroit qu’elle ne visite que très brièvement et avec réticence.
Comme pour les autres personnages de la section « Canadians Abroad », le séjour en Europe de Lottie laisse le lecteur devant plusieurs perspectives et de multiples analyses historiques, et ce, tant d’un point de vue personnel que du point de vue collectif. Grâce à ses conversations avec Vera à Strasbourg, Lottie arrive à remettre en question la théorie sociologique et l’universalité de ses propositions concernant les minorités ; elle prend alors connaissance de la répression policière des mouvements de réfugiés, que subit l’amant de Vera, Al Wiezinski, en Europe. Cependant, Lottie semble peu changée par son séjour à l’étranger : elle rompt finalement son amitié avec Vera et retourne chez elle avec son copain Kevin parce qu’il est précisément un « conservative Canadian type[56] » (HT, 212) qui « could not read anything but English[57] » (HT, 212). Comme Peter dans « The Ice Wagon Going Down the Street », Lottie partage peu sa réalité avec les autres ; les lettres qu’elle compose ne sont d’ailleurs jamais envoyées à Kevin. À la fin du récit, le lecteur est le seul à avoir accès aux possibilités de transformations personnelles que Lottie décrit dans ses lettres – tout comme le lecteur est le seul à avoir accès aux possibilités qui résident dans les souvenirs de Peter.
« JOURNEYING HOME FROM EXILE INTO IDENTITY[58] »
Même si le voyage vers l’Europe joue un rôle important dans Home Truths, le point culminant du recueil est le retour de New York vers Montréal. Et si Montréal est moins présente dans la section « Canadians Abroad » – seule la nouvelle « Bonaventure » y situe le point d’attache de son personnage principal –, elle est le décor principal des histoires de la suite de nouvelles intitulée « Linnet Muir[59] ». En effet, dans son introduction à Home Truths, Gallant laisse entendre que le personnage de Linnet Muir est, dans une certaine mesure, un reflet d’elle-même (HT, xxii). Lire le recueil sans tenir compte de l’introduction de Gallant serait donc malvenu étant donné les continuités radicales entre la fiction et le vécu – ce que Gallant qualifie, en s’inspirant de Cocteau, de « mensonge qui dit la vérité[60] » (HT, xxii). La fiction et l’histoire personnelle réfèrent obliquement l’une à l’autre et recréent des moments de départ et de retour, sans toutefois prendre la forme d’un aller-retour cohérent. Dans son introduction, Gallant raconte, par exemple, son expérience en tant qu’enfant unique anglophone dans plusieurs couvents à Montréal, ses déménagements en Ontario et à New York après la mort de son père, puis son retour à Montréal.
Déjà déracinée de son milieu protestant-anglophone à un jeune âge, Gallant s’est ensuite déracinée elle-même en quittant New York pour retourner à Montréal. Ce déplacement entre les États-Unis et le Canada est directionnellement opposé au scénario habituel que l’on retrouve en littérature québécoise : il s’agit plus d’un voyage de retour[61] que d’un voyage vers l’extérieur, pour reprendre les termes de Besner. « In Youth Is Pleasure[62] », la première nouvelle de cette série mettant en scène le retour d’exil de la protagoniste et narratrice Linnet Muir, donne un aperçu de son séjour à New York et de la relation ambivalente qu’elle entretient avec les États-Unis. Lorsqu’elle y étudie, elle refuse de saluer le drapeau (HT, 220). Or, les États-Unis sont aussi le premier endroit où elle entend un public rire ouvertement en visionnant un film (HT, 227). D’ailleurs, si Linnet quitte New York dès ses 18 ans, elle chérit quand même cette expression ouverte des émotions qui lui manque manifestement dans le Montréal anglophone. Ce rire lui donne la confiance – tant comme personnage que comme narratrice – d’entreprendre ce qu’elle décrit comme étant « my journey into a new life and a dream past[63] » (HT, 228). Ainsi, à travers une exploration de sa relation à divers endroits, les histoires de Linnet Muir ne s’intéressent pas aux nationalismes américain, canadien ou québécois. « I did not feel a scrap British or English », déclare Linnet, « but I was not an American either[64] » (HT, 220). Elles suggèrent plutôt qu’il est possible de se concevoir comme Canadienne ou Québécoise sans être pour autant nationaliste.
Les mouvements de la protagoniste et narratrice de la nouvelle « In Youth Is Pleasure » ont pour effet de toujours présenter plus d’une perspective d’un même lieu. La délocalisation – encore plus que le voyage – permet aux récits d’interroger les cadres d’opposition et d’insécurité à travers lesquels le Canada se définit au milieu du vingtième siècle. Les États-Unis sont ainsi un lieu d’ignorance face au Canada (HT, 220), où Linnet trouve une forme de « deliverance [délivrance] » des villes de l’Ontario (HT, 223 ; VP, 246). Quoique désagréable à ses yeux, l’Ontario s’avère être une province où le Montréal de son enfance prend forme et est commémoré (HT, 223 ; VP, 246-247). Traverser la frontière des États-Unis pour se rendre au Canada rend cette prise de conscience possible : « I was entering a poorer and a curiously empty country, where the faces of the people gave nothing away[65]. » (HT, 222) Lorsqu’elle entreprend le voyage vers Montréal, Linnet est entièrement seule avec la responsabilité de sa propre survie économique. Elle décrit en détail son « travel costume[66] » – le seul qu’elle possède –, son bagage minimal, son panier à pique-nique rempli d’histoires, le fait qu’elle n’a pas de passeport, son arrivée à la gare Windsor où elle est agressée par un vagabond et son trajet en taxi jusqu’à un appartement froid de l’est de Montréal où son ancienne gouvernante, Olivia Carette, lui donne un lit. La détermination de Linnet à retourner à Montréal malgré ses moyens très limités nous redirige vers l’épigraphe de l’introduction de Gallant : « Only personal independence matters[67]. » (HT, xi)
La ville de Montréal n’est cependant pas présentée comme un point d’arrivée idéal, même s’il s’agit de l’endroit où Linnet est née et où elle a vécu ses dix premières années. Elle n’y retrouve que très peu de signes de son passé et doit se résoudre à se réconcilier avec l’idée d’un nouveau départ. Sans aucune formation professionnelle, Linnet considère le français comme étant son « only commercial asset [unique atout commercial] » (HT, 243 ; VP, 267) dans sa recherche d’emploi. Du même souffle, elle remarque, amèrement, que « French was of no professional use to anyone in Canada then[68] » (HT, 243). Elle est aussi à l’aise en français qu’en anglais, mais elle se trouve dans une ville composée de deux populations qui « knew nothing whatever about each other[69] » (HT, 245). Même les Montréalais, fiers de vivre à l’extérieur des « social enclosures [enclos sociaux] » (HT, 306 ; VP, 335) dans la nouvelle « The Doctor[70] », démontrent une attitude hautaine face au français que Linnet a appris dans son enfance à Montréal. Ce faisant, les histoires de Linnet mettent en relief plusieurs aspects du Montréal des années 1940, notamment la pauvreté des femmes comme Olivia, la « blind sureness [certitude aveugle] » des hommes dans les bureaux où elle travaille (HT, 247 ; VP, 271) et les signes inéluctables du privilège colonial anglais. Comparant Montréal à New York, Linnet se désole : « There was no theatre, no music; there was one museum of art with not much in it. There was not even a free public lending library[71]. » (HT, 249) En d’autres termes, ces histoires éclairent les raisons qui pourraient pousser une écrivaine à vouloir quitter Montréal, mais, étonnamment, ce départ n’a jamais lieu dans les récits recueillis au sein de Home Truths.
Agissant notamment comme un prétexte nécessaire à la publication du recueil complet, les voyages de Gallant – de Montréal vers Paris – demeurent la suite cachée de la série de nouvelles qui mettent en scène Linette Muir ; après tout, les nouvelles de Home Truths sont à l’image du choix de l’autrice d’aller vivre en Europe et de se consacrer à l’écriture. Toutefois, ce choix de quitter le Canada pour écrire n’est pas le bienvenu en études canadiennes, car, pour le dire avec les mots de Gallant, « the word “expatriate” is regularly spelled in Canadian newspapers as “expatriot”[72] » (HT, xii). En même temps, notons que le sujet de l’exil est pour le moins sensible dans le contexte du Québec. Quand Bougé lui demande ce qui l’a poussée à quitter la province en 1950, Gallant précise : « Je n’ai pas quitté le Québec, j’ai quitté l’Amérique du Nord – c’est autre chose[73]. » Affirmant cela, Gallant évite les cadres de référence nationaux de manière à se concentrer sur son écriture. Malgré cette réponse, Bougé insiste, lui suggérant : « Il fallait toujours aller ailleurs, c’est ça[74] ? » Gallant lui répond sans détour : « Non[75]. » Elle recentre alors la conversation autour du fait que c’est son départ qui lui a permis d’écrire. La question de Bougé, davantage qu’une explication aux éloignements physiques de Gallant, pointe plutôt vers une manière de lire les tensions entre l’ici et l’Ailleurs produites au sein de son écriture même.
FIGURES DU VOYAGE
Si, pour Gallant, quitter Montréal est une question d’écriture, il semble alors aller de soi que les figures du voyage s’inscrivent dans son discours dès qu’elle est amenée à parler de sa propre écriture. Pensons notamment à ce qu’elle appelle son « passeport d’écrivain[76] ». La préface de Gallant à The Selected Stories s’ouvre sur la comparaison entre l’écriture et l’acte de ramer évoquée par le personnage de Georges Bernanos : « rowing a boat out to sea: the shoreline disappears, it is too late to turn back, and the rower becomes a galley slave[77] ». C’est en référant à cette métaphore que l’autrice explique sa démission du journal montréalais The Standard, en 1950, pour se concentrer sur l’écriture de fiction : « I still do not know what impels anyone sound of mind to leave dry land and spend a lifetime describing people who do not exist[78]. » En illustrant son départ par l’image d’un rivage qui disparaît, Gallant recourt à l’idée du voyage pour parler de sa propre écriture et de son besoin d’avoir laissé derrière un point de référence habituel. Quant aux personnages de la section « Canadians Abroad » de Home Truths, ils ne laissent pas ce rivage disparaître ; ils demeurent attachés tant aux attentes qu’ils ont à l’égard de leur destination qu’à la perception qu’ils entretiennent de leur lieu de départ. S’ils finissent par écourter leur voyage, c’est parce qu’ils ne sont jamais vraiment partis. Les histoires de Linnet Muir traduisent explicitement la manière dont certains Montréalais privilégiés s’approprient le voyage comme s’il s’agissait d’une expérience prestigieuse, d’un avantage. Dans « The Doctor », Linnet explique que le « geographical elsewhere [ailleurs géographique] » (HT, 306 ; VP, 335) du cercle social de ses parents se limite à « a few cities of Europe with agreeable-sounding names like Vienna and Venice[79] » (HT, 306). Ces quelques villes, que la narratrice associe à un chapelet de cloches de traîneau, sont familières et prévisibles. Elles n’ont rien de l’inattendu, de l’inconcevable, du précaire ou du compromettant que Gallant associe à l’écriture et au voyage vers l’Ailleurs.
D’un autre côté, l’objet qu’est le livre occupe une place importante dans l’oeuvre de Gallant. Dans son introduction à Home Truths, elle mentionne le livre illustré The Joyous Travellers, qu’elle a emporté avec elle au premier pensionnat de son enfance. Il s’agit d’une de ses premières expériences de l’ailleurs. Aussi, le titre de ce livre souligne l’ironie douloureuse d’un voyage qui, loin d’être joyeux, lui était imposé ; elle n’avait pas le choix d’y participer. Le souvenir qui lui en reste n’est d’ailleurs pas tant lié au récit qui y est raconté, mais au fait que la religieuse qui enseignait l’anglais l’a brandi et a expliqué aux autres enfants que le titre signifiait « les joyeux travailleurs ». Avec du recul, Gallant résume l’expérience de la manière suivante : « What interests me about it now is that a deadlock could develop between a grown woman and a child over a word and its meaning. I knew the meaning; she was led astray by the sound[80]. » (HT, xvi) Quel commentaire extraordinaire sur les écarts qui se creusent au sein de la poétique, sur la façon dont les langues « voyagent » ou non, ainsi que sur l’importance du voyage chez Gallant à un très jeune âge ! Ces liens entre le voyage et les livres refont surface dans la nouvelle « In Youth Is Pleasure » du recueil Home Truths, où la métaphore du voyage renvoie à l’impossibilité du retour plutôt qu’à un départ. En effet, Linnet laisse derrière elle, à New York, des oeuvres littéraires qu’elle a retranscrites dans sa mémoire et dont elle dit qu’elles contiennent « the New York I knew I would never have again, for there could be no journeying backward[81] » (HT, 221). Pour Gallant, quitter Montréal pour aller en Europe s’est aussi avéré permanent : nul voyage de retour au programme, sauf – et c’est un « sauf » important – dans la fiction. La fiction – le fait de se souvenir en écrivant – devient pour elle la seule forme possible de retour en arrière.
Parties annexes
Note biographique
Professeure d’études anglaises à l’Université de Montréal depuis 1993, et membre du CRILCQ depuis 2004, LIANNE MOYES se spécialise en lettres canadiennes et (anglo-)québécoises, de même qu’en écriture des femmes. Elle s’intéresse aux frontières poreuses et contestées entre les littératures qui émergent à Montréal ainsi qu’aux paradigmes critiques qui ont été utilisés pour en rendre compte sur le plan textuel et institutionnel. Coéditrice à la revue bilingue féministe Tessera de 1993 à 2003, elle étudie également les relations intertextuelles entre des écrivaines expérimentales du vingtième siècle afin de discerner les modèles non linéaires, discontinus, voire anachroniques de l’histoire littéraire.
Notes
-
[1]
Cet article a été traduit de l’anglais par William Brubacher et Emilie S. Caravecchia.
-
[2]
Voir aussi Vers le rivage : nouvelles, traduit de l’anglais par Nicole Côté, Québec, L’instant même, 2002, 294 p.
-
[3]
Comme l’indique Jane Koustas, les histoires de Gallant sont souvent difficiles à situer et il n’est pas toujours possible d’identifier la ville d’attache des personnages qui voyagent. Voir Jane Koustas, Les belles étrangères. Canadians in Paris, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, coll. « Perspectives on Translation », 2008, p. 48.
-
[4]
Mordecai Richler, « Afterword », Mavis Gallant, The Moslem Wife and Other Stories, Toronto, McClelland & Stewart, 1994, p. 251. Je traduis : « elle est une observatrice avisée et dépourvue de sensiblerie par rapport à la vie d’expatrié ».
-
[5]
En 1981, dans son introduction à Home Truths, Gallant explique qu’elle n’a pas de difficulté à s’identifier comme Canadienne – et ce, malgré le fait d’avoir vécu à Paris de nombreuses années et d’être considérée comme « a Frenchwoman and addressed in French [une femme française que l’on aborde en français] ». Mavis Gallant, Home Truths: Selected Canadian Stories, Toronto, Stoddart, 1992 [1981], p. xiii. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle HT suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[6]
En 1996, dans la préface de The Selected Stories of Mavis Gallant, Gallant affirme que « there is no such thing as a Canadian childhood. One’s beginnings are regional. Mine are wholly Quebec, English and Protestant, yes, but with a strong current of French and Catholic ». Mavis Gallant, The Selected Stories of Mavis Gallant, Toronto, McClelland & Stewart, 1996, p. xv. Je traduis : « il n’existe pas une telle chose qu’une enfance canadienne. Certains la vivent régionalement. Quant à la mienne, elle fut entièrement québécoise, anglaise, protestante, oui, mais aussi fortement influencée par le français et le catholicisme ».
-
[7]
Nicole Côté, « Introduction », Nicole Côté et Peter Sabor (dir.), Varieties of Exile : New Essays on Mavis Gallant, New York, Peter Lang, 2002, p. 3. Je traduis : « l’ironie de Gallant engage le lecteur dans un mouvement paradoxal où l’exil conserve sa promesse de retour à la maison en la refusant ».
-
[8]
Danielle Schaub, « Gallant’s Irony and its Double Edge », Nicole Côté et Peter Sabor (dir.), Varieties of Exile : New Essays on Mavis Gallant, p. 14. Je traduis : « éternellement en exil chez elle, elle perçoit la culture et la langue comme des doubles ».
-
[9]
Pierre-Edmond Robert, « Table ronde sur la traduction des oeuvres de Mavis Gallant », Nicole Côté et Peter Sabor (dir.), Varieties of Exile: New Essays on Mavis Gallant, p. 77.
-
[10]
Réjane Bougé, « Mavis Gallant », André Major (dir.), L’écriture en question. Onze portraits d’écrivains [entretiens radiophoniques], Montréal, Leméac, coll. « L’écritoire », 1997, p. 45.
-
[11]
À ce sujet, voir Jane Koustas, Les belles étrangères. Canadians in Paris, p. 45.
-
[12]
Réjane Bougé, « Mavis Gallant », p. 43.
-
[13]
Ibid., p. 44.
-
[14]
Ibid.
-
[15]
Voir, par exemple, les dossiers suivants, que j’ai dirigés : « Écrire en anglais au Québec : un devenir minoritaire ? », Québec Studies, vol. XXVI, automne 1998-hiver 1999, p. 3-37 ; « Textes, territoires, traduction : (dé)localisations/dislocations de la littérature anglo-québécoise » (codirigé avec Gillian-Lane Mercier), Québec Studies, vol. XLIV, automne 2007-hiver 2008, p. 1-101 ; « La littérature anglo-québécoise », Revue d’études canadiennes, vol. XLVI, no 3, automne 2012, p. 3-286.
-
[16]
A. M. Klein, The Second Scroll, Toronto, McClelland & Stewart, 1982 [1951], 142 p.
-
[17]
Voir Zailig Pollock, A.M. Klein: The Story of the Poet, Toronto, University of Toronto Press, 1994, p. 233-252.
-
[18]
Mordecai Richler, The Acrobats, Toronto, McClelland & Stewart, 2002 [1954], 223 p.
-
[19]
Voir Patrick Coleman, « Writing beyond Redemption: Hubert Aquin and Mordecai Richler in Postwar Paris », Paula Ruth Gilbert et Miléna Santoro (dir.), Transatlantic Passages : Literary and Cultural Relations between Quebec and Francophone Europe, Montréal/Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2010, p. 67-79.
-
[20]
Mordecai Richler, Joshua Then and Now, Toronto, McClelland & Stewart, 1980, 435 p.
-
[21]
Gail Scott, My Paris: A Novel, Toronto, Mercury, 1999, 165 p.
-
[22]
Voir, entre autres : Ann Charney, Dobryd, Toronto, New Press, 1973, 170 p. ; David Homel, The Speaking Cure, Vancouver, Douglas & McIntyre, 2003, 329 p.; et Linda Leith, Birds of Passage, Montréal, NuAge, 1993, 236 p.
-
[23]
En guise d’exemples, citons Heather O’Neill, The Lonely Hearts Hotel, New York, Riverhead, 2018, 389 p., et Zoe Whittall, The Best Kind of People, Toronto, Cormorant, 2007, 189 p.
-
[24]
Par exemple : Charles Foran, Butterfly Lovers, Toronto, HarperCollins, 1996, 308 p., et Rawi Hage, Di Niro’s Game, Toronto, Anansi, 2012, 277 p.
-
[25]
John Glassco, Memoirs of Montparnasse, 2e édition, avec l’introduction originale de Leon Edel et une introduction critique et des notes de Michael Gnarowski, Toronto/Oxford, Oxford University Press, 1995 [1970], 259 p.
-
[26]
William Weintraub, Getting Started: A Memoir of the 1950s, Toronto, McClelland & Stewart, 2001, 286 p.
-
[27]
Michael Gnarowski, « Fiction for the Sake of Art: An Introduction to the Making of Memoirs of Montparnasse », John Glassco, Memoirs of Montparnasse, p. xvi-xxi.
-
[28]
John Glassco, cité dans ibid., p. xx. Je traduis : « plutôt un montage de cette époque qu’une version littérale des faits ».
-
[29]
Gail Scott, « My Montreal: Notes of an Anglo-Quebecois Writer », Brick, no 59, printemps 1998, p. 8. Je traduis : « faux journal intime parisien ».
-
[30]
William Weintraub, Getting Started, p. 13.
-
[31]
Mordecai Richler, « Afterword », p. 248.
-
[32]
William Weintraub, Getting Started, p. 12. Je traduis : « tous les endroits où on peut manger pour moins de 300 francs (moins d’un dollar) ».
-
[33]
Ibid., p. 13. Je traduis : « Nous écrivions tous, ou prétendions écrire, mais à l’heure de l’apéro nous nous réunissions, pour des Pernods ou des fines à l’eau, avec un groupe grandissant d’expatriés. Les jours de prospérité, c’était les Deux Magots, les jours de vaches maigres, le Mabillon… C’était l’âge d’or de la rive gauche et dans ces buvettes nous étions à l’affût pour apercevoir Jean-Paul Sartre, Jacques Prévert, Albert Camus, Juliette Greco. »
-
[34]
Gail Scott, My Paris, p. 81. « Certains expatriés sont toujours à la recherche de moments forts. Ils l’entendent dire dans les départements de Lettres. Paris leur appartient. » Gail Scott, My Paris: roman, traduit de l’anglais par Julie Mazzieri, Montréal, Héliotrope, 2010, p. 118.
-
[35]
À ce sujet, voir Charlotte Biron, Mavis Gallant et Gabrielle Roy, journalistes, Québec, Codicille éditeur, coll. « Prégnance », 2016, 124 p.
-
[36]
Mavis Gallant, Paris Notebooks: Essays & Reviews, Toronto, Macmillan, 1986, 249 p.
-
[37]
Dans Mavis Gallant, The Other Paris, Toronto, Macmillan, 1986 [1956], p. 1-30.
-
[38]
Stéphan Bureau, « An Interview with Mavis Gallant », traduit du français par Wyley Powell, Brick, no 80, hiver 2007, en ligne : https://brickmag.com/an-interview-with-mavis-gallant/ (page consultée le 7 juillet 2023).
-
[39]
Ibid. Je traduis : « Écoute, Mavis, je suis écoeuré à mort de ces génies canadiens-français que tu essaies toujours de pousser au fond de ma gorge. »
-
[40]
Mordecai Richler, « Afterword », p. 249. Je traduis : « Je me suis fait dire qu’une fois, un jeune reporter canadien lui a demandé “Pourquoi vivez-vous à Paris ?”, ce à quoi Mavis a répondu : “Avez-vous déjà été à Paris ?” ».
-
[41]
Titre d’une section de la traduction du recueil Home Truths : Mavis Gallant, Voix perdues dans la neige : nouvelles, traduites de l’anglais par Éric Diacon, Paris, Fayard, coll. « Littérature étrangère », 1991, p. 83. Désormais, les références à cette traduction seront indiquées par le sigle VP suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[42]
Je traduis : « Je ne comprends pas ces Canadiens que l’on rencontre occasionnellement à l’étranger et qui semblent être réticents à l’idée de dire qui ils sont. (Cela ne s’applique pas, il faut le noter, aux Canadiens français.) Parfois, ils essaient de passer pour des Anglais, sans grand succès, ou pour des gens vaguement chics qui voyagent de l’Atlantique. »
-
[43]
Diacon traduit ces titres ainsi : « Le camion à glace », « Le tunnel » et « Virus X ».
-
[44]
« mettre un nom sur l’expression de son visage » (VP, 148).
-
[45]
« après tous ces voyages, après Ceylan, après Hong Kong, après le quasi-départ de Sheila et tous leurs problèmes – les dettes, les disputes avec les gérants d’hôtels, la malle-cabine perdue et retrouvée, les filles ne supportant pas la nourriture » (VP, 148).
-
[46]
« une fille de piètre qualité, vraiment » (VP, 146).
-
[47]
« étudier la civilisation française – en fait, pour l’éloigner d’un homme, un professeur, dont il fit toujours mine de croire qu’il s’appelait Déchu » (VP, 86).
-
[48]
Neil Besner, The Light of Imagination: Mavis Gallant’s Fiction, Vancouver, University of British Columbia Press, 1988, p. 117. Je traduis : « l’histoire familière chez Gallant de jeunes femmes nord-américaines qui voyagent en Europe pour trouver l’amour ».
-
[49]
« exilés [britanniques] sur le terrain » (VP, 98).
-
[50]
« Études urbaines et régionales des défavorisés en Colombie-Britannique » (VP, 86).
-
[51]
« l’intégration des groupes minoritaires sans perte de caractères ethniques » (VP, 197).
-
[52]
« pour faire moins ukrainien » (VP, 195).
-
[53]
« Une minorité, tu sais seulement ce que c’est ? » (VP, 198)
-
[54]
« je devrais » (VP, 198).
-
[55]
« le pays qu’elle avait en horreur tout en y aspirant » (VP, 216).
-
[56]
« [t]ype canadien conservateur » (VP, 233).
-
[57]
« ne [comprend] rien que l’anglais » (VP, 233).
-
[58]
Neil Besner, The Light of Imagination, p. 139. Je traduis : « le voyage de retour, de l’exil vers l’identité ».
-
[59]
Voir aussi la sélection de nouvelles dans Mavis Gallant, Montreal Stories, Toronto, McClelland & Stewart, 2004, 324 p.
-
[60]
En français dans le texte de Gallant.
-
[61]
Neil Besner, The Light of Imagination, p. 139.
-
[62]
Diacon traduit ce titre ainsi : « Dans la jeunesse est le plaisir ».
-
[63]
« mon voyage dans une nouvelle vie et un passé de rêve » (VP, 252).
-
[64]
« je ne me sentais en rien Britannique ou Anglaise, mais je n’étais pas non plus Américaine » (VP, 243).
-
[65]
« J’arrivais dans un pays pauvre et étrangement vide, où le visage des gens ne livrait rien. » (VP, 245)
-
[66]
« tenue de voyage » (VP, 243).
-
[67]
Je traduis : « Seule l’indépendance personnelle compte. »
-
[68]
« le français n’était alors d’aucun usage professionnel pour qui que ce soit au Canada » (VP, 267).
-
[69]
« ne savaient absolument rien l’une de l’autre » (VP, 270).
-
[70]
Diacon traduit ce titre ainsi : « Le docteur ».
-
[71]
« Il n’y avait pas de théâtre, pas de musique; il y avait un Musée des Beaux-Arts, mais pas grand-chose dedans. Il n’y avait même pas de bibliothèque publique. » (VP, 274)
-
[72]
Je traduis : « le mot “expatrié” est régulièrement épelé “expatriote” dans les journaux canadiens ».
-
[73]
Réjane Bougé, « Mavis Gallant », p. 36.
-
[74]
Ibid.
-
[75]
Ibid.
-
[76]
Ibid., p. 44.
-
[77]
Mavis Gallant, The Selected Stories of Mavis Gallant, p. ix. Je traduis : « ramer dans un bateau vers la mer : le rivage disparaît, il est trop tard pour faire demi-tour, et le rameur devient un galérien ».
-
[78]
Ibid., p. x. Je traduis : « Je ne sais toujours pas ce qui amène quelqu’un de sain d’esprit à quitter la terre ferme pour passer sa vie à décrire des gens qui n’existent pas. »
-
[79]
« quelques villes européennes dont le nom résonnait agréablement, comme Vienne et Venise » (VP, 335).
-
[80]
Je traduis : « Ce qui m’intéresse dans ce souvenir maintenant, c’est l’impasse qui peut se développer entre une femme et une enfant autour d’un mot et de son sens. J’en connaissais le sens; le son l’avait confondue. »
-
[81]
« le New York que je savais que je ne retrouverais jamais, car il ne pouvait être question de retour en arrière » (VP, 244).