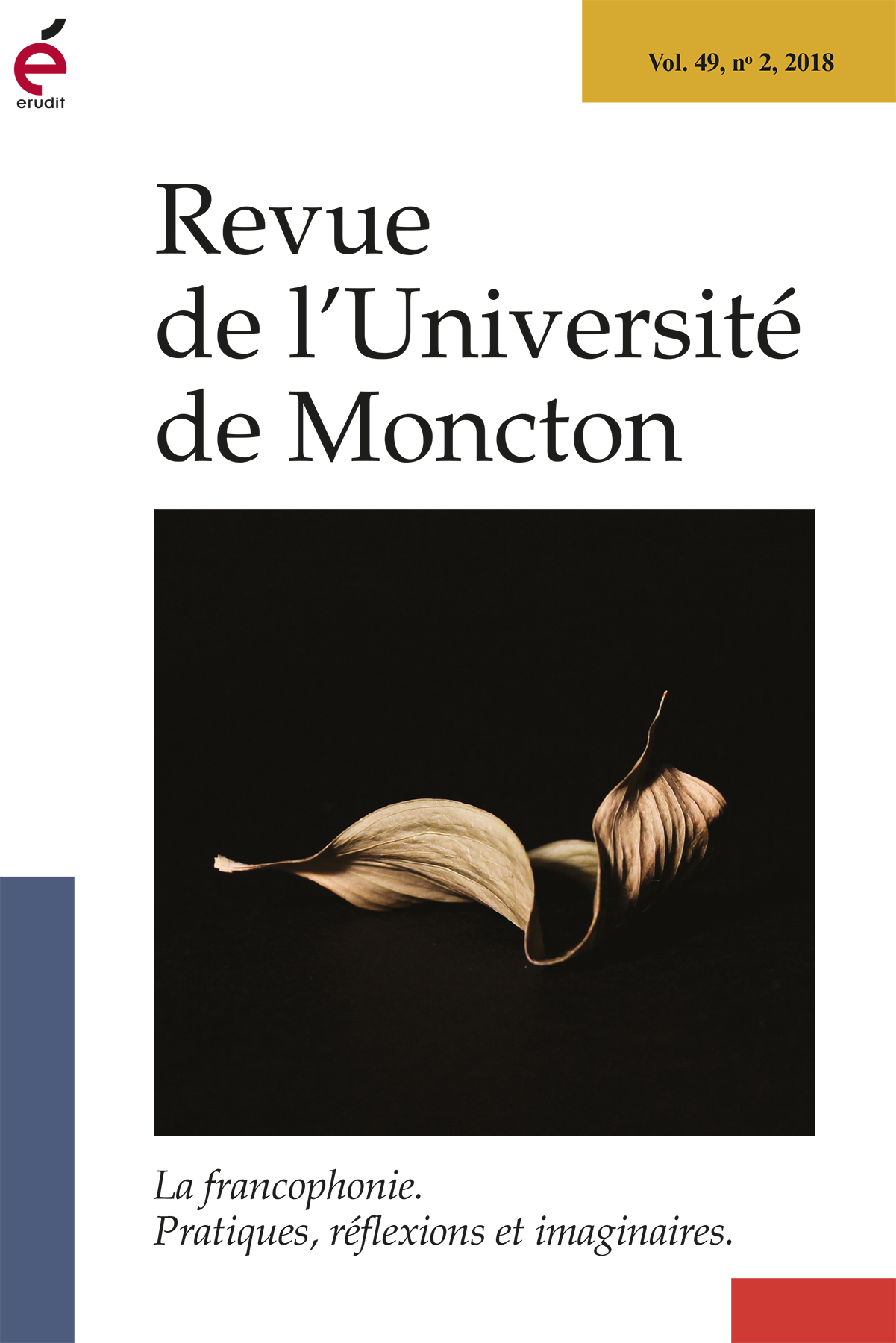Le programme de La littérature malgré tout est rendu explicite dès les premières pages; l’unité du livre ‒ et ce malgré son aspect disparate, les différents essais le composant ayant été écrits au fil des ans ‒ résiderait non pas dans une pensée sur la littérature, mais bien dans une sensibilité à la littérature. L’ouvrage ne s’adresserait donc pas aux spécialistes du fait littéraire et aurait plutôt pour public cible « un individu [...] pour qui les oeuvres littéraires ne sont pas un objet d’étude mais un art de vivre, une manière de préserver et d’approfondir en nous le petit espace dʼhumanité et de liberté qui nous reste » (pp. 7-8). Même si la littérature comme art de vivre est posée comme le fil conducteur du recueil, il demeure que le principal objet de son propos semble être ailleurs. Sitôt annoncée, cette prémisse paraît remplacée par ce qui préoccupe réellement l’auteur : la fin de la littérature ou, plus particulièrement, sa normalisation. Cette normalisation de la littérature, c’est, pour Ricard, la perte des grands courants rassembleurs, l’éclatement de la forme, la désuétude de la notion d’école ou de mouvement littéraire. Pis encore, la plus grande facilité de lʼécriture qui caractérise notre époque contemporaine ‒ les apprenti.e.s écrivain.e.s seraient désinhibé.e.s et ne frémiraient plus devant la tâche de l’oeuvre à écrire ‒ ainsi que son explosion provoqueraient, irrémédiablement, un appauvrissement de la littérature. Cette post-littérature aurait perdu sa fonction de médium pour parvenir à une forme de connaissance, de même que son pouvoir d’ébranlement; bref, l’art de vivre de la littérature serait à trouver dans ses vestiges. Malgré l’invitation à la lectrice et au lecteur de considérer la littérature comme un art de vivre formulée dans la préface intitulée « Avertissement », il est difficile d’adopter cette posture comme critique, puisque l’auteur lui-même ne reste pas sur ce terrain. En fait, dans les différentes parties de son ouvrage, Ricard s’applique à montrer ce qui est et ce qui n’est pas de la littérature. La littérature que l’essayiste privilégie est celle qu’il connaît et à laquelle il a participé sous différents chapeaux. Il partage lʼhabitus de nombreu.x.ses écrivain.e.s de sa génération, étant un produit du collège classique où il s’est formé comme lecteur : la littérature est au coeur de son identité depuis son adolescence. Ricard mentionne également sa participation à lʼéquipe de la revue Liberté pendant les années 1970 : L’auteur souligne sa présence parmi les grand.e.s de Liberté, qui sont aussi les grand.e.s de la littérature québécoise. En prenant en considération la formation classique de Ricard ainsi que son rôle de témoin auprès du panthéon des lettres québécoises, de ceux et celles qui ont « fait » la littérature québécoise, on devine son goût pour la valeur canonique de la littérature. Comme le note avec beaucoup d’à-propos Patrick Guay dans son commentaire de lecture sur La littérature malgré tout, c’est « une vision crépusculaire et nostalgique » de la littérature que propose Ricard. Il est nostalgique de la production littéraire québécoise des décennies 1960 et 1970, qui « se voulait aussi moderne que possible, en ce sens qu’elle privilégiait l’expérimentation, la nouveauté, mais aussi la critique et la contestation (sociale, politique, idéologique, morale, esthétique) » (p. 111). Notons au passage que ces propos sont contradictoires, en connaissant la « méfiance instinctive [de l’auteur] à l’égard de la littérature dite engagée ou militante » (p. 44). Il y aurait donc une bonne et une mauvaise littérature engagée, des bons (la Révolution tranquille et ses épiphénomènes) et des mauvais contextes de contestation. Ricard affirme que les frontières de la …
François Ricard (2018). La littérature malgré tout. Montréal : Éditions du Boréal. [coll. Papiers collés]. 200 pages[Notice]
…plus d’informations
Isabelle Kirouac Massicotte
Université de Moncton