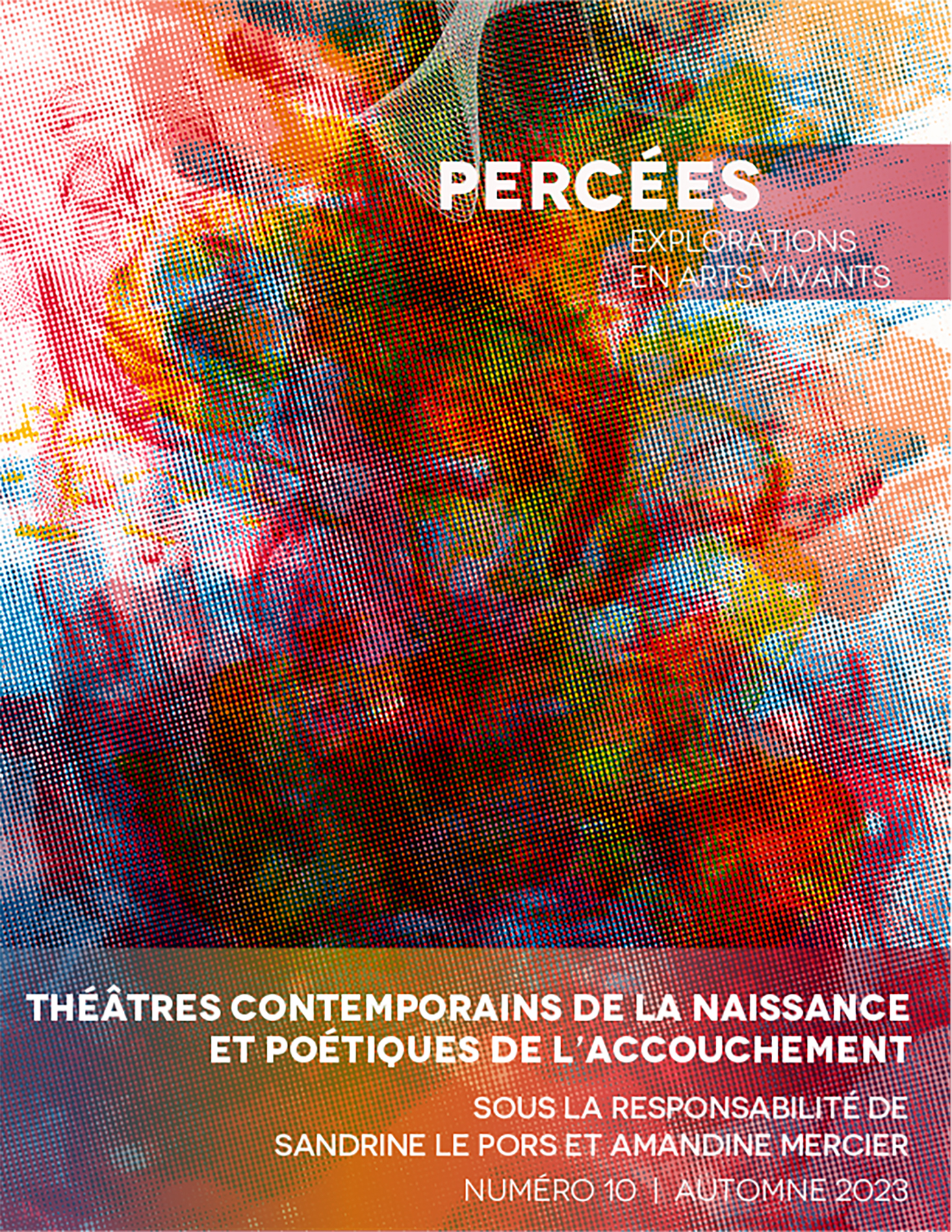Résumés
Mots-clés :
- Québec,
- théâtre amateur,
- son,
- plantes
L’écoute (celle qu’on accorde ou non, celle qu’il faut développer et entretenir) est au coeur des récents dossiers thématiques recensés dans cette « Revue des revues ». Les numéros 187 et 188 de Jeu (« Québec : scènes capitales »; « Fragments d’un théâtre amateur ») nous invitent respectivement à prêter attention aux voix qui animent les scènes de la ville de Québec et du théâtre non professionnel de manière à reconnaître – si ce n’était pas déjà fait – leur apport inestimable dans l’écosystème artistique provincial, mais aussi international. La captation, la fabrication, la représentation et la réception du son s’inscrivent quant à elles au centre du huitième chantier de Thaêtre (« Dispositifs sonores »), où sont mis en relief les effets d’écho, de résonance et de dissonance à l’oeuvre dans nombre de performances et de spectacles contemporains. C’est enfin l’écoute, attentive et attentionnée, du plus-qu’humain végétal qui traverse les articles réunis dans le dernier numéro de Tangence (« Dramaturgies des plantes »); à l’heure de l’Anthropocène, elle apparaît tout à la fois délicate et urgente. Le titre du numéro 187 de Jeu, « Québec : scènes capitales », « n’est pas qu’un jeu de mots », signale Raymond Bertin dans son éditorial, réaffirmant, vingt-cinq ans après la parution du dossier « Le théâtre à Québec » (1998), le dynamisme important des scènes de la capitale. Créant et réfléchissant depuis celle-ci, les contributeur·trices rendent compte, « au-delà du lieu géographique », du foisonnement des pratiques en arts vivants, celles qui se déploient « dans les rues de la ville, dans les têtes des créateurs et créatrices, dans la société que nous habitons et construisons par nos actions », explique la codirectrice Josianne Desloges en introduction. Alain-Martin Richard amorce cette exploration en brossant un portrait des propositions in situ (cirque, danse, théâtre, opéra, manoeuvre, etc.) qui ont animé, d’hier à aujourd’hui, les parcs, escaliers et autres espaces de la ville; devant leur effervescence, Québec apparaît d’emblée comme une « scène permanente ». Sa vitalité est également manifeste dans les salles, tel qu’en témoignent les directeur·trices artistiques de théâtres ou de festivals Olivier Arteau (Le Trident), Gabrielle Ferron et Samuel Corbeil (Théâtre Périscope), Marie-Ève Lussier-Gariépy (Festival du Jamais Lu Québec) et Mélissa Merlo (Théâtre jeunesse Les Gros Becs), dont les propos ont été recueillis par Josianne Desloges dans l’article suivant. Récemment entré·es en poste, il·elles font part de leurs espoirs quant à l’avenir de leur milieu, qu’il·elles souhaitent polyvalent, inclusif et rassembleur. Julie Veillet s’intéresse quant à elle à l’impressionnant travail de Marie Gignac, dont elle propose une rétrospective : après vingt-cinq années de programmations où se sont entrelacés les désirs de faire connaître les théâtres internationaux et de mettre en valeur les oeuvres québécoises, l’actrice de formation a quitté ses fonctions à titre de directrice artistique du Carrefour international de théâtre à l’été 2023. Une autre « ruche au service de la création » est mise de l’avant dans l’entrevue qu’Émile Beauchemin, cofondateur de la Charpente des fauves, accorde à Ludovic Fouquet. Ce vaste lieu de conception et de diffusion soutient des activités de recherche-création variées – résidences, laboratoires, répétitions, soirées performatives, etc. – et semble offrir, à l’image de Québec, « un potentiel de pollinisation disciplinaire infini ». Plusieurs contributeur·trices du dossier unissent ensuite leurs efforts pour présenter dix compagnies et collectifs dont les membres sont souvent issu·es des programmes de formation en arts vivants de la capitale; leurs dernières productions s’affirment comme des « essaims » d’innovations. Après y avoir abordé les créations de la Trâlée et du collectif des Soeurs Amar, Émilie Rioux se concentre dans …