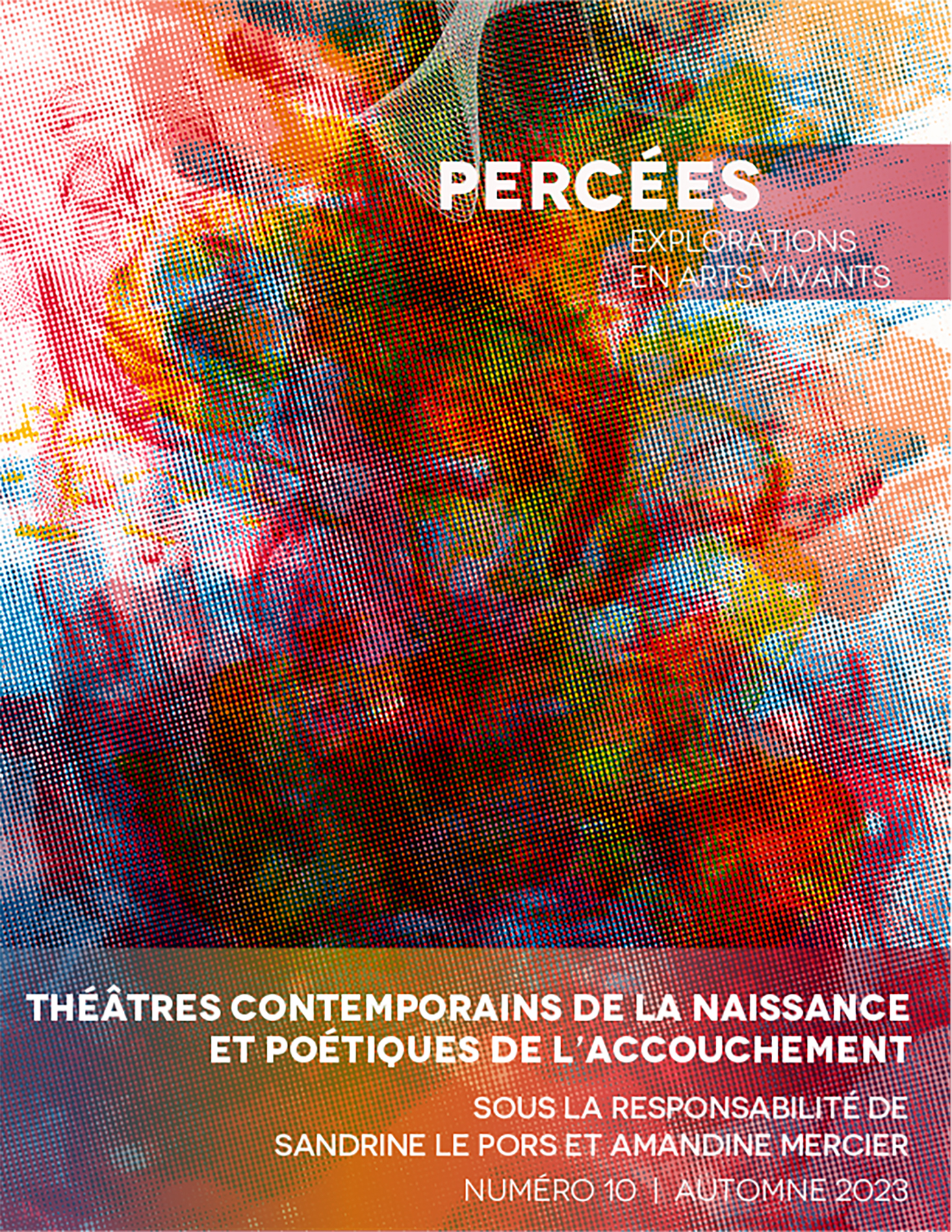Résumés
Mots-clés :
- gestation,
- rituel,
- partition,
- care,
- naissance
Que se joue-t-il dans l’accompagnement de la grossesse, dans le lien en « gestation » entre un bébé, celle qui le porte et ceux·celles autour? De quelles façons « prendre soin » des parents et de l’enfant à naître, afin qu’il arrive dans un milieu où il est accueilli, sécurisé? Dans la vie intra-utérine, que se joue-t-il sur le plan du soma, de l’embodiment, et qu’est-il à imaginer, en matière de gestes artistiques qui prendraient soin du vivant, de la relation entre les êtres? L’article qui suit prévaut comme note de synthèse d’un projet de recherche en cours, encore au stade embryonnaire, dont je souhaite toutefois dévoiler les premières orientations méthodologiques, théoriques et expérientielles. Il faut d’emblée informer le·la lecteur·trice que ce projet, appelé provisoirement « Ritualités et gestation », me mobilise d’une façon particulière, tant il s’est élaboré en résonance à un moment particulier de mon processus de chercheuse, de danseuse, de chorégraphe, dans la temporalité d’un désir de devenir mère biologique jusqu’à l’expérimentation de la grossesse. Cette présentation de chantier en cours assumera donc les « tissages » heuristiques (parfois tâtonnants) qui bordent l’intimité de la chercheuse et l’élaboration d’une pensée en mouvement, convoquant l’enquête, la recherche en création, la pédagogie et les pratiques créatives. Pour contextualiser le point d’émergence de ce travail, il fait suite à une invitation proposée en mars 2021 à participer au lancement d’un projet de recherche collectif sur la thématique des mues, à l’initiative de ma collègue Julia Peslier, maître de conférences à l’Université de Franche-Comté, spécialiste en littérature générale et comparée. J’ai tout de suite accepté d’ouvrir cette fenêtre d’exploration qui m’a d’abord incitée à projeter la mue en tant que membrane, poche des eaux, la mue faisant appel aussi à la plasticité d’une limite entre deux mondes, à la frontière entre l’intérieur et l’extérieur. Puis en pensant la mue, on glisse assez naturellement au verbe « muer », qui invoque tout le processus de « se transformer en… », « se dépouiller de quelque chose ». J’étais en mars 2021 en désir fort d’enfant, de second enfant, et j’ai alors souhaité répondre à ce projet autour des mues en impulsant un chantier de recherche qui se mettrait en marche depuis mon expérience de la grossesse, de mon corps en transformation. Au cours d’un échange avec Julia Peslier sur mes prémices d’envies exploratoires, celle-ci m’a recommandé la lecture de l’ouvrage d’Aurélie William Levaux, illustratrice et écrivaine belge, Menses ante rosam, publié en 2012 aux éditions La cinquième couche. Au sein de ce livre composé de cinquante dessins et broderies sur tissus, l’artiste nous partage son regard sur son corps qui se transforme, son ventre qui se déforme avant l’arrivée de sa fille Rosa, le désarroi de son compagnon cherchant sa place; elle fait le récit de ce corps qui se transforme, puis s’ouvre, se déchire pour accueillir l’enfant, lui faire place. La focale prise par l’artiste-brodeuse-écrivaine résonnait avec certaines de mes explorations-réalisations antérieures élaborées durant mon travail de thèse de doctorat en recherche-création. Ma recherche doctorale, fondée sur ma pratique de danseuse, intégrait les démarches de la practice-based research, mais combinait également la performance as research (recherche-performance) avec des finalités de créations de matériaux et de supports créatifs. Un travail plastique et chorégraphique avait été mené autour de la thématique du fil pour envisager la poétique de la gestation, du naissant, au sein du projet de recherche-création Paso, processus de création chorégraphique, scénique et vidéophotographique où j’abordais la thématique de la maïeutique dans une approche archétypale des images et des imaginaires véhiculés autour du personnage de la …
Parties annexes
Bibliographie
- BAINBRIDGE COHEN, Bonnie (2002 [1993]), Sentir, ressentir et agir : l’anatomie expérimentale du Body-Mind Centering, trad. Madie Boucon, Bruxelles, Contredanse.
- BARTH, Fredrik (1975), Ritual and Knowledge Among the Baktaman of New Guinea, Oslo, Universitetsforlaget; New Haven, Yale University Press.
- BARTOLI, Lise (2007), Venir au monde : les rites de l’enfantement sur les cinq continents, Paris, Payot, « Petite bibliothèque Payot ».
- BEN SOUSSAN, Patrick (2009), « Naître au monde et à la culture », Spirale, no 52, p. 23-34.
- DESPRÉS, Aurore (dir.) (2016), « Performances et gestes en éclats », introduction à Gestes en éclats : art, danse et performance, Dijon, Les Presses du réel, « Gestes », p. 10-24.
- DEWEY, John (2010 [1934]), L’art comme expérience, trad. Jean-Pierre Cometti et al., Paris, Gallimard, « Folio Essais ».
- GEERTZ, Clifford (1980), Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali, Princeton, Princeton University Press.
- GENNEP, Arnold van (2011 [1909]), Les rites de passage, Paris, Picard.
- HALPRIN, Lawrence (2010 [1969]), « Les cycles RSVP : dispositifs de création dans le champ des activités humaines », trad. Élise Argaud, dans Simone Forti et al., De l’une à l’autre : composer, apprendre et partager en mouvements, Bruxelles, Contredanse, p. 8-32.
- JODOROWSKY, Alexandro (2001), Le théâtre de la guérison, Paris, Albin Michel, « Espaces libres ».
- KAPROW, Allan (1996), L’art et la vie confondus, Jeff Kelley (éd.), trad. Jacques Donguy, Paris, Éditions du Centre Pompidou, « Supplémentaires ».
- LEVAUX, Aurélie William (2012 [2008]), Menses ante rosam, Bruxelles, La cinquième couche.
- LÉVI-STRAUSS, Claude (1962), La pensée sauvage, Paris, Plon.
- NOUHET-ROSEMAN, Joëlle (2003), « Le rituel du bain au Japon », Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, no 40, p. 79-91.
- ORIA, Nathalie et Jérôme CAMUS (2012), « Avoir un premier enfant : un rite d’institution », Recherches familiales, no 9, p. 49-59.
- PRADIER, Jean-Marie et al. (1995), « Ethnoscénologie : manifeste », Théâtre/Public, no 123, p. 46-48.
- RANCIÈRE, Jacques (2000), Le partage du sensible : esthétique et politique, Paris, La Fabrique.
- SANCHEZ, Carolane (2019), « Ce qui fait flamenco : palimpseste d’une recherche-création avec Juan Carlos Lérida », thèse de doctorat, Besançon, Université Bourgogne Franche-Comté.
- SOMA (2017), « Body-Mind Centering », www.soma-france.org/bonnie-bainbridge-cohen
- TURNER, Victor (1967), The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual, Ithaca, Cornell University Press.