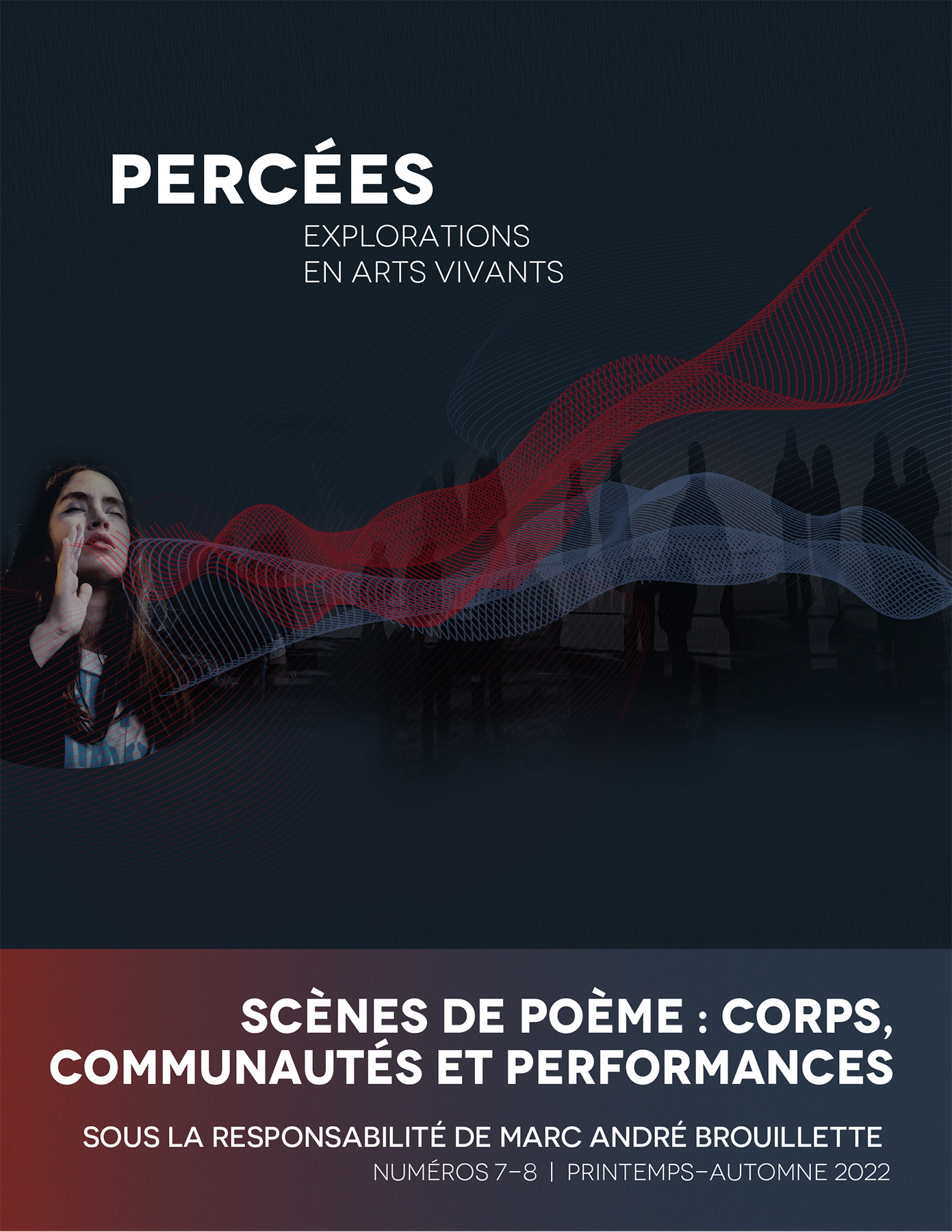Résumés
Mots-clés :
- silence,
- guerre,
- paix,
- exil,
- document
Tournées vers les pratiques contemporaines, les récentes parutions de Jeu, Études théâtrales et Thaêtre épluchées dans cette recension proposent un riche panorama des lignes de force qui animent actuellement la recherche et la création en arts vivants. Si les derniers numéros d’Études théâtrales (« Théâtre et exil ») et de Jeu (« Guerre et paix ») sont axés sur le théâtre, le dossier 183 de la même revue (« Silence ») et le septième chantier de Thaêtre (« Document-matériau ») s’ouvrent, pour leur part, à plusieurs disciplines : danse, performance, installation, mime, butō, etc. Les thèmes et les enjeux autour desquels s’articulent les dossiers apparaissent foncièrement protéiformes et polysémiques. En témoigne la diversité des réflexions, menées au prisme de considérations esthétiques, scéniques, disciplinaires, culturelles et sociopolitiques à la fois singulières et complémentaires. À notre plus grand plaisir, chaque revue s’attache à mettre en valeur des trajectoires et des paroles d’artistes, tantôt invité·es à rendre compte de leurs propres démarches et trouvailles dans des entretiens ou des témoignages, tantôt mis·es en présence à travers l’analyse de leurs discours. La constellation réflexive ainsi tracée réaffirme l’étendue des possibles et des imaginaires qui nourrissent les (hors-)scènes d’aujourd’hui, au Québec comme ailleurs. Si le silence est un « sujet qui peut surprendre », tel que l’affirme Raymond Bertin dans son éditorial du numéro 183 de Jeu, force est d’admettre, à la lecture du dossier thématique codirigé par Virginie Chauvette et Sophie Pouliot, que l’analyse de ses multiples facettes est des plus pertinentes et stimulantes en études des arts vivants. Dans les rapports variés qu’il entretient avec le texte, le plateau, le jeu ou la réception, et dans les dynamiques de présence, d’absence, mais aussi d’exclusion et d’oppression qu’il est susceptible d’installer, de déjouer ou de mettre au jour, « le silence est vaste, le silence est partout, le silence est parlant ». C’est ce que souligne Virginie Chauvette en introduction, en s’appuyant notamment sur les propos de la comédienne Debbie Lynch-White, qui a participé à l’idéation du dossier et qui signe un texte dans lequel elle présente les notions phares de son mémoire en recherche-création. Pour elle, l’absence de parole chez « l’interprète impressionniste », à l’écoute des sensations et des émotions furtives qui le·la traversent, stimule un « dialogue silencieux [des] intériorités » en amenant les spectateur·trices à se replier sur eux·elles-mêmes pour mieux participer à la coconstruction du sens. Non-dits, ellipses, didascalies et autres « textures » esthétiques muettes sont ensuite au coeur de l’examen de Caroline Mangerel, qui montre que le silence ne doit pas être envisagé comme étant subordonné ou opposé à la parole pour qui souhaite prendre la pleine mesure de ses fonctions au théâtre. Estelle Bourbon, quant à elle, met en relief la richesse des pratiques en arts vivants qui sont actuellement proposées par les personnes S / sourdes et malentendantes canadiennes. À partir de conversations avec les comédiennes Hodan Youssouf et Jennifer Manning, elle identifie des enjeux créatifs, communicationnels et institutionnels liés à l’accessibilité, à l’inclusion et à la visibilité. En fin d’article, des pistes d’action sont présentées pour que « l’inclusion ne soit pas un terme creux, mais bien une réalité ». Dans une entrevue accordée à Virginie Chauvette, Francine Alepin, interprète et professeure spécialisée en théâtre corporel, aborde les puissances physiques, expressives et poétiques du mime, de même que sa résilience et son avenir dans le paysage artistique québécois. Malgré sa position quelque peu marginale sur nos scènes, le mime infuse et inspire les arts du geste tels qu’ils sont pratiqués aujourd’hui et restera vivant tant qu’il sera enseigné, selon Alepin. Enzo …