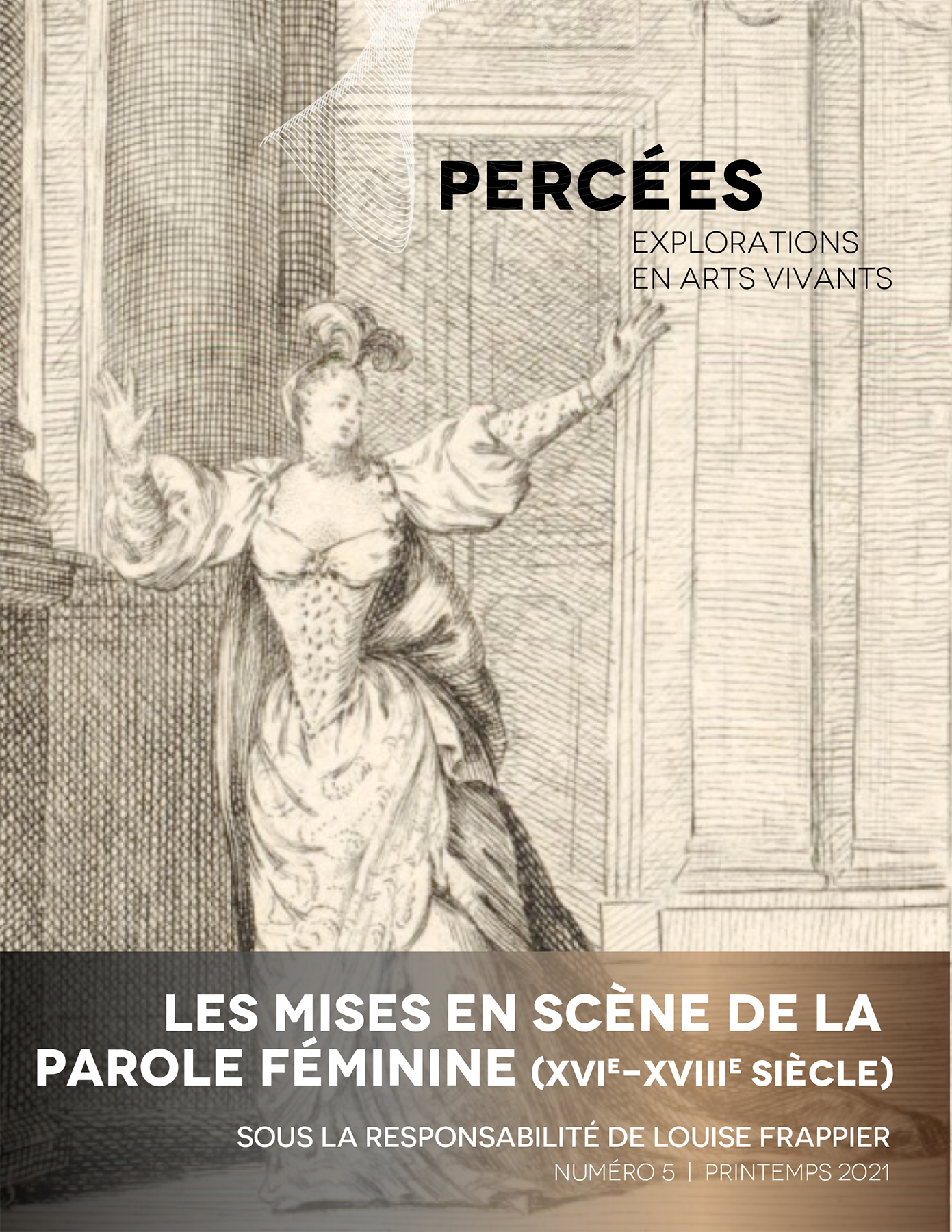Résumés
Mots-clés :
- théâtre contemporain,
- formes esthétiques,
- société québécoise,
- histoire littéraire,
- dramaturgie
À défaut d’avoir pu assister à des productions théâtrales cet automne, on a tout de même pu se réjouir de la parution de l’ouvrage le plus ambitieux jamais publié au Québec dans le champ des études théâtrales. Le théâtre contemporain au Québec, 1945-2015 :essai de synthèse historique et socio-esthétique arrive en effet à point, près de dix ans après la dernière grande étude sur le théâtre québécois. Il faut dire que, depuis la parution des travaux dirigés par Dominique Lafon qui étudiaient deux décennies (1975-1995) du théâtre québécois, et de ceux de Sylvain Schryburt, qui exploraient les mutations des années 1940 à 1980, on attendait impatiemment qu’un chantier poursuive l’effort entamé par ces chercheur·euses et aboutisse à une rétrospective approfondie, retraçant les mutations de notre théâtre national depuis sa fondation. Voilà donc l’entreprise dans laquelle s’est lancé Gilbert David, accompagné par Hervé Guay, Hélène Jacques, Yves Jubinville ainsi qu’une vingtaine de chercheur·euses issu·es de différentes universités québécoises. On ne peut qu’être enthousiaste en ouvrant Le théâtre contemporain au Québec, colosse de près de six-cent-cinquante pages, qui, avec ses allures de livre de table à café, n’annonce en rien la profondeur des recherches qui le précèdent. Le livre a pour objectif de s’adresser autant au « grand public » qu’aux étudiant·es et aux enseignant·es, expliquaient Gilbert David et Hélène Jacques dans un entretien accordé cet automne au Devoir. À ce titre, on peut dire que le pari est relevé : un lectorat curieux ou une personne amatrice d’histoire prendra en effet plaisir à feuilleter cet ouvrage, alors qu’un·e féru·e de théâtre ou un·e chercheur·euse voudra s’y consacrer pleinement, en le parcourant de long en large. L’ouvrage est composé de cinq parties, qui épousent autant de périodes historiques, chacune d’elles couvrant entre dix et vingt années : 1. Le temps des réformes (1945-1959); 2. Du renouveau théâtral à l’éclatement des pratiques (1960-1979); 3. Du théâtre postcolonial aux scènes postmodernes (1980-1989); 4. Percées internationales et horizons incertains (1990-1999); et 5. Porosité des frontières et défis de transmission (2000-2015). Les chapitres, quant à eux, reprennent une structure tripartite similaire : d’abord, la description de l’institution théâtrale, ensuite l’analyse des pratiques scéniques et enfin, l’étude de la réception critique. La section portant sur la réception critique, qui épingle les discours sur le théâtre propres à l’époque concernée, est probablement la plus stimulante, mais c’est également celle qui fut la plus laborieuse à concevoir en raison de la nature éphémère de la représentation théâtrale, comme le soulignent les auteur·trices du livre. Dans les cas où il n’y a pas de captation des oeuvres ni de critiques parues dans les périodiques, il faut s’en remettre au « rayonnement » d’une pièce ou encore à la mémoire des chercheur·euses qui ont assisté aux productions, ce qui limite la fiabilité de la réception. Outre la difficulté d’étudier la réception critique des pièces, d’autres obstacles se sont présentés aux auteur·trices durant la conception de l’ouvrage. Le livre s’ouvre d’ailleurs sur un constat d’échec, alors qu’on affirme sans ambages qu’il est impossible « d’aboutir à une véritable histoire du théâtre au Québec » (23). Les auteur·trices nous invitent plutôt à envisager cet ouvrage comme un « appel à poursuivre le travail interprétatif déjà entamé » (24). L’approche préconisée se veut donc moins mémorielle qu’analytique. Les auteur·trices disent en effet vouloir se tenir « à distance [de] la célébration mémorielle qui a trop souvent consisté à aplanir voire à taire les tensions qui dynamisent le théâtre comme la société elle-même pour leur substituer un récit louangeur et triomphaliste » (23). Ils ont donc préféré « mettre d’abord en relief …