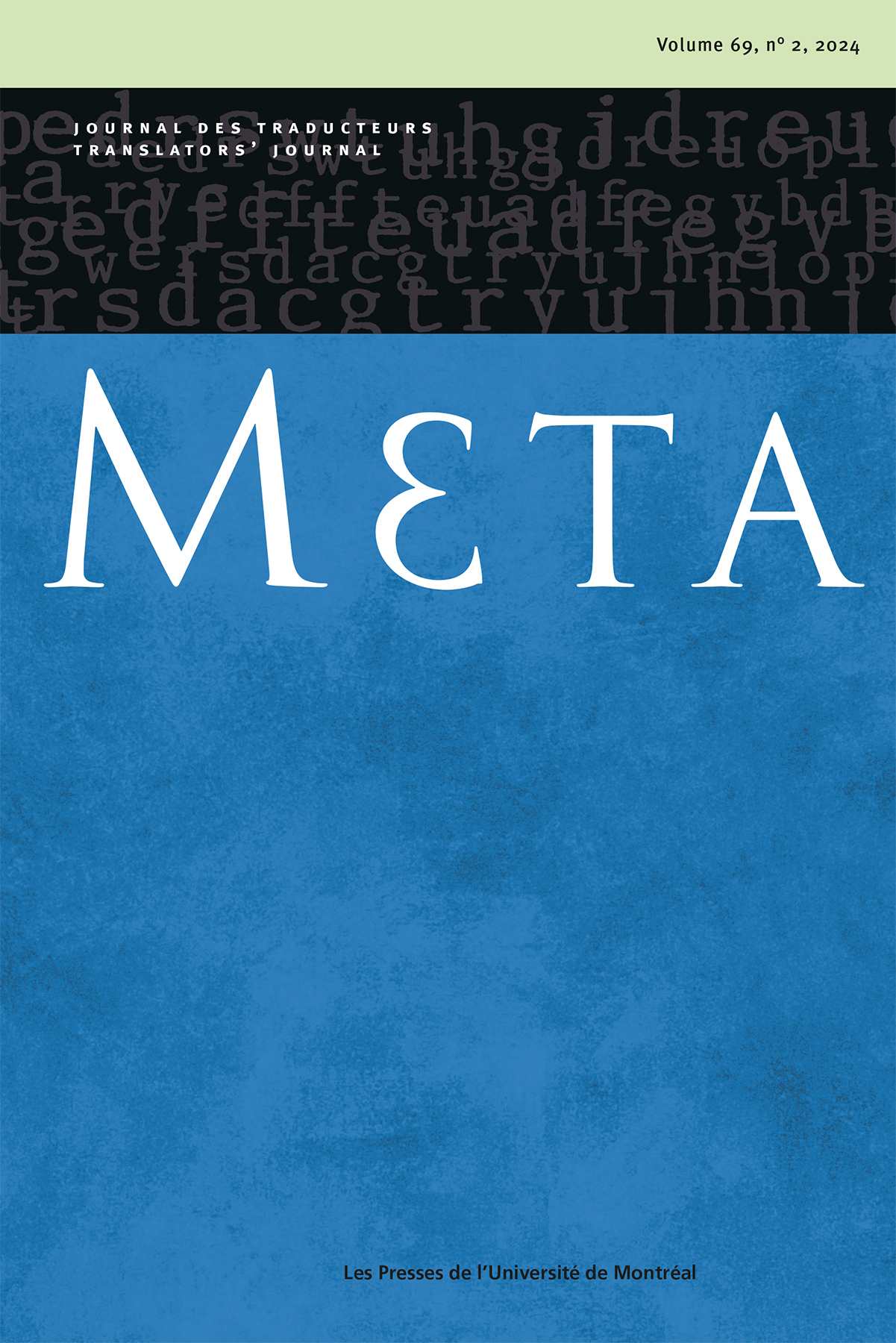L’ouvrage collectif Langues et rapports de force. Les enjeux politiques de la traduction propose de poursuivre l’exploration des liens entre traduction et politique, un domaine qui occupe un pan non négligeable de la traductologie depuis un certain temps désormais. Bien que relativement mince, le recueil réunit dix articles qui offrent des angles d’analyse divers et variés sur les liens entre langue(s), politique et traduction. Ainsi, dans un premier groupe d’articles, la nature politique qui justifie la place de l’étude dans l’ouvrage collectif découle directement de la confrontation entre langues ou variétés langagières aux statuts différents, que ce soit dans le texte source, dans le texte cible ou dans la rencontre entre le texte source et le texte cible. C’est le cas par exemple de la contribution de Rosana Orihuela intitulée « Traduire l’étranger dans la langue et l’étrangeté de la langue : variations autour de la dissonance linguistique dans El zorro de arriba y el zorro de abajo ». La chercheuse se penche sur le roman de José María Arguedas, qui traite des thèmes de la migration et du déracinement et dont le message politique est reflété notamment par une langue qui mêle espagnol et quechua, ou, pour reprendre une expression de Rosana Orihuela, par une « palpitation du quechua dans l’espagnol » (p. 21). Elle analyse la manière dont cette hétérogénéité présente dans le texte source est abordée dans les traductions italienne et anglaise, ainsi que dans une proposition de traduction en français. Sans exposer un cas d’hétérolinguisme, l’article de Valérie Bada et Christine Pagnoulle, « Traduire Gem of the Ocean d’August Wilson : démarche politique et limites de la traduction ? », aborde, lui aussi, un cas de figure où la revendication politique d’un auteur se déploie pleinement dans la variété utilisée dans le texte source et se présente comme un élément que le traducteur doit gérer. Partant d’une expérience de traduction, les auteures expliquent le défi qu’a constitué le passage de cette pièce de théâtre au français : visant la reconnaissance de l’histoire et de l’identité afro-américaines (face à la domination blanche), le texte d’August Wilson non seulement met en scène des éléments culturels de la communauté afro-américaine, mais elle repose aussi linguistiquement sur le vernaculaire noir américain. Si ces deux articles montrent que la dimension politique peut intervenir dès le texte source, il n’en reste pas moins que les enjeux politiques peuvent se trouver du côté du texte cible, notamment en ce qui concerne le choix de la variété langagière privilégiée. C’est ce que met en évidence la contribution d’Alejandrina Falcón sur le sujet de la « Naturalisation, manipulation et circulation internationale de traductions argentines ». Cet article renseigne le lecteur sur une pratique adoptée par certaines maisons d’édition catalanes dans les années 1970 et 1980, en particulier dans les collections des romans noirs : celles-ci reprenaient des traductions argentines en les modifiant de sorte que la langue corresponde à l’espagnol péninsulaire (les correcteurs étaient, de plus, souvent des collaborateurs argentins exilés). En outre, les modifications pouvaient également porter sur les paratextes, ce qui, parfois, conférait aux romans des significations nouvelles. Enfin, le rapport de force peut surgir par la rencontre entre langue source et langue cible, comme l’illustre l’article « Translating Indian Vernacular Literature : Arvind Krishna Mehrotra’s English Translations of Prākrit Love Poetry and of bhakti Verse », proposé par Julie Beluau. Il est question ici des traductions effectuées par Arvind Krishna Mehrotra de deux recueils de poésie, le premier réunissant des poèmes romantiques, voire érotiques, et prenant le titre de The Absent Traveller, et le deuxième se rattachant au courant bakhti et …
Parties annexes
Bibliographie
- Zhang, Florence Xiangyun et Froeliger, Nicolas, dir. (2021) : Traduire, un engagement politique ? Bruxelles : Peter Lang.