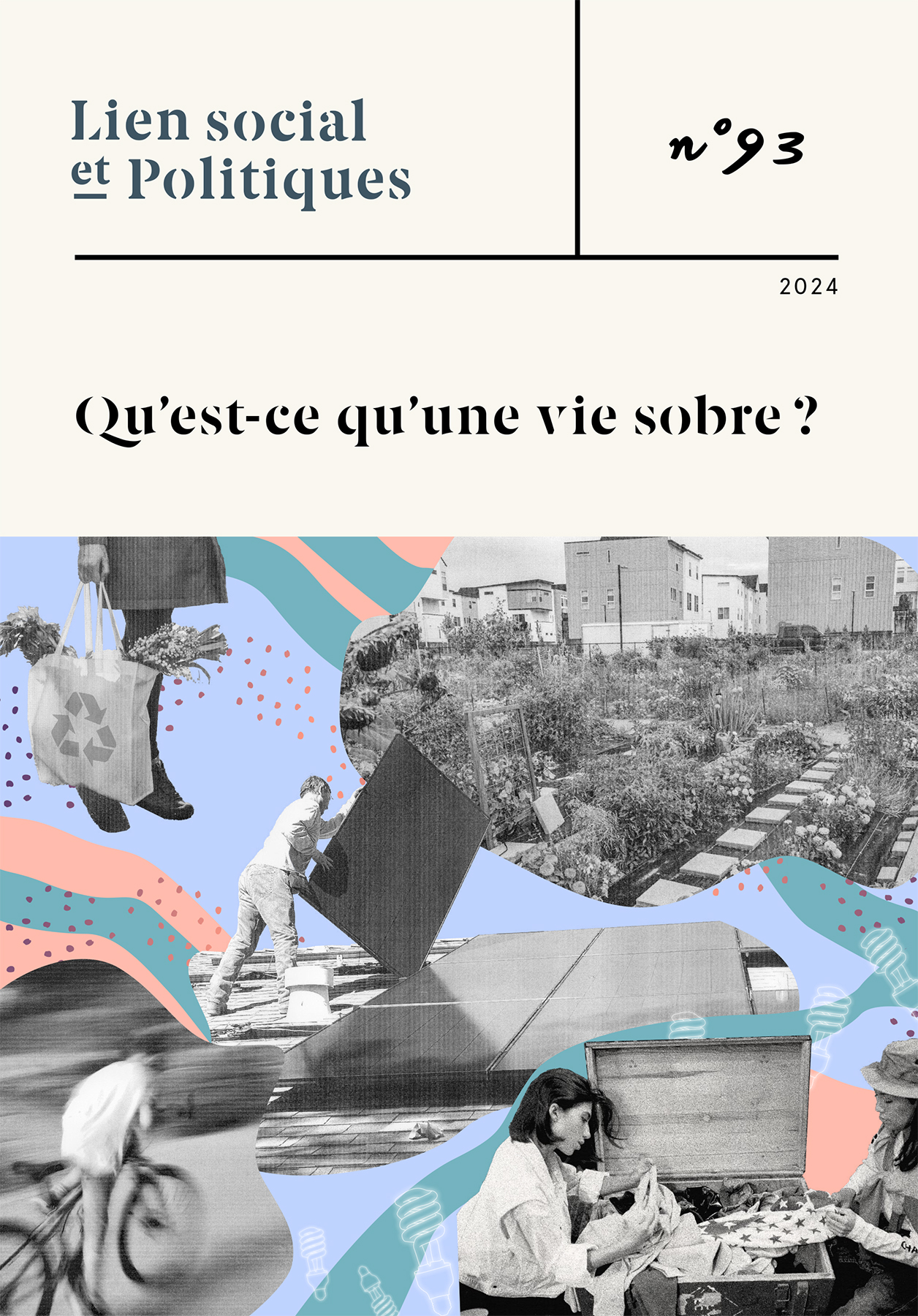Depuis moins d’une décennie, nos sociétés affrontent une succession de crises structurelles sans précédent. Si les racines en sont déjà lointaines, les bouleversements qui affectent le climat sont aujourd’hui de plus en plus tangibles. Nous savons pertinemment désormais que, à défaut de vigilance et de volontarisme, notre planète sera rapidement condamnée à subir toujours plus de dérèglements délétères et irréversibles. La pandémie imputable à la covid-19 a pareillement fragilisé l’ensemble des populations à l’échelle du monde. Elle a crûment révélé à quel point les choix économiques et politiques qui, hier, avaient été effectués pour préparer l’avenir étaient en réalité dysfonctionnels pour juguler la survenue et la propagation d’un virus jusqu’alors inconnu. Last but not least, après que la chute du mur de Berlin a signé la fin d’un long épisode d’affrontement entre l’Est et l’Ouest, les tensions ont resurgi violemment en 2022. Elles ont modifié les équilibres géopolitiques et ravivé le spectre d’une destruction nucléaire. Elles ont également provoqué une crise de la production énergétique et obligé un grand nombre d’Européen·nes, au-delà même des territoires directement concernés par les affrontements militaires, à tempérer leur consommation d’énergie, voire plus généralement à amender leurs façons de vivre. Sur ce fond chaotique, plusieurs voix s’élèvent régulièrement pour réclamer un changement radical des modes de vie, seule façon, à les en croire, de nous permettre de lutter efficacement contre la dégradation de notre habitat naturel, de prévenir les risques de nouvelle crise sanitaire et d’expérimenter un rapport moins destructeur et plus apaisé au monde. La sobriété (ou sufficiency dans le vocabulaire anglo-saxon) s’est ainsi imposée il y a peu dans l’espace public à titre de mot d’ordre capable d’agréger les bonnes volontés décidées à réinventer nos façons de travailler, de produire, de consommer, d’habiter, de voyager, de communiquer…, bref, de vivre ensemble sur une planète viable. Indice intéressant à ce titre : en 2022, le GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat) s’est emparé officiellement du terme sufficiency pour désigner ce qui est suffisant afin de vivre convenablement sans nuire à la planète ni au bien-être des individus. En réalité, comme le note Sophie Dubuisson-Quellier (Cailloce, 2022), la sobriété fait l’objet d’une attention particulière de la part des sciences sociales depuis une vingtaine d’années déjà au moins. La théorie du donut de Kate Raworth (2017) a largement contribué à la légitimité d’une telle question. La thèse défendue par l’économiste anglaise est qu’une vie sobre devrait nous permettre, collectivement, de bâtir une économie régénérative et redistributive d’une part, d’instituer un espace de sécurité et de justice accessible à toute l’humanité de l’autre. Le philosophe Dominique Bourg et le juriste Alain Papaux (2010) n’ont pas davantage attendu la conversion du GIEC à la sufficiency pour clamer haut et fort que c’est vers une société « sobre et désirable » qu’il convient de nous diriger aujourd’hui. Les questions posées par la thématique de la sobriété sont aussi vastes que multiples. L’ambition de ce numéro de Lien social et Politiques n’est pas de les appréhender toutes dans leur profondeur comme dans leur diversité. En posant une question générique – Qu’est-ce qu’une vie sobre ? – il propose de baliser un territoire de savoirs en émergence en sondant les significations sociales et les implications pratiques de la sobriété. Les nombreuses contributions de ce numéro, le plus volumineux de l’histoire de la revue, témoignent de fait de l’importance croissante de la question de la sobriété au coeur des préoccupations actuelles. Plus que la seule émergence d’un nouveau savoir, la notion de sobriété met en lumière des inquiétudes multiples, notamment celles liées aux excès du capitalisme et aux effets …
Parties annexes
Bibliographie
- Arendt, Hannah. 2020. Condition de l’homme moderne. Paris, Le Livre de poche.
- Bardi, Ugo. 2017. « Des transports sobres en période de descente énergétique », dans Agnès Sinaï et Mathilde Szuba (dir.). Gouverner la décroissance. Politiques de l’anthropocène III. Paris, Presses de Sciences Po : 179-194.
- Barnard, Alex V. 2011. « ‘Waving the Banana’ at Capitalism: Political Theater and Social Movement Strategy Among New York’s ‘Freegan’ Dumpster Divers », Ethnography, 12, 4 : 419-444.
- Bellora, Cecilia et Malte Thie. 2022 (novembre-décembre). « Quelles clauses environnementales dans les accords commerciaux ? », La Lettre du Cepii, 432.
- Bergeron, Henri, Patrick Castel, Sophie Dubuisson-Quellier, Jeanne Lazarus, Étienne Nouguez et Olivier Pilmis. 2018. Le biais comportementaliste. Paris, Presses de Sciences Po.
- Berrebi-Hoffmann, Isabelle, Marie-Christine Bureau et Michel Lallement. 2018. Makers. Les laboratoires du changement social. Paris, Éditions du Seuil.
- Bonneuil, Christophe. 2020. « Der Historiker und der Planet. Planetaritätsregimes an der Schnittstelle von Welt-Ökologien, ökologischen Reflexivitäten und Geo-Mächten », dans Frank Adloff et Sighard Neckel (dir.). Gesellschaftstheorie im Anthropozän. Frankfurt, Campus Verlag : 55-92.
- Bonneuil, Christophe. 2022. « Terre », dans Didier Fassin (dir.). La société qui vient. Paris, Édition du Seuil : 37-54.
- Bourg, Dominique et Alain Papaux. 2010. Vers une société sobre et désirable. Paris, Presses universitaires de France.
- Boyer, Robert. 2022. « Développement anthropogénétique et reconnaissance de l’utilité sociale du travail », Sociologie du travail, 64, 1-2. https://doi.org/10.4000/sdt.40685
- Butler, Judith. 2014. Qu’est-ce qu’une vie bonne ? Paris, Payot & Rivages.
- Butler, Judith et Frédéric Worms. 2021. Le vivable et l’invivable. Paris, Presses universitaires de France.
- Cailloce, Laure. 2022. « La sobriété ne peut pas reposer seulement sur les individus » [entretien avec Sophie Dubuisson-Quellier], CNRS Le Journal. https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-sobriete-ne-peut-pas-reposer-seulement-sur-les-individus?s=09. Page consultée le 13 novembre 2024.
- Collectif. 2020. « Lutter contre le gaspillage : réforme ou révolution » (dossier), Écologie et Politiques, 1, 60. https://shs.cairn.info/revue-ecologie-et-politique-2020-1?lang=fr. Page consultée le 19 novembre 2024.
- Dechézelles, Stéphanie. 2022. « Occupations », dans Didier Fassin (dir.). La société qui vient. Paris, Éditions du Seuil : 1013-1033.
- Devette, Pascale. 2024. « Privilège et sacrifice chez Simone Weil : entre décroissance de l’égo, attention impersonnelle et résistance au pouvoir », Recherches féministes, 37, 1 : 63-79.
- Ferdinand, Malcom. 2019. Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen. Paris, Éditions du Seuil.
- Ferrarese, Estelle. 2023. Le marché de la vertu : critique de la consommation éthique. Paris, Vrin.
- Glissant, Édouard. 1990. Poétique de la relation. Paris, Gallimard.
- Guillard, Valérie. 2021. Comment consommer avec sobriété. Vers une vie mieux remplie. Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur.
- Haraway, Donna J. 2016. Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene. Durham, Dukes University Press.
- Lallement, Michel. 2019. Un désir d’égalité. Vivre et travailler dans des communautés utopiques. Paris, Éditions du Seuil.
- Le Bas, Christian. 2021. « L’innovation frugale peut-elle être un levier de croissance économique pour les pays en développement ? », Mondes en développement, 194, 2 : 121-136.
- Lévinas Emmanuel. 1991. Totalité et infini. Essai sur l’extériorité. Paris, Le Livre de poche.
- Lorrain, Dominique, Charlotte Halpern et Catherine Chevauché. 2018. Villes sobres. Nouveaux modèles de gestion des ressources. Paris, Presses de Sciences Po.
- Mini, Caroline, Eulalie Saïsset et Alexandre Saubot. 2021. Ajustement carbone aux frontières. L’Europe à l’heure des choix. Paris, Presses des Mines.
- Monsaingeon, Baptiste. 2017. Homo detritus. Critique de la société du déchet. Paris, Édition du Seuil.
- Moore, Jason W. 2016. Anthopocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism. Oakland, PM Press.
- Moore, Jason W. 2017. « The Capitalocene, Part I: On the Nature and Origins of Our Ecological Crisis », The Journal of Peasant Studies, 44, 3 : 594-630.
- Plumwood, Val, Diane Linder et Laurent Bury. 2020. Réanimer la nature, Paris, Presses universitaires de France.
- Pruvost, Geneviève. 2021. Quotidien politique. Féminisme, écologie et subsistance. Paris, La Découverte.
- Raworth, Kate. 2017. Doughnut Economics. Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. Londres, Random House.
- Rosa, Hartmut, Sacha Zilberfarb et Sarah Raquillet. 2021. Résonance. Une sociologie de la relation au monde, Paris, La Découverte.
- Semal, Luc, Mathilde Szuba et Bruno Villalba. 2014. « “Sobriété” (2010-2013) : une recherche interdisciplinaire sur l’institutionnalisation de politiques locales de sobriété énergétique », Nature, Sciences, Société, 22, 4 : 351-358.
- Stroude, Aurianne. 2021. Vivre plus simplement. Analyse sociologique de la distanciation normative. Québec, Presses de l’Université Laval.
- Supiot, Alain. 2019. Mondialisation ou globalisation ? Les leçons de Simone Weil. Paris, Éditions du Collège de France.
- Tassin, Étienne. 2012. « La mondialisation contre la globalisation : un point de vue cosmopolitique », Sociologie et sociétés, 44, 1 : 143-166.