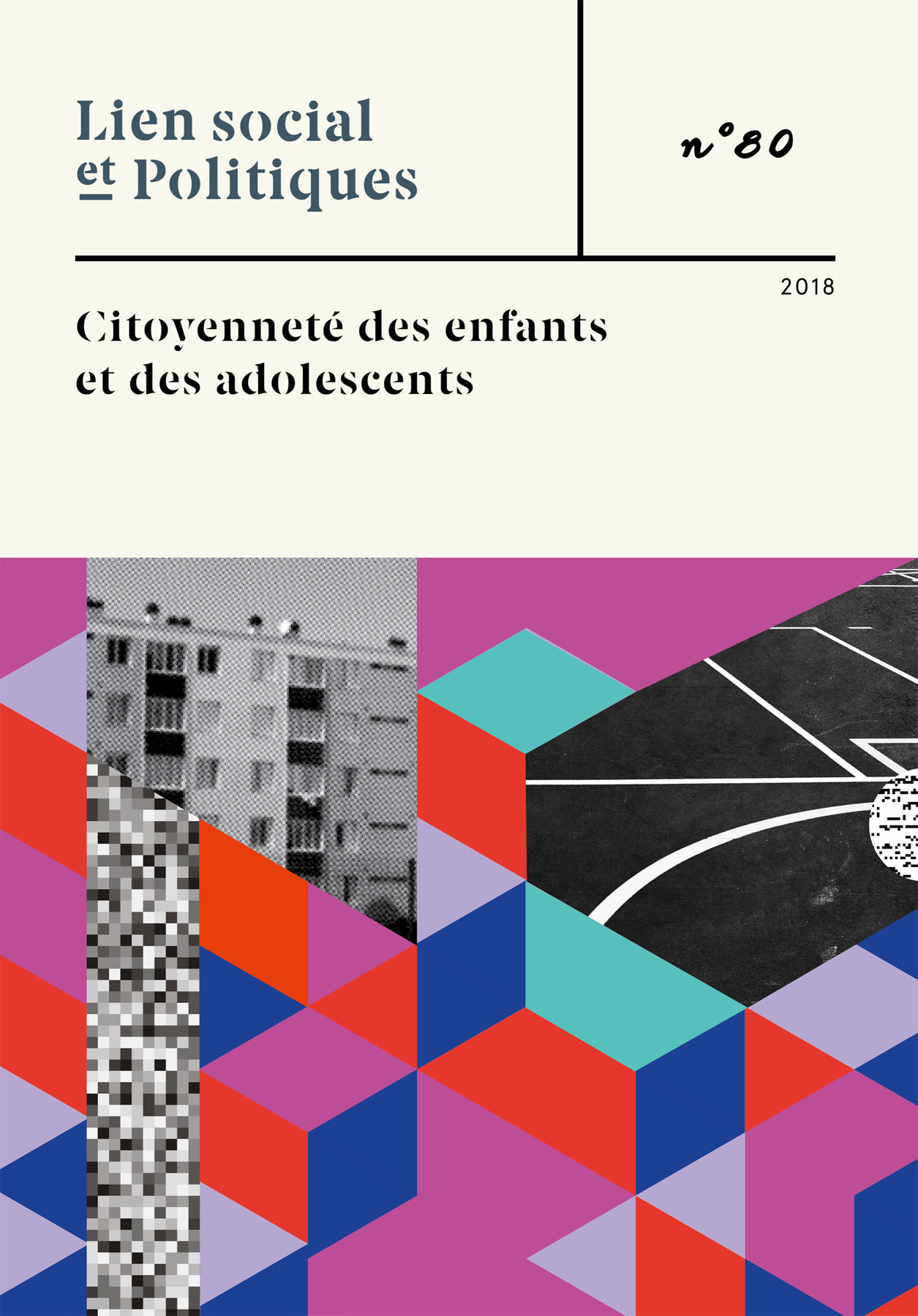Toutes les sociétés, à travers le cours de leurs histoires respectives, ont eu à coeur de former et de socialiser les enfants afin qu’ils deviennent de « bons citoyens ». Dès que des turbulences sociales sont pointées du doigt telles que l’accroissement de la violence, la radicalisation ou même le désengagement politique, les enfants et les adolescents sont la cible de discours publics réformateurs, d’actions éducatives et disciplinaires. Ils deviennent l’écran de projection des peurs, des craintes sociales et des désirs du monde adulte. Même si la citoyenneté des enfants et des adolescents est au coeur de nos politiques publiques, de nos institutions et de nos interactions quotidiennes, elle demeure nébuleuse par son caractère polysémique. Elle fait l’objet d’une pluralité de discours normatifs, d’impératifs moraux et de représentations sociales en tensions les uns avec les autres. En effet, qu’est-ce qu’un bon citoyen ? Selon qui ? Et dans quelle visée ? Les textes réunis pour ce numéro invitent à réfléchir à la notion de citoyenneté enfantine et adolescente dans le contexte des régimes politiques démocratiques. Westheimer (2015) rappelle que l’éducation à la citoyenneté réduite à une socialisation à la civilité et à la responsabilité individuelle s’observe autant dans les régimes totalitaires que dans les régimes démocratiques. La particularité de la citoyenneté démocratique est qu’elle implique une réflexion sur l’égalité et la justice et appelle à des compétences délibératives, critiques et collectives. La difficulté de penser la citoyenneté des enfants et des adolescents s’explique peut-être par son inscription récente dans l’histoire des sociétés. Depuis 1989, La convention internationale relative aux droits de l’enfant leur reconnait de nouveaux droits et un nouveau statut, celui d’un sujet de droit égal à celui des adultes. La question n’est donc plus de savoir s’ils sont citoyens ou non, mais plutôt de réfléchir à la particularité de leur statut, d’analyser le rôle des institutions sociales à leur égard, de comprendre leurs pratiques au sein de la société. Il s’agit d’un chantier de recherche assez récent et ce numéro met en lumière trois défis intellectuels : 1) penser la citoyenneté substantive en tension avec la citoyenneté formelle ; 2) penser la citoyenneté différenciée des enfants et des adolescents ; 3) penser la citoyenneté des enfants au-delà des discours capacitaires. Chacune des contributions de ce numéro révèle clairement un ou plusieurs de ces défis selon différences échelles d’analyse. La première partie du numéro porte sur les normativités et les représentations sociales de la citoyenneté enfantine et adolescente véhiculées par les instruments de politiques publiques en France et au Québec. La deuxième section porte sur les institutions qui répondent directement des politiques publiques et qui ont pour mandat de socialiser et d’éduquer les enfants et les adolescents aux pratiques de citoyenneté démocratique. La troisième section de ce numéro présente deux contributions qui rendent compte de l’agencéité (agency) des jeunes et de leurs pratiques citoyennes, c’est-à-dire leur capacité à développer des intentions politiques et à les mettre en action les uns avec les autres. Ce terme se distingue de celui d’agentivité qui est utilisé davantage en sciences cognitives et s’intéresse plus spécifiquement aux mécanismes de l’action individuelle (Glossaire, 2009). Finalement, nous terminons le numéro par des analyses à l’échelle des quartiers et des organisations jeunesse. On y voit comment les intervenants de première ligne, et leurs organisations locales, négocient différentes visions de l’éducation citoyenne, allant de l’éducation à la civilité jusqu’à l’intervention démocratique. Ces échelles d’analyse nous permettent d’observer les représentations de la citoyenneté en fonction des rapports de classe et d’ethnicité. Les considérations sur la citoyenneté des enfants renvoient directement aux réflexions en cours au sein des citizenship studies …
Parties annexes
Bibliographie
- Ariès, P. (1960c2014). Enfant et la Vie familiale sous l’Ancien Régime (L’). Paris : Le Seuil.
- Bélanger, N., et Connelly, C. (2007). « Methodological considerations in child-centered research about social difference and children experiencing difficulties at school. » Ethnography and Education, 2(1), 21-38. https://doi.org/10.1080/17457820601158994
- Breviglieri, M. (2014). « La vie publique de l’enfant ». Participations, (9), 97-123.
- Caron, C. (2014). Vues, mais non entendues : les adolescentes québécoises et l'hypersexualisation. Consulté à l’adresse http://ebookcentral.proquest.com/lib/uqac-ebooks/detail.action?docID=4797153
- Clarke, J et al., (2014). Disputing citizenship. Bristol : Policy Press.
- Corsaro, W. (2011). « Reproduction interprétative et culture enfantine », dans Julie Delalande et Andy Arleo (dir.) Cultures enfantines. Universalité et diversité, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, France, p. 59-73.
- Glossaire. (2009). « Les mots de Sen... Et au-delà ». Revue Tiers Monde, 198,(2), 373-381. doi :10.3917/rtm.198.0373.
- Isin, E. F., et Turner, B. S. (2007). Investigating Citizenship : An Agenda for Citizenship Studies. Citizenship Studies, 11(1), 5-17. https ://doi.org/10.1080/13621020601099773
- Lister, R. (2007). « Why Citizenship : Where, When and How Children ? » Theoretical Inquiries in Law, 8(2).
- Neveu, C. (2015). « Of ordinariness and citizenship processes ». Citizenship Studies, 19(2), 141–154. https ://doi.org/10.1080/13621025.2015.1005944
- Ogien, A., et Laugier, S. (2014). Le principe démocratie : Enquête sur les nouvelles formes du politique. Paris : La Découverte.
- Vromen, A., et Collin, P. (2010). « Everyday youth participation ? Contrasting views from Australian policymakers and young people ». Young, 18(1), 97-112. https ://doi.org/10.1177/110330880901800107
- Westheimer, J. (2015). What Kind of Citizen ? : Educating Our Children for the Common Good. New York : Teachers College Press.