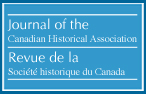Résumés
Abstract
Taking the life of Sarah Selwyn (1809-1907), wife of the first Anglican bishop to New Zealand, the article plots the dynamics of geographic movement and varying communities of connection through which the mid-19thC imperial world was constituted. Negotiating empire and religion, mission and church, high church and evangelical, European and indigenous Maori and Melanesian, Sarah’s life illuminates the intricate networks underpinning – and at times undermining – colonial governance and religious authority. Sarah embarked for New Zealand in late 1841 at a high point of English mission and humanitarian idealism, arriving into a hierarchical and substantially Christianised majority Maori society. By the time she departed, in 1868, the colonial church and society, now European-dominated, had largely taken a position of support for a settler-led government taking up arms against “rebellious” Maori in a battle for sovereignty. In later life Sarah Selwyn became a reluctant narrator of her earlier “colonial” life while witnessing the emergence of a more secular empire from the close of Lichfield cathedral. The personal networks of empire are traced within wider metropolitan and colonial communities, the shifting ground from the idealistic 1840s to the more punitive later 19thC. The discussion traces the larger contexts through which a life was marked by the shifting ambiguities of what it was to be Christian in the colonial world: an agent of empire at the same time as a fierce critic of imperial policy, an upper class high church believer in the midst of evangelical missionaries, someone for whom life in New Zealand was both a profound disjuncture and a defining narrative.
Résumé
À partir de la biographie de Sarah Selwyn (1809-1907), femme du premier évêque anglican de Nouvelle-Zélande, cet article étudie les forces dynamiques qui sous-tendent les déplacements géographiques et les communautés de relations variables grâce auxquelles le monde impérial du milieu du XIXe siècle a pu se constituer. Tiraillée entre les forces en jeu (Empire et religion, mission et Église, High Church et évangélisme, Européens et Maoris ou Mélanésiens), la vie de Sarah illustre les réseaux complexes qui soutiennent (et parfois contribuent à saper) l’autorité coloniale et l’autorité religieuse. Sarah s’était embarquée pour la Nouvelle-Zélande à la fin 1841, à l’apogée d’un mouvement d’idéalisme missionnaire et humanitaire anglais, pour arriver dans une société maorie hiérarchique et dans l’ensemble christianisée. Au moment de son retour en Angleterre, en 1868, l’Église et la société coloniales, désormais sous emprise européenne, s’étaient ralliées à l’idée d’un gouvernement dirigé par les colons qui allaient s’armer contre les Maoris rebelles dans une lutte pour la souveraineté. Plus tard dans sa vie, Sarah Selwyn s’est faite la narratrice réticente de sa vie coloniale , au moment où elle était témoin de l’émergence d’un Empire plus séculier, dans l’enceinte de la cathédrale Lichfield où son mari était évêque. L’auteure reconstitue ici les réseaux personnels de l’Empire dans le cadre de communautés métropolitaines et coloniales larges et changeantes, qui sont passées de l’idéalisme des années 1840 à un climat plus punitif à la fin du XIXe siècle. L’analyse évoque le contexte général dans lequel une vie s’est vue marquée par les ambiguïtés liées à l’affirmation d’une identité chrétienne au sein du monde colonial, Sarah représentant l’Empire tout en étant une critique acharnée de la politique impériale, étant une croyante de la haute société se rattachant à la High Church tout en vivant aux côtés de missionnaires évangéliques, et étant une personne pour qui la vie en Nouvelle-Zélande représentait tout à la fois une profonde disjonction et un récit déterminant.