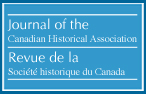Résumés
Abstract
The paper, focused on a few years at the end of the First World War, explores the request of a group of Aborigines in the Australian state of Victoria for freedom of religion. Given that the colony and now state of Victoria had been a stronghold of liberalism, the need for Indigenous Victorians to petition for the removal of outside restrictions on their religious beliefs or practices might seem surprising indeed. But with a Pentecostal revival in train on the mission stations to which many Aborigines were confined, members of the government agency, the Board for the Protection of the Aborigines, preferred the decorum of mainstream Protestant church services to potentially unsettling expressions of charismatic and experiential spirituality. The circumstances surrounding the revivalists’ resistance to the restriction of Aboriginal Christians’ choice of religious expression offer insight into the intersections of faith and gender within the historically created relations of power in this colonial site. Though the revival was extinguished, it stood as a notable instance of Indigenous Victorian women deploying the language of Christian human rights to assert the claims to just treatment and social justice that would characterize later successful Indigenous activism.
Résumé
Cet article explore la demande de liberté de culte, à la fin de la Première Guerre mondiale, présentée par un groupe d’Aborigènes de l’État australien de Victoria. Sachant que la colonie (et désormais l’État) de Victoria était un bastion du libéralisme, il peut paraître surprenant que les Aborigènes aient senti le besoin de présenter une pétition visant à lever des contraintes extérieures imposées sur leurs croyances ou pratiques religieuses. Pourtant, dans la mouvance du renouveau pentecôtiste dans les missions auxquelles nombre d’Aborigènes étaient confinés, les représentants du gouvernement, notamment du Board for the Protection of the Aborigines, préféraient le décorum du culte protestant dominant aux manifestations potentiellement dérangeantes de la spiritualité charismatique et expérientielle des Aborigènes. L’analyse des circonstances entourant la résistance exprimée par les adeptes du renouveau religieux quant aux restrictions imposées aux revendications de liberté religieuse des chrétiens aborigènes ouvre une fenêtre sur l’intersection entre la foi et le statut social des hommes et des femmes dans le cadre des relations de pouvoir historiques créées dans cette société coloniale. Si le renouveau religieux s’est finalement estompé, il n’en demeure pas moins un exemple marquant d’Aborigènes victoriennes ayant recours à la terminologie chrétienne des droits de la personne pour revendiquer un traitement équitable et une justice sociale qui allaient subséquemment caractériser un activisme indigène réussi.