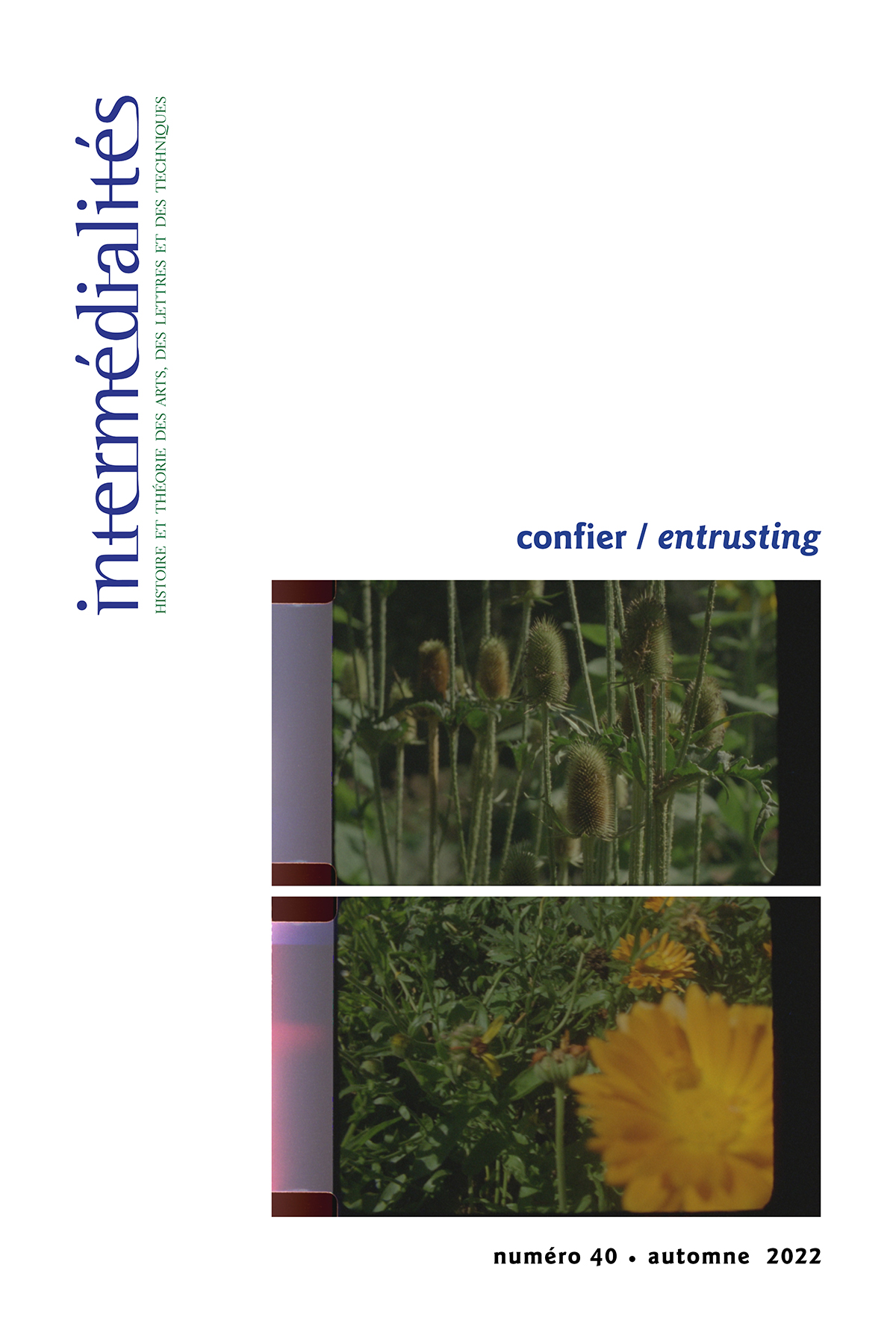Au mois de novembre 2021, nous avons écrit un premier texte liminaire sur le thème de « confier », curieuses de voir se diffracter l’action de « confier » et de « se confier » au prisme de l’intermédialité. Les mots alors choisis avaient pour but de faire émerger un faisceau d’actions, aussi ténues fussent-elles, et de poser quelques balises permettant d’emprunter une approche intermédiale. Ce texte programmatique entendait susciter le désir d’autres chercheurs de réfléchir à cette notion et il a ainsi constitué la trame de l’appel à contributions pour ce 40e numéro de la revue Intermédialités. Parallèlement, il a servi de cadre à deux volets d’un séminaire que nous avons donné conjointement, de part et d’autre de l’Atlantique, au cours des automnes 2021 et 2022. Ce séminaire pluriannuel a servi de laboratoire in vivo, d’expérience orale et chorale assurant la verbalisation autant que la progression de notre enquête. Nous choisissons ici de reproduire ce texte (« Confier : ouvrir »), tant cette étape fut importante dans notre parcours, et tant elle rend compte des formes de médiations créées par les chercheurs eux-mêmes. Si la confiance ne cesse d’être interrogée par les économistes et les sociologues comme un phénomène sociétal dont on mesure le degré, étudie les variations à l’échelle de l’histoire, déplore le manque ou loue le règne, le geste de faire confiance et de confier reste peu étudié en tant que tel. Geste de médiation par excellence aux enjeux multiples, il implique des situations critiques, des choses vulnérables, des êtres aux destins liés, un moment et un lieu propices. Il vise une situation relationnelle, un état, un trait de caractérisation propre tout en étant sans cesse sur le fil et menacé de revirements. On confie son coeur, son âme, sa vie, ce que l’on a de plus cher, ce qui ne peut subsister sans veille. On peut être obligé de faire confiance ou choisir de le faire. On perd en assurance ce que la foi nous donne. L’acte de confier transforme une relation en pari pour l’avenir, au risque de la perdre. On fabrique des secrets, des promesses, des asiles, mais aussi des trahisons, des périls, des chagrins. Il suffit parfois d’une nuit tiède pour aligner les âmes et les corps tels les astres, et d’une autre pour que tout s’effondre. Mais a-t-on toujours pris la mesure de la dimension médiale du geste ? Faire confiance semble relever d’une recherche de relation sans médiation. Point besoin de contrat ou de pacte. Le lien à l’autre devient le seul garant de la bienveillance et de la vigilance de ceux qui se font confiance, réciproquement. Pourtant, il s’agit bien de « faire », donc de fabriquer les conditions qui permettent à un tel lien de s’établir, de produire « l’air » où la confiance (l’ouverture à l’autre, l’engagement) se respire. Comment instaurer la relation là où elle manque, sinon d’abord et avant tout dans le langage, comme premier médium ? Comme tous les gestes, celui de confier se voit aussi façonné par son environnement sociotechnique. Confier quelque chose prend une tournure différente quand cela est fait oralement, corporellement ou au moyen de supports matériels. Ce qui est confié est toujours susceptible d’être partagé, déplacé, transmis, remédié, diffusé par toutes sortes de médias. Rapporter le geste de confiance à l’histoire des techniques (et en particulier des techniques engageant un geste artistique) permet alors de prendre la mesure de cette interdépendance et de voir évoluer les termes mêmes de la relation, entre abandon et contrat, rapport intime et ouverture créative au monde. Et puis, il y a ce …
Introduction. Confier[Notice]
…plus d’informations
Frédérique Berthet
Université Paris CitéMarion Froger
Université de Montréal