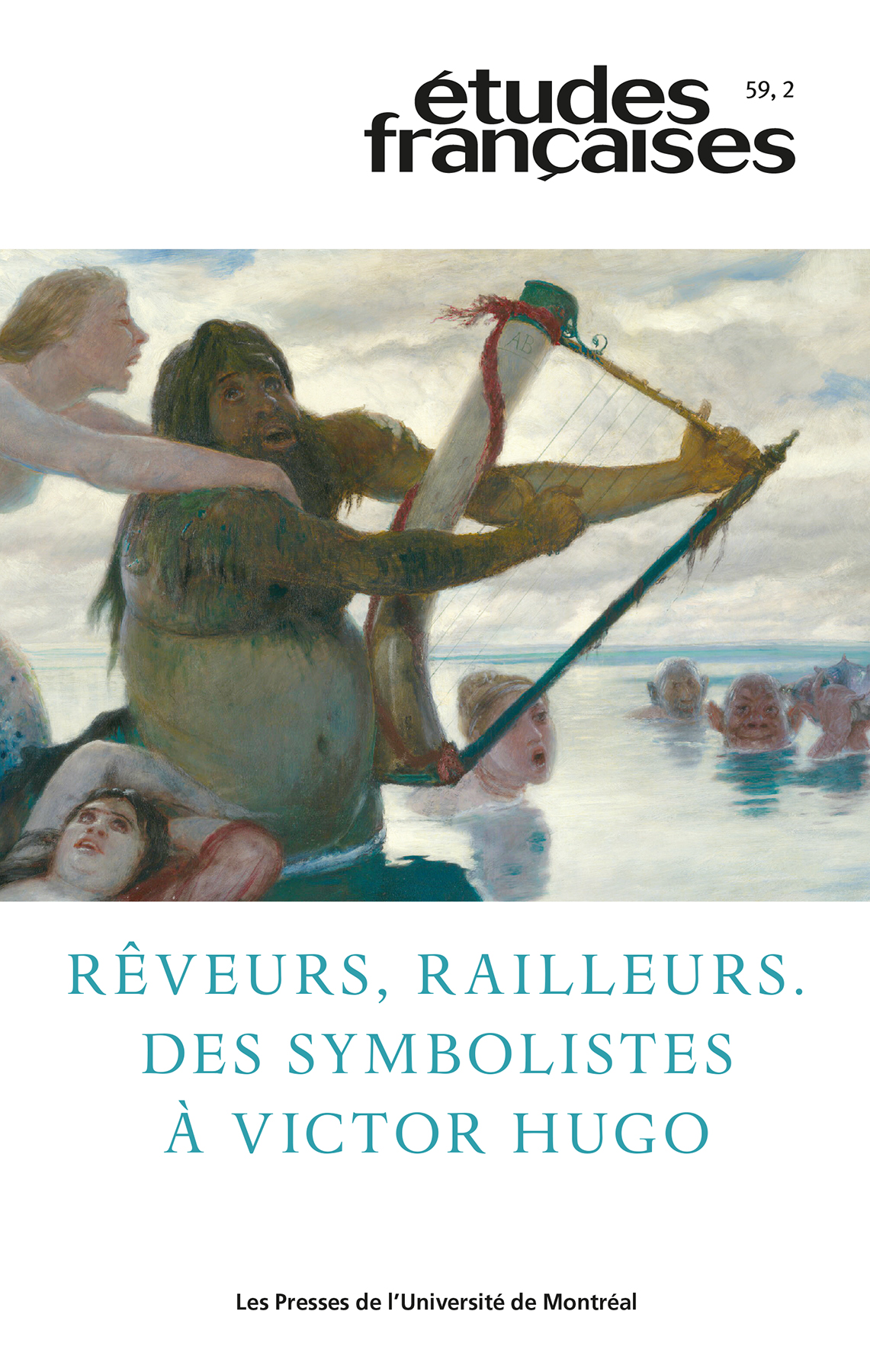Résumés
Résumé
Cet article propose une lecture de trois récents recueils de poèmes portant sur la Côte-Nord québécoise. En s’appuyant sur l’approche phénoménologique des ambiances proposée par Bruce Bégout, il analyse comment Et arrivées au bout nous prendrons racine de Kristina Gauthier-Landry (2020), Juillet, le Nord d’Andréane Frenette-Vallières (2019) et La patience du lichen de Noémie Pomerleau-Cloutier (2021) mobilisent l’affectivité, la sensorialité et une esthétique de la quotidienneté pour créer des ambiances propres à cette région. Tout en inventant de nouvelles façons de dire la Côte-Nord, ces recueils révèlent une nouvelle sensibilité, un nouveau mode d’être dans la poésie contemporaine des femmes au Québec. Ils inaugurent une poésie résolument tournée vers le monde extérieur, dans laquelle le sujet lyrique exprime une appartenance profonde à son milieu. Ce faisant, ils font entendre des voix féminines amples, amplifiées et en symbiose avec l’espace septentrional qu’elles ont choisi.
Abstract
This article proposes an analysis of three recent poetry collections focusing on the North Shore of Quebec. Drawing on Bruce Bégout’s phenomenological approach to atmospheres, it examines how Et arrivées au bout nous prendrons racine by Kristina Gauthier-Landry (2020), Juillet, le Nord by Andréane Frenette-Vallières (2019), and La patience du lichen by Noémie Pomerleau-Cloutier (2021) mobilize affectivity, sensoriality, and an aesthetics of everyday life to create atmospheres specific to this region. While inventing new ways of writing about the North Shore, these collections reveal a new sensitivity, a new way of being in Quebec contemporary women’s poetry. They inaugurate a poetry resolutely oriented towards the external world, in which the lyrical subject expresses a deep sense of belonging to her milieu. In doing so, they give voice to full, amplified feminine voices in symbiosis with the northern space they have chosen.
Corps de l’article
La poésie des femmes a longtemps été abordée selon un nombre restreint de prismes critiques : le féminisme[1], le corps[2], l’intime[3] ou encore la quotidienneté[4]. Ces approches ont permis de mettre en valeur des ambiances souvent feutrées, que ce soit de façon positive (l’intime, le corps comme exploration du sujet, la familiarité du quotidien) ou négative (la chambre comme espace de prédation, le corps souffrant). Plus récemment, le mouvement #MoiAussi a suscité une prise de parole et la parution de nombreux recueils pour dénoncer violences et abus – mouvance qui constitue une part notoire de la poésie des femmes ces dernières années[5]. À certains égards, il est possible d’affirmer que ces recueils s’inscrivent dans une forme de relative continuité avec les prismes critiques que nous venons de citer. Ils problématisent à leur tour les espaces intérieurs, la quotidienneté, le corps, les relations, l’intime – si ce n’est de cette distinction importante : la composante de violence physique, psychologique et symbolique est vigoureusement dénoncée.
En marge cependant de cette urgente problématique sociale, on remarque depuis une dizaine d’années environ l’émergence d’autres voix féminines qui entrent en poésie par des cheminements et des sujets bien différents. Ces poètes se proposent d’explorer des espaces extérieurs en apparence rudes, traditionnellement associés à des valeurs (la force physique, la résistance au froid, le courage) et des activités (la chasse, la pêche, l’exploration, la foresterie) socialement construites comme masculines. On se rappellera la petite fortune littéraire qu’a connue une entrée du blogue « L’Oreille tendue » de Benoît Melançon[6] pour désigner un ensemble d’oeuvres narratives, majoritairement écrites par des hommes, qui inauguraient une néo-régionalité littéraire[7] dont le blogueur identifiait quelques caractéristiques avec autant de malice que de perspicacité. Il relevait, entre autres, l’intérêt que ces auteurs portaient aux régions et tendaient à en souligner des aspects souvent rattachés à la virilité[8].
Si cette mouvance du « néo-terroir » a reçu une certaine attention critique, notons que dans les mêmes années, plusieurs auteures ont repris à leur compte cet intérêt et cette problématisation de la vie en région dans des oeuvres narratives[9]. Mais d’autres choisissent la poésie pour traiter du sujet de la régionalité : Juillet, le Nord[10] d’Andréane Frenette-Vallières, Et arrivées au bout nous prendrons racine[11] de Kristina Gauthier-Landry et La patience du lichen[12] de Noémie Pomerleau-Cloutier sont trois récentes parutions évoquant la Côte-Nord comme objet de représentation et lieu de prise de parole. Ces trois oeuvres aimantent ainsi la réflexion au coeur de notre étude dont l’hypothèse centrale consiste à démontrer que ces recueils, bien loin de réactiver les topoï de la régionalité, proposent des textes où la régionalité est une façon de désenclaver le sujet féminin, de le projeter à, ou vers, l’extérieur, souvent au contact de la nature. Ils évoquent tantôt les villages nord-côtiers, tantôt des espaces forestiers ou boréals marqués par le froid et l’isolement. Ils ont respectivement recours à la mémoire individuelle ou collective, au vécu humain et à la biodiversité (animale, végétale et minérale) de l’endroit. Plus qu’une configuration paysagère en deux dimensions reposant largement sur le visuel, les auteures font émerger un milieu dense, vivant, habité et coloré par les affects d’un sujet lyrique sensible, à l’écoute de ses sensations et sentiments, et des signes qu’envoient la terre et les habitants de ces lieux. S’écartant des dualités « sujet / objet », « nature / culture », cette poésie déplie ainsi une riche écologie relationnelle entre le sujet humain, féminin, et son environnement.
Qu’ont en commun ces recueils ? Il semblerait que ces voix féminines s’attachent à faire émerger une poétique du dehors centrée moins sur l’action, les objets, l’apparence et la parole de personnages (tel qu’on le voit dans les romans néo-régionaux qui avaient suscité la curiosité de Benoît Melançon) que sur des ambiances évoquant la dureté ou une certaine adversité. Ces ambiances sont à la fois propres à chaque lieu défini, mais elles entretiennent aussi certains points communs. En prenant appui sur les travaux du phénoménologue Bruce Bégout, nous suggérons que le concept d’ambiance permet de penser le sujet (féminin ici) en extérieur, littéralement dehors – que ce soit en pleine nature, ou bien dans les rues ou sur le quai d’une localité. Chacun à sa manière, ces recueils mettent en place une ambiance paradoxale propre aux espaces qu’ils évoquent : une ambiance de proximité, de confidence, d’apaisement au sein d’espaces immenses, hostiles ou violents. Mais comment faire émerger des formes d’apaisement dans ce dehors où le sujet se sent souvent vulnérable ? Grâce à une démarche théorique inspirée de la phénoménologie, notre étude propose une lecture analytique des recueils de Kristina Gauthier-Landry, d’Andréane Frenette-Vallières et de Noémie Pomerleau-Cloutier. Les principaux axes de réflexion porteront successivement sur l’attention accordée aux affects, une approche sensible et sensorielle du lieu, et enfin l’ordinaire (comme praxis et objet d’écriture).
Ambiance : cerner l’indéfinissable ?
Le concept d’ambiance est diffus, vaporeux, difficile à saisir. Chacune et chacun en a une compréhension immédiate, mais il semble se dérober aussitôt qu’on essaie de l’expliquer. Il a peut-être en cela quelques accointances avec celui de procédé poétique, volontiers sollicité pour évoquer de façon un peu vague un passage dans un récit, une scène de film ou de la vie quotidienne, doté d’un certain charme ou qui éveille la sensibilité. Ainsi que le résume Vincent Jouve, la poétique « s’est banalisée : elle fait partie du bagage commun et passe inaperçue tant elle est devenue naturelle. […] / [… F]ort de son succès, le terme a pris des acceptions non seulement diverses, mais contradictoires[13]. » Les travaux du sociologue et urbaniste Jean-Paul Thibaud exemplifient ce paradoxe. L’un de ses articles, intitulé « Les puissances d’imprégnation de l’ambiance »[14], multiplie les formulations soulignant la ténuité de toute ambiance : « Il suffit parfois d’un souffle ou d’un murmure, d’un geste ou d’un regard pour qu’une ambiance s’installe, se transforme, s’évanouisse[15] », écrit-il. « [R]éalité atténuée »,
[l]’ambiance peine à s’affirmer et à se faire entendre, sans être pour autant inexistante, illusoire ou irréelle. Cela ne signifie pas non plus qu’elle soit sans effets et sans conséquences. Au contraire, une ambiance n’a d’existence qu’en acte, quand elle exerce son influence et que nous éprouvons son autorité. […] Elle n’est pas la cause d’une influence, mais l’influence elle-même[16].
On comprend dès lors l’intérêt que reçoit ce terme dans des champs de recherche et de recherche-création aussi variés que l’urbanisme, l’architecture, la musique ou les arts visuels. Dans Le concept d’ambiance, le phénoménologue Bruce Bégout évoque d’emblée « cette connaissance spontanée et irréfléchie[17] » que quiconque peut ressentir en pénétrant dans un lieu. Il pose que le sens commun perçoit l’ambiance comme « subjective ou objective[18] », c’est-à-dire comme « interaction à double sens entre l’humeur et le monde ambiant[19] ». Certains théoriciens essaient de penser l’ambiance comme étant à la fois « subjective et objective[20] », « comme un intermédiaire entre eux qui assure leur dialogue[21] ». Rejetant dos à dos les deux faces d’un même dualisme, Bruce Bégout préconise une « approche mersive [qui] vise à saisir l’ambiance comme une expérience qui n’est ni substantielle ni relative. Elle seule laisse être le phénomène comme il se donne, selon sa logique propre, et respecte son auto-déploiement libre et authentique[22] ». Cette conception immersive permet de mieux saisir l’ambiance qui n’est, à vrai dire, ni une entité, ni un arrière-plan, ni une relation. Elle serait plutôt un affect cosmique – au sens de présent dans l’air, sans qu’on puisse ni le voir ni le saisir, mais qui est pourtant bien perceptible. Si son mode temporel varie entre le toujours déjà-là et le passager, son mode spatial est celui de l’ubiquité. L’ambiance traverse, pénètre les êtres qu’elle enveloppe. « Il y a » de l’optimisme ou de la tristesse : l’ambiance se donne de façon immédiate, intuitive, impersonnelle, et peut pourtant être ressentie par tout un chacun. Telle une brume affective et sensorielle, elle enveloppe avec une certaine homogénéité les êtres dans une situation. Dans des termes assez proches, Jean-Paul Thibaud décrit comment l’ambiance est apte à « infuser les expériences quotidiennes et à “atmosphériser” les situations de tous les jours[23] », à définir « l’individuation, […] la singularisation et […] la qualification d’une situation[24] ».
On pourrait penser que cette « approche mersive » et cette « connaissance spontanée et irréfléchie » reposeraient dans un premier temps sur une saisie sensorielle. Or philosophes et créateurs s’accordent sur le « primat de l’affectivité[25] » dans la saisie ambiancielle. Dans une conférence de 2003, l’architecte suisse Peter Zumthor réfléchit à la notion d’ambiance (atmosphere). Comme bien d’autres, il commence par souligner son immédiateté :
Nous percevons l’ambiance à travers notre sensibilité émotionnelle – une force de perception qui fonctionne incroyablement vite et dont nous, humains, avons grand besoin pour nous aider à survivre. […] Quelque chose en nous nous en dit énormément de façon instantanée. Nous sommes capables d’une appréciation immédiate, d’une réponse émotionnelle spontanée, de rejeter les choses le temps d’un éclair[26].
Il revient ensuite sur sa visite d’une église à deux clochers : « Qu’est-ce qui m’a ému ? Tout. Les choses elles-mêmes, les gens, l’air, des bruits, le son, des couleurs, des présences matérielles, des textures, des formes aussi. […] Quoi d’autre encore ? Mon humeur, mes sentiments, une impression d’attente qui m’a envahi alors que j’étais assis là[27]. » Si l’architecte commence par énumérer des perceptions sensorielles, il se rend compte que sa « sensibilité émotionnelle » est au coeur de l’expérience qu’il décrit. Dès l’introduction de son ouvrage, Bruce Bégout insiste lui aussi sur les affects, leur donne préséance sur les perceptions sensorielles. Ainsi, « [l]e sensible, loin d’être inaugural, dérive de l’affectif, et nous ressentons avant de percevoir[28] ». C’est précisément la nature affective de l’ambiance qui semble dicter son approche mersive et son refus de la dichotomie entre objectivité et subjectivité : « L’ambiance est affective dans la mesure où elle nous affecte comme un tout sans objet qui enveloppe, pénètre et transcende notre sensibilité[29]. » Cette dimension affective de l’ambiance constitue un premier point d’entrée dans les oeuvres à l’étude.
L’attention portée aux affects
Et arrivées au bout nous prendrons racine (2020), premier recueil publié par Kristina Gauthier-Landry, fait la part belle aux affects. Il ne s’agit pas d’un flot d’émotions mais d’un effet chromatique, tonal : les émotions « atmosphérisent » les scènes qu’elle évoque dans ce recueil du retour. Le jeu des pronoms entretient une certaine ambiguïté. Trois observations se dégagent toutefois avec une certaine clarté : le « je » est celui d’une femme qui revient dans le village de la Côte-Nord d’où elle est originaire, après l’avoir quitté il y a plusieurs années. La figure du père est importante, notamment dans la première moitié du recueil, alors que la seconde partie illustre davantage le titre : le « je » parle en son nom et en celui d’autres femmes – peut-être la mère, l’aïeule, ou une amie, des voisines. Le recueil s’ouvre dans un mouvement d’approche : les noms des localités avoisinantes (EAB, 13), la route aveuglée par les arbres (EAB, 14, 15), l’orientation des maisons (EAB, 16), le fleuve omniprésent et pourtant invisible (EAB, 17), les odeurs de l’été et de « hot-dogs grillés » (EAB, 18) finissent par mener à « la maison » d’enfance (EAB, 19) ; les poèmes suivants définissent la focale et le ton qui prévalent ensuite dans le recueil – au moment où le « je » bascule dans ses souvenirs d’enfance. Il reste que le propos conserve une certaine réserve. Le « je » évoque ces « villages entiers construits / sur tout ce dont / on ne parle pas » (EAB, 21). La vue est vaste, mais « toutes les maisons boudent / tournent le dos / à la mer » (EAB, 16), « les aulnes sont des oeillères » (EAB, 14) et tous les jours, c’est la même histoire qui se rejoue : « [T]u es parti / compter les jours par brasses / un dessin de moi / en guise de crucifix » (EAB, 23). La petite fille attend son père parti en mer, et cette histoire est celle de toutes les petites filles du village :
EAB, 29cordées sur le quai
on regarde nos pères rentrer la cale comble d’aubes
manquées
et fièrement nous chantons
nos mères sont folles nos mères ont épousé
l’horizon
Rarement nommé de façon explicite, l’ennui règne :
EAB, 55derrière les bardeaux de peur
ça sent la poussière
d’heures
elle s’accumule le long des soirs
et devant la porte
le prélart roule
d’ennui
L’ambiance est ici exprimée par des tours impersonnels (« ça »), un brouillage créé par une image spatiale (« le long de ») pour évoquer une durée et une fréquence (les soirées). Enfin, l’affect comme tel, l’ennui, est attribué à une étendue (« le prélart ») qui s’invisibilise au fil du temps. Au fil des pages, l’absence de visibilité – « stores fermés » (EAB, 34), « yeux barrés » (EAB, 54) –, l’absence de choix, d’autres chemins, d’autres destins renforcent cet affect. Ceci est rendu particulièrement saillant dans le poème qui confectionne « la liste de tous les bonheurs disponibles » (EAB, 33) qui s’offrent à la petite fille. Cette liste se décline en quelques vers volontairement maigres :
EAB, 33un sac de chips
un crush aux fraises
un tour de char
au dépanneur
une tresse française
tirer des roches
sauter du pont
descendre la côte
sans les mains
Malgré tout, à huit ou dix ans, « avoir hâte à demain / est encore mon activité préférée » (EAB, 32), comme si demain allait apporter du nouveau. On comprend que ces bonheurs simples, presque dérisoires, expriment un sentiment d’étiolement. Une ambiance à saveur de « chips » et aux effluves de « fraise » artificielle enrobe le village et ne laisse rien imaginer plus loin que le « pont ». Ici, l’effet de liste décline différentes sensations juxtaposées sans logique ni jugement axiologique ; il fait le pari de re-créer le ressenti en combinant l’odeur, le goût, la mobilité (le « tour de char » et la descente de « la côte »), la proprioception (le lancer de « roches »).
Le recours à l’enfance, période qui préexiste aux mots, mais imprime la mémoire d’images, d’odeurs et de saveurs indélébiles, permet de faire émerger douceur et harmonie. Avec Bruce Bégout, on pourrait dire qu’il s’agit d’une « affectivité vitale[30] », sans objet, sans intentionnalité, et qui se résume à l’expression de « la vitalité interne[31] » du corps et de l’esprit. Il s’agit tantôt d’une douceur tactile et réconfortante qu’évoque « un beau châle » (EAB, 94), tantôt du souvenir auditif de « tes chansons bleues de mer » (EAB, 62). Le goût et les couleurs de l’enfance reviennent lorsque « le ketchup dessine des coeurs / sur nos joues » (EAB, 18), lorsque le père « ram[è]n[e] / des piasses en chocolat » (EAB, 28) ou lors de ce
EAB, 47matin flanelle
beurré doux
joues de farine
aux lèvres
on s’aime grand ouvert
saute pas à côté du four le pain va tomber
Tout est « doux », sucré, tendre et « les baies » cueillies alentour deviendront « confiture » (EAB, 46). Textures et goûts sont convoqués pour faire émerger un ordinaire réconfortant. Les aliments de tous les jours rythment repas et célébrations, ils créent un décor, mais leur disposition dit aussi quelque chose d’un quotidien qu’on imagine fait de peu :
EAB, 45du pain du lait des fruits
sur le comptoir
une canne de fèves ouverte
une cuillère plantée
là
sur le tapis
du soleil et du sable
c’est tout ce qu’on trouvera
en arrivant
Le « je » décrit ces aliments simples car ils constituent tout ce qu’il y a à voir et à offrir. Ces trop rares denrées et objets réfractent le vide et l’absence que laissent les pères et les maris partis en mer. Le poids de l’inquiétude, des « peut-être » est immense et interminable :
EAB, 43on patientait sans but
autre que de voir
nos mères rire
délestées devant la promesse jaunie
d’un lendemain sans peut-être
Kristina Gauthier-Landry décrit un monde où les sentiments se vivent, mais ne se nomment pas : « [L]e lichen millénaire / recouvre le territoire / amortit / notre chute » (EAB, 112). Organisme composite résultant de la symbiose permanente entre un champignon et une algue, le lichen est presque ici une métaphore de l’ambiance qui enveloppe les environs et s’étale pour ne pas parler d’une autre symbiose, celle de sentiments indémêlables : la peine, les déceptions, une certaine langueur et, tout au fond, une sourde angoisse et beaucoup de silence.
De fait, le « je » souligne l’absence de mots significatifs en répertoriant en une accumulation hétéroclite les mots réclames qu’exhibent les murs, panneaux et prospectus :
EAB, 69hôtel motel piscine bar spa wifi 24 heures ordinaire suprême diesel glace ice freins moteurs non merci la violence j’y pense attention à nos enfants ça pourrait être le vôtre bleuets framboises bourgots clams 10 dollars danseuses nues buffet à volonté menu du jour
ici
il n’y a que les napperons
pour vous souhaiter la bienvenue
Chacun est « en rang » pour « la messe » le dimanche, mais « personne ne se rappelle / les paroles » (EAB, 91). Dans les dernières pages du recueil, il ne fait pas de doute que le sujet s’évertue à renverser cette logique des mots automatisés et qui perdent leur sens. Le « nous » féminin et pluriel affirme la nécessité de dire la beauté pour la faire exister : « [N]ous brisons le silence / pour nommer / les choses belles » (EAB, 107). Or « les plus jolis mots / ne sont pas reliés par la route » (EAB, 89). Le sujet égrène des toponymes innus dont les consonnes [k] [p] [t] sont comme des roches pour faire rebondir les voyelles chantantes : « musquaro / makatinau / napetipi » (EAB, 89). Le « je » lyrique devra donc quitter la route du souvenir qui l’avait ramenée jusqu’au village pour aller encore plus loin, là où il n’y a plus ni route ni logique linéaire. Il faudra aller hors de soi, « dans la plaine bienveillante » où « les rubans rose vent / nous guident / nos voeux laissent des traces // nous sommes déjà passées par ici » (EAB, 106). Signes dispersés, fragiles, éminemment féminins, ces « rubans » expriment une présence ténue, discrète, mais résistante.
Kristina Gauthier-Landry donne à voir une Côte-Nord rêche et belle, à travers une sensibilité résolument féminine. La notion d’ambiance permet de résoudre le paradoxe sur lequel repose ce recueil : le propos prend fortement appui sur les sentiments, les affects du « je », mais ne les nomme que très peu tant il est vrai que l’auteure diffracte les affects sur le monde – sans les attribuer directement au « je » lyrique ni aux autres personnes. Sous sa plume, les douceurs de l’enfance, l’attente et les déceptions des femmes, tout comme le relatif silence de la communauté, n’appartiennent pas aux humains ; ils imprègnent tout : le vent, la mer, les fruits, les heures et jusqu’au « ciel bleu fou » (EAB, 7). En ceci, ce recueil crée une ambiance affective qui transcende l’expérience individuelle du « je » lyrique. Ainsi, l’ambiance « est la manifestation que nous sentons autour de nous, et en nous, vibrer le milieu lui-même, que nous éprouvons dans notre chair notre appartenance affective aux situations, et plus profondément au monde, selon un mode de participation absolu qui révèle notre être inséré dans l’être[32] ». Et arrivées au bout nous prendrons racine est un recueil de retour aux origines qui réverbère ainsi cette vibration affective jusqu’aux lectrices et lecteurs.
Les appels de la sensorialité
Pour aussi séduisantes que soient les formulations de Jean-Paul Thibaud lorsqu’il évoque « la réalité atténuée » des ambiances, leurs « puissances d’imprégnation » et la façon dont elles « atmosphérisent » les situations, on comprend qu’elles relèvent davantage d’un certain impressionnisme que d’une entreprise de définition et de conceptualisation très précises. Mais se pourrait-il que ce flou relatif qui persiste autour de la notion d’ambiance tienne moins aux propriétés de l’ambiance qu’aux mots et schémas conceptuels auxquels nous avons recours pour les saisir et les comprendre ? Telle est l’une des pistes de réflexion proposées par Bruce Bégout, qui n’hésite pas à remettre en cause tout un large pan de l’épistémologie occidentale qui considère toujours, d’une part, des entités individuelles (des organismes, humains la plupart du temps, mais pas seulement) dont l’existence se joue, d’autre part, sur un fond qui les entoure : leur environnement. La pensée occidentale dualiste sépare ainsi les entités de leur milieu et conçoit ensuite comme des interactions les relations entre une entité et son environnement, mais aussi les relations des entités entre elles (humain et animal, par exemple). Bruce Bégout va jusqu’à souligner que les langues occidentales elles-mêmes induisent ce modèle de pensée dualiste fondé sur la distinction et l’interaction par leur modèle syntaxique basé sur la partition entre sujet et prédicat : encore une fois, une entité (le sujet) entre en interaction (le prédicat) avec une autre entité ou avec son environnement. Tout un pan de la pensée écologiste est tributaire de ce modèle épistémologique qui consiste à décomposer le monde en entités pour ensuite analyser leurs relations. La pensée écologiste souligne ainsi l’interdépendance de différents organismes dans un même milieu, et comment un changement affectant l’un finit par produire des effets sur d’autres. Pour le phénoménologue, ce paradigme extrêmement prégnant échoue, en partie, à penser le monde, les ambiances et le fragile tissu de relations et d’influences sur lesquels il repose. En effet, une ambiance est un phénomène vague qui n’a pas de limites (du latin finis) et qui est donc indéfini et difficile à définir, impossible à délimiter ou à circonscrire.
Bruce Bégout en appelle donc à un changement de paradigme pour sortir de l’impasse factuelle et conceptuelle qui affecte notre compréhension du monde. Ce ne serait pas sur le mode de la distinction ni même sur celui de la relation qu’il faudrait penser les entités et le monde qui les entoure, mais sur le mode d’une appartenance essentielle, fondamentale. Les êtres vivants s’inscrivent dans le monde dont ils font partie et dont ils s’imprègnent. La compréhension (im)mersive de l’ambiance qu’il promeut relève d’une approche éco-phénoménologique[33] : « Ce que je suis ne se limite pas aux contours de mon corps, aux frontières de ma peau. Je suis pénétré si intimement par le milieu qu’il est en moi comme je suis en lui[34]. » Considérer que les êtres s’inscrivent dans, font partie de ne suffit pas : il faut plutôt penser les ambiances en termes d’appartenance, d’imprégnation, voire de pénétration.
Tel est bien ce qui semble en jeu dans le premier recueil d’Andréane Frenette-Vallières, Juillet, le Nord, dans lequel le sujet féminin tend peu à peu à se dissoudre dans le milieu septentrional qu’il explore. La voix féminine paraît encline à une certaine retenue, à une économie de mots et d’émotions. Mais face à cette posture introvertie, propice à l’introspection – « Je reste intérieure » (JN, 19) –, les espaces immenses et ouverts qui l’entourent la projettent à l’extérieur d’elle-même vers le dehors, dans l’ambiance unique de ce lieu sauvage que la jeune femme découvre en grande partie seule, par elle-même : « Je refusais toute aide, essayais d’être indépendante » (JN, 12). Il en résulte une articulation saisissante entre la vie intérieure et le monde vivant à l’extérieur – équivalente à celle que propose le titre en associant de façon elliptique la chaleur d’un moment de l’année (« Juillet ») à un espace septentrional évoquant le froid (« le Nord »), contraste qui revient à plusieurs reprises dans les poèmes.
Le « je » lyrique s’initie à l’apprentissage des codes pour lire et dire l’espace nordique. De multiples et riches sensations viennent tout d’abord éveiller la sensibilité : « La lumière », omniprésente, « exige trop / crève mes yeux » (JN, 43), mais aussi les cris des oiseaux de mer – « Des goélands braillent / à la fenêtre » (JN, 63) – et les saveurs que font découvrir la cueillette : « Je tire sur des fleurs violettes / les mange : / elles goûtent les petits pois » (JN, 20). Les sensations tactiles que procurent « un lit / de mousses » (JN, 29) ou « les lichens [qui] chatouillent » (JN, 30) sont nombreuses, exacerbées par des contrastes : « [L]es eaux glaciales de juillet / me ramènent / la clarté » (JN, 25), « [m]ais je vais trop vite, dévore tout / rouge / de brûlures et de / pelures » (JN, 25). Ainsi que le souligne Jean-Paul Thibaud,
[l]a lumière, le son, l’odeur, la chaleur et, plus généralement, l’air, sont des médiums plastiques, réceptifs et réactifs aux conditions de leur propagation. En se diffusant, ils se chargent de l’espace qu’ils traversent, se colorent des formes et des matériaux qu’ils rencontrent. […] L’ambiance relève donc d’une physique contextuelle qui ne peut se passer de l’épreuve du in situ[35].
Tout semble indiquer que le « je » veuille justement vivre cette « épreuve du in situ » de façon intense, complète. Les rares personnes que le « je » voit sont « [l]es femmes de la côte » (JN, 22). Dans une formulation très proche de celle de Kristina Gauthier-Landry, Andréane Frenette-Vallières décrit comment « [e]lles vont, flottantes / elles sont le bout du monde » (JN, 23). Leurs corps sont tellement acclimatés à ces régions qu’elles en ont « le sang salé », faisant ainsi véritablement corps avec leur milieu. Il en est bientôt de même pour un personnage de médiation qui apparaît quelques pages plus loin :
JN, 26Le coussinet moelleux de
mon doigt se pique
sur le contour d’un sapin.
Ce sapin, un homme sorti des branches
l’a dessiné
pour moi
Cet « homme du dessin » (JN, 35) qui « a poussé ici » (JN, 51) semble se confondre avec son milieu :
JN, 51Des grains de sable se lovent dans les plis
de son cou
la couleur de ses yeux s’ajuste à celle
de l’eau, sa voix à celle
de la forêt
Il l’initie à la lenteur et aux savoirs que requièrent ces paysages, leurs textures et les possibles qu’ils offrent – ou peut-être n’est-il que le véhicule que la nature emploie pour se révéler au « je ». Et de fait, le « je » va peu à peu se confondre à son tour avec ce milieu :
JN, 31J’ai la peau vert menthe
à force de m’étendre dans la forêt
brûlée.
J’en reviens égratignée
les arbres noircis fendent
ma surface
Les contours de son corps s’estompent pour se laisser envahir par l’ambiance locale : « La brume, épaisse / creuse mon corps » (JN, 33) ; « défaisons / nos visages » (JN, 52), dit-elle encore, « nous nous regardons maigrir / nous laissons aller à / l’effacement » (JN, 63), « [j]e n’ai plus de contours / ils s’accordent fluides / aux siens » (JN, 51). Nous évoquions un peu plus tôt comment l’ambiance est sans limites claires. Ici, la brume enveloppe la silhouette, efface les contours corporels, et notamment le visage. Cette perméabilité corporelle du sujet confine presque à la consubstantialité. Elle apparaît à travers des images évoquant le brouillage et la fluidité : « Mélange d’obscurité et d’eau : le fleuve, la douche, la pluie, les larmes, la salive. […] Il pleut si fort » (JN, 67). Les eaux des alentours et celles du corps se confondent : « La bruine la nuit passée / c’était moi » (JN, 42). Ces images témoignent d’une expérience totale qui engage pleinement la subjectivité en même temps qu’elle semble se dissoudre dans l’air et les éléments environnants, les infusant de sa présence. Dans les dernières pages du recueil, le « je » mesure la prégnance de son expérience :
JN, 58Je ne connais pas
ce territoire
mais tranquillement, il me fait ;
je ne sais plus où
revenir
La catachrèse visant à opposer « un avant » et « un après » à une expérience déterminante est ici transposée en termes spatiaux entre un ici (« ce territoire ») et un là-bas (« où revenir »). Juillet, le Nord illustre avec éloquence et simplicité la dimension sensorielle et puissamment (im)mersive de cette ambiance d’espace sauvage : l’attention aux perceptions sensorielles révèle le monde différemment et donne à ressentir une appartenance profonde à qui sait accepter d’abandonner les logiques dualistes, et de se laisser sentir « enveloppé, pénétré, agrandi[36] », débordé par le ressenti. Bégout a recours au concept d’ampleur[37] pour qualifier la spatialité et le ressenti des ambiances. Le mot « immensité » met l’accent sur la dimension effarante de ces espaces ; celui d’« ampleur » tend plutôt à souligner la liberté et les possibilités qu’ils offrent. Une femme ample, amplifiée, en symbiose avec l’espace septentrional qu’elle apprend à déchiffrer : telle est bien la voix que fait résonner Juillet, le Nord.
La pratique et l’écriture de l’ordinaire
Un troisième recueil portant sur la Côte-Nord et ses ambiances particulières a retenu l’attention ces dernières années. Après Brasser le varech (2017), Noémie Pomerleau-Cloutier fait paraître La patience du lichen en 2021. À certains égards, ce recueil est à la poésie ce que les films de cinéma direct de Pierre Perrault sont au cinéma : entreprise documentaire et poétique où le « je » s’efface autant que possible pour se mettre tout entier au service de son sujet, les « Coasters francophones, anglophones et innus » (PL, 6) de la Basse-Côte-Nord. La patience du lichen se présente ainsi comme une collection de témoignages glanés dans les villages grâce à « une enregistreuse » (PL, 6). Cette fabuleuse odyssée humaine commence bien après l’endroit où « il y a toujours quelqu’un pour faire une photo / de la pancarte 138 FIN » (PL, 22). Ce recueil est ainsi un hommage « Aux Coasters » (PL, 7) éparpillés le long de « la route qui ne se rend jamais » (PL, 249), mais c’est surtout un livre qui leur donne voix, car chaque poème retrace l’histoire d’une vie, donnant souvent à entendre les mots mêmes dans lesquels elle a été racontée. Dans une note liminaire expliquant son projet, l’auteure précise : « J’ai séjourné dans chacune de ces communautés […] pour écouter ces gens me raconter leurs vies plus saisissantes encore que les paysages de leur côte » (PL, 6). Le recueil se construit donc selon une logique géographique linéaire, chacune de la quinzaine de communautés visitées donnant son nom à l’une des sections. En cela, La patience du lichen est avant tout une aventure d’écoute exemplaire. L’ambiance des lieux est rendue non plus tant par le prisme des affects ou des sensations du sujet – encore que ceux-ci affleurent souvent –, mais bien davantage par le pouvoir d’évocation des formulations, des anecdotes et récits de vie qui lui sont confiés. Saisir une vie ou donner un aperçu d’un incident qui a eu lieu des années plus tôt en quelques vers est un vaste projet où l’ordinaire occupe un point focal. Cherchant à cerner les manifestations de l’ordinaire en poésie, François Paré énumérait dans cette revue « la recherche sporadique, mais tenace, des formes multiples du simple : transparence supposée de l’objet décrit, dénuement syntaxique et lexical, oralité[,] refus de l’institution sociale, subjectivité[38] ». Tous ces traits se rencontrent dans le recueil de Noémie Pomerleau-Cloutier, mais la simplicité présupposée de l’objet (la vie de ces habitants) et celle du projet d’écriture (écrire des poèmes à partir de ces témoignages) ne sont qu’apparentes. Les poèmes, tous parfaitement autonomes, ont ce côté « sporadique », hasardeux, relevé par François Paré, mais leur nombre même, ainsi que l’exigence éthique de rendre la parole reçue de façon juste, dénotent aussi une ténacité remarquable.
Là où « la survivance / [est] une entreprise en soi » (PL, 32) et où « [l]e ravitaillement est un art complexe » (PL, 107), il est toujours question de distances, de pêche et d’entraide. L’ambiance est de sel, de vent, de morue, de « plage devenue argentée » où « le capelan roule » (PL, 223). La mer, le froid, la maladie ne pardonnent guère ; l’enfance n’a que peu de temps pour l’innocence. L’isolement est à peu près le seul paramètre qui ordonne la vie individuelle et collective. Il n’a pas besoin d’être nommé : il résonne dans chaque témoignage. Dans ce contexte, tout ce qui crée un lien, tout ce qui met en relation, permet l’échange ou fournit un point de repère, devient précieux tant sur le plan pratique que symbolique. Ainsi, « les lignes hydroélectriques » (PL, 23) que construisent les hommes, les signaux du « télégraphe » (PL, 42) dont les femmes se transmettent le langage au fil des générations, la poste (PL, 89, 170), les phares, « les bateaux » (PL, 241), « le pont de glace » (PL, 92), tissent de précieux réseaux de circulation et de communication censés suppléer à la route inexistante, jamais achevée :
PL, 245dans vos communautés
invisibles
sur leurs cartes
vous aimeriez seulement
connecter les miettes d’asphalte
une maille à l’endroit
une maille à l’envers
tout le monde ensemble
un chalut de garnotte
pour finir les quatre cents kilomètres
qui endigueront
l’épuisement
Les métaphores féminines de la couture et du tricot ou encore de la musique (PL, 136) reprennent les mêmes sèmes à plus petite échelle. Ainsi les femmes tissent-elles, « le long de la laine » (PL, 81), avec « leurs mots reprisés // une sororité / sertie de fils / pour ce qui s’élime » (PL, 34). On perçoit, dans ces citations, l’importance du lien, du tissage, de ce qui fait tenir ensemble. Preuve de leur force évocatrice et symbolique, ces éléments deviennent à l’occasion des comparants entre eux : ainsi, « le bureau de poste » est métaphorisé en « phare » lumineux en cela qu’il contribue à maintenir la communication avec l’extérieur : « [L]e bureau de poste est un phare / dans l’obscurité / du dépeuplement » (PL, 212). Mais les phares eux-mêmes, censés entretenir la lumière, donnent lieu à une autre forme d’« obscurité » : « [A]vec les phares / s’éteignent / les savoirs maritimes » (PL, 91). La métaphore de la lumière qui s’estompe aux sens propre (la luminosité du phare) et figuré (les savoirs spécifiques) est reprise d’une image à l’autre. La survie, « l’épuisement » (PL, 245), les fermetures d’écoles sont d’autres façons de parler de communautés clignotantes, à l’avenir incertain : « [D]ouze ans de jachère / se terminent cette année / par une classe de maternelle / fleurissant enfin » (PL, 73).
Les portraits de pêcheurs, de guides de pêche, de mineurs, d’enseignantes, de mères de famille, de sages-femmes, de contrebandiers se racontent en français, en anglais, en innu-aimun, dans leurs propres mots. Tous racontent des modes de vie qui s’effilochent :
PL, 26these were the old days
when people would come to help you
and we were living pretty much
off the land and off the sea[39]
l’érosion affecte bien plus que le territoire
Des communautés, des arts de faire, de dire et de partager s’efforcent de résister à l’« érosion ». Significativement, le « je » lyrique reprend plus loin cette métaphore entre « territoire » et « humain », soulignant à nouveau leur perméabilité : « Je ne comprendrai jamais la frontière entre le territoire et l’humain » (PL, 123). On retrouve, comme chez Andréane Frenette-Vallières, une imprégnation mutuelle entre l’« humain » et le milieu. L’ambiance est ici d’épuisement, d’essoufflement. Elle prend consistance un peu plus à chaque page : « aucun coup de pagaie n’est assez fort / pour ramener ce qui est disparu » (PL, 104) lorsque « ne reste que le blanc du silence / les vagues sans pieds / et un nom gravé quelque part » (PL, 105). Les plaies sont particulièrement douloureuses, impossibles à cicatriser dans les communautés innues :
PL, 163tu iras là
où la rivière coule
rouge
voir la tombe
de l’homme
qui se prenait pour Dieu
j’irai quand je serai prête
nika ituten miam aieshkuapiani
à pardonner
tshetshi kashinamuk
Il n’y a aucune tension ni concurrence entre les communautés. La tension vient d’ailleurs, de très loin :
PL, 46entre les peuples
les gouvernements
sont des barrages
encore plus imposants
que ceux d’Hydro
Ces communautés n’entrent dans aucun plan d’aménagement du territoire, de développement touristique ou d’infrastructure. Par leurs identités mêlées, elles suscitent une certaine méfiance de la part des gouvernements qui ne peuvent les fixer ni dans les cases de leurs formulaires ni dans leurs plans. Un sentiment d’être oublié, inconnu, de valeur négligeable s’exprime alors :
PL, 82we are
this weird English Newfie place
yet extremely beautiful
in Quebec
that no one knows
or cares about[40]
Il est difficile ici de démêler les sentiments de paix et d’abandon. « [D]es décideurs qui ignorent ton existence / déterminent si tu manges à ta faim // dans cet écosystème / tu es un plancton » (PL, 234), affirme le « je » avec une métaphore parfaitement ajustée au propos des pêcheurs soumis aux quotas. Peut-on trouver métaphore plus humble que celle du « plancton », pourtant chaînon essentiel de vie qui assure la survie de tous les autres situés plus haut dans la chaîne alimentaire ?
Tout ce recueil baigne dans une ambiance douce-amère : faire appel à la mémoire ravive toujours quelques souvenirs de temps plus glorieux, d’anecdotes touchantes ou précieuses que les gens confient au « je ». Mais une certaine inquiétude, un sentiment d’inéluctabilité, de perte, rôde, omniprésent : « Je reconnais la douceur et le poids de ce qu’on me donne à rapporter. / Les limites du monde sont des lieux de proximité » (PL, 153). Bien conscient de la portée éthique de son propos, le « je » lyrique mesure l’accès privilégié à leur quotidien que lui offrent de parfaits inconnus. Dans ces contrées qui paraissent situées aux « limites du monde », encore une fois ces limites s’estompent par l’ambiance de proximité que créent la courtepointe de témoignages que collecte le « je ».
La lecture de ces trois remarquables recueils fournit l’occasion d’une réflexion sur le concept d’ambiance, avec un éclairage essentiellement phénoménologique, précisément parce que ces recueils développent des ambiances marquantes qui colorent leur lecture. Et arrivées au bout nous prendrons racine a permis de souligner la dimension affective des ambiances, Juillet, le Nord, la dimension sensorielle, tandis que les ambiances dans La patience du lichen sont tributaires des activités et des paroles quotidiennes des interlocuteurs du « je » lyrique.
La poésie contemporaine, incarnée ici par Kristina Gauthier-Landry, Andréane Frenette-Vallières et Noémie Pomerleau-Cloutier, montre qu’il est possible de parler de région, d’espaces périphériques, de façon originale, sans réactiver ni détourner des traits stylistiques ou des stéréotypes associés à la littérature du terroir, ou à la (néo-)régionalité. Leurs recueils révèlent qu’une génération de femmes à la parole mûre explore de nouveaux territoires, par-delà ceux de l’intime, du corps ou du minimalisme. Les sujets de ces recueils mettent en scène des femmes souvent à l’extérieur, qui font face aux rigueurs de la vie, au contact des éléments (Et arrivées au bout nous prendrons racine), seule (Juillet, le Nord) ou en se mettant à l’écoute des populations locales (La patience du lichen). Si Kristina Gauthier-Landry et Noémie Pomerleau-Cloutier mettent surtout l’accent sur les gens et leurs arts de faire, Andréane Frenette-Vallières s’intéresse davantage à la végétation et à la faune. Dans les trois cas, les auteures soulignent une certaine ambivalence entre la fragilité du sujet et sa détermination à surmonter cette vulnérabilité. Se mesurer à ces espaces amples et farouches est une mise à l’épreuve de soi-même (surtout chez Frenette-Vallières) en même temps qu’une quête aux accents presque ethnographiques (chez Pomerleau-Cloutier et Gauthier-Landry). Ces voix féminines du dehors font exister poétiquement la Côte-Nord dans toutes ses dimensions oxymoriques : une beauté rude, une nature austère et généreuse autant qu’envoûtante, une mémoire individuelle et collective douce-amère, un accueil chaleureux dans des villages qui s’effacent des cartes.
Parties annexes
Note biographique
Les travaux d’Élise Lepage, professeure agrégée à l’Université de Waterloo, portent sur l’imaginaire géographique et le paysage dans la littérature québécoise et la francophonie canadienne, notamment en poésie. Elle a, entre autres, publié Géographie des confins. Espace et écriture chez Pierre Morency, Pierre Nepveu et Louis Hamelin (David, 2016), codirigé deux ouvrages collectifs et plusieurs dossiers de revues savantes. Depuis 2015, elle tient la chronique annuelle de poésie de la revue University of Toronto Quarterly. Elle dirige la collection « Voix savantes » aux Éditions David et est membre du comité éditorial des revues @nalyses et Québec Studies.
Notes
-
[1]
Isabelle Boisclair et Catherine Dussault Frenette, « Mosaïque : l’écriture des femmes au Québec (1980-2010) », Recherches féministes, vol. 27, no 2, 2014, p. 39-61.
-
[2]
Voir par exemple Denise Brassard, « Fenêtre sur corps. L’esthétique du recueillement dans la poésie de Louise Dupré », Voix et images, no 101 (vol. 34, no 2, « Louise Dupré »), hiver 2009, p. 43-58.
-
[3]
Voir notamment les travaux de Nicoletta Dolce, La porosité au monde. L’écriture de l’intime chez Louise Warren et Paul Chamberland, Montréal, Nota bene, « Littérature », 2012 et « Parcours intimes dans la poésie québécoise contemporaine », dans Jacques Paquin (dir.), Nouveaux territoires de la poésie francophone au Canada 1970-2000, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, « Archives des lettres canadiennes », t. XV, 2012, p. 95-114, ainsi que la section « La poésie et la fiction intimistes », dans Michel Biron, François Dumont et Élisabeth Nardout-Lafarge, avec la participation de Martine-Emmanuelle Lapointe, Histoire de la littérature québécoise, Montréal, Boréal, 2007, p. 604-612.
-
[4]
Voir par exemple Louise Dupré, « Denise Desautels : la pensée du jour », Études françaises, vol. 29, no 3 (« La poétique de poète »), hiver 1993, p. 41-50.
-
[5]
Élise Lepage, « Poésie », University of Toronto Quarterly, vol. 87, no 3 (« Lettres canadiennes 2016 / Letters in Canada 2016 »), été 2018, p. 64-84.
-
[6]
Benoît Melançon, « Histoire de la littérature québécoise contemporaine 101 », L’Oreille tendue, 19 mai 2012 (en ligne : oreilletendue.com/2012/05/19/histoire-de-la-litterature-quebecoise-contemporaine-101/, page consultée le 31 mars 2024).
-
[7]
Voir à ce sujet les travaux de Francis Langevin, « Un nouveau régionalisme ? De Sainte-Souffrance à Notre-Dame-du-Cachalot, en passant par Rivière-aux-Oies (Sébastien Chabot, Éric Dupont et Christine Eddie) », Voix et images, no 101 (vol. 36, no 1, « Narrations contemporaines au Québec et en France : regards croisés »), automne 2010, p. 59-77 ; « La régionalité dans les fictions québécoises d’aujourd’hui. L’exemple de Sur la 132 de Gabriel Anctil », Temps zéro, nº 6, 2016 (disponible en ligne : tempszero.contemporain.info/document936, page consultée le 31 mars 2024) ; « Mourir en région », Voix et images, no 133 (vol. 45, no 1, « La région dans la littérature du Québec »), automne 2019, p. 29-47. Voir aussi la présentation de ce numéro de Voix et images par Isabelle Kirouac Massicotte, Élise Lepage et Mathieu Simard, p. 7-13.
-
[8]
Quelques-uns des points communs que Benoît Melançon identifie sont « une présence forte de la forêt, la représentation de la masculinité, le refus de l’idéalisation et une langue marquée par l’oralité ». Des personnages masculins sont au centre de récits réalistes qui frôlent parfois le fantastique ; « saisis dans un décor non urbain », ils expriment ou subissent diverses formes de violence (loc. cit.).
-
[9]
Quelques exemples de la même génération que celle identifiée par Benoît Melançon : Mylène Bouchard, La garçonnière, Saguenay, La Peuplade, 2009 ; Myriam Caron, Génération pendue et Bleu, Montréal, Leméac, 2011 et 2014 ; Geneviève Pettersen, La déesse des mouches à feu, Montréal, Le Quartanier, 2014 ; Érika Soucy, Les murailles, Montréal, VLB, 2016 ; Virginie Blanchette-Doucet, 117 Nord, Montréal, Boréal, 2016 ; et, dans un ordre un peu différent, on peut penser à Malabourg de Perrine Leblanc, Paris, Gallimard, 2014 et aux romans d’Audrée Wilhelmy.
-
[10]
Andréane Frenette-Vallières, Juillet, le Nord, Montréal, Noroît, « Initiale », 2019. Désormais abrégé JN suivi du numéro de la page.
-
[11]
Kristina Gauthier-Landry, Et arrivées au bout nous prendrons racine, Saguenay, La Peuplade, « Poésie », 2020. Désormais abrégé EAB suivi du numéro de la page.
-
[12]
Noémie Pomerleau-Cloutier, La patience du lichen, Saguenay, La Peuplade, « Poésie », 2021. Désormais abrégé PL suivi du numéro de la page.
-
[13]
Vincent Jouve, « De quoi la poétique est-elle le nom ? », Fabula-LhT, no 10 (« L’Aventure poétique », dir. Florian Pennanech), décembre 2012, § 1 et 2 (disponible en ligne, DOI : 10.58282/lht.425).
-
[14]
Jean-Paul Thibaud, « Les puissances d’imprégnation de l’ambiance », Communications, no 102 (« Exercices d’ambiances. Présences, enquêtes, écritures », dir. Olivier Gaudin et Maxime Le Calvé), 2018, p. 67-79 (nous soulignons).
-
[15]
Ibid., p. 67.
-
[16]
Ibid.
-
[17]
Bruce Bégout, Le concept d’ambiance. Essai d’éco-phénoménologie, Paris, Seuil, « L’ordre philosophique », 2020, p. 14.
-
[18]
Ibid., p. 400.
-
[19]
Ibid.
-
[20]
Ibid.
-
[21]
Ibid.
-
[22]
Ibid., p. 44.
-
[23]
Jean-Paul Thibaud, loc. cit., p. 67.
-
[24]
Ibid., p. 71.
-
[25]
Bruce Bégout, op. cit., p. 8.
-
[26]
Peter Zumthor, Atmospheres. Architectural Environments. Surrounding Objects, Basel / Boston / Berlin, Birkhäuser, 2006, p. 13 (« We perceive atmosphere through our emotional sensibility – a form of perception that works incredibly quickly, and which we humans evidently need to help us survive. […] Something inside us tells us an enormous amount straight away. We are capable of immediate appreciation, of a spontaneous emotional response, of rejecting things in a flash » ; nous traduisons).
-
[27]
Ibid., p. 17 (« So what moved me ? Everything. The things themselves, the people, the air, noises, sound, colours, material presences, textures, forms too […]. What else moved me ? My mood, my feelings, the sense of expectation that filled me while I was sitting there » ; nous traduisons).
-
[28]
Bruce Bégout, op. cit., p. 10-11. « Ainsi, la perception ne se prolonge pas en affectivité. Elle naît de l’affectivité elle-même. Je ne perçois pas un objet isolé dans une intuition sensible simple et pure, auquel, ensuite, je peux attribuer, selon mon tempérament et mon histoire personnelle, des qualités affectives variables. Je perçois d’emblée quelque chose qui vibre comme agréable ou triste, paisible ou inquiétant. Et ce n’est qu’ensuite, grâce à son atténuation progressive, que je peux détacher de cette impression affective originelle des qualités sensibles, des informations objectives. La vision des formes succède toujours à l’impact des affects » (ibid., p. 10).
-
[29]
Ibid., p. 11.
-
[30]
Ibid., p. 11.
-
[31]
Ibid.
-
[32]
Ibid., p. 44-45.
-
[33]
Bruce Bégout a soin de préciser : « [L]e point de vue écologique dont nous parlons ici ne renvoie pas à la nature et à sa protection. Philosophiquement parlant, il signifie la prise en compte de la situation environnementale de tout phénomène » (ibid., p. 39).
-
[34]
Ibid., p. 44.
-
[35]
Jean-Paul Thibaud, loc. cit., p. 69.
-
[36]
Bruce Bégout, op. cit., p. 134.
-
[37]
Voir notamment ibid., p. 122-134.
-
[38]
François Paré, « Présentation », Études françaises, vol. 33, no 2 (« L’ordinaire de la poésie »), automne 1997, p. 3 (nous soulignons).
-
[39]
« C’était d’même dans l’temps / quand le monde venait t’aider / et on vivait plus ou moins / de la terre et de la mer » (nous traduisons).
-
[40]
« On est / cette drôle de place d’Anglos de Terre-Neuve / pourtant extrêmement belle / au Québec / que personne ne connaît / dont personne ne se préoccupe » (nous traduisons).