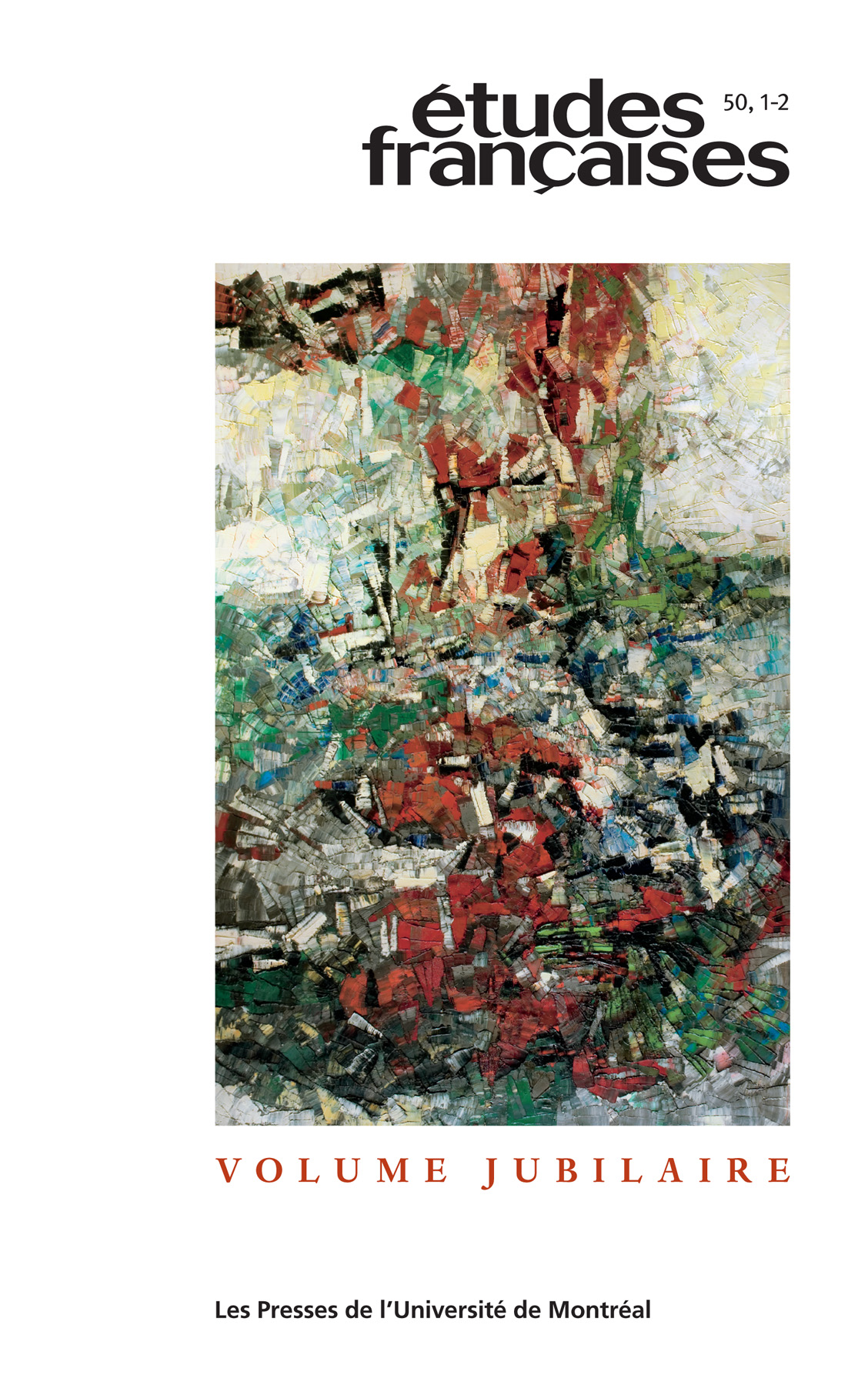J’ai longtemps cru qu’un atavisme insurmontable me rattachait à la race des vaincus. Je le crois toujours, mais sans voir là rien de malheureux ni même de déplorable. J’aurai au moins réussi à voir un peu clair dans ce que j’appelle mes ténèbres, à être par moments secourable pour mes proches — surtout attentif aux enfants que la vie a mis sur mon chemin. Avoir réussi cela n’a, bien sûr, rien d’extraordinaire. Mais l’extraordinaire ne m’a jamais attiré, moi à qui la vie ordinaire offre suffisamment d’occupations et de satisfactions. En 1870, Victor Hugo note dans ses Choses vues qu’il a planté un chêne. La veille, le concile avait déclaré le Pape infaillible ; sans préciser si ce décret avait un effet rétroactif, Hugo annonce avec cette belle assurance que lui donne le sentiment de son génie : « Dans cent ans, il n’y aura plus de guerre, il n’y aura plus de pape, et le chêne sera grand. » Il aura eu raison pour ce qui est du chêne. La révision de mes carnets pour Le sourire d’Anton, j’en tire une certaine satisfaction, bien que me pèse par moments ce retour aux décennies passées et au personnage que j’étais, pas si différent de celui que je suis maintenant. Quand j’en serai à traiter les carnets plus récents, il n’est pas sûr que je me plairai davantage en ma compagnie. Dès qu’on est ramené dans le passé, on se sent réduit à soi — sensation qu’une réécriture un tant soit peu rigoureuse tente de nous rendre supportable. Voilà pourquoi on a une nette préférence pour les notes moins intimes et qu’on passe du je au on avec un sentiment d’allégement. On entend chez Tolstoï un cheval penser, chez Platonov le vent psalmodier, chez Gabrielle Roy l’horizon chuchoter à nos oreilles. En guise d’épitaphe, je verrais bien ceci : Ci-gît l’homme que j’ai été et qu’on n’a connu que par ouï-dire. Envie de lire Goethe plus sérieusement. Si ma lecture de Werther date de mon adolescence, celle, toute récente, de ses entretiens avec Eckermann n’a fait qu’aviver ma curiosité pour les grandes oeuvres de la maturité. Je ne sais quelle prudence m’a fait différer si longtemps ma rencontre avec Lesannées d’apprentissage de Wilhelm Meister, Faust et Les affinités électives — de peur, peut-être, de ne pas être à la hauteur de ces oeuvres ou d’en être déçu comme ce fut le cas de L’arrière-saison de Stifter, roman célébré par de grands esprits comme Nietzche. Il y a des oeuvres vers lesquelles on va sans hésitation, poussé par la certitude qu’elles ont été écrites expressément pour nous. D’autres devant lesquelles on se sent intimidé, comme en présence d’une beauté hors de l’ordinaire ou d’une force écrasante. J’aborde Goethe avec une plus grande confiance depuis que j’ai passé de longues heures bienheureuses dans ses Conversations avec Eckermann. Je pourrais dire, comme Jules Renard, que je n’oublie rien, même les impressions les plus anciennes. En cela, je peux prétendre être « un sentimental qui rumine », ainsi qu’il se décrit. Mais si les souvenirs me reviennent avec une grande précision, c’est sans émotion que je les revis, qu’ils soient douloureux ou heureux. Le temps en a fait des objets que je pourrais prêter au premier personnage venu. Assumer sa singularité n’est pas donné à tout le monde. La plupart des gens préfèrent s’identifier à un modèle courant, ce qu’ils font tout naturellement ; d’autres se travestissent pour ne pas souffrir de ce qui les distinguerait de leurs semblables. Seule une âme forte (au sens où l’entendait Giono) accepte de vivre selon …