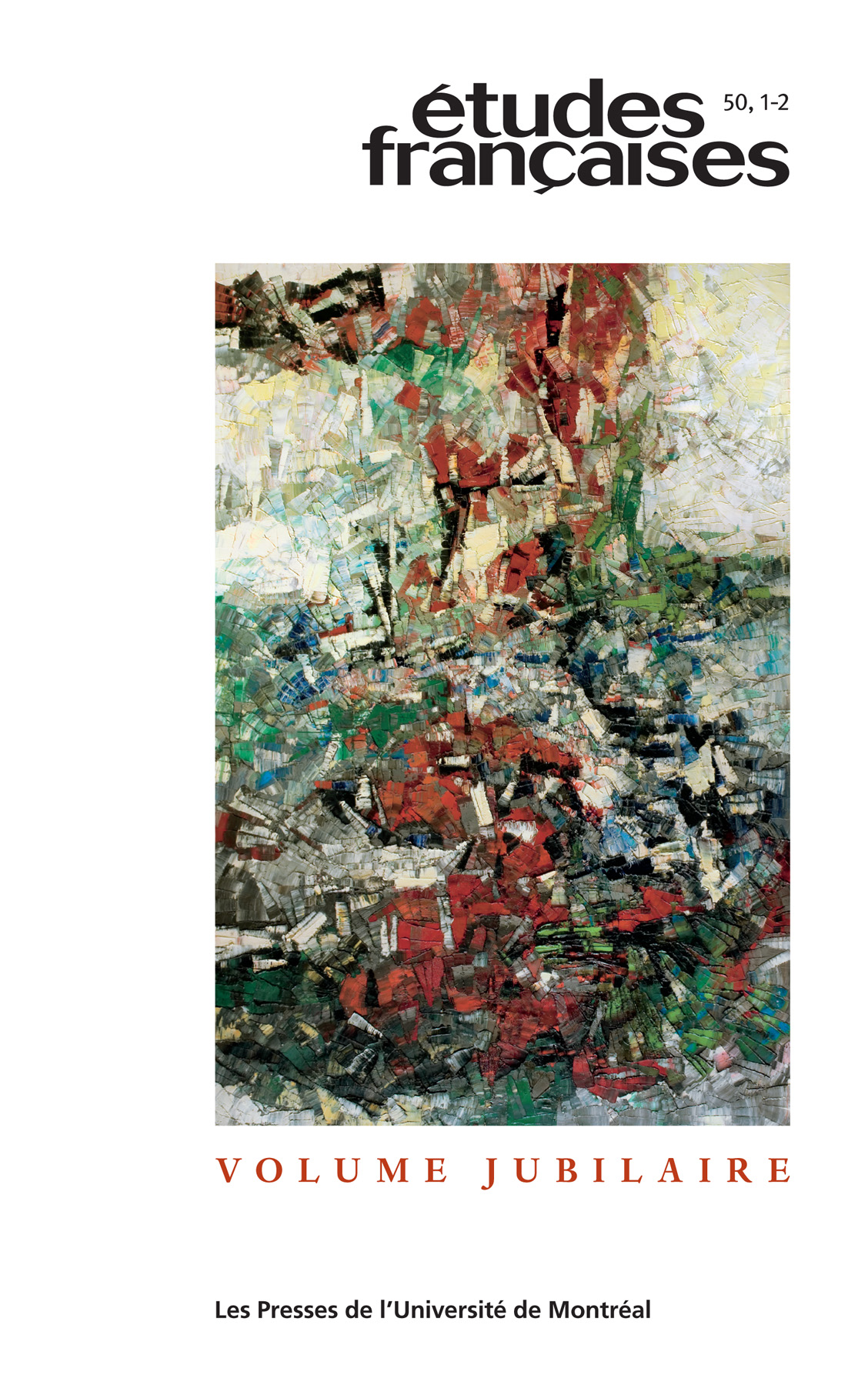J’ai été d’accord, bien sûr, et j’ai placé les vers du poème « Foyer naturel » en épigraphe de mon texte. C’est un petit détail, mais je le signale pour éclairer la réaction de Miron. À l’époque, il m’envoyait des textes, mais, lors de la publication de L’homme rapaillé pour le prix de la revue Études françaises, ce n’était pas moi le maître d’oeuvre, je servais d’intermédiaire. Au colloque de 1970 organisé par La Barre du jour, on a parlé d’« un livre consenti par Miron », c’était injuste et ce n’était pas exact. Gaston Miron est resté le maître d’oeuvre de son livre. Il ne se serait pas laissé imposer des choses qu’il ne voulait pas. C’est Georges-André Vachon qui a eu l’idée d’inclure les textes en prose dans le livre, pour des raisons d’édition, pour faire un volume un peu plus substantiel en termes de quantité, comme le souhaitait aussi Danielle Ros. Nous en avions également discuté avec Paul-Marie Lapointe et Naïm Kattan. Il fallait qu’il y ait une certaine harmonie quantitative avec le livre du lauréat précédent, le roman de Kourouma. Georges-André Vachon trouvait que, du point de vue de l’édition — même s’il n’était pas éditeur —, le livre avec les seuls poèmes serait un peu mince… Georges-André Vachon pouvait être un peu carré quand il s’exprimait avec conviction. J’aimais bien sa manière, on savait ce qu’il pensait, même quand il se trompait, on pouvait discuter avec lui. C’est ainsi que L’homme rapaillé est un livre double. Mais dans l’optique de Miron qui a sans cesse été consulté. Il était d’accord avec la structure du livre et, en effet, la présence des textes en prose est intéressante parce que c’est tout Gaston Miron qui se trouve réuni : l’homme, l’écrivain, le poète. Ainsi le texte « Le poème et le non-poème » éclaire les poèmes. Georges-André Vachon a mis en ordre les proses et a soumis le projet à Gaston Miron qui a retiré un texte et en a ajouté un autre. Tout cela pour rappeler que, surtout quand il s’agissait de ses textes, Gaston Miron ne se laissait pas imposer quoi que ce soit. Par la suite, nous avons gardé le contact. Aussi quand Gaston Miron est arrivé à Paris en 1959, où j’étais déjà installé comme étudiant depuis l’automne 1958, à la Cité universitaire, nous nous sommes revus. Il lisait beaucoup. Par exemple, il me cassait les pieds avec Qu’est-ce que la littérature ? de Sartre. Moi, je ne l’avais pas encore vraiment lu, mais j’avais trouvé sur les quais un exemplaire pas cher, je me suis mis à le lire de A à Z, à l’annoter. Ensuite, j’en ai discuté avec Gaston Miron, sur des points précis, et j’ai fini par lui dire : « Tu ne l’as pas vraiment lu. » Il s’est mis à rire et il en a convenu. Un ou deux mois plus tard, nous en avons reparlé et j’ai pu voir que cette fois il l’avait lu attentivement. S’il lui arrivait parfois de survoler des livres, on le savait, mais, quand le sujet lui tenait à coeur, c’était un lecteur très, très attentif. Après, nous avons continué à nous voir à Montréal. Si lire revient à se faire un chemin dans un texte, comme votre essai le performe en ajoutant à votre première lecture au fil des années, où en êtes-vous aujourd’hui dans la poésie de Miron ? Mais ce sont là des lectures courantes. La littérature, et pas seulement la poésie, il est très rare qu’elle soit lue comme littérature. Avec tout ce qu’elle comporte. …
Entretien avec Jacques Brault[Notice]
- Élisabeth Nardout-Lafarge
Diffusion numérique : 19 août 2014
Un document de la revue Études françaises
Volume 50, numéro 1-2, 2014, p. 51–64
Volume jubilaire
Tous droits réservés © Les Presses de l’Université de Montréal, 2014