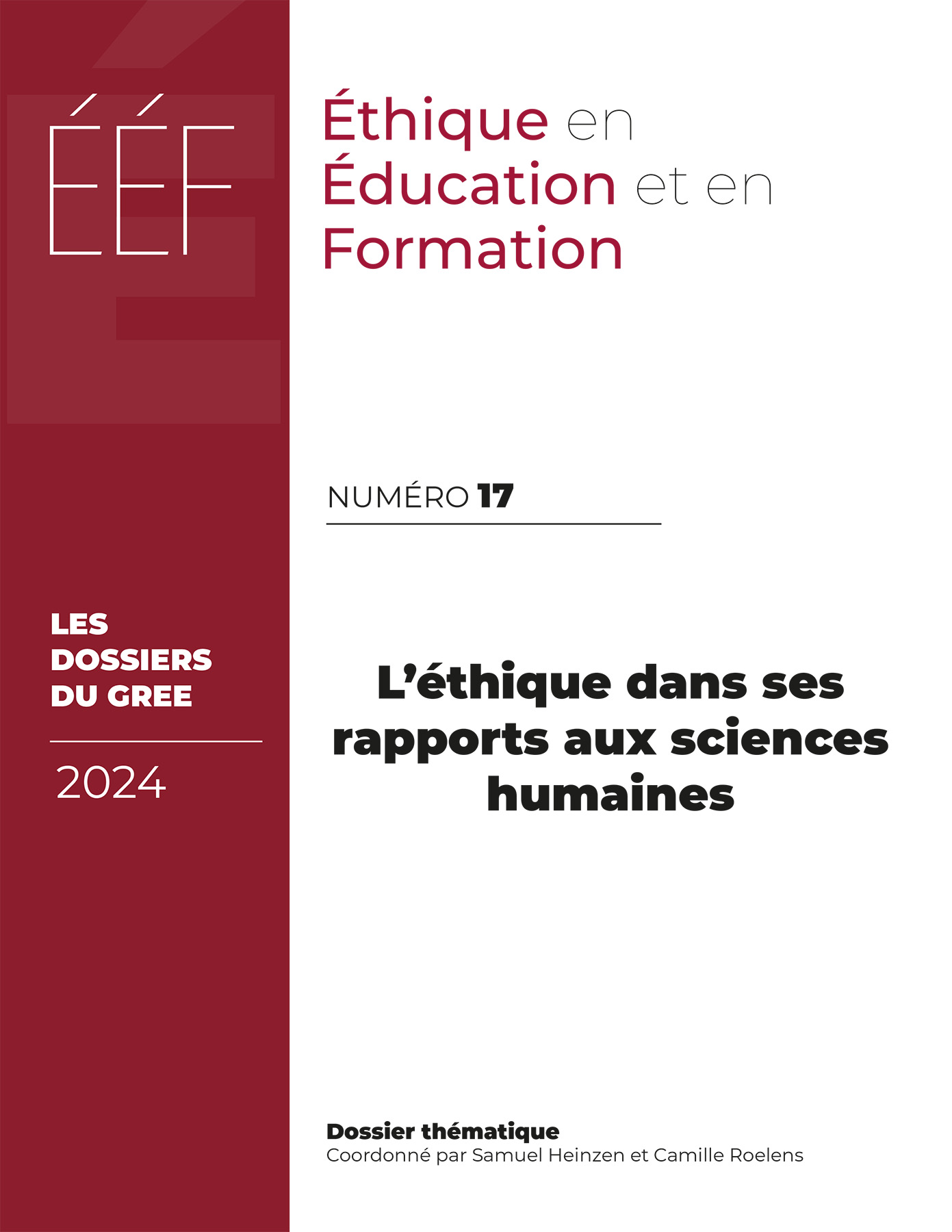Corps de l’article
Depuis une dizaine d’années, l’enseignement de l’éthique s’est imposé plus largement dans les curricula d’Europe et d’Amérique du Nord. Dans le Plan d’études suisse romand, par exemple, l’éthique a été rendue visible à travers l’appellation « éthique et cultures religieuses » qui est venue remplacer d’anciennes désignations cantonales se référant uniquement à l’axe des religions. En France, où la laïcité scolaire demeure un sujet vif et rémanent de controverses, l’éthique est travaillée au sein d’un cours interdisciplinaire dédié à l’enseignement moral et civique. En Belgique, un cours de philosophie et de citoyenneté est proposé, invitant les élèves à prendre position de façon autonome et réfléchie sur des questions éthiques. Au Québec, le programme Culture et citoyenneté québécoise prévoit un axe dédié, entre autres, à la pratique du dialogue et de la réflexion éthique. Ainsi, quel que soit le contexte scolaire considéré, l’éthique se voit systématiquement associée ou intégrée à d’autres disciplines scolaires des sciences humaines et sociales : l’enseignement sur les religions, faits religieux ou cultures religieuses, l’éducation civique ou l’éducation à la citoyenneté, ou encore l’histoire. À ces différentes configurations disciplinaires s’ajoute le fait que l’éthique est un domaine de réflexion privilégié de la philosophie, elle-même discipline scolaire, qui appartient au domaine des sciences humaines et sociales. Au bout du compte, toutes ces possibilités créent certes un large éventail de combinaisons interdisciplinaires, notamment en sciences humaines et sociales, mais celles-ci doivent simultanément répondre aux injonctions institutionnelles diverses et variées, qui les légitimisent. L’éthique se retrouve ainsi prise en étau entre des attentes externes et des exigences internes, qui la poussent à rechercher des configurations à la fois viables et pertinentes. C’est à partir de cette préoccupation que le présent numéro propose plusieurs éléments d’analyse, de réflexion et de questionnement, dans le but de contribuer, autant que faire se peut, à la réalisation des ambitions internes et externes de l’éthique à l’école.
Le dossier que l’on va découvrir se compose ainsi de huit textes. Les quatre premiers abordent le thème davantage par des prismes curriculaires situés géographiquement (en Suisse romande, en France…) et/ou institutionnellement (en école d’ingénieurs et d’ingénieures, dans l’enseignement secondaire…). Les deux articles suivants se proposent d’entrer dans la problématique du dossier à partir des réflexions plus spécifiques d’auteurs contemporains ayant incarné des positions fortes sur les rapports possibles entre philosophie et sciences humaines. Les deux derniers proposent une exploration heuristique plus panoramique, à partir d’un concept, d’une part (celui d’hospitalité scolaire), et d’autre part d’une réflexion sur un objet historique signifiant (la chasse aux sorcières).
Le premier de ces articles, écrit par Maude Ouellette-Dubé, s’intéresse à la déclinaison, datant de 2019, du Plan d’études romand en Suisse francophone, au niveau cantonal, en Plan d’études vaudois. Prenant acte de la centralité qu’y tient la notion de « responsabilité éthique », l’auteure en propose une analyse critique visant tout à la fois à la restituer dans sa complexité et à mettre en lumière des enjeux théoriques et pratiques sous-jacents forts autour des conceptions de l’autonomie auxquelles elle peut s’adosser et/ou qu’elle peut prétendre former.
Le second texte permet à Jean-Nicolas Revaz de porter un regard complémentaire sur ce même sujet, en s’adossant en particulier aux ressources tout à la fois compréhensives, critiques et normatives des éthiques du care.
Sous la plume d’Anne-Claire Husser est abordée dans le troisième texte la question délicate de la place de la philosophie en général et de l’éthique en particulier dans les programmes scolaires en France. Une question d’actualité s’il en est, puisque les instructions curriculaires officielles de 2015 prétendent donner un nouvel élan à cette dernière dimension, dans le cadre d’un nouvel « enseignement moral et civique ».
La quatrième des contributions de ce dossier, que l’on doit à Marie-Pierre Escudié et Carine Goutaland, s’intéresse pour sa part à un public spécifique de l’enseignement supérieur, à savoir les élèves ingénieurs et ingénieures. En s’inspirant notamment des travaux de Martha Nussbaum, les auteures mettent en lumière les ressources des humanités pour l’exercice et le développement de la responsabilité éthique dans ce cadre de formation et de projection professionnelle.
Diane Laflamme, dans le cinquième article, organise un dialogue entre les pensées et les écrits du sociologue allemand Niklas Luhmann et du philosophe français Paul Ricoeur, autour du statut qui peut échoir à l’éthique à partir d’inspirations communes puisées dans la phénoménologie husserlienne.
C’est ensuite des critiques adressées par Bernard Stiegler à la philosophie pour enfants que Christophe Point, dans la sixième contribution, amorce une discussion critique des prétentions respectives de la philosophie et des sciences humaines à être des ressources cardinales pour l’enseignement de l’éthique aux enfants.
Dans le septième article, Cécile Lacôte-Coquereau met au travail la notion d’hospitalité – mise en avant en particulier ces dernières années par Eirick Prairat dans le champ de la recherche en éthique en éducation et formation – et, plus précisément, d’hospitalité scolaire, pour mieux penser et incarner les enjeux contemporains de l’école inclusive.
Enfin, le huitième et dernier texte, celui de Samuel Heinzen, propose une entrée tout à fait originale dans le thème du dossier, à savoir celle de la place du fait historique et de l’imaginaire subséquent de la chasse aux sorcières dans l’histoire moderne de la Suisse. Il montre en effet que l’intérêt pour cet objet ouvre des pistes de problématisations épistémologiques et méthodologiques fécondes, y compris face à des enjeux sociétaux actuels.