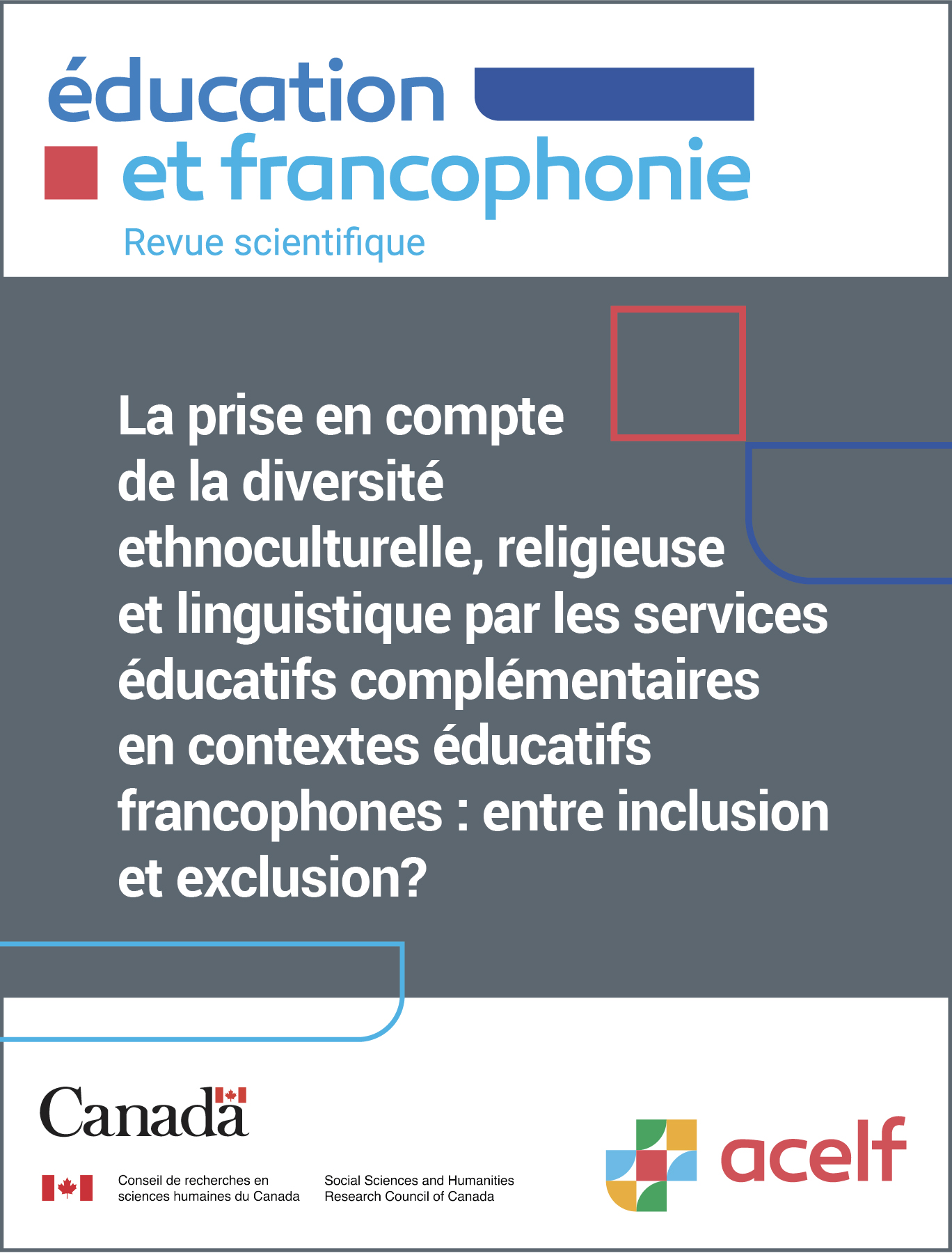Résumés
Résumé
Le personnel infirmier scolaire joue un rôle clé dans la promotion de la santé et la prévention des maladies chez les jeunes, particulièrement dans un contexte marqué par la diversité culturelle et les enjeux d'équité, diversité et inclusion (EDI). Au Québec, ces infirmières, souvent basées dans les Centres locaux de services communautaires (CLSC), assument des responsabilités allant au-delà des soins cliniques, collaborant avec les élèves, leurs familles et les équipes éducatives pour soutenir le bien-être et la réussite scolaire. Cependant, la formation infirmière initiale présente des lacunes en matière d'EDI. Bien que des concepts liés à la diversité soient abordés dans certains cours optionnels, ils sont insuffisamment développés. De plus, les simulations cliniques, qui renforcent les compétences techniques, ne traitent pas adéquatement des enjeux interculturels et d'EDI. Une analyse secondaire de données issues d'une thèse doctorale sur l'avancement des infirmières de minorités visibles met en évidence des obstacles importants à l'inclusion et à la mobilité professionnelle. Les résultats soulignent la nécessité d'intégrer une formation interculturelle et des stratégies pédagogiques adaptées, comme l'enseignement par simulation, afin de mieux préparer les infirmières à collaborer efficacement avec divers acteurs du milieu scolaire et à offrir des soins adaptés aux besoins spécifiques de chaque élève.
Abstract
School nurses play a key role in promoting healthy habits and disease prevention among young people, especially in a context of cultural diversity and issues related to equity, diversity and inclusion (EDI). In Quebec, these nurses, often based in local community service centres (CLSCs), take on responsibilities that go beyond clinical care, collaborating with students, their families and educational teams to support well-being and academic success. However, initial nursing training is lacking in terms of EDI. Although concepts related to diversity are covered in some non-compulsory courses, they are not presented in depth. Furthermore, clinical simulations, which strengthen technical skills, do not effectively address intercultural and EDI issues. A secondary analysis of data taken from a doctoral thesis on the advancement of visible minority nurses reveals substantial barriers to inclusion and professional mobility. The results underscore the need to incorporate intercultural training and adapted pedagogical strategies, such as simulation-based learning, to better prepare nurses for collaborating effectively with school stakeholders and offering care adapted to the specific needs of each student.
Resumen
El personal de enfermería escolar desempeña un papel clave en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades en los jóvenes, en particular en un contexto marcado por la diversidad cultural y los desafíos de diversidad, equidad e inclusión (DEI). En Quebec, estas enfermeras, con frecuencia ubicadas en los Centros locales de servicios comunitarios (CLSC), asumen responsabilidades que van más allá de los cuidados clínicos, colaborando con sus alumnos, sus familias y los equipos educativos para sostener el bienestar y el rendimiento escolar. Sin embargo, la formación inicial en enfermería presenta lagunas en cuanto a la DEI. Aunque ciertos conceptos relacionados con la diversidad estén tratados en algunos cursos opcionales, no están suficientemente desarrollados. Además, las simulaciones clínicas, que refuerzan las competencias técnicas, no tratan adecuadamente de los retos interculturales y de la DEI. Un análisis secundario de los datos de una tesis doctoral acerca del ascenso de las enfermeras de minorías visibles pone en evidencia importantes obstáculos a la inclusión y a la movilidad profesional. Los resultados ponen de relieve la necesidad de integrar una formación intercultural y estrategias pedagógicas adaptadas, como es la enseñanza por simulación, con el fin de preparar mejor las enfermeras a colaborar de manera eficaz con diversos actores del medio escolar y a proporcionar cuidados adaptados a las necesidades específicas de cada alumno.
Corps de l’article
INTRODUCTION
Les infirmières[1] scolaires, en tant que professionnelles dans les établissements éducatifs, jouent un rôle crucial dans la réponse aux besoins des jeunes provenant de milieux socio-économiques, culturels et linguistiques variés. Leur travail se situe à l’intersection de la santé, de l’éducation et de la justice sociale, ce qui exige une capacité à naviguer dans des environnements marqués par des défis complexes liés aux principes d’une approche à l’équité, à la diversité et à l’inclusion (EDI). Ces défis incluent notamment la nécessité d’adapter les soins aux réalités des élèves issus de minorités culturelles, de répondre aux inégalités d’accès aux services de santé et de favoriser un climat scolaire inclusif. Au Québec, l’EDI est devenu un axe prioritaire dans plusieurs domaines, y compris en santé et en éducation, afin de répondre aux besoins des populations historiquement marginalisées (Gallani et Brière, 2024).
Les infirmières en milieu scolaire occupent une place centrale dans la promotion de la santé et la prévention de la maladie chez les jeunes. Le travail en milieu éducatif requiert des adaptations de la part des professionnelles, qui sont de plus en plus confrontées à l’impératif d’intégrer des approches d’EDI pour mieux répondre aux besoins des élèves et de leur famille tout en s’attaquant aux inégalités systémiques qui se manifestent, notamment par des écarts d’accès aux soins, des discriminations institutionnelles et des différences dans la qualité des services offerts aux minorités (Battiste, 2019; McDermott et al., 2021).
Au Québec, les infirmières scolaires sont des professionnelles qui travaillent dans les Centres locaux de services communautaires (CLSC) [2] dont le rôle est central dans la prestation de soins de proximité. Les infirmières, en tant que professionnelles de première ligne, assument des responsabilités multiples allant au-delà des soins cliniques. Elles collaborent avec les élèves, leur famille et le personnel éducatif pour aborder des enjeux de santé variés, tout en soutenant le bien‑être global et la réussite scolaire (Ministère de la Santé et des Services sociaux [MSSS], 2022). Cette mission exige d’elles une grande adaptabilité, notamment dans des environnements scolaires où les besoins de santé et de soutien social des populations sont culturellement diversifiés.
Les changements dans la diversité ethnique et raciale au Canada ont transformé les contextes de pratique dans les professions de santé en général, et plus particulièrement celle des infirmières. Dans ce contexte, l’EDI se positionne comme axe incontournable pour répondre efficacement aux inégalités systémiques et aux disparités en santé. Au Québec, le racisme systémique, bien que débattu, affecte l’accès aux soins et la qualité des services pour les populations racisées (Pierre et Bosset, 2020). Les infirmières scolaires sont souvent confrontées à des situations nécessitant une sensibilité culturelle et une compréhension approfondie des dynamiques sociales qui influencent la santé des jeunes. Par exemple, les questions de prévention de grossesse chez les adolescents et les immunisations, qui incluent des vaccins obligatoires pour les enfants d’âge scolaire, sont des thématiques ancrées de manière différente selon la culture (Kenyon et al., 2019). Pour l’infirmière, cela souligne l’urgence de renforcer la formation initiale et continue pour leur permettre de développer les compétences nécessaires à une pratique sensible et adaptée aux réalités des populations issues de la diversité ethnique et culturelle (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec [OIIQ], 2019). Le défi émerge de la grande diversité dans les parcours éducatifs (DEC, BAC, passerelles, etc.) lors de la formation infirmière, et que celle-ci a une visée généraliste, sans aucun cours spécifique à la pratique en milieu scolaire (OIIQ, 2019).
La reconnaissance de ces enjeux par l’OIIQ souligne l’urgence de revoir les approches pédagogiques et les curriculum pour mieux préparer les infirmières à travailler dans des contextes diversifiés. Il est essentiel d’identifier les priorités éducatives qui auront le plus d’impact sur leur pratique, tant en milieu scolaire que dans d’autres environnements. Cet article s’appuie sur une analyse secondaire de données provenant d’une recherche doctorale afin d’explorer les stratégies éducatives novatrices nécessaires pour développer des compétences spécifiques permettant de promouvoir les principes d’EDI dans la formation infirmière.
PROBLÉMATIQUE
Au Canada et au Québec, la formation initiale en sciences infirmières constitue une étape cruciale dans la construction de l’identité professionnelle. Elle introduit les bases théoriques, les concepts et savoirs infirmiers ainsi que les valeurs associées à cette discipline (Hoeve et al., 2014; Létourneau et al., 2020). Ces concepts sont approfondis à travers divers cours théoriques en fonction de l’expertise et des intérêts de l’enseignant (Halverson et al., 2010; Gagnon, 2014). Cependant, dans un contexte de diversité ethnoculturelle croissante, cette formation montre des lacunes importantes en ce qui concerne l’intégration des concepts d’EDI (Borri‑Anadon et al., 2023). Si certaines notions sont abordées dans des cours optionnels, elles demeurent insuffisamment développées et peu systématiques.
Au Québec, le cursus du programme de premier cycle des universités et collèges (ces derniers correspondent au niveau postsecondaire) comprend plusieurs heures de pratique en laboratoire, intégrant largement l’utilisation de simulations. La simulation est reconnue comme efficace pour renforcer les compétences cliniques et techniques qui sont des tâches mesurables, en offrant un environnement sûr pour pratiquer et perfectionner des techniques sans risquer de compromettre la sécurité des patients (Cant et Cooper, 2010; Foronda et al., 2020). Elles permettent également de reproduire des situations cliniques complexes, favorisant ainsi le développement de la prise de décision critique, de la collaboration interprofessionnelle et des compétences en communication (Jeffries et al., 2015). Cependant, les dimensions interculturelles et les enjeux d’EDI sont peu, voire pas du tout, intégrés dans ces activités. Ce manque laisse les étudiantes en sciences infirmières moins préparées à gérer des conflits critiques à caractère culturel ou à promouvoir l’EDI dans leur pratique professionnelle (Desrosiers et al., 2022). En outre, la sensibilisation à ces sujets demeure à la discrétion des membres du corps enseignant, ce qui entraîne une approche fragmentée et inégale dans la formation. De plus, il n’y a pas un programme spécifique qui circonscrit de manière exhaustive les dimensions qui relèvent des conflits critiques à caractère culturel (Desrosiers et al., 2022), que ce soit en matière de soins ou en matière de promotion et d’emploi. Par ailleurs, de nombreuses études se sont penchées sur l’écart entre les compétences infirmières développées dans l’enseignement théorique et celles développées dans la pratique et qui sont reconnues et valorisées (Ajani et Moez, 2011; Bvumbwe, 2016; Hussein et Osuji, 2017; Ziani, 2022;). À cet effet, le corps enseignant et les autres personnes impliquées dans la formation (ex. superviseur de stage) ont besoin d’exercer une vigie quant aux besoins futurs en matière de soins interculturels collaboratifs et interprofessionnels dans un contexte d’EDI. Le manque de flexibilité des programmes pour permettre une bonne sensibilisation aux sources complexes des incidents critiques d’ordre culturel expose les futures infirmières à un risque accru d’en générer. Le MSSS (2020) définit un incident critique comme une « situation qui n’entraîne pas de conséquences sur l’état de santé ou le bien-être d’un usager […], mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, pourrait entraîner des conséquences » (p. 3).
Un manque de connaissances des us et coutumes de l’ethnie du patient, ainsi que ceux du personnel infirmier dont l’identité ethnique et religieuse est variée, peut nuire aux relations entre infirmières et patients, d’une part, et entre les infirmières du milieu et avec les autres membres de l’équipe de soins, d’autre part. Ces relations, essentielles à une collaboration efficace, risquent d’être fragilisées par des maladresses, des biais inconscients culturels ou un manque de sensibilisation culturelle. Or, cette collaboration interprofessionnelle, fondée sur la confiance, la communication et la compréhension mutuelle, est au coeur de la qualité des soins infirmiers (Wei et al., 2020).
Face à l’ampleur et à la complexité des enjeux liés à l’EDI, il est impératif de faire des choix de priorités qui sont stratégiques pour en maximiser la portée. En préparation à un projet de recherche visant à mettre en place une stratégie novatrice pour développer des compétences interculturelles et de sensibilisation à la justice sociale, il a fallu identifier les contenus à y intégrer.
L’objectif de la présente recherche est d’identifier les thématiques prioritaires en matière d’EDI qui devraient être intégrées dans les programmes de formation, ainsi que de proposer des moyens pédagogiques pour les intégrer dans la formation des infirmières. Le choix de ces éléments vise à permettre une meilleure prise en compte des enjeux liés à la diversité culturelle, tout en favorisant des soins collaboratifs, qui est une approche de travail interdisciplinaire (infirmières, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, etc.), qui soient équitables et adaptés aux besoins des patients et des équipes interdisciplinaires. Pour ce faire, une analyse secondaire des résultats de la thèse doctorale de l’auteure, portant sur l’avancement de carrière des infirmières issues de minorités visibles (IMV)[3] a été effectuée (Bouabdillah, 2016). Conformément aux exigences éthiques, les données brutes ayant servi à cette thèse avaient déjà été détruites, mais les résultats, les témoignages et les expériences documentés dans la thèse offrent une base riche pour explorer de nouvelles perspectives. Au-delà des obstacles systémiques et des défis personnels relevés dans les résultats de la thèse, tels que la sous-représentation des IMV dans les postes de gestion, le manque de mentors issus de la diversité entre autres, l’analyse secondaire met plutôt l’accent sur l’identification des éléments à inclure lors de la formation initiale des sciences infirmières, afin de mieux préparer les infirmières à naviguer dans des environnements de travail diversifiés et inclusifs, tout en renforçant l’impact de ces initiatives sur la pratique quotidienne en milieu hospitalier et communautaire.
L’analyse proposée mettra en lumière des pistes pour transformer la formation infirmière, en vue d’améliorer les interventions auprès des populations scolaires marginalisées.
CADRE THÉORIQUE
L’analyse secondaire est menée sur les résultats de l’étude originale, qui s’est appuyée sur les concepts de l’altérité (Canales, 2010), de stigmate (Goffman, 1963), de stéréotype (Abrams, 2010), de la lutte des classes et de la violence symbolique (Bourdieu, 2001). Ces concepts ont éclairé la justice et l’équité pour tenter de mettre fin aux discriminations et à l’exclusion ethnoculturelle (Bouabdillah, 2016). Ces mêmes concepts, ainsi que les notions d’EDI sont explorés dans cette analyse afin de proposer des perspectives pour une formation infirmière adaptée à la réalité multiculturelle du Québec.
Perspectives conceptuelles et sociologiques
Tout d’abord, la notion d’altérité consiste en la reconnaissance et en la valorisation de la différence de l’Autre. Inspirée des travaux de philosophes tels que Levinas (1981), elle met en avant l’importance de l’éthique dans les relations humaines. L’infirmière est confrontée à l’altérité sous diverses formes et doit mobiliser non seulement ses savoirs, savoir-faire et savoir-être, mais aussi ses qualités humaines et relationnelles pour faire face à l’altérité, à savoir, ses capacités d’attention, de compréhension, de respect, de générosité et aussi, de prendre ses distances (Papadopoulos et al., 2021). La relation de soin repose sur trois piliers clés reliés à l’altérité qui sont l’empathie, qui consiste à comprendre le point de vue de l’Autre sans le réduire à ses propres cadres de référence; la reconnaissance, qui valide l’unicité de chaque individu au-delà des stéréotypes ou biais culturels; et la responsabilité éthique, qui appelle à répondre à l’Autre en tenant compte de sa vulnérabilité (Thomas et Hazif-Thomas, 2022). Ainsi, dans un contexte de soin où les interactions entre soignants et patients issus de divers horizons sont fréquentes, l’altérité fournit un cadre conceptuel pour promouvoir des soins équitables, respectueux et adaptés aux besoins de chacun (Bouabdillah et al., 2021). Plus spécifiquement, le concept d’altérité a permis de mieux saisir la construction sociale des catégories de l’altérité « nous/eux ». Canales (2010), souligne que l’altérité ne doit pas être conçue sous sa forme d’exclusion dans le rapport de pouvoir dans les relations de domination et de subordination, mais sous forme d’inclusion en utilisant le pouvoir dans les relations de transformation et de construction de coalitions.
Par ailleurs, les concepts de stigmate et de stéréotype permettent d’expliquer les dynamiques de discrimination et d’exclusion. Selon Goffman (1963), le stigmate est une caractéristique qui discrédite un individu aux yeux de la société, tandis que le stéréotype, tel que défini par Abrams (2010), est une représentation simplifiée attribuée à un groupe. Dans le contexte des sciences infirmières, ces concepts permettent d’analyser comment certaines catégories sociales sont perçues et traitées, influençant ainsi la qualité des soins reçus.
Quant à la lutte des classes et la violence symbolique, Bourdieu (2001) souligne que les groupes dominants imposent leurs productions culturelles et symboliques jouant un rôle essentiel dans la reproduction des rapports sociaux de domination, ce qu’il appelle la violence symbolique. Ainsi, une appellation à connotation péjorative ou raciste produit une catégorie sociale de l’altérité qui tend à rabaisser et à mener vers l’exclusion (Phelan et al., 2008). Dans la profession infirmière, ces dynamiques peuvent affecter les relations entre soignants et soignés issus de divers horizons culturels.
Finalement, le concept d’Équité, diversité et inclusion (EDI) dans le contexte québécois avec l’accroissement de la diversité culturelle au Québec, sa population étudiante en sciences infirmières s’est également diversifiée (Conseil supérieur de l’éducation, 2022; Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, 2023). Au sein des établissements d’enseignement supérieur, les identités des personnes étudiantes se multiplient, mais aussi s’entrecroisent; une étudiante peut être issue de l’immigration, avec des enfants à charge, tout en vivant une situation de handicap, par exemple. De ce fait, les notions EDI sont devenues au coeur de la réussite scolaire et académique, incitant les établissements à revoir leur façon de faire afin d’assurer l’inclusion efficace (El‑Hage, 2020). D’abord, l’équité vise à corriger les désavantages historiques existants entre les groupes, elle peut être comprise comme un moyen de soutenir l’instauration de l’égalité réelle (Solar, 2019). Ensuite, la diversité valorise les différences culturelles, ethniques, sociales ou autres. Dans la formation infirmière, cela implique de considérer la variété des identités pour enrichir les pratiques pédagogiques. Et finalement, l’inclusion, quant à elle, consiste à créer un environnement respectueux qui favorise le bien-être de tous les membres de la communauté étudiante.
Au Québec, les infirmières sont amenées à travailler auprès de populations culturellement hétérogènes. Elles estiment manquer de formation pour les outiller afin d’intervenir efficacement dans ce contexte interculturel et craignent de commettre des erreurs lors de leurs interventions (Pouliot et al., 2015). Des études aux États-Unis ont relevé des résultats similaires confirmant aussi l’insatisfaction des étudiantes quant à la formation reçue sur les enjeux interculturels (Gregus et al., 2020). Ces recherches montrent qu’il y a carences de formation à l’altérité, cette capacité d’entrer en rapport avec l’Autre semblable, mais différent, et de remplacer la peur de lui par de l’ouverture et de l’inclusion.
Perspectives de la formation infirmière
L’ensemble de ces concepts permet d’éclairer la manière dont les dynamiques de discrimination et d’exclusion influencent la formation infirmière et, par extension, la qualité des soins offerts aux populations diversifiées. L’intégration des notions d’altérité, de stigmate, de stéréotype et de violence symbolique dans l’analyse permet d’identifier les barrières à une formation inclusive, faisant ainsi de l’EDI un levier clé pour transformer les pratiques pédagogiques.
Afin d’aboutir à des résultats concrets, il est nécessaire de penser aux pratiques éducatives susceptibles de rehausser les capacités des infirmières en interculturalité, soit les dynamiques et interactions entre des groupes issus de cultures différentes (White, 2018). Ainsi, il est important de savoir quels contenus enseigner et comment les enseigner. La qualité de l'éducation dépend non seulement du contenu enseigné, mais aussi des méthodes pédagogiques appropriées pour transmettre les savoirs. De plus, le contenu doit être régulièrement révisé selon l’évolution des réalités des milieux de pratique. Ainsi pour réduire les inégalités en santé et améliorer la qualité des soins, la formation initiale et continue des infirmières devraient accroître la compétence en EDI de futurs professionnels dans les programmes éducatifs (Govender et al., 2017; Smith et Trimble, 2016). La formation inclusive est essentielle pour favoriser un environnement stimulant où chacune des infirmières se sent valorisée et autonome, peu importe son origine ethnique.
Le choix des méthodes pédagogiques influence l'efficacité de l'enseignement et la rétention des connaissances. Parmi les méthodes pédagogiques actives, les études de cas, la simulation et les jeux de rôle favorisent l'engagement et la réflexion critique des infirmières (Brusilovsky et Millán, 2007; Pelánek et al., 2017).
MÉTHODOLOGIE
L’analyse secondaire présentée ici repose sur les résultats d’une thèse doctorale dont les données ont été collectées entre 2014 et 2015, portant sur l’avancement de carrière des IMV au sein d’une institution de soins de santé canadienne. Dans cette institution, les infirmières de chevet ont un travail très orienté vers les patients, sans rôles administratifs, contrairement aux chefs d’équipe et gestionnaires. La recherche initiale a adopté une méthodologie ethnographique critique, où 12 infirmières (8 infirmières – IMV – de chevet et 4 infirmières gestionnaires issues du groupe ethnique majoritaire) ont été interviewées. Ces entretiens semi-structurés ont permis de recueillir des témoignages détaillés sur leur parcours professionnel, les défis vécus et les stratégies utilisées pour naviguer dans un environnement professionnel marqué par des inégalités. Un formulaire sociodémographique a également été utilisé pour mieux contextualiser leurs parcours. Parallèlement, des observations sur une période de plus de quatre mois ont été réalisées directement sur les lieux de travail des infirmières pour analyser les dynamiques relationnelles et hiérarchiques et identifier les obstacles structurels affectant leur avancement. Un tableau de bord spécifique a été utilisé pour structurer les observations, en se concentrant sur des éléments comme les interactions entre les infirmières et leurs collègues ainsi que sur les stratégies d'adaptation. Ces données ont enrichi l’analyse, permettant de mieux comprendre l’impact de différents facteurs externes sur l’expérience des infirmières.
Les données brutes de cette première étude ont été détruites conformément aux exigences éthiques, mais les résultats et témoignages recueillis dans la thèse offrent un socle précieux pour cette analyse secondaire. Les verbatim et résultats de l’étude initiale sont en effet amplement suffisant pour identifier des thématiques prioritaires en matière d’EDI à intégrer dans les programmes de formation (Bouabdillah, 2016). Selon Heaton (2008), l’analyse des données secondaires doit avoir pour but soit de vérifier les résultats d'études précédentes, soit d'examiner de nouvelles questions de recherche. Dans cette étude, la question principale est de vérifier comment la formation initiale peut aborder les défis rencontrés par les IMV, et si des approches pédagogiques comme l’enseignement par simulation pourraient être efficaces pour relever ces défis. L'analyse s'appuie sur les six étapes de l'analyse thématique de Braun et Clarke (2019). Ces étapes sont les suivantes : 1) se familiariser avec les données, 2) générer des codes initiaux, 3) rechercher des thèmes, 4) examiner les thèmes, 5) définir les thèmes, et 6) rédiger l'analyse. Étant familière avec sa propre recherche et le contexte de collecte des données, la chercheurea rapidement exécuté la première étape. Dans la deuxième étape, des segments de résultats pertinents ont été identifiés et codés pour répondre à la nouvelle question de recherche. Ensuite, les codes ont été regroupés en thèmes potentiels, puis vérifiés et définis lors des étapes 4 et 5. Le choix des thèmes a été effectué dans l’optique d’identifier des thématiques cruciales pour l’amélioration de la formation des infirmières, notamment en matière d’EDI.
RÉSULTATS
Les résultats de cette analyse secondaire mettent en évidence l’existence d’obstacles significatifs auxquels les IMV sont confrontées en matière de mobilité professionnelle et d’inclusion dans les établissements de soins. Cette analyse met en lumière l'importance cruciale de l'intégration de stratégies visant à surmonter ces défis, notamment par le biais de la formation interculturelle et de la simulation.
Obstacles structurels et institutionnels
Les obstacles structurels et institutionnels réfèrent aux barrières systémiques dans l’organisation des soins qui limitent l’accès aux opportunités et la progression des IMV. Ils incluent des politiques de recrutement, des pratiques de gestion et des normes organisationnelles influençant la reconnaissance et l’avancement professionnel. La gestion de la diversité culturelle nécessite une planification (planning) et une mise en oeuvre de systèmes et de pratiques organisationnels afin de maximiser la capacité de tous les employés à contribuer aux objectifs de l’institution de soins et de réaliser leur plein potentiel. L’une des participantes a illustré ces enjeux en décrivant l’influence de la culture organisationnelle de son établissement :
On te cultive que tu n’es pas tellement bonne, que tu vas finir par manquer de confiance en toi. Donc, finalement, tu es convaincue à l’avance que tu ne vas pas pouvoir obtenir cette position [de gestionnaire]. (Participante P9, IMV de chevet)
Cette infirmière perçoit que la culture organisationnelle a tendance à laisser les IMV en bas de l’échelle, cette dynamique reflète des biais inconscients et des pratiques systémiques qui peuvent être ancrés dans l’organisation. Une telle culture risque de rendre les IMV enclines à sous-estimer leurs capacités, prédire qu'elles seront moins performantes, se considérer comme moins dignes de progresser, même lorsque leurs expériences et études montrent qu'elles ont les mêmes performances que leurs homologues caucasiennes.
Peu importe à ce que j’effectue mon travail à cent pour cent et que je m’applique, que je réponds à tous les règlements, que j’ai toutes les éducations, ça [ne] sera jamais suffisant pour que je monte les échelons. (Participante P6, IMV de chevet)
Ces verbatim mettent en lumière les défis spécifiques auxquels sont confrontées les IMV, en particulier en ce qui concerne leur confiance en elles et leur mobilité professionnelle. Ces verbatim illustrent des expériences individuelles, qui s’inscrivent dans un ensemble plus large de témoignages qui convergent vers une même problématique. Bien qu’ils ne puissent être généralisés à toutes les IMV, leur récurrence dans les données recueillies suggère un enjeu structurel nécessitant une attention particulière. Pour répondre à ces défis, il est essentiel que la formation des infirmières intègre des modules sur la diversité, l'inclusion, la lutte contre la discrimination et les biais inconscients. Cela permettrait non seulement de sensibiliser les étudiantes aux défis spécifiques auxquels sont confrontées les personnes IMV, mais aussi de comprendre le rôle crucial que le corps professoral peut jouer dans la perpétuation de ces biais et dans la création d’un environnement éducatif plus inclusif et équitable. L'intégration de la simulation dans la formation infirmière est essentielle pour contrer les messages négatifs sur ces minorités. Elle offre un environnement sécurisé et constructif où les étudiantes peuvent pratiquer et perfectionner les compétences nécessaires. Ainsi, elles se perçoivent comme capables et compétentes, ce qui les aide à aspirer à des postes de leadership et contribue à une plus grande équité dans les milieux de soins. La simulation comme stratégie de formation peut être à la fois considérée comme un dispositif et comme une pratique didactique. La mise en situation permet aux infirmières de développer une pensée critique dans l’analyse et la résolution de situations complexes.
Discrimination
Les résultats de l’étude initiale ont révélé qu’il y a une perception de discrimination de la part des IMV dans la répartition des postes et un manque de reconnaissance de leurs qualifications. Il n'est pas surprenant que ces infirmières soient plus enclines à croire que la discrimination continue d'exister et de les affecter négativement, leurs compétences sont sous‑utilisées en raison d’une rigidité institutionnelle à leur égard :
Quand tu prends quelqu’un [IMV] qui a 15 années d’expérience avec une autre [infirmière caucasienne] … qui vient juste d’obtenir son diplôme, ils vont juste lui donner le poste [à l’infirmière caucasienne], puis avec plein d’excuses qui vont avec. (Participante P10, p34, IMV de chevet)
Ce verbatim traduit une frustration liée à la sous-utilisation des compétences des IMV et à une perception de favoritisme envers les infirmières caucasiennes. Cette situation peut refléter un manque de formation préalable sur l’importance de l’équité dans la gestion des équipes et sur la reconnaissance des parcours professionnels variés que les infirmières interprètent comme une discrimination systémique.
Il y a des infirmières qui sont là depuis dix ans, ce sont des infirmières autorisées; elles ont leur bac. Puis des infirmières blanches qui viennent tout juste de graduer auxquelles on va donner le poste de chef d’équipe, alors que les autres étaient là pendant tout ce temps et qu’on ne leur propose jamais. (Participante P7, p2, IMV de chevet)
Dans ce verbatim la participante soutient l’existence de problèmes systémiques, de discrimination raciale et de favoritisme dans le processus de promotion et de recrutement des infirmières. L’introduction de l'enseignement inclusif dans la formation en soins infirmiers contribuerait à créer des environnements accueillants pour les apprenants et favoriserait un sentiment de confiance et d’appartenance chez les futures infirmières.
La formation par la simulation peut jouer un rôle crucial dans la promotion de l'équité par la sensibilisation aux biais et peut aider à réduire la discrimination. Il est d’une grande importance aussi d’inclure dans le programme des simulations entre le mentorat et des encadreurs issus de diverses origines, ce qui peut fournir des modèles de rôle et renforcer la confiance en soi des IMV.
Préjugés
En analysant les résultats de l’étude primaire, on a relevé le thème des préjugés qui était au centre de la discrimination. Les IMV perçoivent que leurs caractéristiques phénotypiques provoquent chez leurs collègues blanches et non immigrantes, infirmières ou gestionnaires, des stéréotypes dévalorisants. Elles croient que le préjugé, cette attitude négative associée à un stéréotype qui porte à avoir un préjugé sur une personne ou une communauté, n’est pas basé sur des faits. Elles le trouvent discriminant et génèrent chez elles des sentiments de frustration, d’isolation et de perte d’estime de soi. L’une des gestionnaires a fait le commentaire suivant :
C’est entre les personnes soient africaines, soient des autres cultures qui se chamaillent entre eux. Les Caucasiennes, on n’a pas une culture à se chicaner ... on a plutôt été élevé dans la paix, puis tout ça. Il y en a qui viennent d’une communauté ou d’un pays que c’est plus rebelle, vous savez ce que je veux dire? (Participante P3, p10, gestionnaire caucasienne)
Par ses propos, la gestionnaire trace une « ligne de démarcation » entre les infirmières caucasiennes « pacifistes » et les infirmières non caucasiennes qu’elle qualifie de « rebelles ». De ce fait, les préjugés contribuent à maintenir les personnes qui en sont la cible dans leur condition de dominance. Ils érigent des barrières entravant ces personnes de leur pleine contribution à leur institution. Les préjugés risquent de développer ainsi un sentiment d’infériorité, obstacle de plus à leur inclusion sociale. Ils se manifestent sous forme de discrimination par le biais de règles et de règlementations institutionnelles qui, bien qu'apparemment neutres, ont pour effet d'exclure les minorités et de maintenir la position privilégiée aux infirmières de la majorité.
Une IMV témoigne de l’existence persistante de préjugés dans certaines unités, qui alimente un climat discriminatoire à l’égard de son groupe.
Il y a des unités où on sent encore que, oui la discrimination existe … oui les personnes de couleur, les personnes noires, ce sont des personnes lentes, c’est des personnes qui ne fonctionnent pas comme il faut. (Participante P9,p8, IMV de chevet)
L’IMV rapporte une catégorisation où son groupe est étiqueté comme « lent » ou « non fonctionnel », ce qui pourrait influencer négativement leur accès à des opportunités équitables, que ce soit pour des promotions, des responsabilités, ou simplement pour une reconnaissance équitable dans leur environnement de travail.
Par conséquent, les programmes de formation devraient inclure des modules sur la diversité culturelle et les biais inconscients des préjugés en s’appuyant sur des points de réflexion sur les compétences en matière de communication interculturelle afin de lutter contre la relation de domination et de hiérarchisation et de chercher à changer ces rapports en vue d’un milieu de travail plus juste, loin des préjugés, ou intimidation, sans porter atteinte à l’Autre dans sa dignité et sa subjectivité. Ainsi, les étudiantes seront en mesure de reconnaître divers types de préjugés qu’ils peuvent rencontrer et les gérer efficacement. La formation par simulation peut être conçue pour développer des compétences interculturelles, en encourageant les infirmières à comprendre et à respecter les différences culturelles et à travailler efficacement dans des équipes diversifiées.
Mentorat et soutien social
Les résultats de l’étude initiale ont aussi révélé que les IMV sont désavantagées par manque de possibilités de réseautage et de mentorat. Ce manque est à l’origine de leur stagnation de carrière. Le mentorat peut être un moyen efficace de soutenir leur avancement et leur développement de carrière. Une gestionnaire a reconnu qu’elles ont besoin d’une personne pour les encadrer, les guider, les conseiller, maximiser leur potentiel, enrichir leurs connaissances et savoir comment augmenter leur capital social. Vu les nombreux défis qu’une future infirmière gestionnaire peut rencontrer, le mentor est appelé à l’outiller en lui montrant la manière dont la mobilité s’opère ainsi que le soutien formel et informel dont elle aura besoin pour réussir une carrière de gestionnaire. Cela ne pourrait être possible sans une volonté politique affirmée de l’institution, accompagnée de mesures concrètes d’équité pour assurer une représentativité rationnelle des IMV aux postes de gestion. Cette gestionnaire a émis le commentaire suivant :
Ce qu’ils veulent dire en matière d’équité c’est qu’on ne refuse pas les Noires. Dans les postes supérieurs de responsabilité, il n’y a pas d’équité, parce que pour accéder à un poste de responsabilité, il faut que tu aies un réseau parmi les gens dans les postes haut placés; or, il n’y a pas assez de minorités visibles qui peuvent te soutenir. (Participante, P12, p16, IMV de chevet)
Le mentorat peut être un moyen efficace de soutenir l'avancement et le développement de carrière des employés, en particulier les personnes nouvelles recrues et celles issues de groupes minoritaires. Les IMV ont rapporté que le manque de gestionnaires IMV constitue un handicap pour leur développement de carrière, car ce manque de support nuit à leur besoin de soutien émotionnel sur la base d’un partage culturel commun. Elles ont aussi souligné le manque de soutien de leurs paires blanches, ce qui entrave leur progression de carrière créant une sous-représentation qui peut être abordée dès la formation initiale. Les programmes de mentorat et de parrainage peuvent être des outils efficaces pour aider les étudiantes IMV à naviguer dans leur carrière et à développer des relations avec des mentors influents. La formation continue s’avère aussi essentielle pour développer les compétences professionnelles chez les mentors face à un environnement en constante évolution. Mentorer de manière juste implique d’offrir un soutien constructif en adoptant une approche équitable sans favoritisme. Lorsqu’un mentor ou une mentore tient des propos biaisés, il est crucial de réagir avec tact et respect, en exprimant ses préoccupations de manière claire et constructive.
La formation par simulation permet aux mentors d’outiller les infirmières afin de renforcer les compétences en matière de négociation, d’élargissement du réseau de contacts professionnels, de renforcement de l’estime de soi, ainsi qu’au niveau des capacités de leadership. S’ajoute à cela la capacité à être ouvert et direct dans les discussions avec les autres et à résoudre les problèmes.
DISCUSSION ET CONCLUSION
En passant en revue les thématiques discutées dans ce texte, on a observé la nécessité d’adresser non seulement les obstacles structurels et institutionnels, mais aussi les dimensions relationnelles telles que la discrimination, les préjugés et le manque de soutien social et de mentorat dans les milieux de travail. Ces éléments soulignent l'importance d'intégrer une formation interculturelle, axée sur la collaboration interprofessionnelle et la gestion des dynamiques interculturelles dans les programmes de formation en sciences infirmières.
La singularité de cette analyse secondaire réside dans l’effort de faire progresser les connaissances sur l’importance de l’interculturalité dans la formation initiale des infirmières, tant pour celles en clinique que pour celles en services complémentaires dans les écoles. Ces dernières sont appelées à travailler en concertation avec l’équipe scolaire pour offrir des services intégrés qui favorisent la réussite du plus grand nombre de jeunes en tenant compte de la différence de chacun et chacune (OIIQ, 2018). Les infirmières ont besoin de formation pour les outiller afin de développer une meilleure compréhension des enjeux que représente le côtoiement d’une population diversifiée et pour faciliter la relation thérapeutique (Chicca et Shellenbarger, 2020). La formation infirmière peut jouer un rôle crucial dans la promotion de l’inclusion et favoriser un sentiment d’appartenance accru à travers des interactions positives entre différents groupes de différents traits (Metzger et al., 2020).
À la suite de l’analyse des résultats de cette étude secondaire, on a relevé une variété d’obstacles structurels institutionnels perçue par les IMV, qui nuisent à leur progression professionnelle, entre autres, la discrimination, les préjugés, le manque de soutien social et de mentorat. Ces obstacles affectent négativement, non seulement leur estime de soi, mais aussi la qualité des soins qu’elles peuvent offrir. Aborder ces thématiques lors de la formation initiale permettrait de mieux préparer les futures infirmières à travailler dans des environnements de soins diversifiés et inclusifs, tout en améliorant leur compréhension des dynamiques interculturelles et des enjeux de justice sociale.
La gestion de la diversité culturelle dans les institutions de soins de santé nécessite une planification rigoureuse et la mise en oeuvre de pratiques organisationnelles adaptées. Comme le souligne une participante, la culture organisationnelle peut influencer négativement la confiance en soi des IMV, les empêchant de viser des postes de gestion (Bouabdillah, 2016). Cette situation est en accord avec les recherches récentes sur l'impact de la culture organisationnelle sur la performance et la perception de soi des employés issus des minorités (Jefferies, 2020; Likupe, 2015). Pour contrer ces défis, il est crucial que la formation initiale et continue des infirmières intègre des modules sur l'inclusion et la diversité. L'intégration de la simulation dans la formation peut contribuer à réduire les obstacles structurels du côté des institutions et à fournir un environnement sécurisé pour développer des compétences essentielles et renforcer la confiance en soi des IMV (Vaccaro, 2019).
La discrimination raciale perçue par les IMV, comme le montrent les résultats, est une réalité préoccupante. Elles ressentent une sous-utilisation de leurs compétences en raison de rigidités institutionnelles et de favoritisme envers les non-IMV (Pierce, 2018). Ces observations corroborent les études antérieures sur les biais systémiques dans les processus de promotion ainsi que le manque de mentor modèle IMV pour les soutenir (Woodley et Lewallen, 2021). La formation inclusive doit non seulement sensibiliser aux biais inconscients, mais aussi à la promotion d’un environnement équitable et inclusif. Les approches pédagogiques telles que la simulation peuvent jouer un rôle significatif en réduisant les biais et en sensibilisant les professionnels à l’EDI (Mutch, 2024).).
Les préjugés raciaux perçus par les IMV, comme le démontre l'exemple d'une gestionnaire décrivant des stéréotypes dévalorisants, contribuent à la discrimination et à la marginalisation de ces professionnelles (Ratcliff et al., 2023). Les préjugés créent des barrières à la pleine inclusion des IMV, renforçant les dynamiques de pouvoir et entravant leur progression de carrière. Elles ont déclaré se sentir discriminées, découragées, sous-estimées et non soutenues par leurs collègues blanches, de telles déclarations ont été rapportées par (Iheduru‑Anderson, 2020). Les programmes de formation devraient inclure des modules sur les préjugés inconscients et les compétences interculturelles, favorisant une meilleure compréhension et une collaboration plus équitable. Le développement de compétences interculturelles est alors considéré comme une solution pour améliorer les interactions interculturelles (Martel et Gagné, 2023).
Le manque de soutien social et de mentorat est un obstacle majeur pour le développement de carrière des IMV. Comme le note une gestionnaire, l'absence de réseau de soutien parmi ces infirmières limite leur accès aux postes de responsabilité. Les programmes de mentorat sont donc essentiels pour les aider à naviguer dans leur carrière et à développer des relations professionnelles influentes (Hill et Sawatzky, 2011). La formation initiale en soins infirmiers devrait intégrer des éléments sur la diversité, l'inclusion et le mentorat. La formation infirmière devrait inclure des cours sur la diversité et l'inclusion pour préparer les futurs professionnels à créer des réseaux de soutien efficaces et inclusifs, les sensibiliser aux enjeux rencontrés par les minorités visibles et comprendre les obstacles spécifiques que ces groupes rencontrent. Ainsi, ils deviendront des alliés et des promoteurs de l'équité dans leurs milieux de travail.
Pour améliorer la situation des IMV dans le domaine des soins infirmiers, il est essentiel de réformer les pratiques organisationnelles, d'intégrer des modules sur la diversité et les biais dans la formation et de mettre en place des programmes de mentorat pour faciliter le parcours professionnel des IMV pour accéder à des postes de gestion. Ces mesures contribueront à créer un environnement de travail plus équitable et à renforcer la qualité des soins fournis. Des infirmières bien formées et soutenues dans leur progression professionnelle sont mieux équipées pour offrir des soins de qualité à une population diversifiée. Elles seront plus outillées afin de mieux comprendre les besoins spécifiques des patients issus de minorités visibles, ce qui améliore la communication, la confiance et les résultats en matière de santé.
Parties annexes
Remerciements
Je tiens à remercier très sincèrement Marianne Paul, professeure agrégée au Département d’orthophonie, Université du Québec à Trois-Rivières, et Estibaliz Jimenez, professeure au Département de psychoéducation et travail social, Université du Québec à Trois-Rivières, pour leur collaboration. Je tiens aussi à remercier les personnes évaluatrices et le comité de rédaction pour les judicieux commentaires qui m’ont permis de bonifier cet article.
Notes
-
[1]
Dans le but de simplifier la lecture et d’alléger le texte, le terme infirmière est utilisé pour désigner à la fois les infirmières et les infirmiers, puisque la profession est majoritairement occupée par des femmes.
-
[2]
Les CLSC assurent des services de santé et des services sociaux de première ligne, incluant prévention, soins et réadaptation, en établissement ou dans la communauté (Loi sur les services de santé et les services sociaux, LSSS, art. 80). Ils contribuent aussi à la santé publique selon la loi sur la santé publique (chap. S-2.2).
-
[3]
Minorités visibles : « personnes autres que les Autochtones qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche » (Loi sur l’équité en matière d’emploi, LEE, ch. 44, p. 2).
Bibliographie
- Abrams, D. (2010). Processes of prejudices: Theory, evidence and intervention. Equalities and Human Rights Commission.
- Ajani, K. et Moez, S. (2011). Gap between knowledge and practice in nursing. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 3927-3931.
- Battiste, M. (2019). Decolonizing education: Nourishing the learning spirit. University of British Columbia Press.
- Bourdieu, P. (2001). Langage et pouvoir symbolique. Éditions du Seuil.
- Borri-Anadon, C., Hirsch, S., Lefevre-Radelli, L. et Cousineau, E. (2023). La prise en compte de la diversité dans la formation des étudiant.e.s à l’UQTR : état de la situation et leviers d’action. Rapport de recherche non publié. Laboratoire Éducation et Diversité en Région (LEDiR), UQTR. http://www.uqtr.ca/ledir/pratiquesformationdiversité
- Bouabdillah, N., Perron, A. et Holmes, D. (2021). Career advancement: The experiences of minority nurses in accessing leadership positions in a tertiary care setting. Witness: The Canadian Journal of Critical Nursing Discourse, 3(1), 73-84.
- Bouabdillah, N. (2016). Infirmières issues de minorités visibles : barrières socio-culturelles à la mobilité́ verticale en milieu hospitalier [thèse de doctorat]. Université d’Ottawa. Bibliothèque et Archives Canada. https://library-archives.canada.ca/eng/services/services-libraries/theses/Pages/item.aspx?idNumber=1292946478
- Braun, V. et Clarke, V. (2019). Thematic analysis. Dans P. Liamputtong (dir.), Handbook of Research Methods in Health Social Sciences, (p. 843‑860). Springer.
- Brusilovsky, P. et Millán, E. (2007). User models for adaptive hypermedia and adaptive educational systems. Dans P. Brusilovsky, A. Kobsa et W. Nejdl (dir.). The adaptive web: methods and strategies of web personalization (p. 3-53). Springer Berlin Heidelberg.
- Bvumbwe, T. (2016). Enhancing nursing education via academic–clinical partnership: an integrative review. International Journal of Nursing Sciences, 3(3), 314-322.
- Canales, M. K. (2010). Othering: Difference understood? A 10-year analysis and critique of the nursing literature. Advances in Nursing Research, 33(1), 15-34.
- Cant, R. P., et Cooper, S. J. (2010). Simulation‐based learning in nurse education: Systematic review. Journal of Advanced Nursing, 66(1), 3-15.
- Chicca, J. et Shellenbarger, T. (2020). Fostering inclusive clinical learning environments using a psychological safety lens, Teaching and Learning in Nursing, 15(4), 226-232. https://doi.org/10.1016/j.teln.2020.03.002
- Conseil supérieur de l’éducation. (2022). Formation collégiale ; expérience éducative et nouvelles réalité. Le Conseil. https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/50-0553-AV-college-experiences-et-nouvelles-realites-2.pdf
- Desrosiers, J., Tuck, J., Awashish, M., Verreault-Paul, F., Lecourt, V., Rochette, M., Vezeau-Beaulieu, K., Vaillancourt, N. et Lavoie, M. (2022). Processus collaboratif menant à un portrait de la formation infirmière initiale au Québec et perspectives de développement au regard de la sécurisation culturelle auprès des Premières Nations et des Inuit. Quality Advancement in Nursing Education/Avancées en formation infirmière, 8(3). http://dx.doi.org/doi.org/10.17483/2368-6669.1362
- El-Hage, H. (dir.) (2020). Mot du directeur. Les Cahiers de l’IRIPI (Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants), 3, 5. https://iripi.ca/wp-content/uploads/2021/08/CahiersIRIPI-No3_VF.pdf
- Foronda, C. L., Fernandez-Burgos, M., Nadeau, C., Kelley, C. N. et Henry, M. N. (2020). Virtual simulation in nursing education: a systematic review spanning 1996 to 2018. Simulation in Healthcare, 15(1), 46-54.
- Gallani, M. C. et Brière, S. (2024). Les enjeux d’équité, diversité et inclusion au coeur du monde académique et d’établissements de santé. Science of Nursing and Health Practices, 7(1), 1‑8.
- Gagnon, J. (2014). Quebec. Recherches en soins infirmiers, 4(119), 59-62.
- Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Simon et Schuster.Govender, P., Mpanza, D. M., Carey, T., Jiyane, K., Andrews, B. et Mashele, S. (2017). Exploring cultural competence amongst OT students. Occupational Therapy International, 2017(1). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2017/2179781
- Gregus, S. J., Stevens, K. T., Seivert, N. P., Tucker, R. P. et Callahan, J. L. (2020). Student perceptions of multicultural training and program climate in clinical psychology doctoral programs. Training and Education in Professional Psychology, 14(4), 293-307.
- Halverson, K., Tregunno, D. et Vidjen, I. (2022). Professional identity formation: A concept analysis. Quality Advancement in Nursing Education/Avancées en formation infirmière, 8(4).
- Heaton, J. (2008). Secondary analysis of qualitative data: an overview. Historical Social Research, 33(3), 33-45.
- Hill, L. A. et Sawatzky, J. A. V. (2011). Transitioning into the nurse practitioner role through mentorship. Journal of Professional Nursing, 27(3), 161-167.
- Hoeve, Y. T., Jansen, G. et Roodbol, P. (2014). The nursing profession: Public image, self‑concept and professional identity. A discussion paper. Journal of Advanced Nursing, 70(2), 295-309.
- Hussein, M. T. E. et Osuji, J. (2017). Bridging the theory-practice dichotomy in nursing: The role of nurse educators. Journal of Nursing Education and Practice, 7(3), 20-25.
- Iheduru‐Anderson, K. (2020). Barriers to career advancement in the nursing profession: Perceptions of Black nurses in the United States. Nursing Forum, 55(4), 664-677.
- Jefferies, K. (2020). Recognizing history of Black nurses a first step to addressing racism and discrimination in nursing. The Canadian Press.
- Jeffries, P. R., Rodgers, B., et Adamson, K. (2015). NLN Jeffries simulation theory: Brief narrative description. Nursing education perspectives, 36(5), 292-293.
- Kenyon, D. B., McMahon, T. R., Simonson, A., Green-Maximo, C., Schwab, A., Huff, M. et Sieving, R. E. (2019). My journey: Development and practice-based evidence of a culturally attuned teen pregnancy prevention program for native youth. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(3), 470.
- Létourneau, D., Goudreau, J. et Cara, C. (2020). Facilitating and hindering experiences to the development of humanistic caring in the academic and clinical settings: An interpretive phenomenological study with nursing students and nurses. International Journal of Nursing Education Scholarship, 17(1), 1‑14.
- Levinas, E. (1981). Otherwise than being or beyond essence. 3. Springer Science et Business Media.
- Likupe, G. (2015). Experiences of African nurses and the perception of their managers in the NHS. Journal of Nursing Management, 23(2), 231‑241.
- Loi sur l’équité en matière d’emploi, LEE. [Site Web de la législation – Justice] https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/e-5.401/page-1.html#:~:text=2%20La%20pr%C3%A9sente%20loi%20a,les%20femmes%2C%20les%20autochtones%2C%20les
- Loi sur la santé publique, LSP. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-2.2
- Loi sur les services de santé et les services sociaux, LSSS. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-4.2/20020419#se:80
- Martel, A. et Gagné, N. (2023). Lorsque les interactions interculturelles sont problématiques: influence mutuelle des facteurs individuels et institutionnels. Recherches sociographiques, 64(3), 523-554.
- McDermott, M., MacDonald, J., Markides, J. et Holden, M. (2021). Uncovering the experiences of engaging Indigenous knowledges in colonial structures of schooling and research. Engaged Scholar Journal, 7(1), 25-44.
- Metzger, M., Dowling, T., Guinn, J. et Wilson, D. T. (2020). Inclusivity in baccalaureate nursing education: A scoping study. Journal of Professional Nursing, 36(1), 5-14.
- Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2020), Déclaration des incidents et des accidents. Lignes directrices. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-735-01W.pdf
- Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2022). Projet épanouir - promotion de la santé mentale positive en contexte scolaire. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2022/22-914-12W.pdf
- Mutch, J., Golden, S., Purdy, E., Chang, C. H. X., Oliver, N. et Tallentire, V. R. (2024). Equity, diversity and inclusion in simulation-based education: Constructing a developmental framework for medical educators. Advances in simulation, 9(20).
- Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur. (2023). Équité, diversité et inclusion (EDI) : au coeur de la réussite étudiante. https://oresquebec.ca/des-realites-heterogenes-des-besoins-differents-en-soutien-a-la-reussite/
- Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2019). Améliorer les soins aux Premières Nations et aux Inuit en contrant le racisme systémique https://www.oiiq.org/documents/20147/237836/5537-enonce-position-premieres-nations-inuit-web.pdf
- Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2018). Standards de pratique pour l’infirmière en santé scolaire (2e éd.). https://www.oiiq.org/documents/20147/237836/4441-santescolaire.pdf
- Papadopoulos, I., Lazzarino, R., Koulouglioti, C., Aagard, M., Akman, Ö., Alpers, L. M., Apostolara, P., Araneda-Bernal, J., Biglete-Pangilinan, S., Eldar-Regev, O., González-Gil, M. T., Kouta, C., Krepinska, R., Lesińska-Sawicka, M., Liskova, M., Lopez-Diaz, A. L., Malliarou, M., Martín-García, Á., Muñoz-Solinas, M., Nagórska, M., … Zorba, A. (2021). The Importance of Being a Compassionate Leader: The Views of Nursing and Midwifery Managers From Around the World. Journal of transcultural nursing. Official Journal of the Transcultural Nursing Society, 32(6), 765–777
- Pelánek, R., Papoušek, J., Řihák, J., Stanislav, V. et Nižnan, J. (2017). Elo-based learner modeling for the adaptive practice of facts. User Modeling and User‑Adapted Interaction, 26(1), 89‑118.
- Phelan, J. C., Link, B. G. et Dovidio, J. F. (2008). Stigma and prejudice: One animal or two? Social Science & Medicine, 67(3), 358-367.
- Pierre, M., et Bosset, P. (2020). Racisme et discrimination systémiques dans le Québec contemporain: présentation du dossier. Nouvelles pratiques sociales, 31(2), 23-37.
- Pierce, L. (2018). Exploring the experiences of African American nurses: An emancipatory inquiry [thèse de doctorat]. University of North Dakota.
- Pouliot, S. Gagnon, S. et Pelchat, Y. (2015). La formation interculturelle dans le réseau québécois de la santé et des services sociaux. Constats et pistes d'action. Institut national de santé publique du Québec. https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2076_formation_interculturelle_reseau_sante.pdf
- Ratcliff, J. J., Andrus, T., Miller, A. K., Olowu, F. et Capellupo, J. (2023). When potential allies and targets do (and do not) confront anti-Asian prejudice: Reactions to blatant and subtle prejudice during the COVID-19 pandemic. Journal of Interpersonal Violence, 38(23-24), 11890-11913.
- Smith, T. B. et Trimble, J. E. (2016). Multicultural education/training and experience: A meta‑analysis of surveys and outcome studies. Dans T. B. Smith et J. E. Trimble (dir.), Foundations of multicultural psychology: Research to inform effective practice (p. 21-47). American Psychological Association.
- Solar, C. (2019). La Toile de l’équité et le débat. Activités de formation pour l’égalité des sexes. Revue Genre éducation formation – GEF, 3, 24‑41. https://doi.org/10.4000/gef.429
- Thomas, P. et Hazif-Thomas, C. (2022). L’empathie et le sens de la relation dans le soin. NPG Neurologie-Psychiatrie-Gériatrie, 22(128), 72-81. https://www.researchgate.net/publication/356248345_L'empathie_et_le_sens_de_la_relation_dans_le_soin
- Vaccaro, A. (2019). Developing a culturally competent and inclusive curriculum: A comprehensive framework for teaching multicultural psychology. Dans J. A. Mena et K. Quina (dir.), Integrating multiculturalism and intersectionality into the psychology curriculum: Strategies for instructors (p. 22-35). American Psychological Association.
- Wei, H., Corbett, R. W., Ray, J. et Wei, T. L. (2020). A culture of caring: the essence of healthcare interprofessional collaboration. Journal of Interprofessional Care, 34(3), 324‑331.
- White, B. (2018). Interculturalité. Anthropen.org, Éditions des archives contemporaines. https://doi.org/10.17184/eac.anthropen.082
- Woodley, L. K. et Lewallen, L. P. (2021). Forging unique paths: The lived experience of Hispanic/Latino baccalaureate nursing students. Journal of Nursing Education, 60(1), 13‑19.
- Ziani, L. T. (2022). Perceptions d’infirmières nouvellement diplômées sur la contribution d’un programme de résidence infirmière à leur compétence de développement professionnel [mémoire de maîtrise]. Université de Montréal, Papyrus. http://hdl.handle.net/1866/27230
Parties annexes
Gracias
Quiero expresar mi profunda gratitud a Marianne Paul, profesora agregada en el Departamento de ortofonía, Université du Québec à Trois-Rivières, y Estibaliz Jimenez, profesora en el Departamento de educación especializada (psicoeducación) y trabajo social, Université du Québec à Trois-Rivières, por su colaboración. También, quiero agradecer a las personas evaluadoras y al comité de redacción para sus juiciosos comentarios, los cuales me permitieron bonificar este artículo.