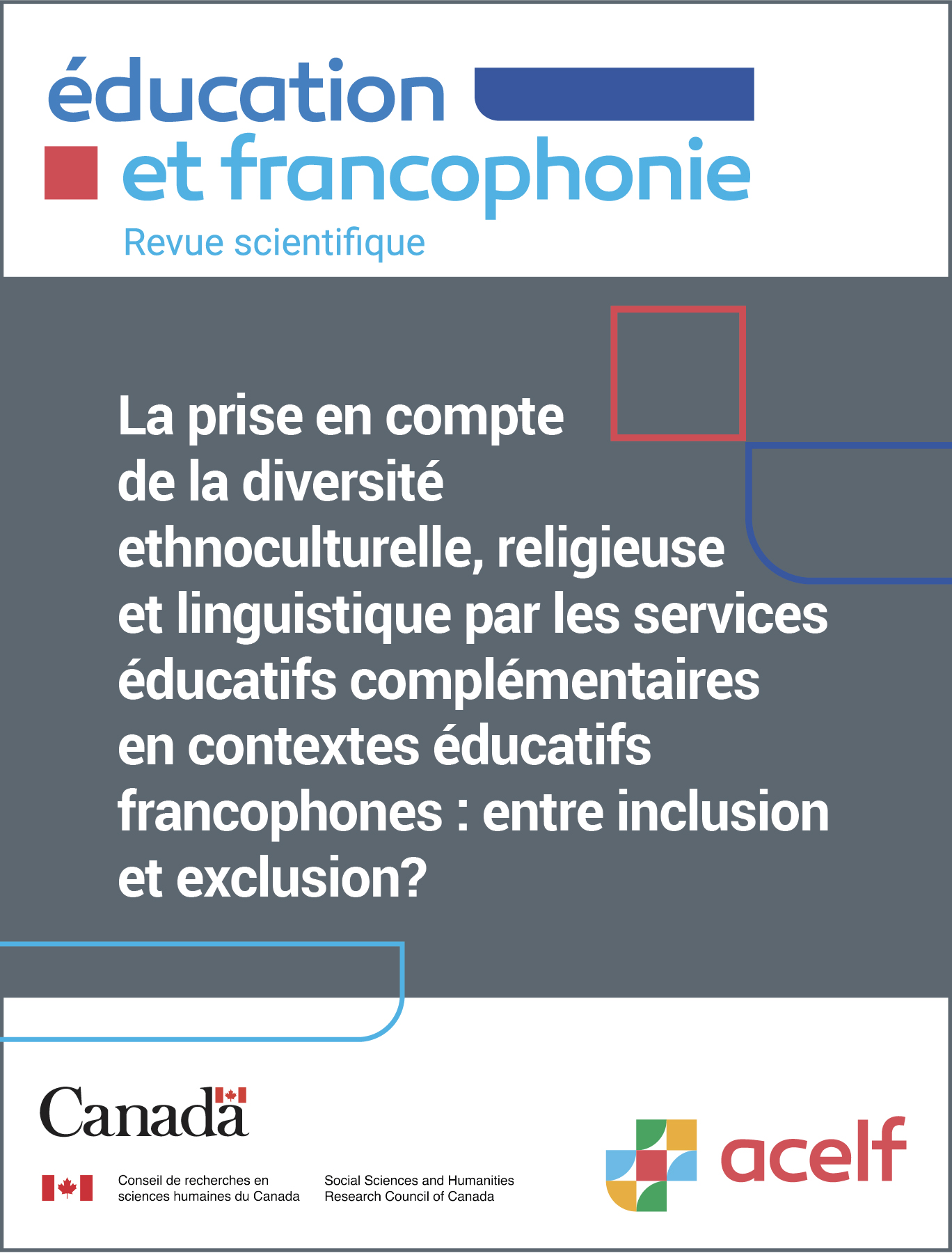Corps de l’article
Contextualisation du numéro thématique
La diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique caractérise la population de plusieurs pays occidentaux francophones, incluant le Canada, la Belgique, la France et la Suisse. Ces pays sont confrontés à des enjeux de diversité similaires comme, par exemple, la mise en oeuvre de leurs politiques migratoires. Certains peuvent aussi être confrontés à des enjeux qui leur sont plus spécifiques, notamment les efforts de réconciliation du Canada avec les nations autochtones ou, encore, les politiques d’aménagement linguistique québécoises. Malgré ces disparités, tous ces enjeux s’inscrivent dans un contexte sociopolitique et médiatique plus large, marqué à la fois par des débats polarisés sur l’accueil et l’intégration des personnes migrantes, sur la place du religieux en contextes éducatifs et sur la reconnaissance du racisme systémique et par diverses initiatives déployées dans les contextes éducatifs pour mettre en oeuvre des pratiques d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI), ou de décolonisation. En effet, les politiques sociales des pays ont un effet direct sur les sentiments d’appartenance ou d’exclusion des groupes minorisés et racisés. Il en est de même pour l’adoption de lois favorisant la culture et la langue du ou des groupes majoritaires, l’élargissement de la laïcité à plusieurs sphères de la société, la fermeture des frontières et le resserrement des lois d’immigration. Ces lois et politiques ont aussi un effet sur l’intégration des individus et groupes minorisés dans divers secteurs, dont l’éducation, la santé et l’emploi.
En contextes éducatifs, la reconnaissance de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique fait l’objet d’initiatives visant à mettre en oeuvre des pratiques de prise en compte de la diversité dans la foulée de l’avènement du paradigme de l’éducation inclusive (Potvin, 2018). Ces initiatives, qui peuvent s’orienter vers une finalité d’équité, s’efforcent notamment de mettre en oeuvre des dispositifs qui assureront l’accessibilité physique et pédagogique, ainsi que la reconnaissance linguistique, culturelle, religieuse ou migratoire de tous les groupes de personnes apprenantes. Elles peuvent aussi tendre vers une finalité de transformation, en favorisant des espaces de participation, en dénonçant les inégalités éducatives et en agissant pour les contrer.
Au-delà des membres du corps enseignant et de l’administration scolaire, plusieurs métiers et professions oeuvrant dans les contextes éducatifs connaissent un essor important. C’est le cas des « techniciennes et techniciens éducatifs » (p. ex. : le personnel de soutien en éducation spécialisée) et des personnels professionnels scolaires (p. ex. : les orthophonistes, les orthopédagogues, les psychologues, etc.) qui peuvent travailler dans divers contextes éducatifs, voire au sein même des institutions éducatives, et ce, de la petite enfance jusqu’à l’université; ou encore dans des organismes communautaires ou dans d’autres services publics tels que les milieux de santé et les milieux privés (Tardif et Levasseur, 2010).
Alors que plusieurs travaux ont déjà porté sur le rôle du personnel enseignant à cet égard (Lorcerie, 2021; Potvin et al., 2021), le présent numéro thématique souhaite se pencher sur la prise en compte de cette diversité par les différentes catégories d’intervenantes et d’intervenants non enseignants qui oeuvrent au sein des services complémentaires en contexte éducatif.
Des services essentiels offerts par les professionnelles et professionnels des services éducatifs complémentaires au Québec
Dans le cadre spécifique de l’école québécoise, les intervenantes et intervenants non enseignants oeuvrent dans les services éducatifs dits « complémentaires » (Ministère de l’Éducation du Québec [MEQ], 2002). Ces services poursuivent quatre visées principales : 1) les services de soutien, visant à offrir à la personne apprenante des conditions propices à l’apprentissage; 2) les services de vie scolaire visant à ce qu’elle développe son autonomie, son sens des responsabilités, sa dimension morale et spirituelle, ses relations interpersonnelles et son sentiment d’appartenance; 3) les services d’aide qui l’accompagnent dans son cheminement, ses choix scolaires et professionnels, et même la recherche de solutions à ses difficultés; 4) les services de promotion et de prévention favorisant sa santé et son bien-être (MEQ, 2002). Ces « services complémentaires » constituent des ressources tant pour les personnes apprenantes et leur famille que pour le personnel enseignant et les autres actrices et acteurs de la communauté éducative. Ils contribuent ainsi aux missions des contextes éducatifs.
Ce numéro thématique vise ainsi à documenter différentes réalités des professionnelles et professionnels des services complémentaires en contextes éducatifs qui oeuvrent auprès des personnes apprenantes issues des minorités visibles, d’origine autochtone ou issues de l’immigration. Pour ce faire, nous proposons neuf contributions scientifiques qui explorent toutes, en vertu de leur discipline, les enjeux actuels de la formation ou du travail de ces professionnelles et professionnels. En effet, la contribution des chercheuses et chercheurs de diverses disciplines (sciences infirmières, orthophonie, psychoéducation, travail social, criminologie, bibliothéconomie, etc.) a rendu possible un numéro interdisciplinaire composé de contributions issues de recherches réalisées dans divers contextes éducatifs francophones du Québec. En tant que l’une des treize provinces et territoires du Canada, le Québec détient les pleines compétences en matière d’éducation et a déployé, dans les cinquante dernières années, divers encadrements qui le distinguent des autres provinces et territoires canadiens, notamment en matière de régulation des droits linguistiques et religieux (p. ex. : la Charte de la langue française[1], la Loi sur la laïcité[2]). Cela pourrait expliquer que nous n’ayons reçu aucune proposition des autres provinces du Canada, et une seul de l’international, mais cette dernière a finalement été écartée, faute d’avoir su démontrer l’apport d’une nouvelle connaissance.
Deux axes structurent l’organisation de l’ensemble des textes proposés dans ce numéro : la formation et les pratiques professionnelles du personnel des services complémentaires.
Axe 1 – La formation : quelle place occupe la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique dans le développement professionnel du personnel des services complémentaires?
Ce premier axe a permis d’interroger les spécificités des domaines d’intervention en matière de préparation des professionnelles et professionnels des services complémentaires, au moment où se multiplient les formations sur les biais inconscients, les pratiques d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI), l’autochtonisation et la décolonisation (.
Selon Borri-Anadon et al. (2018), la formation à la prise en compte de la diversité en contextes éducatifs se caractériserait par une « hégémonie du cloisonnement » (p. 209) reposant sur un découpage par publics, une centration sur la finalité d’équité ainsi que sur un isolement disciplinaire qui ne permet de reconnaître ni la complexité des phénomènes en présence ni leurs incidences multiples. De plus, plusieurs des domaines d’intervention associés à ces professionnelles et professionnels sont ancrés dans une perspective psychomédicale centrée sur des déficits individuels, ce qui peut constituer un frein à la pleine reconnaissance de la diversité des publics (Conseil supérieur de l’éducation [CSE], 2017).
Aussi, comment former les personnels à prendre en compte la complexité des phénomènes en présence dans une perspective plus constructiviste? Comment éviter les enjeux d’essentialisation ou de folklorisation qui nourrissent une vision immuable et fixe des identités des groupes minorisés? Comment la formation peut-elle contribuer à réduire la survisibilité ou l’invisibilité de certains groupes minorisés sur les plans ethnoculturel, religieux ou linguistique?
De plus, de nombreuses transformations actuelles sont également associées à la diversification et à la complexification des expériences migratoires (p. ex. : les immigrantes et immigrants forcés, les personnes réfugiées ayant vécu des traumas et des deuils multiples, les personnes réfugiées mineures non accompagnées, la victimisation et la vulnérabilité spécifique des femmes et des filles issues de l’immigration). Considérant cela, comment adapter les pratiques de formation pour appréhender les spécificités de ces populations de manière adéquate? Comment inclure de manière efficace ces personnes dans le cadre de la formation en évitant le tokénisme et la déresponsabilisation des formatrices et formateurs? Quelle place accorder aux représentations de la diversité de ces futurs personnels dans la formation? Quelles sont les pratiques ou approches innovantes à cet égard?
Dans le cadre de ce premier axe, ce numéro propose quatre articles, dont trois issus respectivement des domaines de la bibliothéconomie, de l’orthophonie et des sciences infirmières, et un quatrième de nature interdisciplinaire.
Dans l’article Conceptions professionnelles de l’équité-diversité-inclusion et mise à l’essai d’un prototype de démarche de formation pour aiguiller les personnes étudiantes en bibliothéconomie jeunesse dans la sélection et l’analyse d’oeuvres littéraires jeunesse, Marie Martel, Catherine Gosselin-Lavoie, Amélie Lemieux, Valérie Bastien et Jean-François Durnin explorent l’effet d’un prototype de démarche de formation mis en place dans un cours universitaire en bibliothéconomie au Québec portant sur la littérature jeunesse. D’abord, la conception de l’équité, de la diversité et de l’inclusion (EDI) des personnes étudiantes inscrites a été explorée dans un questionnaire en ligne. Ensuite, l’analyse qualitative d’un travail visant à sélectionner puis à analyser un album jeunesse a permis de documenter la capacité des personnes étudiantes à appliquer les critères en EDI lors de la sélection et de l’analyse de l’oeuvre.
De leur côté, Manar Jaber, Vincent Bourassa-Bédard, Cassandra Girard, Jessica Lesage, Dima Safi, Édith Coulombe et Marie-Ève Caty examinent la formation des orthophonistes scolaires auprès d’élèves issus de milieux diversifiés dans l’article intitulé De la formation universitaire en orthophonie vers la pratique en milieu scolaire au Québec : processus et résultats sommaires d’une analyse situationnelle menée au sujet des pratiques en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. S’appuyant sur une approche évaluative, les autrices et l’auteur examinent les pratiques du programme d’orthophonie de l’Université du Québec à Trois-Rivières en matière d’EDI. Ils formulent des recommandations concrètes pour renforcer l’adéquation entre la formation en orthophonie et la diversité linguistique et culturelle.
Naima Bouabdillah, dans son article Vers une formation interculturelle renforcée : stratégies innovantes pour les sciences infirmières basées sur une analyse secondaire des défis identifiés, aborde le rôle essentiel des infirmières scolaires dans la promotion de la santé et la prévention des maladies auprès des jeunes, particulièrement dans un contexte marqué par la diversité culturelle. L’autrice met en lumière les lacunes de la formation infirmière initiale, notamment en ce qui concerne l’intégration des concepts d’EDI. L’analyse secondaire d’une thèse doctorale révèle que l’absence de préparation adéquate dans les formations cliniques laisse les infirmières mal équipées pour répondre aux défis interculturels. L’article recommande l’intégration d’une formation interculturelle et des stratégies pédagogiques adaptées pour mieux préparer les infirmières à offrir des soins plus appropriés dans des environnements diversifiés.
Enfin, le quatrième article, La formation des personnes professionnelles des services complémentaires à la prise en compte de la diversité : portrait des pratiques déclarées à l’Université du Québec à Trois-Rivières, se penche sur les pratiques de formation au sein de quatre départements de cette institution au moyen d’un questionnaire en ligne. À partir d’une typologie basée sur le statut accordé à la diversité, l’analyse des autrices Corina Borri-Anadon, Sivane Hirsch, Marianne Paul, Naima Bouabdillah et Estibaliz Jimenez met de l’avant la saillance des pratiques centrées sur certains groupes spécifiques et les risques qui leur sont associés. De plus, certaines pratiques novatrices qui reconnaissent et valorisent la contribution des personnes issues des groupes minorisés dans la formation, et qui suscitent la réflexivité et l’engagement des personnes étudiantes, ont également été documentées et constituent une voie prometteuse pour orienter la recherche et la formation dans ce domaine.
Axe 2 – Les pratiques professionnelles du personnel des services complémentaires : quelle reconnaissance est accordée aux réalités et aux expériences des personnes apprenantes des groupes racisés ou minorisés?
Ce deuxième axe aborde la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique par le personnel des services éducatifs complémentaires lors de leurs pratiques professionnelles en contextes éducatifs. En effet, sachant que ces dernières ont une incidence certaine sur les expériences socioéducatives des personnes apprenantes (Demeuse et Baye, 2008), il importe de reconnaître leurs réalités spécifiques afin de réduire les obstacles susceptibles d’entraver leurs parcours éducatifs. Pensons, par exemple, aux initiatives, aux activités et aux ressources développées qui, finalement, et malgré de bonnes intentions, peuvent générer des obstacles et des exclusions supplémentaires, notamment via les processus d’évaluation des besoins et de classement vers des services spécialisés (Bauer et Borri-Anadon, 2021; Borri-Anadon et al., 2021). Cela pourrait même contribuer à la surreprésentation des personnes apprenantes autochtones, racisées, issues de l’immigration ou, encore, celles qui sont minorisées sur les plans linguistique, religieux ou migratoire, celles qui sont en adaptation scolaire et celles placées sous la responsabilité de la Direction de la protection de la jeunesse.
Les questions en lien avec cet axe sont les suivantes : comment les réalités et expériences des personnes apprenantes autochtones, racisées, issues de l’immigration ou minorisées sur les plans linguistiques, religieux ou migratoires sont-elles considérées lors de la mise en place des services complémentaires? Comment les services complémentaires soutiennent-ils la participation de ces personnes dans les prises de décisions qui les concernent? Quels sont les enjeux à cet égard?
Cinq articles composent cet axe, dont deux viennent du domaine de l’orthophonie, et un autre de la sociologie de l’éducation. Les deux derniers adoptent une approche interdisciplinaire.
Dans leur article La prise en compte du bilinguisme lors d’un dépistage en orthophonie : vers une meilleure identification des enfants bilingues d’âge préscolaire, Marianne Paul et Elin Thordardottir abordent l’effet du bilinguisme sur l’identification d’un trouble de langage en présentant différentes stratégies pouvant être mises en place par les orthophonistes. Deux de ces stratégies sont explorées par un questionnaire destiné aux parents qui vise le dépistage des difficultés langagières chez les enfants d’âge préscolaire au Québec. La première consiste à séparer les items en deux sous-échelles selon l’effet attendu (plus ou moins fort) du bilinguisme sur le domaine du langage concerné, tandis que la deuxième s’attarde au choix du point de repère permettant d’identifier la présence de difficultés. Ces stratégies gagneraient à être mobilisées parmi d’autres afin de tendre vers des pratiques évaluatives plus équitables et inclusives lors de l’utilisation de tests normés.
Dans l’article Les rôles professionnels des orthophonistes scolaires en matière d’évaluation en contexte de diversité linguistique : constats à partir d’une enquête exploratoire, Marie Nader et Corina Borri-Anadon abordent, pour leur part, les rôles d’expertes et de défenseuses dans les pratiques évaluatives des orthophonistes scolaires oeuvrant en contexte de plurilinguisme au Québec. À partir de données portant sur leur identité linguistique, leurs croyances quant à l’évaluation orthophonique et leurs pratiques d’évaluation déclarées, des tensions entre ces deux rôles sont discutées, de même que les pistes pour favoriser leur complémentarité.
Roberta de Oliveira Soares analyse l’expérience des élèves en apprentissage du français à travers les concepts d’altérisation et de pensée déficitaire, et de techniques de contrôle dans son article L’expérience des élèves en apprentissage de la langue de scolarisation à l’égard des services éducatifs complémentaires au Québec : entre soutien et altérisation. À partir d’entretiens réalisés avec des professionnelles des services éducatifs complémentaires et des élèves du secondaire qui ont fréquenté une classe d’accueil, l’autrice propose une réflexion critique sur la prise en compte de la diversité à travers le rôle attribué aux services éducatifs complémentaires.
Dans son article Services éducatifs complémentaires à la formation générale des adultes : considération de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique, Carl Beaudoin explore la façon dont cette diversité est prise en compte par le personnel des services éducatifs complémentaires provenant de divers domaines professionnels. Quatre types de pratiques sont déclarées par les participantes et participants lors de groupes de discussion : universelles, individuelles, de groupe et indirectes. L’auteur discute du risque d’invisibilisation ou d’essentialisation des élèves lorsque la représentation de la diversité est individuelle.
Finalement, l’article Les violences basées sur l’honneur (VBH) au Québec : défis de dépistage et d’intervention pour les intervenantes psychosociales et intervenants psychosociaux en milieu collégial de Bryan Dallaire-Tellier, Estibaliz Jimenez et Marie-Marthe Cousineau utilise une approche interdisciplinaire pour aborder l’intervention psychosociale auprès des victimes des violences basées sur l’honneur (VBH). Cet article s’intéresse aux expériences des personnes intervenantes psychosociales en milieu collégial au Québec susceptibles d’intervenir dans les situations marquées par les VBH. À partir de la perception d’intervenantes et d’intervenants de divers champs d’intervention, cette contribution analyse leur niveau de connaissances, de même que les défis de dépistage et d’intervention rencontrés afin de préciser leurs besoins de formation.
Conclusion
Ce numéro thématique s’était donné pour objectif de documenter, à partir de différentes perspectives et approches disciplinaires, les avenues par lesquelles les professionnelles et professionnels des services éducatifs complémentaires en contextes éducatifs francophones sont préparés à oeuvrer en contexte de diversité, et leurs pratiques à cet égard. Ce faisant, les contributions réunies dans ce numéro mettent en lumière la complexité des enjeux liés à la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en contextes éducatifs. Les constats partagés dans les différentes contributions révèlent l’existence d’une tension entre la volonté des professionnelles et professionnels des services complémentaires d’adopter des pratiques équitables, et les contraintes imposées par des cadres souvent ancrés dans une logique normative qui tend à invisibiliser les dimensions culturelles, sociales et historiques des parcours des personnes des groupes minorisés. Cette tension appelle à un changement de posture et à une révision des paradigmes dominants : il ne s’agit plus juste d’adapter les pratiques actuelles et d’« intégrer » la diversité dans les modèles existants. En effet, il faut, d’une part, repenser en profondeur les formations professionnelles, tant initiales que continues, qui s’avèrent des leviers centraux de transformation, et, d’autre part, réfléchir aux conditions d’exercice qui permettent la remise en question des normes implicites, et qui favorisent une posture réflexive et l’émergence de pratiques véritablement inclusives.
En somme, ce numéro thématique démontre que reconnaître la diversité dans les contextes éducatifs ne saurait se limiter à des ajustements techniques ponctuels. Cela exige une véritable transformation systémique. Cette transformation, si elle est portée de façon critique et engagée, peut contribuer à construire des environnements éducatifs plus équitables et socialement justes, où les pratiques peuvent faciliter la reconnaissance identitaire des personnes apprenantes. Ces constats effectués, nous invitons les chercheuses et chercheurs à s’attarder dès maintenant aux pratiques de formation qui permettent de mieux reconnaître les diverses situations d’exclusion et de discrimination, et aux pratiques professionnelles qui permettent d’agir afin de les contrer collectivement dans une perspective de coresponsabilité. Il importe aussi de considérer les bouleversements rapides en matière d’acquis au regard de l’EDI, au Québec comme ailleurs, et de maintenir une compréhension complexe des enjeux actuels vécus par les personnes membres des groupes minorisés.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Charte de la langue française. RLRQ. c. C -11. http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-11
-
[2]
Loi sur la laïcité de l’État. Chapitre L-0.3. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/l-0.3
Bibliographie
- Bauer, S. et Borri-Anadon, C. (2021). De la reconnaissance à l’invisibilisation : une modélisation des enjeux conceptuels de la diversité en éducation inclusive. Alterstice, 45-56. https://www.erudit.org/fr/revues/alterstice/2021-v10-n2-alterstice06650/1084912ar/
- Borri-Anadon, C., Audet, G. et Lemaire, E. (2021). Regards d’acteurs et d’actrices scolaires quant à l’engagement en faveur d’une culture d’équité dans des écoles secondaires québécoises. Recherches en éducation, 44, 57-71. https://journals.openedition.org/ree/3352
- Borri-Anadon, C., Prud’homme, L., Ouellet, K. et Boisvert, M. (2018). « La formation à l’enseignement dans une perspective inclusive : de l’hégémonie du cloisonnement à une approche holistique ». Dans C. Borri-Anadon, G. Gonçalves, S. Hirsch et J. Queiroz Odinino (dir.), La formation des éducateurs en contexte de diversité : une perspective comparative Québec-Brésil (p. 206-224). Deep Education Press.
- Conseil supérieur de l’éducation (2017). Pour une école riche de tous ses élèves : s’adapter à la diversité des élèves, de la maternelle à la 5e année du secondaire. https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2017/10/50-0500-AV-ecole-riche-eleves.pdf
- Demeuse M. et Baye A. (2008). Indicateurs d’équité éducative : une analyse de la ségrégation académique et sociale dans les pays européens. Revue française de pédagogie, 165, 91-103.
- Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) (2002). Les services éducatifs complémentaires : essentiels à la réussite. Direction de la formation générale des jeunes. http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/SEC_Services_19-7029_.pdf
- Lorcerie, F. (2021). Éducation et diversité : les fondamentaux de l’action. Presses universitaires de Rennes.
- Potvin, M. (2018). Guide pour les intervenants scolaires : pour des milieux éducatifs inclusifs, démocratiques et antidiscriminatoires [document inédit]. Observatoire sur la formation à la diversité et l’équité.
- Potvin, M., Magnan, M.-O., Larochelle-Audet, J. et Ratel, J.-L. (dir.) (2021). La diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation : théorie et pratique (2e éd.). Fides Éducation.
- Tardif, M. et Levasseur, L. (2010). La division du travail éducatif. Une perspective nord-américaine. Paris: PUF. 206 p