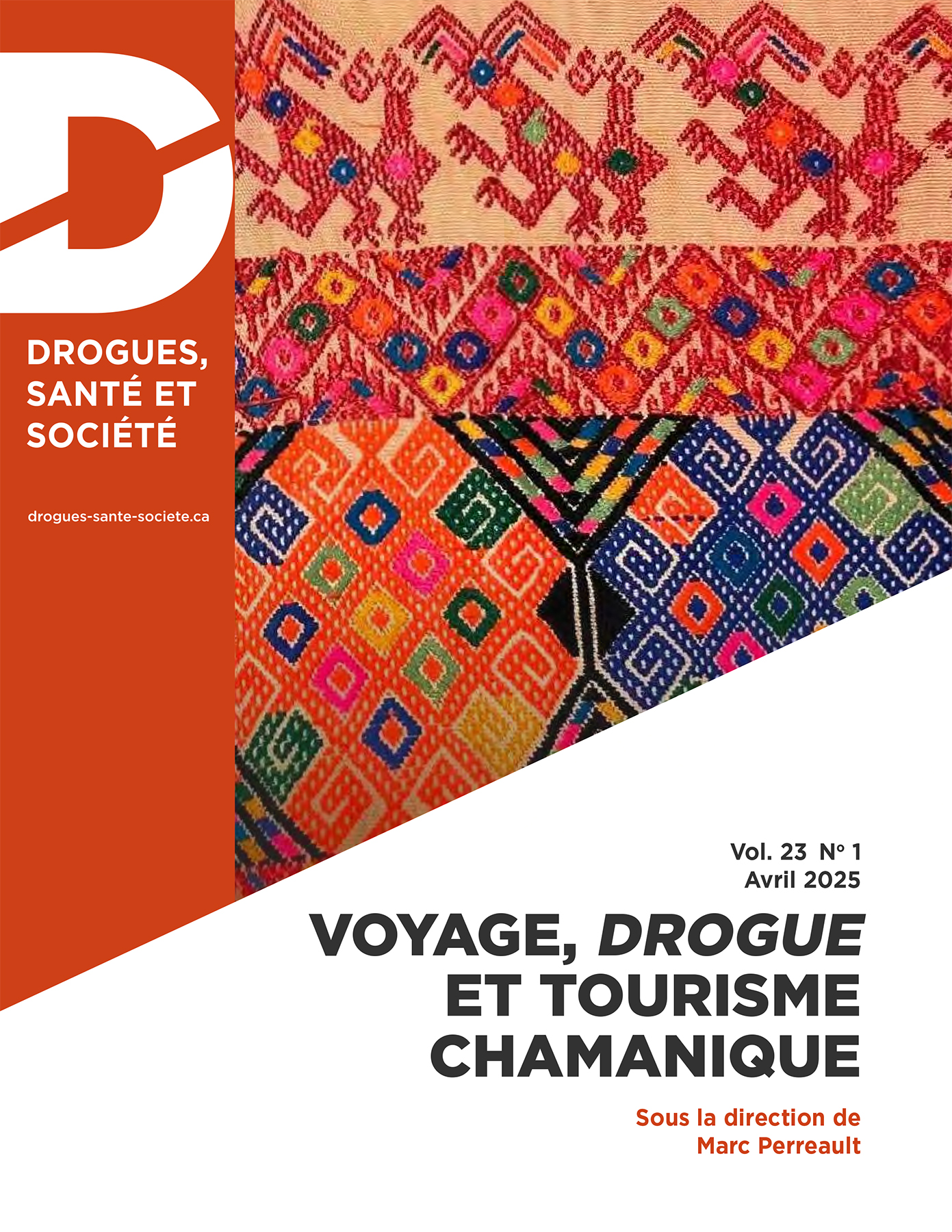Les drogues voyagent et font voyager au propre comme au figuré. Elles deviennent les substances que l’on connaît sous des noms distincts en franchissant des territoires et des frontières de sens qui transforment leur usage, tandis que les chemins que prennent ses voyageurs sont autant réels et parsemés d’épreuves qu’imaginaires. En empruntant la piste de la drogue, nous proposons dans ce numéro de la revue Drogues, santé et société d’aller à la rencontre de ces voyageurs particuliers, touristes-explorateurs entre les mondes visibles et invisibles d’ici et d’ailleurs, pour découvrir avec eux les représentations du voyage et de ses multiples usages. Fils conducteurs emmaillés de la présente aventure, la drogue, avec toutes les ambiguïtés qui l’entourent, devient un prétexte pour interroger « la relation du moi au monde que tisse le voyage » (Urbain, 2003, p. 188), alors que le voyage, dans toutes ses étendues imaginables, se révèle un prétexte pour nous pencher sur le « devenir-drogue » et ses voies de sortie. Si le voyage des drogues peut mener jusqu’à des mondes encore inexplorés, voire dans l’« hyperespace » (St. John, 2017), il n’est pas rare que son trajet se déroule dans l’intériorité des corps en « résonnance ». Peu importe la distance parcourue et la nature des espaces visités, l’accompagnement d’un « guide » pourra s’avérer déterminant dans l’accomplissement dudit voyage. S’il est devenu un lieu commun de comparer l’expérience des drogues à un voyage, pour certains, l’expérience du voyage se compare volontiers à l’effet d’une drogue. Il existe des « drogués » du voyage tout comme on a pu parler durant une période pas très éloignée de nous de « fous voyageurs ». Le rêve de partir, la fébrilité du départ, l’exaltation de l’arrivée, l’idée de s’évader du quotidien aliénant afin de vivre de nouvelles expériences contribuent à faire du voyage — ou de l’idée que l’on se fait de celui-ci — une « drogue » sans substance. Et puisque cela ne suffit pas toujours, pour pousser son adrénaline à des sommets personnels le touriste-aventurier n’hésitera pas à s’adonner à des activités périlleuses où le défi et la sensation du risque le transporteront dans un état altéré proche de « la petite mort » surpassant en gratification l’effet attendu des drogues. Avec ses propriétés autant stimulantes qu’introspectives, le voyage pourra aussi être vécu comme un moyen d’échapper à ses problèmes de « dépendance ». On quitte pour changer son mal de place et dans l’espoir de se créer de nouvelles habitudes. Qu’il soit « intérieur » ou d’aventure, le voyage appartient à la panoplie des outils adoptés dans le cadre d’une démarche d’abstinence ou de retour à l’équilibre de la santé. Que l’on parte en groupe sur les eaux du monde dans une sorte de cure fermée sur un navire comme le Bel Espoir du père Michel Jaouen ou avec des « aînés » dans un campement « dans le bois » proche de sa communauté afin de se raccorder avec ses traditions et son autochtonie, le « voyage » contient des propriétés thérapeutiques dont on connaît encore mal toutes les vertus. À l’inverse, par son côté « extra-ordinaire » créant une brèche dans les repères habituels du quotidien, le voyage s’avérera pour plusieurs une raison pour tenter de nouvelles expériences sans prendre garde aux risques qu’elles comportent. Combien de touristes insouciants sont-ils tombés dans le panneau de (faux-vrais) policiers-malfrats et ont dû payer un gros prix pour éviter la prison lors de l’achat d’une petite (ou moins petite…) quantité de drogues ; ou encore, ont dû recevoir des soins parce qu’ils avaient exagéré sur les doses ou …
Parties annexes
Bibliographie
- Bouvier, N. (2014) L’usage du monde. La Découverte.
- Christin, R. (2020) La vraie vie est ici. Voyager encore ? Les Éditions Écosociété.
- Cooper, D. (1976). Une grammaire à l’usage des vivants. Seuil.
- Deleuze. G. (1969). Logique du sens. Les Éditions de Minuit
- Duchaussois, C. (1971) Flash ou le Grand Voyage. Fayard.
- Eliade, M. (1983). Le chamanisme et les techniques archaïques de l’extase. Payot.
- Furst, P.T. (1974). Trouver notre vie : le peyotl chez les Indiens huicholes du Mexique. Dans P.T. Furst (dir.), La chair des dieux. L’usage rituel des psychédéliques (p. 122-181). Seuil.
- Ginsburg, C. (2010). Les Européens découvrent (ou redécouvrent) les chamans. Dans C. Ginsburg, Le fil et les traces. Vrai faux fictif (p. 141-167). Verdier.
- Hacking, I. (2002). Les fous voyageurs. Les empêcheurs de penser en rond.
- Heidegger, M. (1958). Science et méditation. Dans M. Heidegger, Essais et conférences (p. 49-79). Gallimard.
- Kerouac, J. (1960). Sur la route. Gallimard.
- Lapouge, G. (2020). L’encre du voyageur. Albin Michel.
- Lenoir, F. (2021). Jung. Un voyage vers soi. Albin Michel.
- Maffesoli, M. (1997). Du nomadisme. Vagabondages initiatiques. Librairie générale française.
- Michel, F. (2004). Désirs d’ailleurs. Essai d’anthropologie des voyages. Les Presses de l’Université Laval.
- Milner, M. (2000). L’imaginaire des drogues. De Thomas de Quincey à Henri Michaux. Gallimard.
- Narby, J. et Huxley, F. (dir.) (2002). Chamanes au fil du temps. Cinq cents ans sur la piste du savoir. Albin Michel.
- Perreault, M. (2009). Rites, marges et usages des drogues : représentations sociales et normativité intellectuelle. Drogues, santé et société, 8(11), 11-55. https://doi.org/10.7202/038915ar
- Rosa. H. (2021). Résonnance. Une sociologie de la relation au monde. Éditions La Découverte poche.
- St. John, G. (2017). Hyperespace dans le cyberespace : DMT et méta-ritualisation. Drogues, santé et société, 16(2), 76-103. https://doi.org/10.7202/1041854ar
- Urbain, J.-D. (1993). L’idiot du voyage. Histoires de touristes. Payot & Rivages.
- Urbain, J.-D. (2003). Secrets de voyage. Menteurs, imposteurs et autres voyageurs impossibles. Petite Bibliothèque Payot.
- Urbain, J.-D. (2017). Le voyage était presque parfait. Essai sur les voyages ratés. Payot & Rivages.
- Wittgenstein, L. (2002). Remarques mêlées. Flammarion.