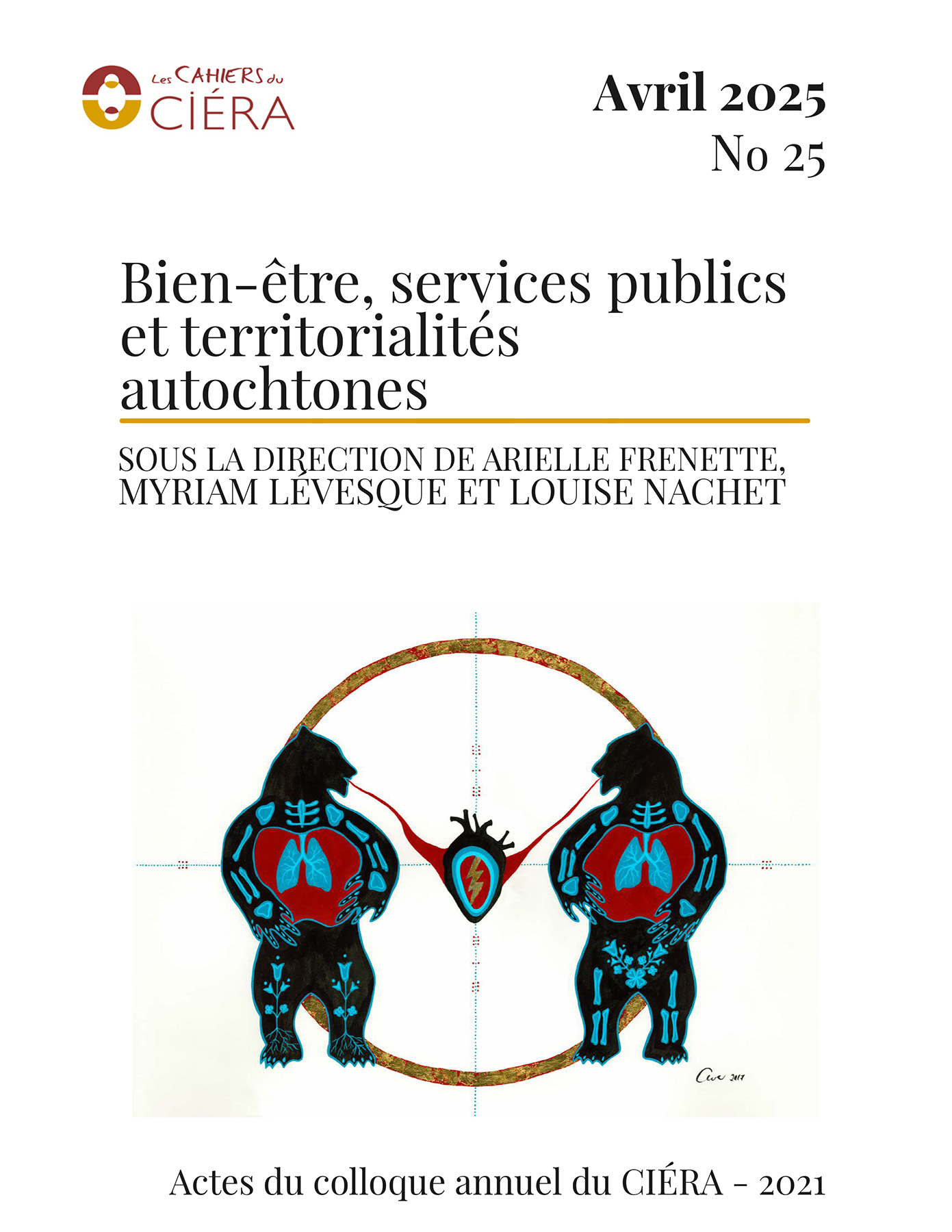Corps de l’article
La plume d’aigle est considérée comme un objet sacré chez plusieurs peuples autochtones et est souvent utilisée dans les cérémonies et certains protocoles au Canada (Swain 2017). Elle peut être utilisée également pour orner certains objets sacrés, comme une coiffe de chef, un calumet de la paix (Dumouchel 2005) ou encore un bâton de parole[15] (Bousquet 2009). Simple ou ornée de perles ou d’un ruban, la plume d’aigle peut être tenue seule dans les mains lorsqu’une personne s’exprime oralement à un événement public (ibid.). Voici deux exemples éloquents et médiatisés de cet usage : lorsque Elijah Harper, de la nation oji-crie et député provincial du Manitoba, alors connu comme « l’homme avec une plume d’aigle » (Swain 2017 : 55), s’était opposé à l’Accord du lac Meech[16] le 12 juin 1990, lors de l’Assemblée législative du Manitoba et lorsqu’Ellen Gabriel avait demandé la reconnaissance du territoire des Kanien'kehà:ka lors de la résistance de 1990 à Kanehsatà:ke[17] (ibid.). Plus récemment, à la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (2016-2019)[18], plusieurs objets culturels ont été intégrés aux protocoles et aux étiquettes diplomatiques à l’intention des personnes autochtones, dont la possibilité de prêter serment avec une plume d’aigle à la main. Ainsi, la présidente de Femmes Autochtones du Québec (FAQ), Viviane Michel, a prêté serment sur la plume d’aigle avant de témoigner (CERP 2018).
La plume d’aigle est toutefois un symbole énigmatique pour plusieurs citoyens canadiens allochtones, dont moi-même, qui en connaissent peu sur la réelle signification et la portée de ses usages. Pour éclairer un peu plus le sujet, le présent article aborde le symbolisme de la plume d’aigle chez les Premières Nations et son association au panautochtonisme ainsi que certains de ses usages dans des événements publics et protocolaires au Canada, notamment dans le domaine judiciaire. Des utilisations problématiques de la plume d’aigle recensées selon les individus qui en font usage seront abordées par la suite. Finalement, j’exposerai en quoi la possession d’une simple plume d’aigle est normée au Canada.
Plusieurs types d’oiseaux et leurs plumes sont utilisés chez les Premières Nations comme des symboles : pour plusieurs, l'aigle est maître du jour, le hibou, maître de la nuit, le pic-bois, maître des arbres et le canard, maître de l'eau (Fletcher 1996, paraphrasé dans Dumouchel 2005). Les plumes de la perdrix sont également estimées chez les Anicinabek; au même titre que celles de l’aigle, elles protègent des mauvais esprits (Clément et Martin 1993; Bousquet 2002). L’aigle est d’ailleurs considéré comme l’animal le plus sacré dans la spiritualité traditionaliste des Premières Nations et il peut être représenté par une seule plume (Bousquet 2002). Associé surtout aux Peuples Originaires des plaines des États-Unis d'Amérique (ibid.), comme les Sioux et les Nakoda Oyadebi, l’aigle est devenu un emblème panautochtone, symbolisant la fraternité entre tous les Autochtones de l’Amérique du Nord (ibid.). Le panautochtonisme se définit comme un mouvement qui s’est développé au début du 20e siècle (Clément 2017) et qui représente un ensemble de pratiques culturelles communes à plusieurs peuples autochtones de cette région (ibid.). Ainsi, tant chez les Atikamekw que chez plusieurs autres nations autochtones, l’aigle est un symbole de force et un « messager entre le Créateur et les humains » (ibid. : 92). L’oiseau capable de planer le plus haut dans le ciel, « il a une vision élargie du monde » (ibid. : 93). L’aigle « représente [alors] les relations de déférence et d’intimité des [Premiers Peuples] avec le Créateur, la communication entre la terre et le ciel. Il est [donc] impensable de tuer un aigle » (Bousquet 2002 : 82). C’est pourquoi ses plumes ont une grande valeur et sont utilisées à des fins cérémonielles. Elles attirent l’énergie et en facilite ainsi la circulation (Bousquet 2009). La plume d'aigle peut également symboliser une valeur bien au-delà d’une perspective instrumentale et intrinsèque, voire économique ; elle représente les valeurs sociales et culturelles qui sont à la fois matérielles et immatérielles (Gray 2017). La plume d'aigle détient alors la plus grande valeur, en ce sens que sa valeur est culturelle et spirituelle :
Value is also culturally linked to other items that have even more value which should never be exchanged for profit. Eagle feathers are one of the most highly prized items for Indigenous people; they hold symbolic meanings across the continent for Indigenous people from all nations.
Barrett et Markowitz 2004 : 287, cité dans Gray 2017 : 36
Ainsi, en Amérique du Nord, sa grande valeur symbolique et sacrée est commune chez plusieurs nations autochtones. Quant à son usage, la plume d’aigle se retrouve souvent lors de cérémonies ou d’événements importants surtout chez les Premières Nations. Par exemple, la plume peut ornée un regalia, être utilisée dans le processus de purification de la fumigation, etc. Il est communément admis que, dans l’ensemble, elle est détenue par « un individu jouissant d’un grand prestige social, en général initié à la philosophie traditionaliste et aux pratiques rituelles qui lui sont associées » (Bousquet 2002 : 82). Une plume d’aigle appartient donc souvent à un leader respecté d’une communauté, qui en prend grand soin (Swain 2017). De façon protocolaire, la plume d’aigle doit être offerte comme gage de reconnaissance, donc par mérite, et non simplement obtenue et brandie sans discernement (ibid.). En revanche, un individu qui trouve une plume d'aigle par hasard doit la considérer comme de bon augure et l’entretenir de manière appropriée (ibid.).
La plume d’aigle est présente de plus en plus dans des événements publics canadiens regroupant tant Autochtones qu’allochtones. Dans ses appels à l’action, la Commission de vérité et réconciliation du Canada (2008-2015) a fait des recommandations pour assurer une sécurisation culturelle autochtone et une autochtonisation des pratiques publiques, par l’intégration d’objets et de pratiques autochtones, entre autres, en matière de justice (CVR 2012). En ce sens, le système de justice canadien intègre de plus en plus dans ses procédures des mesures culturellement adaptées aux Autochtones. Dans plusieurs provinces ou territoires, il est dorénavant possible pour une personne autochtone à la cour criminelle, qu’elle soit accusée, témoin ou encore victime, de prêter serment une plume d’aigle à la main au lieu de sur la Bible. À cet égard, en 2018, le Barreau de l’Ontario a élaboré un guide visant à soutenir cette pratique et bien d’autres (Société des plaideurs, Association du Barreau autochtone et Barreau de l’Ontario 2018). Par exemple, une personne autochtone peut également demander qu’une plume d’aigle soit présente dans la salle d’audience, afin d’aider les autres participants à faire preuve de courage et de franchise (ibid.). Dès lors, il existe des protocoles précis sur la façon de prendre soin de la plume d’aigle ainsi que de l’utiliser et de la protéger. D’ailleurs, l’avocat qui en a la responsabilité en salle d’audience doit veiller à respecter ces protocoles (ibid.). Dans la même optique, plusieurs détachements de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont devenus gardiens de plumes d'aigle, afin de fournir aux victimes, aux témoins, aux suspects et aux agents de police « une option spirituellement significative sur laquelle ils peuvent prêter des serments juridiques ou qu'ils peuvent tenir pour se réconforter » (GRC 2021).
Par ailleurs, l’utilisation de la plume d’aigle peut être également objet de contestation au sein des différentes Premières Nations. Par exemple, l’importance symbolique entourant l’aigle comme un élément emblématique est surtout commune chez les membres de factions dites traditionalistes (Bousquet 2002). D’autres membres ayant des visions différentes croient que cet animal est plus associé symboliquement aux régions des Plaines que celles de l’Est canadien; ainsi, sa valeur emblématique serait exagérée selon eux (ibid.). L’usage de la plume d’aigle par une personne non autochtone peut également faire l’objet d’une controverse. Certains membres des Premières Nations pensent qu’il est approprié qu’un·e allochtone puisse utiliser une plume d’aigle s’il lui arrivait d’en trouver une, à condition de la respecter (Swain 2017). Mais d’autres s’y opposent, et ce, particulièrement quand il s’agit d’allochtones représentant l’État canadien. Ce genre de situation peut être perçu par certains comme « une réappropriation symbolique de l’autochtonie pour perpétuer la répression des nations autochtones » [Notre traduction] (Swain 2020 : 143). À titre d’exemple, lorsque Carolyn Bennett a été assermentée à titre de ministre des Affaires autochtones et du Nord en 2015, celle-ci avait reçu de la part de Claudette Commanda, petite-fille de feu William Commanda (1913-2011), leader et aîné algonquin honoré, une plume d’aigle « afin que la ministre l’emporte avec elle lors de son séjour au Cabinet fédéral » [Notre traduction] (Barrera 2015, cité dans Swain 2020 : 149). Or, la ministre représente l’État colonial canadien. En exerçant cette fonction, elle travaille au nom des intérêts de l’État, notamment pour faire respecter et maintenir la souveraineté de l’État (Swain 2020). Ce constat soulève des questions sur « le projet d’inclusion de l’État colonisateur, qui est alors une réappropriation symbolique de la souveraineté autochtone tout en niant celle-ci de façon matérielle et politique » [Notre traduction] (ibid. : 149).
Par ailleurs, la possession de plumes d’aigle est très réglementée au Canada. Le Règlement sur les oiseaux migrateurs (ROM), mis en vigueur en 1917 pour protéger les oiseaux migrateurs, autorise seuls les Canadiens ayant un permis ainsi que les « Indiens inscrits[19] » en vertu de la Loi sur les Indiens (1876) et les Inuit à exercer la chasse d’oiseaux migrateurs et à posséder des plumes à des fins déterminées (Gouvernement du Canada 2022). Or, un projet de loi a été déposé en 2019 en vue d’étendre le ROM à l’ensemble des peuples autochtones au Canada exerçant un droit reconnu et affirmé en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les autorisant à donner une plume à une autre personne à des fins éducatives, sociales, culturelles ou spirituelles (Gouvernement du Canada 2019). Pour illustrer un problème particulier que peut soulever cette loi : Patrick Deranger, un aîné de la nation dénée de l’Alberta et sa conjointe ont voulu offrir en 2019 une plume d’aigle à chaque étudiant·e d’un groupe issu des Premières Nations de Calgary, afin de souligner leur persévérance scolaire (McLean 2019). L’aigle comme les autres oiseaux de proie étant sous la juridiction provinciale de la Wildlife Act (2020 [2000]), la Fish and Wildlife Enforcement Branch n’a pas pu approuver la demande de M. Deranger de permettre aux étudiants issus de la nation des Métis ou n’ayant pas le statut d’Indien inscrit de recevoir ladite plume (ibid.). À l’instar du Canada, les États-Unis d’Amérique réglementent fortement l’aigle, notamment en vertu du : The Bald and Golden Eagle Protection Act (1940). Ainsi, seuls ceux et celles ayant le statut d’Indien inscrit au Canada peuvent voyager aux États-Unis d’Amérique en possession personnelle d’une plume d’aigle à des fins spirituelles ou cérémoniales seulement (Gouvernement du Canada 2017).
En conclusion, la plume d’aigle est un objet sacré, voire spirituel pour de nombreux Premiers Peuples au Canada et en Amérique du Nord. Entre autres, elle transmet des valeurs comme la force, la transparence et l’honnêteté à celui ou celle qui la tient dans ses mains en s’apprêtant à prendre la parole. Par sa seule présence dans une pièce, elle peut également donner du courage à tous ceux et celles qui s’y trouvent. Depuis la tenue de nombreuses commissions concernant les peuples autochtones, dont la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR), il a été recommandé d’autochtoniser et de sécuriser culturellement certaines pratiques dans les services publics canadiens. Ainsi, la plume d’aigle s’est peu à peu intégrée dans les cérémonies et les protocoles étatiques, dont ceux des instances judiciaires. En prenant conscience de sa signification transmise dans son usage, la plume d’aigle doit être utilisée avec tout le respect qu’elle commande et ne doit pas être perçue comme un élément folklorique ou un simple accommodement esthétique. Un symbole de cette nature devrait inspirer les allochtones à faire preuve d’ouverture et de véracité quant aux actions passées et les guider vers une réelle réconciliation.
Parties annexes
Note biographique
Karine Villeneuve est étudiante à la mineure en études autochtones à l’Université de Montréal et y complète un baccalauréat par cumul (criminologie et victimologie). Elle s’intéresse aux modes de justice et de résolution de conflits autochtones et allochtones.
Notes
-
[15]
Appartenant généralement à un·e guérisseur·se ou leader·euse spirituel·le, le bâton de parole est un objet « chargé de pouvoir et confié à celui [ou celle] qui a besoin de s’exprimer en public ». De même que pour la plume d’aigle, « personne ne peut interrompre quelqu’un qui en a un entre les mains » (Bousquet 2009 : 70).
-
[16]
Il s’agit d’un projet de ratification de la Constitution canadienne négocié en 1987 entre le gouvernement du Canada, alors dirigé par le cabinet de l’honorable Brian Mulroney, et les dix provinces. Les négociations ont avorté en 1990.
-
[17]
Cet événement est également connu sous le nom de la Crise d’Oka (1990).
-
[18]
Elle est également connue sous le nom de Commission Viens.
-
[19]
Il s’agit de toute personne issue d'une Première Nation qui est reconnue par le gouvernement fédéral comme inscrite au registre des Indiens, et ce, en vertu de la Loi sur les Indiens (1876). Les Métis et Inuit n’ont pas ce statut, tout comme tous les membres des Premières Nations qui n’y sont pas inscrits.
À noter qu'il est péjoratif pour les allochtones d’employer le terme « Indien », et ce, hors de ce contexte strictement juridique.
Bibliographie
- BOUSQUET, Marie-Pierre, 2002, « Les Algonquins ont-ils toujours besoin des animaux indiens? Réflexions sur le bestiaire contemporain », Théologiques, 10(1) : 63-87.
- BOUSQUET, Marie-Pierre, 2009, « Régler ses conflits dans un cadre spirituel : pouvoir, réparation et systèmes religieux chez les Anicinabek du Québec », Criminologie, 42(2) : 53–82.
- CLÉMENT, Sarah, 2007, Guérison communautaire en milieu atikamekw. L’expérience du Cercle Mikisiw pour l’espoir à Manawan. Mémoire de maîtrise, Université Laval.
- Commission d'enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics [CERP], Audience tenue le 14 décembre 2018, Volume 174, Val d’or : Gouvernement du Québec. En ligne : https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Transcriptions/Notes_stenographiques_-_CERP_14_decembre_2018_avec_num_corriger.pdf, [consulté le 13 février 2022].
- Commission de vérité et réconciliation du Canada [CVR], 2012, « Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l’action », Winnipeg : Gouvernement du Canada. En ligne : https://nctr.ca/wp-content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf, [consulté le 13 février 2022].
- DUMOUCHEL, Jean-François, 2005, « Le calumet de paix, un objet de contacts : Étude et analyse d’une pipe amérindienne », Recherches amérindiennes au Québec, 35(2) : 29-37.
- Gendarmerie royale du Canada [GRC], 2021, « Les plumes d’aigle rapprochent les communautés autochtones et la GRC de la Saskatchewan », Saskatchewan : GRC, 25 mai 2021. En ligne : https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2021/plumes-daigle-rapprochent-communautes-autochtones-et-grc-saskatchewan?re, [consulté le 12 février 2022].
- Gouvernement du Canada, 2017, « Voyager aux États-Unis avec des produits de l’aigle : consignes pour les Autochtones », Gouvernement du Canada, 5 juillet 2017. En ligne : https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/convention-commerce-international-especes-menacees-extinction/legislation-protection-animaux-plantes-sauvages/voyager-produits-aigle-consignes-autochtones.html, [consulté le 18 février 2022].
- Gouvernement du Canada, 2019, « Règlement sur les oiseaux migrateurs », La Gazette du Canada, Partie I, 153(22) », Gouvernement du Canada 1er juin 2019. En ligne : https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-06-01/html/reg3-fra.html, [consulté le 13 février 2022].
- Gouvernement du Canada, 2022, « Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., ch. 1035) », Gouvernement du Canada, 8 février 2022. En ligne : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._1035/TexteComplet.html, [consulté le 19 février 2022].
- GRAY, Malinda Joy, 2017, Beads: Symbols of Indigenous Cultural Resilience and Value. Mémoire de maîtrise, Université de Toronto.
- MCLEAN, Tanara, 2019, « Dene elder questions Alberta eagle feather policy », Edmonton: Canadian Broadcasting Corporation [CBC], May 2, 2019. Retrieved from : https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/eagle-feathers-alberta-1.5119356, [has been consulted on February 12, 2022].
- Société des plaideurs, Association du Barreau Autochtone et Barreau de l’Ontario, 2018, « Guide pour les avocats qui travaillent avec des parties autochtones », Barreau de l’Ontario. En ligne : https://www.advocates.ca/Upload/Files/PDF/Advocacy/BestPracticesPublications/Guide_pour_les_avocats_qui_travaillent_avec_des_parties_autochtones_may16.pdf, [consulté le 12 février 2022].
- SWAIN, Stacie, A., 2017, Armed with an Eagle Feather Against the Parliamentary Mace: A Discussion of Discourse on Indigenous Sovereignty and Spirituality in a Settler Colonial Canada, 1990-2017. Mémoire de maîtrise, Université d’Ottawa.
- SWAIN, Stacie, 2020, « Ceremony and the symbolic re-appropriation. A feminist critique of settler colonialism in a progressive liberal democratic nation-state », in Kathleen McPhillips et Naomi Goldenberg (dirs.), The End of Religion. Feminist Reappraisals of the State (pp. 139-168). London: Routledge.