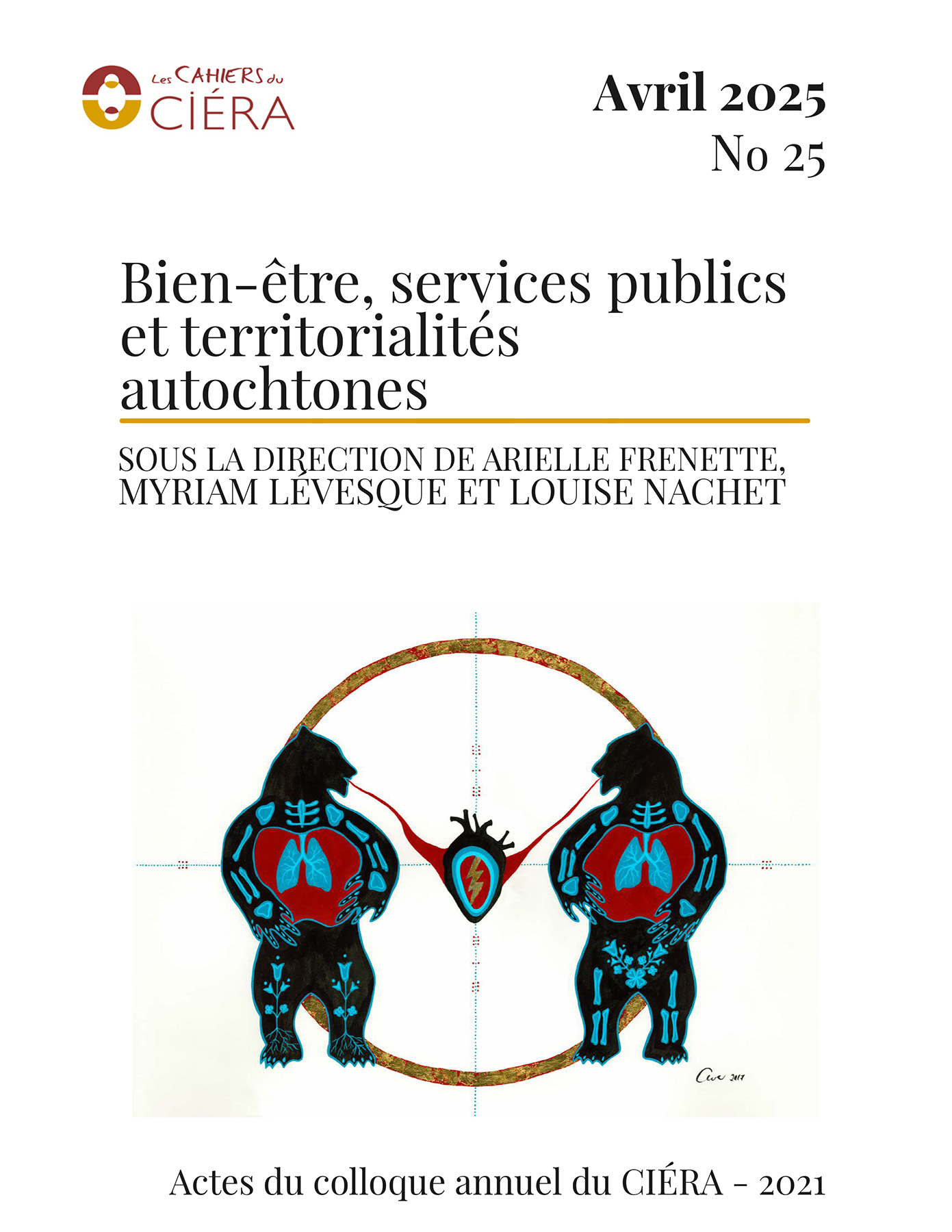Corps de l’article
Les Indigenous Music Awards (IMA)[2] de 2019 ont débuté par une cérémonie d’ouverture mettant en vedette une délégation de trois personnes autochtones (PowWows.com 2020[3]). À droite se trouve une femme recouverte d’une peau d’ours, Laura Grizzlypaws (aussi connue sous son nom st’át’imc : Stálhalamcen)[4], à gauche, Miss Manito Ahbee[5], Wamblie Littlesky[6] et au centre, le conseiller spirituel et waokiye (Traditional Healer) Eyapaha[7], Donald G. Speidel[8] (aussi connu sous son nom lakota : Tatanka Hoksila), portant une coiffe à plumes, qui interprète un chant en langue vernaculaire. La coiffe que porte l’homme est un symbole important pour plusieurs peuples autochtones, incluant notamment, mais non limitativement, les Premières Nations situées au Canada, tandis qu’elle fait appel à un imaginaire connu, popularisé par les films hollywoodiens pour un public non autochtone. Or, à quel point le port de la coiffe à plumes lors de la cérémonie d’ouverture des Indigenous Music Awards de 2019 est-il légitime et dans le respect des traditions autochtones? Nous verrons dans un premier temps en quoi consiste cet événement et, dans un second temps, nous explorerons diverses particularités de la coiffe à plumes. Enfin, nous nous interrogerons sur les controverses entourant le port de la coiffe à plumes selon les contextes.
La quatorzième édition[9] des IMA s’est tenue le 17 mai 2019 au Club Regent Event Centre, lors d’une cérémonie qui a coïncidé avec le Manito Abhee Festival[10], à Winnipeg, au Manitoba. C’est la cérémonie de remise de prix honorant les réalisations d'artistes autochtones et de professionnels de l'industrie de la musique la plus importante du Canada. On y retrouve différents types de prix comme les albums selon leur genre musical, les pow-wow, les nouveaux artistes, les singles ou encore les vidéoclips. Quant au Manito Abhee Festival, il s’agit d’un événement qui promeut « l’art, la culture et la musique des Autochtones » [Notre traduction] (Manito Abhee s.d) et qui se nomme d’après le site sacré de Manito Abhee (mot objiway signifiant where the Creator sits). Ce festival a notamment pour mission de faire rayonner les cultures autochtones à travers le monde (Manito Abhee s.d.). Les performances en direct et autres sont donc faites par des artistes autochtones. Le Manito Abhee Festival se révèle alors d’une importance capitale pour promouvoir les cultures autochtones. Rappelons que de la fin du XIXe siècle jusqu’en 1951, les cérémonies, danses et chants autochtones, entre autres choses, étaient réprimés par la Loi sur les Indiens (1876) (Robinson 2018). En outre, le Manitoba est une place de choix pour les événements autochtones, car plusieurs nations autochtones y vivent et c’est la deuxième province où les membres des Premières Nations sont les plus nombreux après l’Ontario (Government of Canada 2021).
Revenons sur la cérémonie d’ouverture des IMA de 2019, qui débute par la performance en direct des personnes autochtones citées précédemment. La personne au centre de la scène portant une coiffe à plumes entonne un chant. Il semble être une figure sociale fondamentale, investie de pouvoir et de responsabilités. Effectivement, le fait qu’il porte une coiffe à plumes est déterminant dans la symbolique de l’individu, de son statut et de ses responsabilités.
De fait, la coiffe à plumes est un objet symboliquement et traditionnellement important, voire lourd de sens. Les ornementations autochtones sont généralement vectrices et indicatrices de l’identité et de la culture de la personne qui les porte. Elles « raconte[nt] une histoire, perpétue[nt] le patrimoine et ser[vent] d’insigne d’honneur » (Robinson 2018). Selon William Burnstick, un concepteur reconnu de coiffes, elle « […] est un symbole de leadership qui force le respect. C’est le plus grand grade qu’un individu puisse atteindre. [La coiffe à plumes] est offerte durant les cérémonies et donne à son détenteur de grandes responsabilités » (Houdassine 2019). Pour certaines nations comme les Cris et les Sioux, elle est associée aux chefs : c’est un symbole politique et de statut social. Même si, au cours des dernières décennies, le port quotidien de cette coiffe au sein de plusieurs nations autochtones a disparu en dehors des occasions solennelles, son symbolisme demeure bien connu. Par exemple, lors des processus de colonisation, la coiffe était aussi portée par des personnes endossant le rôle de leader à l’occasion de certains événements organisés par l’État canadien. C’était le cas notamment de certains délégués autochtones, formés lors des cours de leadership offerts par le département des Affaires indiennes[11] dans les années 1950 et 1960 (Morrissette 2014). Ainsi, la coiffe est devenue un symbole de leadership. Or, il faut la mériter, on doit se la faire offrir. Le simple fait d’être un Autochtone ne suffit pas pour se prévaloir du droit de la porter (Neepin 2017). Comme ce sont les chefs ou d’autres leaders qui la portent, elle est aussi symbole de diplomatie. Par exemple, les chefs wendats portaient leur coiffe à plumes[12] lors des négociations avec les Français ou encore les Anglais, coiffes qui symbolisaient le poids diplomatique et géopolitique de l’échange (Durand 2003). Cependant, la coiffe à plumes est aussi portée par les guerriers chez d’autres nations autochtones. En effet, Jeannine Belgodère affirme que les Premières Nations des Plaines étaient à l’origine des sociétés guerrières et que les obligations des leaders lors des conflits armés étaient perçues comme un honneur. Ainsi, pour raconter leurs récits guerriers lors des cérémonies, ces derniers portaient la coiffe à plumes en signe d’honneur et de bravoure. C’est pourquoi elle fait alors partie de l’habit de cérémonie rituel (Belgodère 2004). D’ailleurs, les Premières Nations des Plaines continuent de porter la coiffe à plumes de manière traditionnelle. Elle est caractérisée par Leo Killsback (2013) de « coiffe de guerre » (war bonnet, en anglais) et de « couronne d’honneur » (crown of honor, en anglais des États-Unis) [Notre traduction], dont le porteur est investi de la vitesse et de la force de l’antilope (antelope, en anglais) qui l’aideront au combat. Par ailleurs, toujours selon Killsback, les porteurs sont liés entre eux par ces coiffes, car elles symbolisent l’unité et la loyauté entre les guerriers et ne permettent pas de différencier les divers statuts des guerriers. Lors des combats, la coiffe à plumes devait donner de la bravoure au porteur et le guider spirituellement, afin qu’il soit prêt à mourir vaillamment au combat.
De nos jours, les Premières Nations des Plaines utilisent encore des coiffes avec de vraies plumes lors des cérémonies, car il s’agit d’objets sacrés. Mais si on compte la porter pour un spectacle ou un festival quelconque, la coiffe est alors faite avec de fausses plumes (Killsback 2013). De ce fait, les coiffes sont portées dans des cérémonies comme les pow-wow. Étant associée aux chefs ou aux guerriers, elle est donc principalement portée lors de la danse la plus compétitive entre les hommes durant le pow-wow (Herle 1994).
De plus, il existe différents types de coiffes à plumes qu’il faut différencier, entre autres, selon les nations. À cet égard, James H. Howard en distingue cinq principaux. Il y a la « coiffe à cornes » (horned bonnet, en anglais) (Howard 1954), dont deux variantes de cette coiffe, puis la « coiffe de guerre à plumes d’aigle flamboyante » (« flaring » eagle feather bonnet, en anglais) et enfin la « coiffe à plumes flottantes » (« fluttering feather » bonnet, en anglais) (Howard 1954). Ainsi, la coiffe à plumes est associée à l’ensemble des Premières Nations de l’Amérique du Nord. Bien qu’elle se décline sous différentes formes, elle est un objet bien connu et respecté par différentes nations autochtones. Cependant, bien que l’apparence de base de la coiffe à plumes soit similaire pour plusieurs de ces peuples, chacune d’entre elles conserve l’expression d’une particularité culturelle. À sa manière, chaque nation a su exprimer sa singularité en y intégrant ses symboles et son style propre. En outre, il importe de noter que le style de coiffe a évolué au fil du temps chez certaines nations (Bruchac 2016). Cette évolution vaut d’ailleurs pour les habits de tradition en général (Belgodère 2004). Néanmoins, la coiffe la plus popularisée demeure celle à plumes d’aigle flamboyantes. C’est d’ailleurs celle que porte le présent sur scène lors de la cérémonie d’ouverture des IMA de 2019. Ainsi donc, la coiffe à plumes apparaît principalement dans des contextes cérémoniels ou officiels. Historiquement, elle était surtout utilisée lors des combats ou des négociations, ou encore pour d’autres raisons officielles. Aujourd’hui, elle est toujours utilisée comme telle, sauf pour les combats, mais elle garde la symbolique guerrière et spirituelle lors des cérémonies. Elle est alors portée par des individus qui en ont la légitimité et le mérite, notamment des chefs ou des leaders.
Étant donné que la plume est l’un des éléments principaux de la coiffe, elle donne une certaine symbolique à la coiffe. Au sein de nombreuses communautés autochtones, la plume d’aigle représente notamment la force inhérente de toute chose et la frontière avec le non-humain. Entre autres, elle est brandie de nos jours par des activistes autochtones comme signe de protestation contre les injustices envers les leurs (Mansbridge 2018). Ainsi, elle est devenue un symbole de lutte et de résistance pour la protection de leurs cultures, de leurs valeurs et de leurs systèmes politiques.
En dépit de tout l’aspect sacré de la coiffe à plumes autochtone, cet objet symbolique est repris par des non-Autochtones. Effectivement, depuis les années 1990, l’appropriation culturelle du patrimoine autochtone est devenue un problème récurrent. L’avocate et doctorante en traditions juridiques autochtones, Vanessa Udy définit ce phénomène comme « un “emprunt” non autorisé des expressions, des styles artistiques, des symboles, des mythes ou du savoir-faire d’une culture dite dominée par un membre d’une culture dite dominante » (Udy 2015 : 355). Udy précise aussi que cela est aussi le cas lorsque l’un des membres de la culture dite dominante se dit en être un expert ou banalise l’expérience vécue par la culture dominée. Or, cette appropriation est pernicieuse, puisqu’elle reprend des formes d’expression du patrimoine culturel d’un autre peuple, et ce, sans prendre en compte les valeurs symboliques. En effet, ce phénomène dépossède les membres de cette culture de leur identité, car leurs valeurs sont dénigrées et réduites par celles de la culture dominante. Il en vient même à « menacer la survie culturelle des peuples autochtones » (Udy 2015 : 855). Malgré bon nombre de débats, il existe un certain consensus chez les peuples autochtones au sujet de l’appropriation de leurs patrimoines matériels, incluant les ornementations traditionnelles (Robinson 2018). Pour ce qui est de la coiffe à plumes : comme il s’agit d’un objet de la plus haute importance, tant politique que spirituelle et culturelle, plusieurs nations autochtones considèrent qu’il est irrespectueux de la part des non-autochtones de la porter, surtout lors d’un contexte festif qui n’a rien à voir avec la culture autochtone, comme à l’halloween (Robinson 2018). À la suite de nombreuses critiques soulevées quant à ce genre de costumes, voire des scandales, des interdictions et des réglementations ont été établies en vue de lutter contre la perpétuation de stéréotypes. Par exemple, le port des coiffes à plumes a été interdit dans plusieurs festivals de musique comme ceux de Bass Coast à Merritt (Colombie-Britannique), en 2014 et d’Osheaga à Montréal (Québec), en 2015. Cette décision a été saluée par plusieurs nations et militants autochtones. À cet égard, la militante mohawk Kim Wheeler insiste sur le fait que « les coiffes sont remises lors d'une cérémonie. Il ne faut pas qu'elles soient portées comme un accessoire par quelqu'un qui va à un party ou à un festival » (Radio-Canada 2014). Plus encore, la militante crie Jenna Neepin souligne que la coiffe n’est pas un objet à prendre à la légère et que l’on ne peut la porter comme un déguisement, puisque c’est irrespectueux. Le port de la coiffe à plumes comporte une responsabilité pour la personne qui la porte envers sa nation et ses semblables. Même un quelconque Autochtone ne peut pas simplement la porter comme il le veut (Neepin et Neepin 2017).
Or, cette appropriation culturelle n’est pas toujours faite avec de mauvaises intentions. Il y a même un certain désir de « faire vivre » et de faire connaître la culture en question. C’est le cas, à notre humble avis, des « indianophiles » (adeptes des cultures des Premières Nations), qui, par l’intermédiaire de la culture matérielle, même hors de son contexte, essaient de faire vivre la culture. Les indianophiles sont les personnes qui cherchent à vivre une expérience qui se rapproche du mode de vie d’origine des peuples autochtones avant les changements qu’ils ont subis depuis l’arrivée des Européens en Amérique notamment dus aux guerres, au système des pensionnats, à la christianisation, à l’industrialisation ou à l’urbanisation. La coiffe à plumes est d’ailleurs l’un des objets principaux qu’utilisent les indianophiles (Maligne 2005). Elle est devenue un stéréotype des peuples autochtones de l’Amérique du Nord, un emblème. De plus, le type de coiffe à plumes le plus connu l’est, On nomme ce type de coiffe en anglais un flaring eagle feather war bonnet (coiffe de guerre à plumes d’aigle flamboyante) (voir figure 1). Cette forme a entre autres été popularisée par le cinéma hollywoodien lors de la première moitié du XXe siècle, à l’instar des vestes à franges (Howard 1954).
Figure 1
Les réalisateurs de cinéma hollywoodien, dans leur ignorance, faisaient porter cette forme de coiffe, déjà existante au sein de certaines communautés autochtones, à la plupart des peuples autochtones figurant dans leurs productions, y compris à des gens comme les Navajos, chez qui elle n’était même pas la coiffe traditionnelle (Aleiss 2005). Comme ce genre de coiffe traditionnelle n’était portée que par certains membres de quelques nations autochtones autrefois, la diffusion de la culture dominante occidentale par la musique, les films et les photos a eu pour effet d’inciter certaines nations autochtones à se (ré)approprier finalement cet objet symbolique (Herle 1994). Toutefois, cette réappropriation est légitime et ne se prête pas à des controverses, car elle n’est pas du même type que l’appropriation culturelle par les non-Autochtones. Il existe donc un consensus chez les Autochtones au Canada à l’égard de cette réappropriation. Et pour ce qui est du festival en question dans cet article, le port de la coiffe à plumes par un eyapaha et guérisseur traditionnel lors des IMA de 2019 semble faire l’unanimité, car son statut lui confère l’autorité suffisante sans qu’il ne soit un chef, surtout que ce soit fait dans le respect des traditions des peuples autochtones de l’Amérique du Nord (cf. Canada et États-Unis d’Amérique).
Pour conclure, les Indigenous Music Awards de 2019 qui se sont déroulés à Winnipeg, au Manitoba ne concernent que des Autochtones. Ainsi, le port de la coiffe à plumes lors de la cérémonie d’ouverture avait notamment pour but d’honorer les cultures autochtones au Canada. En effet, la coiffe est portée par un membre autochtone et, comme cette cérémonie vient ouvrir un événement de remise de prix à des Autochtones, l’utilisation de cet élément symbolique est entérinée par les parties prenantes. De plus, la cérémonie d’ouverture est considérée comme étant un aspect symbolique pendant les événements organisés par et pour les Autochtones. C'est pourquoi aucune contestation n’a été soulevée dans les médias. En revanche, cela n’aurait pas été le cas si cette coiffe avait été portée par des non-autochtones, ce qui aurait été considéré comme de l’appropriation culturelle. Or, il existe quelques exceptions quoique controversées au port de la coiffe à plumes par des non-autochtones. C’est le cas de Justin Trudeau, qui, en 2016, a porté ce genre de coiffe lui ayant été offerte par le chef de la Première Nation Tsuu T’ina pour souligner « l’accomplissement, le respect, la bravoure et la consolidation de la paix » (La presse canadienne 2016). Cependant, ce geste n’a pas reçu l’approbation de l’unanimité et a été critiqué par plusieurs Premières Nations. Ainsi, lors d’événements politiques, il existe de rares cas de ports de coiffes à plumes traditionnelles par des non-autochtones; toutefois, ils demeurent sujets à débat chez les membres des Premières Nations.
Parties annexes
Note biographique
Marie Lallement est une étudiante française qui a réalisé son baccalauréat par cumul (majeure en anthropologie et mineure en science politique) à l’Université de Montréal, Canada, entre septembre 2019 et mai 2022, et est aujourd’hui étudiante à la maîtrise en développement international (spécialisation Politique et Gouvernance) à l’Université de Wageningen, Pays-Bas.
Notes
-
[1]
Majeure en anthropologie et mineure en science politique
-
[2]
Auparavant appelé les Aboriginal Peoples’ Choice Music Awards, ce prestigieux gala annuel décerne des prix aux Autochtones oeuvrant dans l’industrie de la musique canadienne.
-
[3]
Pour plus de détails, veuillez consulter le lien URL suivant afin d’accéder à l’enregistrement vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=VU54Mnk5ZQQ&ab_channel=PowWows.com (consulté le 11/07/2022).
-
[4]
Stálhalamcen appartient au clan de l’ours de la Première Nation Xwisten. Sa communauté est située en Colombie-Britannique (Canada).
-
[5]
Le titre de Miss Manito Ahbee est décerné à une jeune ambassadrice élue afin d’honorer notamment la mémoire des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.
-
[6]
Elle est issue de la Première Nation Stoney Nakoda, située en Alberta (Canada).
-
[7]
Traditionnellement, un Eyapaha (ou, en anglais, Camp Crier) était un officiel choisi pour propager la parole des chefs. (Crissel 2006, 95)
-
[8]
Il est issu de la Première Nation de Standing Rock, située dans le Dakota du Sud (États-Unis d’Amérique).
-
[9]
L’édition de 2020 devait avoir lieu à Edmonton, en Alberta. En raison de la pandémie du COVID-19, le gala s’est tenu en mode virtuel.
-
[10]
Le festival a eu lieu du 15 au 19 mai 2019.
-
[11]
Ce département a été enchâssé dans le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration jusqu’en 1965 et a fait depuis l’objet de divers transferts ministériels et de changements de nom. Le dernier en liste date de 2017 : le ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada, qui est scindé actuellement en deux : 1) le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et 2) le ministère des Services aux Autochtones.
-
[12]
Les coiffes wendates n’ont pas les mêmes formes ni les mêmes plumes que les coiffes notamment attribuées aux Sioux. Il existe donc plusieurs styles de coiffes à plumes chez les Autochtones, une apparence distincte pour chaque nation ou encore propre au panautochtonisme (Ka’nhehsí:io Deer 2019).
Bibliographie
- ALEISS, Angela, 2005, « Making the white man’s Indian: Native Americans and Hollywood movies », Greenwood Publishing Group. Retrieved from: Making the White Man’s Indian: Native Americans and Hollywood Movies – Angela Aleiss – Google Livres.
- BELGODERE, Jeanine, 2004, « Tradition et évolution dans l’art du Powwow contemporain » Revue LISA / LISA e-Journal, 2 (6). En ligne : https://doi.org/10.4000/lisa.2766.
- BRUCHAC, Margaret, 2016, « Considering the Feather Headdress », Penn Museum Blog, University of Pennsylvania museum of Archeology and Anthropology. Retrieved from: “Considering the Feather Headdress” by Margaret Bruchac (upenn.edu).
- CRISSEL, Andrew, 2006. More Than a Music Box: Radio Cultures and Communities in a Multi-Media World. Berghann Series. Retrieved from: More Than a Music Box: Radio Cultures and Communities in a Multi-Media World - Google Livres.
- DEER, Ka’nhehsí:io, 2019, « Exhibition of First Nations headdresses explores issues of diversity and cultural appropriation », CBC News, August 7, 2019. Retrieved from: https://www.cbc.ca/news/indigenous/headdresses-exhibition-montreal-festival-1.5237516 .
- DIAMOND, Neil, BAINBRIDGE, Catherine et Jeremiah HAYES, 2009, Reel Injun, feature-length documentary, 1 h 28 min. Retrieved from: https://www.nfb.ca/film/reel_injun/.
- DURAND, Guy Sioui, 2003, « Jouer à l’Indien est une chose, être un Amérindien en est une autre ». Recherches amérindiennes au Québec, 33 (3) : 23–35. En ligne : https://doi.org/10.7202/1082420ar.
- Government of Canada, 2021, First Nations in Manitoba. Government of Canada. Retrieved from: First Nations in Manitoba (sac-isc.gc.ca).
- HERLE, Anita, 1994, « Dancing Community: Powwow and Pan-Indianism in North America », Cambridge Anthropology, 17(2): 57–83. Retrieved from: http://www.jstor.org/stable/23820415.
- HOUDASSINE, Ismaël, 2019, « Essence et Apparât : démystifier la coiffe autochtone », Radio-Canada, 7 août 2019. En ligne : Essence et Apparât : démystifier la coiffe autochtone | Radio-Canada.ca.
- HOWARD, James H., 1954, « Plains Indian Feathered Bonnets », Plains Anthropologist (2) : 23–26. Retrieved from: http://www.jstor.org/stable/25666195.
- Indigenous Music Awards, s.d., « Page d’accueil », Indigenous Music Awards. Retrieved from: Indigenous Music Awards.
- KILLSBACK, Leo, 2013, « Crowns of Honor: Sacred Laws of Eagle-Feather War Bonnets and Repatriating the Icon of the Great Plains », Great Plains Quarterly, 33 (1) : 1–23. Retrieved from: http://www.jstor.org/stable/23534356.
- La Presse Canadienne, 2016, « Les Premières Nations exhortent Trudeau à respecter ses promesses », Le nouvelliste numérique, En ligne : Les Premières Nations exhortent Trudeau à respecter ses promesses | Actualités | Le Nouvelliste – Trois-Rivières.
- MALIGNE, Olivier, 2005, « La matière du rêve : matériaux, objets, arts et techniques dans les pratiques indianophiles », Recherches amérindiennes au Québec, 35 (2) : 39–48. En ligne : https://doi.org/10.7202/1082145ar.
- Manito Abhee, s.d., « History », Manito Abhee History | Manito Ahbee Festival. Retrieved from: https://www.manitoahbee.com/about-us/history.
- MANSBRIDGE, Joanna, 2018, « Animating Extinction, Performing Endurance: Feathers, Angels, and Indigenous Eco-Activism », Theatre Topics, 28(2) : 113-123. Retrieved from: Project MUSE – Animating Extinction, Performing Endurance: Feathers, Angels, and Indigenous Eco-Activism (jhu.edu).
- MORISSETTE, Anny, 2014, Le leadership interstitiel, le champ d’action des Amérindiens ou le pouvoir dans la marge : l’exemple de la communauté algonquine de Kitigan Zibi (Québec). Mémoire de maîtrise, Université de Montréal. En ligne : Le leadership interstitiel, le champ d’action des Amérindiens ou le pouvoir dans la marge : L’exemple de la communauté algonquine de Kitigan Zibi (Québec) – ProQuest.
- NEEPIN, Jenna and Justina NEEPIN, 2017, « Headdress », CBC short docs, Curio.ca. Retrieved from: Headdress (curio.ca).
- PowWows.com, 2020, « Opening Ceremony - 2019 Indigenous Music Awards - Manito Ahbee Festival », YouTube. Retrieved from: Opening Ceremony - 2019 Indigenous Music Awards - Manito Ahbee Festival - YouTube.
- Radio-Canada, 2014, « Des Autochtones appuient l'interdit du port de coiffes traditionnelles d'un festival », Radio-Canada ICI Colombie-Britannique-Yukon. En ligne : Des Autochtones appuient l'interdit du port de coiffes traditionnelles d'un festival | Radio-Canada.ca.
- Radio-Canada, 2017, « La ville de Winnipeg a la plus grande population d’Autochtones au Canada », Radio-Canada, 26 octobre 2017. En ligne : https://www.rcinet.ca/regard-sur-arctique/2017/10/26/la-ville-de-winnipeg-a-la-plus-grande-population-dautochtones-au-canada/ .
- ROBINSON, Amanda, 2018a, « Chef », L’encyclopédie canadienne. En ligne : Chef | l'Encyclopédie Canadienne (thecanadianencyclopedia.ca).
- ROBINSON, Amanda, 2018b, « Ornementation autochtone au Canada », L’encyclopédie canadienne. En ligne : Ornementation autochtone au Canada | l'Encyclopédie Canadienne (thecanadianencyclopedia.ca).
- UDY, Vanessa, 2015, « L’appropriation du patrimoine culturel autochtone : examen des avantages et inconvénients du régime de propriété intellectuelle au Canada », Les cahiers de Propriété Intellectuelle, 27 (2). En ligne : L’appropriation du patrimoine culturel autochtone: examen des avantages et inconvénients du régime de propriété intellectuelle au Canada | Les Cahiers de propriété intellectuelle (openum.ca)
Liste des figures
Figure 1