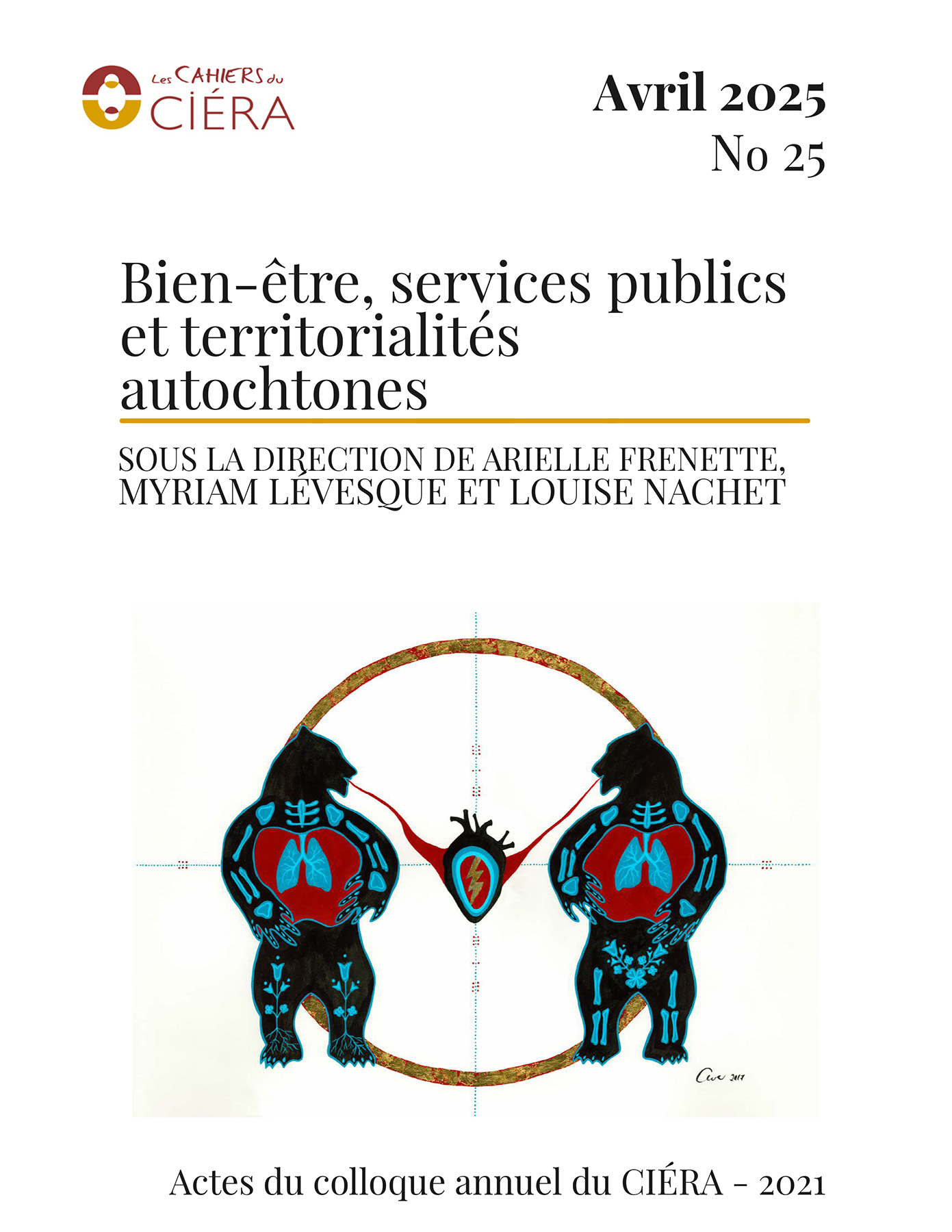En mai 2020, sous l’impulsion de Musique Nomade, soit un groupe de production de musiciens autochtones, la vidéo Heading to New Mexico (mettant en vedette Tee Cloud, mi’kmaw originaire de Metepenagiag et bien d’autres artistes) est diffusée sur les réseaux sociaux (YouTube, Facebook, Tik Tok). Dix chanteurs issus de sept différentes nations autochtones au Canada — et d’une provenant de Finlande — se sont rassemblés pour produire ce chant composé à la fois en anglais, en mi’kmaw, en oji-cree et en atikamekw. Tee Cloud, le compositeur de l’oeuvre, y bat du tambour à main, véritable entité vivante notamment chez les cultures algonquiennes (Audet 2012). Sa pratique est à l’origine réservée à la sphère privée, par laquelle le joueur de tambour entretient des relations avec sa communauté, les animaux et le cosmos (Audet 2012). Le tambour à main constitue lui-même un être vivant pour les peuples autochtones. Véritable symbole identitaire, il apparaît aussi comme un outil de transmission de la culture au sein de la communauté envers les plus jeunes. Or, son utilisation se démocratise jusqu’à accompagner des rassemblements, à l’instar de rencontres panautochtones, ou des événements plus politiques, voire hautement symboliques, comme la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la fête du Canada ou encore la rencontre de délégations de Premières Nations, de Métis et d’Inuit avec le Pape. Le tambour à main voit ainsi son utilisation étendue et son public élargi, puisqu’il est convoqué en présence de membres d’autres communautés autochtones ou d’allochtones. Il évolue dans de nouveaux « espaces relationnels », faisant office de lien entre différents groupes : entre les générations, entre les communautés et avec les allochtones (Delamour 2019). Dans le présent court texte, il s’agit de se pencher sur l’évolution de l’histoire du tambour à main plus précisément chez les peuples algonquiens, afin de comprendre les nouvelles significations qu’il embrasse. Mes recherches m’ont montré qu’au sein des traditions algonquiennes, les utilisations du tambour sont nombreuses; la terminologie, les rites et le symbolisme liés aux tambours à main varient en fonction des communautés. Afin d’éviter l’écueil de l’homogénéisation et, au contraire, de faire valoir les spécificités de chaque culture, je me suis concentrée sur le teueikan innu et le tewehikan atikamekw. De façon générale, le tambour à main est réalisé sur un cadre circulaire et est constitué à partir d’une membrane faite de peau d’animal. Les timbres de résonance du teueikan innu sont généralement constitués de petits os d’animaux. On bat le tambour à main à l’aide d’un bâton de bois (Delamour 2019). Le tambour à main est souvent associé aux battements du coeur, à ceux de l’âme de celui qui bat le tambour et qui communique avec la nature. Le son du tambour est aussi assimilé aux mouvements du coeur de la Terre-Mère (Audet 2012). À cet égard, Beverly Diamond (Diamond 1994) indique que le terme innu-aimun « teueikan » est significatif : le [ue] fait référence à la vibration produite par ces battements — de coeur comme de tambour. La répétition d’une variation du lexème [ue] dans le [euei] crée un mouvement de vague, qui décrit le battement de ce même coeur. De plus, le [te] renvoie à la vie, puisque [teua] signifie « cela existe ». Le lexème [teh] signifie aussi coeur (Diamond 1994). Les multiples interprétations de la signification du terme « teueikan » renvoient, lorsqu’on fait vibrer le tambour, au battement du coeur et à une entité vivante. Notons que la fabrication du tambour répond à des codes précis ancestraux; traditionnellement, chez certains peuples autochtones, seuls les hommes en jouaient. Toutefois, certaines femmes autochtones, dont la chanteuse innue …
Parties annexes
Bibliographie
- AUDET, Véronique, 2012, « Chapitre I : les musiques traditionnelles innues », dans Innu nikamu. Pouvoir des chants, identité et guérison chez les Innus (pp 41-80). Québec : Presses de l’Université de Laval
- DELAMOUR, Carole, 2019, « Les multiples résonances du teuehikan (tambour) des Ilnuatsh de Mashteuiatsh dans le renouvellement d’une éthique de l’attention », Revue d'anthropologie des connaissances, 13, 3(3) : 793-816.
- DIAMOND, Beverley, CRONK, Sam M. and Franziska VON ROSEN, 1995, Visions of Sound: Musical Instruments of First Nations Communities in Northeastern America. Waterloo : Wilfrid Laurier University Press.
- JÉROME, Laurent, 2005, « Musique, tradition et parcours identitaire de jeunes Atikamekw : la pratique du tewehikan dans un processus de convocation culturelle / Music, tradition and the identity route of young Atikamekw: the evoking of cultural processes through the tewehikan », Recherches amérindiennes au Québec, 35(3) : 19-30.
- JÉROME, Laurent, 2015, « Les cosmologies autochtones et la ville : sens et appropriation des lieux à Montréal », Anthropologica, 57(2) : 327-339.