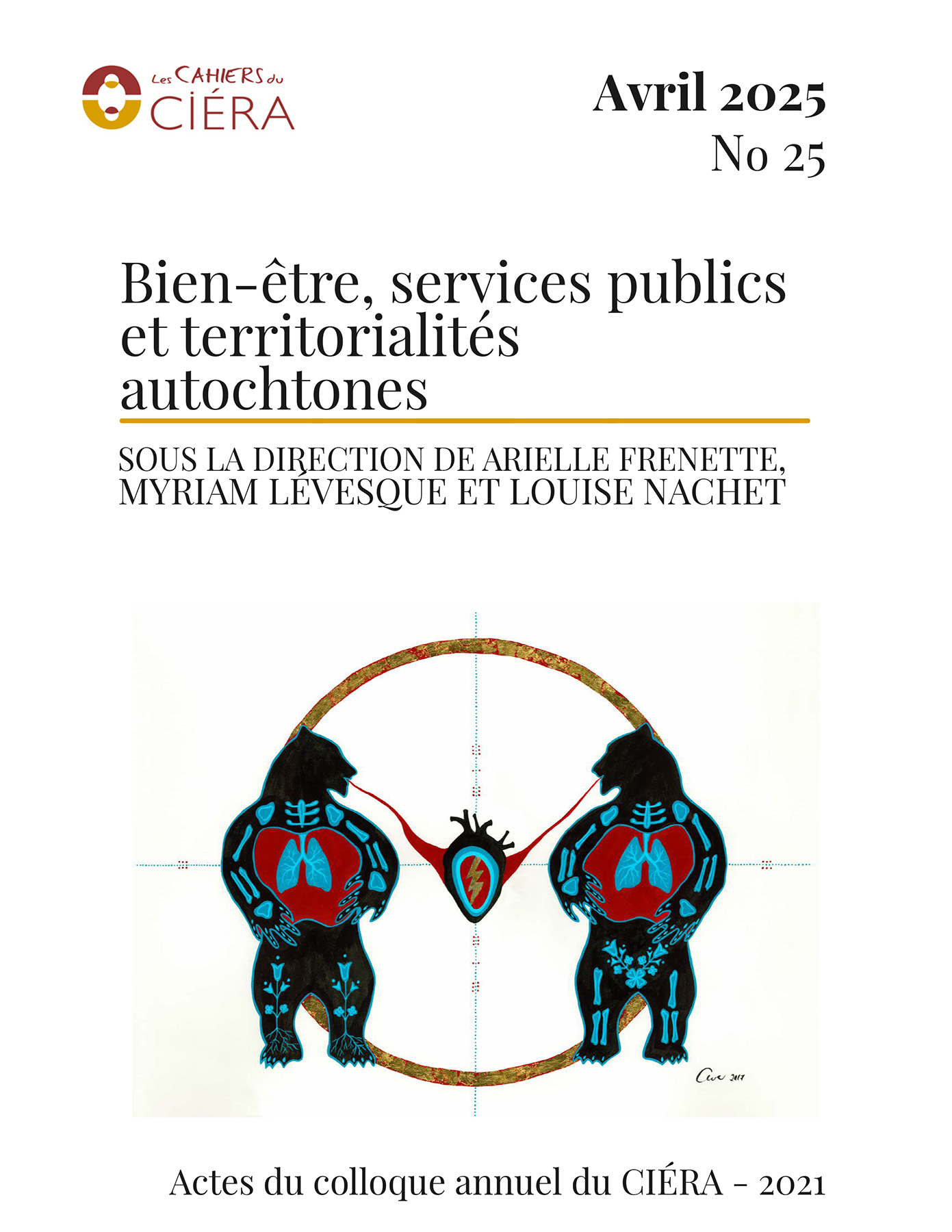Corps de l’article
En mai 2020, sous l’impulsion de Musique Nomade[2], soit un groupe de production de musiciens autochtones, la vidéo Heading to New Mexico[3] (mettant en vedette Tee Cloud, mi’kmaw originaire de Metepenagiag et bien d’autres artistes[4]) est diffusée sur les réseaux sociaux (YouTube, Facebook, Tik Tok). Dix chanteurs issus de sept différentes nations autochtones au Canada — et d’une provenant de Finlande — se sont rassemblés pour produire ce chant composé à la fois en anglais, en mi’kmaw, en oji-cree et en atikamekw. Tee Cloud, le compositeur de l’oeuvre, y bat du tambour à main, véritable entité vivante notamment chez les cultures algonquiennes (Audet 2012). Sa pratique est à l’origine réservée à la sphère privée, par laquelle le joueur de tambour entretient des relations avec sa communauté, les animaux et le cosmos (Audet 2012). Le tambour à main constitue lui-même un être vivant pour les peuples autochtones. Véritable symbole identitaire, il apparaît aussi comme un outil de transmission de la culture au sein de la communauté envers les plus jeunes. Or, son utilisation se démocratise jusqu’à accompagner des rassemblements, à l’instar de rencontres panautochtones, ou des événements plus politiques, voire hautement symboliques, comme la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation[5], la fête du Canada ou encore la rencontre de délégations de Premières Nations, de Métis et d’Inuit avec le Pape[6]. Le tambour à main voit ainsi son utilisation étendue et son public élargi, puisqu’il est convoqué en présence de membres d’autres communautés autochtones ou d’allochtones. Il évolue dans de nouveaux « espaces relationnels », faisant office de lien entre différents groupes : entre les générations, entre les communautés et avec les allochtones (Delamour 2019). Dans le présent court texte, il s’agit de se pencher sur l’évolution de l’histoire du tambour à main plus précisément chez les peuples algonquiens, afin de comprendre les nouvelles significations qu’il embrasse.
Mes recherches m’ont montré qu’au sein des traditions algonquiennes, les utilisations du tambour sont nombreuses; la terminologie, les rites et le symbolisme liés aux tambours à main varient en fonction des communautés. Afin d’éviter l’écueil de l’homogénéisation et, au contraire, de faire valoir les spécificités de chaque culture, je me suis concentrée sur le teueikan innu et le tewehikan atikamekw.
Comment le tambour est-il fabriqué? Que symbolise-t-il?
De façon générale, le tambour à main est réalisé sur un cadre circulaire et est constitué à partir d’une membrane faite de peau d’animal. Les timbres de résonance du teueikan innu sont généralement constitués de petits os d’animaux. On bat le tambour à main à l’aide d’un bâton de bois (Delamour 2019). Le tambour à main est souvent associé aux battements du coeur, à ceux de l’âme de celui qui bat le tambour et qui communique avec la nature. Le son du tambour est aussi assimilé aux mouvements du coeur de la Terre-Mère (Audet 2012). À cet égard, Beverly Diamond (Diamond 1994) indique que le terme innu-aimun « teueikan » est significatif : le [ue] fait référence à la vibration produite par ces battements — de coeur comme de tambour. La répétition d’une variation du lexème [ue] dans le [euei] crée un mouvement de vague, qui décrit le battement de ce même coeur. De plus, le [te] renvoie à la vie, puisque [teua] signifie « cela existe ». Le lexème [teh] signifie aussi coeur (Diamond 1994). Les multiples interprétations de la signification du terme « teueikan » renvoient, lorsqu’on fait vibrer le tambour, au battement du coeur et à une entité vivante. Notons que la fabrication du tambour répond à des codes précis ancestraux; traditionnellement, chez certains peuples autochtones, seuls les hommes en jouaient. Toutefois, certaines femmes autochtones, dont la chanteuse innue Kathia Rock, se sont vu offrir le droit de battre le tambour à main.
La pratique du tambour à main est liée à la vie (semi-)nomade de nombreux peuples autochtones, et particulièrement au territoire. Chez les Innus, elle est réservée aux chasseurs. Instrument de communication et de rassemblement de la communauté, le tambour à main est utilisé pour favoriser la chasse et la guérison (Audet 2012). Le tambour crée alors un lien entre le chasseur et l’esprit-maître des animaux. La chasse est un moyen de subsistance, mais aussi de socialisation avec les non-humains, socialisation favorisée et renforcée par l’utilisation du tambour à main (ibid.). De nos jours, les tambours à main sont utilisés non seulement lors des rassemblements panautochtones, mais aussi lors des makushans. Il s’agit d’une danse traditionnelle et d’un rassemblement innus, qui comportent des célébrations rituelles et festives de même que le partage d’un repas, après une chasse fructueuse, par exemple (Delamour 2019).
Dans la tradition algonquienne, notamment chez les lnuatsh, l’apprentissage du tambour à main — sa fabrication comme son utilisation — est transmis par les aînés de façon orale, comme lors d’un travail d’observation et d’imitation par les plus jeunes (ibid.). Le tambour devient alors un outil qui rapproche les générations. On entonne également un chant en battant du tambour, le chant relatant un rêve chez les Pekuakamiulnuatsh, par exemple. Comme pour d’autres, le rêve revêt une importance spirituelle particulière au sein de cette communauté autochtone : les chasseurs doivent rêver trois fois du teueikan avant de pouvoir l’utiliser pour la première fois (ibid.). Les enfants, dans la plupart des communautés, ne peuvent pas y toucher. La plupart du temps, les femmes n’ont normalement pas le droit de jouer du tambour. Dans certaines cultures algonquiennes, comme au sein de la communauté innue, cela s’explique par le fait que, selon la tradition, chaque femme a un tambour en elle, modélisé par exemple par le battement du coeur de l’enfant qu’elle porte (ibid.).
Ainsi, la relation au tambour à main est fondée sur le respect, puisque c’est un objet sacré qui lie l’homme et sa communauté à des puissances supérieures. L’usage du tambour est donc associé à de nombreuses règles : entre autres, il ne peut toucher le sol et doit être toujours emballé lorsqu’il n’est pas utilisé.
Quelles nouvelles significations le tambour à main porte-t-il?
Communiquer avec le reste de la communauté
La pratique du tambour à main ne se limite plus à la communication avec la nature et le cosmos. Il est notamment employé pour demander une forme de protection envers les plus jeunes ou pour les rapprocher des aînés (Delamour 2019). La signification du tambour paraît donc glisser pour s’adapter aux évolutions des communautés et à leurs enjeux respectifs, qui, en raison de la sédentarisation, sont parfois moins liés à la chasse.
Se différencier des allochtones
L’utilisation du tambour à main hors de la sphère privée, ou plus largement d’un cercle « d’initiés » lors de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation est à mes yeux un acte fort. Il s’agit avant tout, sans l’ombre d’un doute, d’entrer en communication avec tous les êtres à qui la journée rend hommage, soit l’ensemble des victimes et des survivants des pensionnats autochtones, les enfants, leurs familles, leurs communautés. Ce choix semble aussi intrinsèquement lié à une revendication identitaire, un moyen de différenciation par rapport aux allochtones présents lors de cette journée.
Ainsi, le tambour à main est de plus en plus lié à une revendication, à une affirmation identitaire. Laurent Jérôme (Jérôme 2005) s’attache à étudier l’évolution de la pratique du tewehikan chez les Atikamekw. Selon lui, mettre en valeur le savoir-faire des Algonquiens est primordial, puisqu’il est la vitrine d’un « savoir-être », d’une identité autochtone. Celle-ci doit être promue et mise en avant au détriment des préjugés des allochtones (ibid.). Il semble donc que les clichés sur les Autochtones soient prégnants et doivent être défiés, notamment par la revitalisation de la tradition du tambour à main.
Panser les blessures de l’entreprise coloniale?
Dans certaines communautés autochtones, la pratique du tambour à main est de plus en plus rare. Nombreux sont ceux qui en possèdent, mais qui ne sont pas disposés à en jouer ou ne s’en sentent pas dignes. Les entretiens réalisés par Carole Delamour (Delamour 2019) révèlent que la colonisation, la sédentarisation et le placement des enfants dans les pensionnats autochtones ont réellement nuit à la pratique du tambour à main chez les Ilnuatsh. Par exemple, la détresse psychologique que la colonisation a engendrée a parfois poussé les hommes à s’automédicamenter en consommant drogues ou alcool. Or, la consommation abusive de ces substances ne les rend pas dignes du teueikan, qu’ils laissent alors « endormi » (ibid.), en attente de pouvoir être utilisé.
En revanche, le tambour à main peut servir comme instrument de guérison à soigner « les maux de l’entreprise coloniale » (Jérôme 2005), en mettant en avant des traditions algonquiennes, entre autres. Chez les Ilnuatsh, la pratique du tambour peut être un outil de différenciation et d’affirmation par lequel ces derniers s’émancipent « des dominants de la société en valorisant ce qui leur est propre, soit leur identité, leurs pratiques et héritages culturels, leur langue, leur territoire ancestral, en se définissant par eux-mêmes et pour eux-mêmes » (Delamour 2019). Le tambour à main et les chants qui l’accompagnent représentent donc la richesse et l’unicité de la culture innue, comme chez d’autres Premières Nations
S’adapter aux évolutions de la société et viser un public élargi
Par ailleurs, comme il a été précisé plus haut, certaines femmes innues rêvent du teueikan et se mettent à en jouer : la pratique se diversifie (Audet 2012). Soulignons également la volonté de certains, plus jeunes, d’apprendre à maîtriser le tambour à main. Toutefois, l’ethnographie effectuée par Carole Delamour à Mashteuiatsh est révélatrice; elle montre comment les processus d’apprentissage du teueikan et de passation des savoirs peuvent différer au sein d’une même communauté. Notons par exemple que l’impossibilité, pour certains, d’apprendre en imitant les aînés les pousse à passer par l’apprentissage du drum, tambour à caisse joué en collectif (Delamour 2019). En battant le drum lors de célébrations comme les pow-wow, les nouvelles générations peuvent apprendre à prendre soin d’un tambour à main et à intégrer la notion de respect qui l’entoure.
La pratique du tambour se transforme alors. Son utilisation apparaît comme un moyen de mettre en valeur entre autres des cultures algonquiennes dynamiques. Il s’agit, d’une certaine façon, d’adapter les traditions aux réalités d’aujourd’hui et aux besoins en matière de rayonnement culturel. Ainsi, Musique Nomade rassemble des membres de différentes nations pour l’enregistrement vidéo de Heading to New Mexico. Tee Cloud est filmé battant le tambour, tradition transmise de façon orale, qui est, d’après mes recherches, peu filmée ou photographiée pour une diffusion grand public. La tradition, alors, a suivi la sédentarisation et les évolutions technologiques ; elle vient revitaliser la culture. Elle se popularise doucement, grâce à la vidéographie et aux réseaux sociaux, mais aussi par la création de groupes autochtones de musique de rock, de folk ou encore de hip-hop.
Comment donc cette évolution de la pratique du tambour à main est-elle perçue?
L’instrument n’a pas perdu sa dimension sacrée et le respect qu’on doit lui accorder semble intact. Cependant, les pratiques changent. Certains Autochtones au Québec y voient un renouvellement d’une pratique traditionnelle, une adaptation de cette dernière à des enjeux d’aujourd’hui (Delamour 2019). D’autres dénoncent la folklorisation de ces traditions sacrées : la pratique du tambour à main, à l’origine très codifiée et entourée d’une forme de secret, se voit révélée aux yeux et aux oreilles de tous, voire banalisée (Delamour 2019). À cet égard, Laurent Jérôme (Jérôme 2015 : 21) cite un témoignage recueilli lors de ses recherches : « Les Atikamekw ne sont pas des joueurs de tambour, ce sont des chasseurs. » (P.M., juin 2005, rapportant des propos entendus dans sa communauté). La pratique du tewehikan, associée à la chasse dans la culture atikamekw, est ici critiquée en ce qu’elle devient presque une profession ou une pratique contemporaine distincte du territoire et de la chasse. Dès lors, la pratique du tambour s’éloignerait de son objectif premier, fondé sur la mise en relation du chasseur avec l’animal qui s’offre à l’homme (Jérôme 2015). Laurent Jérôme rapporte aussi les propos d’un Innu vivant à Montréal, dont les pratiques musicales sont marquées par la ville. Il explique par exemple que le fait de vivre dans une maison fermée favorise moins la circulation des esprits. Il relate également qu’il chante dans d’autres communautés et notamment lors de mariages (ibid.). La pratique du teueikan évolue alors, en ce qu’elle n’est pas nécessairement exercée après en avoir rêvé, bien que certains soient réfractaires à cette idée; surtout, son usage peut également être réservé à l’action « sur commande », et ce, pour des questions bien précises.
En somme, il semble que le tambour à main, objet sacré, change de signification. Sa pratique contemporaine est décidément liée à la guérison, et peut-être moins à la chasse qu’à l’affirmation d’une identité particulière. Le tambour à main conserve certes son aspect sacré et vient instaurer des relations avec trois groupes d’individus : les autres nations autochtones, les différentes générations et les allochtones. Il s’agit d’abord d’opérer des échanges avec d’autres nations autochtones, notamment lors de rassemblements panautochtones ou de pow-wow. La pratique du tambour à main introduit aussi une relation entre les générations, en vue de (r/d’)établir une forme de contact : les aînés transmettent leurs savoirs à la communauté et la communauté se les (ré)approprie, les transformant parfois. La chanson Heading for New Mexico (2019) incarne cette (ré)appropriation de la tradition : majoritairement interprétée en langue vernaculaire, elle associe plusieurs voix autour d’un tambour à main, tout en conservant un objectif spirituel. Enfin, ce vent de fraîcheur apporté aux pratiques du tambour à main sert à affirmer une identité distincte par rapport aux allochtones et à revendiquer une forme de fierté quant à des savoir-faire et des savoir-être. La pratique du tambour à main lors d’événements hautement symboliques, comme la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation ou la rencontre de délégations autochtones avec le Pape François[7], semble s’inscrire dans cette dynamique. Ainsi, on peut observer que le tambour à main, même s’il ne s’inscrit pas nécessairement dans toutes les traditions autochtones, devient un symbole commun aux Premières Nations, qui doivent se garder le droit d’y donner d’autres significations et codes.
Parties annexes
Note biographique
Étudiante en baccalauréat en double diplôme en Sciences Sociales à Sciences Po Paris et en littérature à Sorbonne Université, Flore Janssen a passé un semestre en échange à l’Université de Montréal à la Faculté des arts et des sciences. Après une année de césure, elle est maintenant étudiante en master de Politiques Publiques, spécialité Culture, à Sciences Po Paris.
Notes
-
[1]
Flore Janssen a terminé ses études de 1er cycle depuis la rédaction de ce texte. Elle est maintenant inscrite au master (maîtrise) de Politiques Culturelles à Sciences Po Paris.
-
[2]
Fondé au Québec en 2006, Musique Nomade est un organisme sans but lucratif oeuvrant au rayonnement des artistes autochtones émergents.
-
[3]
La version originale de la performance par Tee Cloud, Laura Niquay et Arachnid se trouve sur l’album Four Sacred Colours (2019).
-
[4]
Laura Niquay, Anachnid, Eadsé, iskwē, G.R. Gritt, Matiu, Shauit, Soleil Launière et Viivi Maria Saarenkylä.
-
[5]
Il est question du 30 septembre 2021.
-
[6]
Il est question du 31 mars 2022.
-
[7]
Il est question du 31 mars 2022. Le Pape a rencontré des délégations des Métis et des Inuit Tapiriit Kanatami, puis de l’Assemblée des Premières Nations, à Rome.
Bibliographie
- AUDET, Véronique, 2012, « Chapitre I : les musiques traditionnelles innues », dans Innu nikamu. Pouvoir des chants, identité et guérison chez les Innus (pp 41-80). Québec : Presses de l’Université de Laval
- DELAMOUR, Carole, 2019, « Les multiples résonances du teuehikan (tambour) des Ilnuatsh de Mashteuiatsh dans le renouvellement d’une éthique de l’attention », Revue d'anthropologie des connaissances, 13, 3(3) : 793-816.
- DIAMOND, Beverley, CRONK, Sam M. and Franziska VON ROSEN, 1995, Visions of Sound: Musical Instruments of First Nations Communities in Northeastern America. Waterloo : Wilfrid Laurier University Press.
- JÉROME, Laurent, 2005, « Musique, tradition et parcours identitaire de jeunes Atikamekw : la pratique du tewehikan dans un processus de convocation culturelle / Music, tradition and the identity route of young Atikamekw: the evoking of cultural processes through the tewehikan », Recherches amérindiennes au Québec, 35(3) : 19-30.
- JÉROME, Laurent, 2015, « Les cosmologies autochtones et la ville : sens et appropriation des lieux à Montréal », Anthropologica, 57(2) : 327-339.