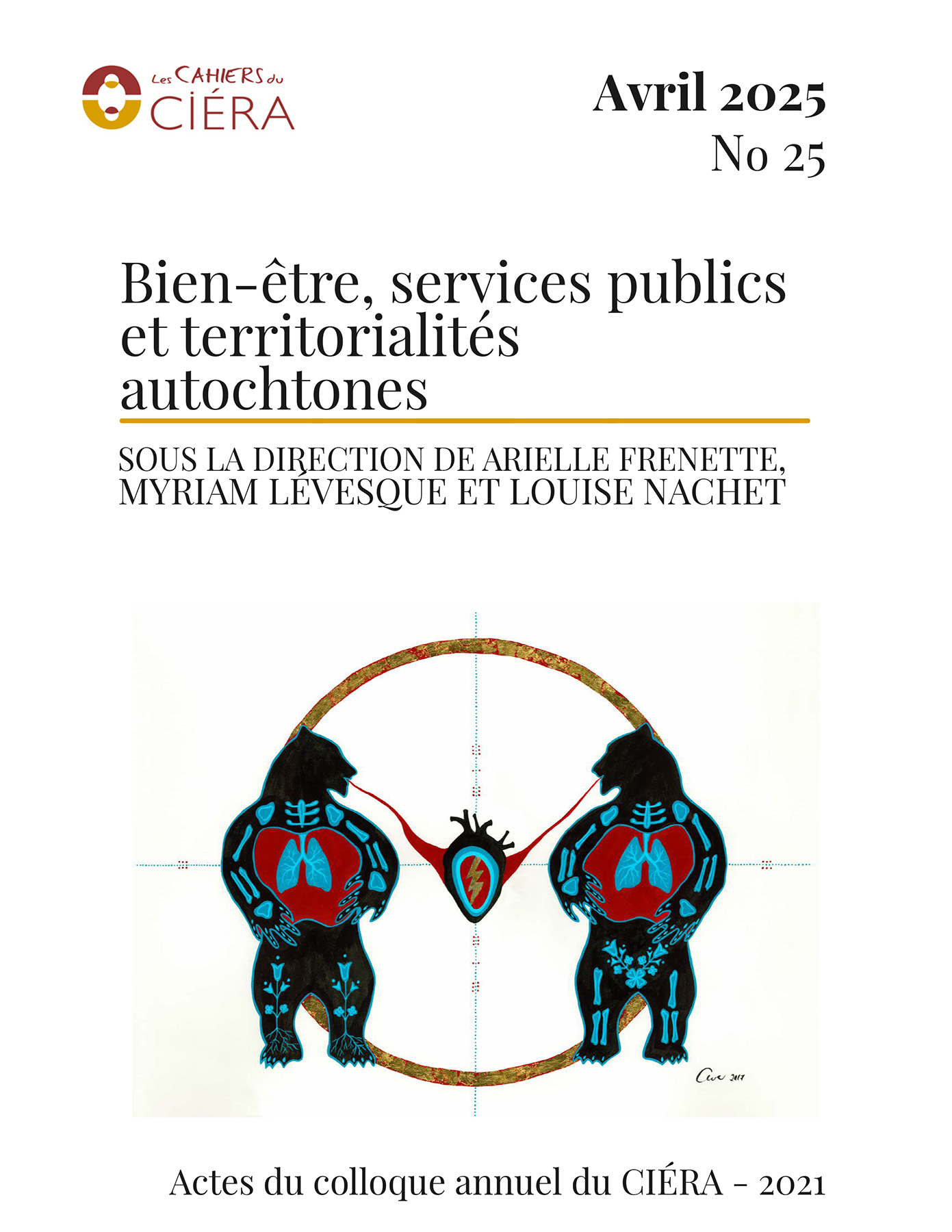Beaucoup d’habitants et habitantes du Canada n’ont pas conscience qu’ils et elles vivent sur un territoire traditionnel autochtone. L’espace public, surtout dans les zones urbaines, a en effet invisibilisé cette connaissance; on a fait commencer l’histoire du territoire à l’arrivée des colons européens et effacé la présence d’une ou de plusieurs communautés autochtones. Pour y remédier, un petit discours de reconnaissance territoriale est parfois prononcé en introduction d’un événement. Il s’agit d’une courte intervention, tout au plus d’une dizaine de phrases et qui précède des événements publics de diverses natures : politique, culturelle, sportive… Ainsi, on peut entendre une reconnaissance territoriale avant un cours universitaire, une réunion de conseil municipal, une réunion d’activistes ou encore un match de hockey sur glace. Ce discours est prononcé par une personne chargée de l’organisation de l’événement, parfois autochtone, mais surtout allochtone et est destiné au public non autochtone (Billows 2021). Nous verrons d’abord le contexte dans lequel les reconnaissances territoriales sont apparues, puis leurs objectifs et, enfin, les limites de cette pratique et les critiques qui en ressortent. Beaucoup plus fréquente au Canada anglais, la reconnaissance territoriale s’est particulièrement généralisée dans le milieu universitaire. Elle reste en revanche encore peu fréquente au Québec, même si elle s’y développe progressivement. Les discours sont très variables dans leur contenu et dans leurs intentions. Principalement, il s’agit de reconnaître que le lieu de l’événement est situé sur le territoire traditionnel d’une Première Nation ou sur un territoire de Métis et d’exprimer de la gratitude et du respect envers ces communautés autochtones. Selon Sheila Cote-Meek (Friesen 2019), la pratique des reconnaissances territoriales s’est multipliée dans les années 2010, particulièrement après 2015 et la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR). Si cette pratique s’est aussi répandue dans les universités étatsuniennes, elle trouve son origine au Canada. Il est délicat de déterminer qui et quand, dans les universités canadiennes, a commencé cette pratique. On en trouve de premiers exemples dans l’Ouest, soit en Colombie-Britannique, soit dans des facultés de droit situées sur des terres visées par des traités. Mais les reconnaissances territoriales en soi ne sont pas un phénomène nouveau, puisqu’elles sont, selon certaines personnes, issues d’une tradition panautochtone (Leblond et Gagnon 2020). La notion de reconnaissance territoriale se base sur une coutume ancestrale commune chez les membres des Premières Nations et les Métis (Joseph 2019). Lorsqu’une personne autochtone se trouvait sur le territoire d’une autre nation, elle prononçait quelques paroles en signe de paix et de respect, afin de reconnaître que le territoire en question était sous la protection de cette Première Nation ou des Métis (cette coutume persiste dans beaucoup de communautés autochtones). Du côté des Inuit, les écrits scientifiques renferment très peu d’information sur cette pratique aussi indéniable que complexe. Néanmoins, les Inuit contemporains incorporent les reconnaissances territoriales dans leurs pratiques. Certains et certaines militent d’ailleurs pour que la place millénaire des Inuit dans l’Inuit Nunangat (la patrie du peuple inuit) soit davantage reconnue par l’État canadien (Simon 2011). Ainsi, l’Assemblée du Manitoba a intégré les Inuit dans la première reconnaissance territoriale prononcée à l’Assemblée, le 29 novembre 2021, au même titre que les autres communautés autochtones présentes au Manitoba. Dans un esprit de réconciliation entre allochtones et Autochtones, cette coutume a donc été reprise et intégrée au début de nombreux événements au Canada. Les reconnaissances territoriales sont de natures variées. En voici deux exemples pour en apprécier la diversité, qui constitue l’un des enjeux de cette pratique. Pour le district scolaire du nord de Vancouver, il est désormais usage de dire : « I would like to start by acknowledging and thanking …
Parties annexes
Bibliographie
- ACPPU — Association canadienne des professeures et professeurs d'université, 2016, Guide de reconnaissance des Premières Nations et des territoires traditionnels. En ligne : https://www.caut.ca/fr/content/guide-de-reconnaissance-des-premieres-nations-et-des-territoires-traditionnels, [has been consulted on September 28, 2022].
- ALICK, Claudia, GEAORGE-WARREN, Roo, SCHACHT, Jessica, MOSES, Tara, KOVICHm Andrea, PAPALIA, Carmen and Mia Susan AMIR, 2020, « Praxis Sessions for Virtual Collaboration: Land Acknowledgements with Unsettling Dramaturgy on Tuesda[y]. HowlRound Theatre Commons [video] », YouTube. Retrieved from : https://www.youtube.com/watch?v=YbPTTi73HG4, [has been consulted on September 28, 2022].
- ASHER, Lila, CURNOW, Joe and Amil DAVIS, 2018, « The limits of settlers’ territorial acknowledgments », Curriculum Inquiry, 48(3). Retrieved from : https://doi.org/10.1080/03626784.2018.1468211, [has been consulted on September 28, 2022].
- BEAULIEU, Alain, 2017, « Montréal, un territoire mohawk ? », La Presse+, 29 septembre 2017. En ligne : https://plus.lapresse.ca/screens/6d3952b1-6fcc-4fd5-8b58-f7f9783a1df1|_0.html, [consulté le 7 mai 2023].
- BILLOWS, Jo, 2021, Territory Acknowledgment, Unacknowledgement, and Misacknowledgement: A Haunting (Master’s Thesis), University of Toronto.
- BLENKINSOP, Sean and FETTES, Mark, 2020, « Land, Language and Listening: The Transformations That Can Flow from Acknowledging Indigenous Land », Journal of Philosophy of Education, 54(4). Retrieved from : https://doi.org/10.1111/1467-9752.12470, [has been consulted on September 28, 2022].
- FRIESEN, Joe, 2019, « As Indigenous Land Acknowledgments Become the Norm, Critics Question Whether the Gesture Has Lost Its Meaning », Canadian Historical Association, 2(2). Retrieved from : https://depot.erudit.org/id/004507dd, [has been consulted on September 28, 2022].
- JOSEPH, Bob, 2019, « First Nation Protocol on Traditional Territory », Indigenous Corporate Training INC: Working Effectively with Indigenous Peoples, July 27, 2019. Retrieved from : https://www.ictinc.ca/first-nation-protocol-on-traditional-territory, [has been consulted on September 28, 2022].
- Library and Information Studies Students' Association, 2019, « LISSA Land Acknowledgement, Template for Personalization, Definitions, and Speaker Protocol », University of Alberta, February 28, 2019. Retrieved from : https://doi.org/10.7939/r3-ypab-8s28, [has been consulted on September 28, 2022].
- LUBECK, Andrea, 2021, « Terres autochtones non cédées : voici pourquoi le message du Canadien fait controverse », 24 heures, 19 octobre 2021. En ligne : https://www.24heures.ca/2021/10/19/terres-autochtones-non-cedees-voici-pourquoi-le-message-du-canadien-fait-controverse, [consulté le 28 septembre 2022].
- RICHOT, Mélanie, 2021, « Nunavut premier assigns portfolios to new cabinet », Nunatsiaq News, November 19, 2021, Retrieved from : https://nunatsiaq.com/stories/article/nunavut-premier-assigns-portfolios-to-new-cabinet/, [has been consulted on May 3, 2023].
- SIMON, Mary, 2011, « Canadian Inuit: Where we have been and where we are going », International Journal, 66(4), 879–891. Retrieved from : https://www.jstor.org/stable/23104399, [has been consulted on April 25, 2023].
- VOWEL, Chelseea, 2016, « Beyond Territorial Acknowledgments », Âpihtawikosisân, September 23, 2016, Retrieved from : https ://apihtawikosisan.com/2016/09/beyond-territorial-acknowledgments/, [has been consulted on September 28, 2022].
- VEILLETTE-CHEEZO, Kijâtai-Alexandra, 2021, « Reconnaître un territoire non cédé, mais encore ? », Radio-Canada, 23 octobre 2021. En ligne : https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1833838/reconnaissance-territoire-autochtone-canadien-chronique-kijaitai, [consulté le 28 septembre 2022].
- WILKES, Rima, Duong, Aaron, KESLER, Linc and Howard RAMOS, 2017, « Canadian University Acknowledgment of Indigenous Lands, Treaties, and Peoples », Canadian Review of Sociology, 54(1). Retrieved from : https://doi.org/10.1111/cars.12140, [has been consulted on September 28, 2022].