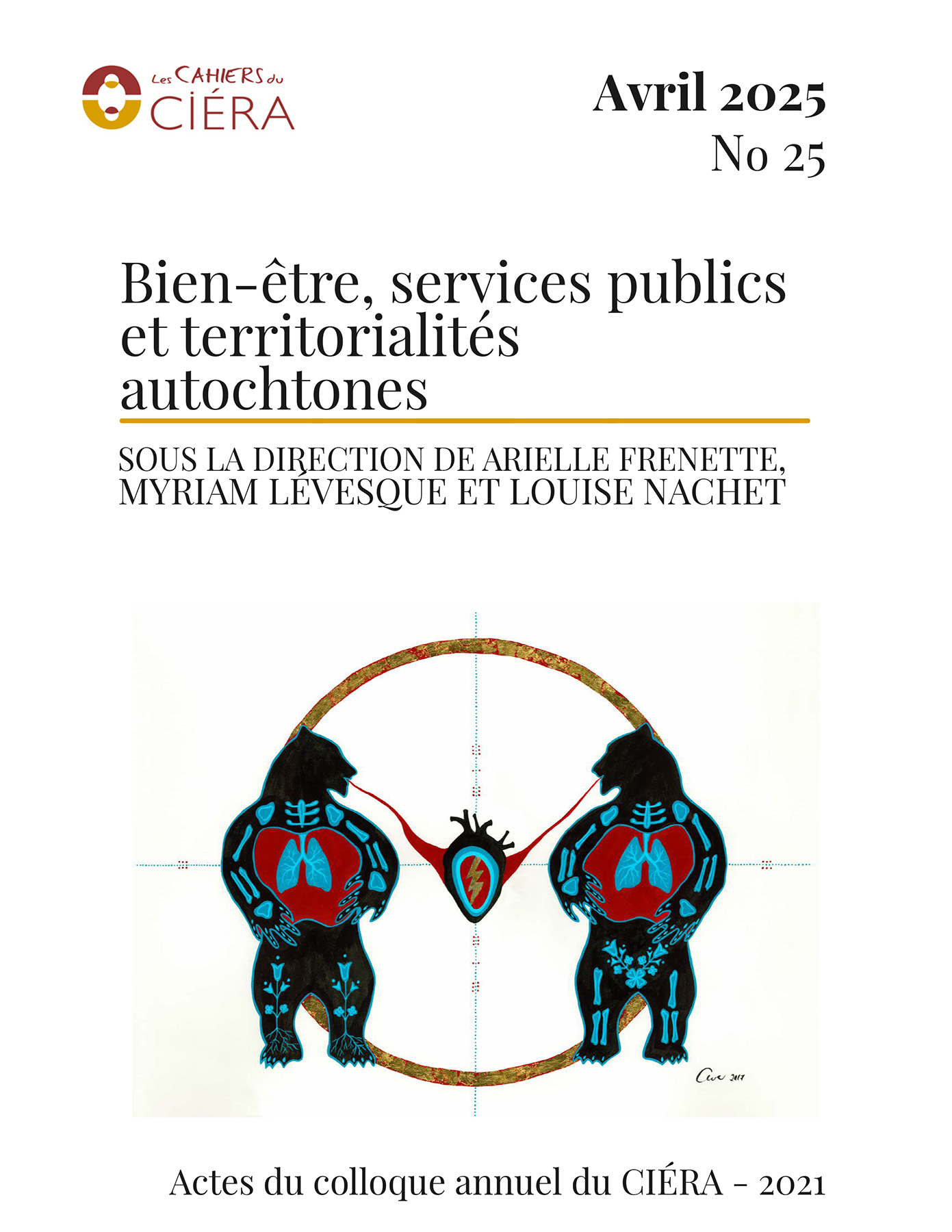Corps de l’article
Beaucoup d’habitants et habitantes[2] du Canada n’ont pas conscience qu’ils et elles vivent sur un territoire traditionnel autochtone. L’espace public, surtout dans les zones urbaines, a en effet invisibilisé cette connaissance; on a fait commencer l’histoire du territoire à l’arrivée des colons européens et effacé la présence d’une ou de plusieurs communautés autochtones. Pour y remédier, un petit discours de reconnaissance territoriale est parfois prononcé en introduction d’un événement. Il s’agit d’une courte intervention, tout au plus d’une dizaine de phrases et qui précède des événements publics de diverses natures : politique, culturelle, sportive… Ainsi, on peut entendre une reconnaissance territoriale avant un cours universitaire, une réunion de conseil municipal, une réunion d’activistes ou encore un match de hockey sur glace. Ce discours est prononcé par une personne chargée de l’organisation de l’événement, parfois autochtone, mais surtout allochtone et est destiné au public non autochtone (Billows 2021). Nous verrons d’abord le contexte dans lequel les reconnaissances territoriales sont apparues, puis leurs objectifs et, enfin, les limites de cette pratique et les critiques qui en ressortent.
Beaucoup plus fréquente au Canada anglais, la reconnaissance territoriale s’est particulièrement généralisée dans le milieu universitaire. Elle reste en revanche encore peu fréquente au Québec, même si elle s’y développe progressivement. Les discours sont très variables dans leur contenu et dans leurs intentions. Principalement, il s’agit de reconnaître que le lieu de l’événement est situé sur le territoire traditionnel d’une Première Nation ou sur un territoire de Métis et d’exprimer de la gratitude et du respect envers ces communautés autochtones. Selon Sheila Cote-Meek (Friesen 2019), la pratique des reconnaissances territoriales s’est multipliée dans les années 2010, particulièrement après 2015 et la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR). Si cette pratique s’est aussi répandue dans les universités étatsuniennes, elle trouve son origine au Canada[3]. Il est délicat de déterminer qui et quand, dans les universités canadiennes, a commencé cette pratique. On en trouve de premiers exemples dans l’Ouest, soit en Colombie-Britannique[4], soit dans des facultés de droit situées sur des terres visées par des traités. Mais les reconnaissances territoriales en soi ne sont pas un phénomène nouveau, puisqu’elles sont, selon certaines personnes, issues d’une tradition panautochtone (Leblond et Gagnon 2020). La notion de reconnaissance territoriale se base sur une coutume ancestrale commune chez les membres des Premières Nations et les Métis (Joseph 2019). Lorsqu’une personne autochtone se trouvait sur le territoire d’une autre nation, elle prononçait quelques paroles en signe de paix et de respect, afin de reconnaître que le territoire en question était sous la protection de cette Première Nation ou des Métis (cette coutume persiste dans beaucoup de communautés autochtones). Du côté des Inuit[5], les écrits scientifiques renferment très peu d’information sur cette pratique aussi indéniable que complexe. Néanmoins, les Inuit contemporains incorporent les reconnaissances territoriales dans leurs pratiques. Certains et certaines militent d’ailleurs pour que la place millénaire des Inuit dans l’Inuit Nunangat (la patrie du peuple inuit) soit davantage reconnue par l’État canadien (Simon 2011). Ainsi, l’Assemblée du Manitoba a intégré les Inuit dans la première reconnaissance territoriale prononcée à l’Assemblée, le 29 novembre 2021[6], au même titre que les autres communautés autochtones présentes au Manitoba. Dans un esprit de réconciliation entre allochtones et Autochtones, cette coutume a donc été reprise et intégrée au début de nombreux événements au Canada.
Les reconnaissances territoriales sont de natures variées. En voici deux exemples pour en apprécier la diversité, qui constitue l’un des enjeux de cette pratique. Pour le district scolaire du nord de Vancouver, il est désormais usage de dire : « I would like to start by acknowledging and thanking the Coast Salish people, whose traditional territory North Vancouver School District resides on. I express our gratitude to the Squamish Nation and Tsleil Waututh Nation, and we value the opportunity to learn, live and share educational experiences on this traditional territory » (ACPPU 2019). Pour l’Université Laval, on dit notamment : « Nous tenons d’abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat » (ACPPU 2019). Ces deux reconnaissances territoriales soulignent, pour la première, la gratitude et le respect et pour la seconde, l’existence d’une Première Nation sur le territoire et le rétablissement de la vérité à propos de son occupation (Wilkes et al. 2017). L’une des questions qui se pose est également la fréquence des reconnaissances territoriales. Pour la réalisatrice mvskoke (muscogee creek) Tara Moses, « I personally feel that land acknowledgements need to be normalized in every single thing that you do, [so] you get so sick of it » (cf. segment à 1 h 44 min de l’enregistrement vidéo, Alick et al. 2020). Les reconnaissances territoriales sont parfois accompagnées d’actes symboliques, dont l’allumage du Qulliq[7], la lampe à huile traditionnelle inuit, au début d’un événement comme la cérémonie d’entrée en fonction du gouvernement du Nunavut (Richot 2021).
Attardons-nous maintenant sur les différentes intentions qui peuvent être associées à ces reconnaissances territoriales. La particularité de ce geste réalisé avant un événement est la variabilité de ses motifs qui diffèrent d’une personne à l’autre, d’autant plus que sa fréquence augmente. L’idée générale des reconnaissances territoriales est celle de la (ré)conciliation avec les peuples autochtones et d’une prise en compte de ces derniers. En effet, l’importance de la présence passée et actuelle des Premières Nations, des Métis et des Inuit dans les différentes régions du Canada a pendant longtemps été ignorée et est même restée inconnue des autres habitantes et habitants du pays. Cette méconnaissance ou incompréhension généralisée, voire le mépris, des revendications territoriales était l’un des éléments de l’invisibilisation des Autochtones dans la société canadienne. Afin de répondre à cette invisibilisation, les reconnaissances territoriales ont pour but de mettre en lumière la présence autochtone locale. Même s’il n’en est pas mention explicite dans la reconnaissance territoriale, il s’agit, à mon sens, de tenter de réparer ou du moins de mettre un terme à certaines pratiques du passé en vue d’établir des relations plus saines avec les peuples autochtones. Dans le prolongement de cette idée, il y a parfois une volonté de pédagogie envers le public n’étant pas nécessairement propre à la Première Nation ou communauté de Métis ou Inuit locale. Parfois, les intentions et le discours sont plus précis, en reconnaissant explicitement les torts causés par le passé. Par exemple, dans le cadre du programme KAIROS de la United Church of Canada, la reconnaissance territoriale a un objectif plus défini de demande de pardon et de reconnaissance des violences commises par l’Église aux Autochtones, notamment dans les pensionnats autochtones (Vowel 2016).
L’intention de suivre le « protocole traditionnel » autochtone d’accueil d’une Première Nation par une autre constitue un autre objectif de ces quelques phrases prononcées (Joseph 2019). Mais une reconnaissance territoriale faite par un ou une allochtone dans le but de suivre cette coutume autochtone fait beaucoup débat au sein des Premières Nations. Bob Joseph, fondateur de l'entreprise Indigenous Corporate Training, qui forme des allochtones sur les relations avec les Autochtones, le défend. Cependant, l’emploi de la reconnaissance territoriale associé à cet objectif est rejeté par l’écrivaine Métis Chelsea Vowel ; elle y voit un point de vue extrêmement réducteur du protocole traditionnel, qui est beaucoup plus complexe que quelques simples phrases de respect (Vowel 2016). En effet, cette idée qu’on « honore un protocole traditionnel autochtone » vient effacer la diversité de ces coutumes autochtones destinées à montrer son respect lors d’une arrivée sur un autre territoire et amoindrit les dynamiques relationnelles à quelques phrases écrites (Billows 2021). Enfin, le fait de contester la notion même d’appartenance de la terre représente une autre utilité et intention des reconnaissances territoriales. En outre, celle-ci peut amener à faire des réflexions écologistes (dans le sens de se préoccuper de la protection de l’environnement) et à ouvrir ainsi le débat sur le rapport des humains à la Terre dans un monde capitaliste, qui conçoit l’espace en termes de propriétés privées et de frontières. En effet, la notion de terres ancestrales ou de territoires pour les Premières Nations et les Métis ne s’insère pas dans les préceptes du capitalisme, puisqu’elle se réfère notamment à une vision comprenant des souvenirs, des traditions ainsi que des vies humaines et non humaines attachés à cette terre. Les reconnaissances territoriales peuvent donc entrer dans le cadre de l’éducation à l’environnement (Blenkisop et al. 2020). On retrouve dans ces textes une volonté de réconciliation avec la Terre, indispensable à la réconciliation avec les Premiers Peuples, comme cela a été souligné par la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR). Bien sûr, la reconnaissance territoriale seule ne peut pas transformer les relations entre la société et la Terre. Ce n’est d’ailleurs pas son objectif premier; mais elle peut y contribuer, ce qui renforce son importance.
Néanmoins, les critiques des reconnaissances territoriales abondent, car ces dernières sont loin de faire l’unanimité auprès des Premières Nations, des Métis et des Inuit. En effet, les dérives sont nombreuses. Les reconnaissances territoriales sont souvent considérées comme de simples formalités par les allochtones, une case à cocher avant de commencer un événement. Il arrive qu’une reconnaissance territoriale soit faite sans même mentionner la Première Nation, les Métis ou les Inuit en question, en se trompant de nom ou alors en ne faisant aucun effort de prononciation (Friesen 2019). En outre, les processus décisionnels opportunistes, voire l’hypocrisie, associés à certaines situations où la reconnaissance territoriale est la seule chose que l’organisme entreprend pour entretenir un dialogue avec les Premiers Peuples et prendre en compte les Autochtones sont critiqués. Cet élément contribue alors à déculpabiliser les membres de l’organisme tenant l’événement, à les déresponsabiliser quant à leurs devoirs envers les communautés autochtones vivant sur les territoires dont il est question ainsi que les Premiers Peuples en général (Asher et al. 2018). Par exemple, Chelsea Vowel critique l’Université McGill située à Montréal. Les étudiants et étudiantes autochtones ont réclamé la création d’un environnement plus accueillant, afin de mener leurs études plus sereinement. L’ajout de reconnaissances territoriales lors d’événements de même qu’à l’écrit dans le site Internet de l’université et dans les signatures de courriels du personnel représente la seule réponse fournie (Vowel 2016). Cela peut donc redorer l’image d’une institution, même si les actions concrètes mises en place par cette dernière pour soutenir ses étudiantes et étudiants autochtones sont minimes. Par ailleurs, les reconnaissances territoriales exercent parfois une contrainte sur les personnes autochtones présentes à un événement, soit parce qu’on leur demande de faire elles-mêmes ce petit discours, soit parce qu’on leur demande de le rédiger, même si elles ne sont pas les organisatrices (LISSA 2019). Comme les reconnaissances territoriales se multiplient, les sollicitations sont aussi de plus en plus nombreuses; d’ailleurs, certains chercheurs, chercheuses ou activistes ne peuvent plus y répondre, à moins d’y consacrer un temps déraisonnable (Billows 2020). En outre, cela peut représenter une charge émotionnelle importante que les Autochtones ne devraient pas avoir à porter. Selon Billows (2020), le principe même d’une reconnaissance territoriale sincère suppose de faire ses propres recherches, d’y consacrer du temps et de l’énergie et de ne pas simplement réciter quelques phrases sans engagement personnel.
Une autre difficulté liée aux reconnaissances territoriales concerne son principe même : on souhaite exprimer le fait que les membres d’une Première Nation, des Métis ou des Inuit sont et étaient les gardiens et gardiennes d’un territoire particulier; toutefois, pour ce faire, il faut déterminer la communauté qui y vit et vivait traditionnellement. Si les traités peuvent parfois aider à régler cette question pour certaines régions du Canada (même si certains traités font l’objet de recours), la tâche est difficile pour le Québec. Ainsi, la décision prise fin 2021 par l’équipe de hockey sur glace du Canadien de Montréal de reconnaître avant chaque match leur présence sur un territoire mohawk non cédé a suscité des controverses. On ne peut affirmer avec certitude que Montréal est située sur le territoire des Kanyen'kehà:ka : il s’agirait plutôt d’un lieu de vie d’autrefois des Innus et des Algonquiens puis des Iroquoiens du Saint-Laurent, où les Mohawks se seraient installés pendant quelques décennies, sans que ce ne soit leur territoire traditionnel (Beaulieu 2017). En tout état de cause, une reconnaissance territoriale au Québec est difficile à faire avec exactitude et sans léser une Première Nation, ce qui met en doute son intérêt. Même ailleurs au Canada, il n’est pas simple de choisir les mots à prononcer; certaines personnes, comme le sociologue anishinaabe Hayden King, regrettent d’ailleurs d’avoir participé à l’écriture de reconnaissances territoriales pour des institutions, comme Ryerson University (Metropolitan University of Toronto depuis 2022). Selon King, entre autres, la reconnaissance territoriale devient superficielle et s’écarte du sens du traité cité (Billows 2021). Pour beaucoup, il faut aller au-delà d’une simple reconnaissance par quelques phrases et réfléchir à la signification d’être des invités sur une terre particulière, aux obligations des personnes invitées de même qu’au comportement à adopter.
Cette pratique est soutenue en dépit de tout, même par celles et ceux qui y posent un regard critique. Néanmoins, elle demeure un bon début, un premier geste symbolique à normaliser et à pratiquer fréquemment au Canada. Selon Penny Bryden, président de la Société historique du Canada, il est toujours préférable de faire une reconnaissance territoriale que de ne rien faire et la critique de cet élément ne doit pas donner une excuse aux plus récalcitrants et récalcitrantes pour ne rien faire du tout. De plus, les reconnaissances territoriales continuent de jouer leur rôle dans les endroits où la pratique n’est pas normalisée, notamment au Québec, où elles continuent de « disrupt and discomfit settler colonialism », selon Vowel (2016) et contribuent à mettre un terme à l’effacement des Premières Nations, des Métis et des Inuit.
Ainsi, les reconnaissances territoriales sont à la fois un outil qui contribue à visibiliser les Premières Nations, les Métis et les Inuit, à amorcer une démarche de (ré)conciliation, d’éducation et de questionnement quant à l’appartenance de la terre, parfois à demander pardon et, pour certains, à suivre un « protocole traditionnel » autochtone. Mais sa banalisation entraîne toutefois des dérives et son intérêt s’en trouve alors discutable. Enfin, les reconnaissances territoriales demeurent certes un premier pas nécessaire, mais celui-ci est loin d’être suffisant en vue d’instaurer la véritable (ré)conciliation.
Parties annexes
Note biographique
Juliette Elie est une étudiante française diplômée d’une licence de Sciences de la Vie et d’une licence d’Histoire à Sorbonne Université à Paris. Elle a effectué une année d’échange universitaire à l’Université de Montréal en 2021-2022, où elle s’est initiée à l’anthropologie et aux études autochtones avec les cours du département d’Anthropologie de l’Université de Montréal. Elle poursuit désormais un master en Sciences appliquées à l’archéologie en France et s’intéresse particulièrement aux interactions entre les populations humaines, leur environnement et les ressources végétales.
Notes
-
[1]
L’autrice a obtenu son diplôme pour ces deux programmes en 2022 et étudie désormais en cycle supérieur, dans le cadre d’une maîtrise Biodiversité Écologie Évolution, parcours Quaternaire, Préhistoire et Bioarchéologie, au Muséum national d’Histoire naturelle (France).
-
[2]
Il a été choisi d’utiliser l’écriture inclusive dans la rédaction de ce texte dans le but de rendre visibles toutes les personnes concernées, quel que soit leur genre. Cela signifie l’utilisation de termes épicènes lorsque c’est possible et de termes masculins et féminins lorsque c’est nécessaire.
-
[3]
Voir https://inclusive.princeton.edu/initiatives/building-community/native-american-indigenous-inclusion/land-acknowledgements (consulté le 12 juillet 2022).
-
[4]
Voir https://www.torontomu.ca/aec/land-acknowledgment/ (consulté le 12 juillet 2022).
-
[5]
Il a été choisi d’utiliser l’ethnonyme Inuit invariable en genre et en nombre, afin de respecter l’ethnonyme en inuktitut, selon la deuxième perspective proposée par le Portail linguistique du Canada, voir https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/blogue-blog/recommandation-inuit-inuk-fra (consulté le 28 novembre 2023).
-
[6]
Voir https://youtu.be/LW-X9vCo0WY (consulté le 22 avril 2023).
-
[7]
En inuktitut.
Bibliographie
- ACPPU — Association canadienne des professeures et professeurs d'université, 2016, Guide de reconnaissance des Premières Nations et des territoires traditionnels. En ligne : https://www.caut.ca/fr/content/guide-de-reconnaissance-des-premieres-nations-et-des-territoires-traditionnels, [has been consulted on September 28, 2022].
- ALICK, Claudia, GEAORGE-WARREN, Roo, SCHACHT, Jessica, MOSES, Tara, KOVICHm Andrea, PAPALIA, Carmen and Mia Susan AMIR, 2020, « Praxis Sessions for Virtual Collaboration: Land Acknowledgements with Unsettling Dramaturgy on Tuesda[y]. HowlRound Theatre Commons [video] », YouTube. Retrieved from : https://www.youtube.com/watch?v=YbPTTi73HG4, [has been consulted on September 28, 2022].
- ASHER, Lila, CURNOW, Joe and Amil DAVIS, 2018, « The limits of settlers’ territorial acknowledgments », Curriculum Inquiry, 48(3). Retrieved from : https://doi.org/10.1080/03626784.2018.1468211, [has been consulted on September 28, 2022].
- BEAULIEU, Alain, 2017, « Montréal, un territoire mohawk ? », La Presse+, 29 septembre 2017. En ligne : https://plus.lapresse.ca/screens/6d3952b1-6fcc-4fd5-8b58-f7f9783a1df1|_0.html, [consulté le 7 mai 2023].
- BILLOWS, Jo, 2021, Territory Acknowledgment, Unacknowledgement, and Misacknowledgement: A Haunting (Master’s Thesis), University of Toronto.
- BLENKINSOP, Sean and FETTES, Mark, 2020, « Land, Language and Listening: The Transformations That Can Flow from Acknowledging Indigenous Land », Journal of Philosophy of Education, 54(4). Retrieved from : https://doi.org/10.1111/1467-9752.12470, [has been consulted on September 28, 2022].
- FRIESEN, Joe, 2019, « As Indigenous Land Acknowledgments Become the Norm, Critics Question Whether the Gesture Has Lost Its Meaning », Canadian Historical Association, 2(2). Retrieved from : https://depot.erudit.org/id/004507dd, [has been consulted on September 28, 2022].
- JOSEPH, Bob, 2019, « First Nation Protocol on Traditional Territory », Indigenous Corporate Training INC: Working Effectively with Indigenous Peoples, July 27, 2019. Retrieved from : https://www.ictinc.ca/first-nation-protocol-on-traditional-territory, [has been consulted on September 28, 2022].
- Library and Information Studies Students' Association, 2019, « LISSA Land Acknowledgement, Template for Personalization, Definitions, and Speaker Protocol », University of Alberta, February 28, 2019. Retrieved from : https://doi.org/10.7939/r3-ypab-8s28, [has been consulted on September 28, 2022].
- LUBECK, Andrea, 2021, « Terres autochtones non cédées : voici pourquoi le message du Canadien fait controverse », 24 heures, 19 octobre 2021. En ligne : https://www.24heures.ca/2021/10/19/terres-autochtones-non-cedees-voici-pourquoi-le-message-du-canadien-fait-controverse, [consulté le 28 septembre 2022].
- RICHOT, Mélanie, 2021, « Nunavut premier assigns portfolios to new cabinet », Nunatsiaq News, November 19, 2021, Retrieved from : https://nunatsiaq.com/stories/article/nunavut-premier-assigns-portfolios-to-new-cabinet/, [has been consulted on May 3, 2023].
- SIMON, Mary, 2011, « Canadian Inuit: Where we have been and where we are going », International Journal, 66(4), 879–891. Retrieved from : https://www.jstor.org/stable/23104399, [has been consulted on April 25, 2023].
- VOWEL, Chelseea, 2016, « Beyond Territorial Acknowledgments », Âpihtawikosisân, September 23, 2016, Retrieved from : https ://apihtawikosisan.com/2016/09/beyond-territorial-acknowledgments/, [has been consulted on September 28, 2022].
- VEILLETTE-CHEEZO, Kijâtai-Alexandra, 2021, « Reconnaître un territoire non cédé, mais encore ? », Radio-Canada, 23 octobre 2021. En ligne : https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1833838/reconnaissance-territoire-autochtone-canadien-chronique-kijaitai, [consulté le 28 septembre 2022].
- WILKES, Rima, Duong, Aaron, KESLER, Linc and Howard RAMOS, 2017, « Canadian University Acknowledgment of Indigenous Lands, Treaties, and Peoples », Canadian Review of Sociology, 54(1). Retrieved from : https://doi.org/10.1111/cars.12140, [has been consulted on September 28, 2022].