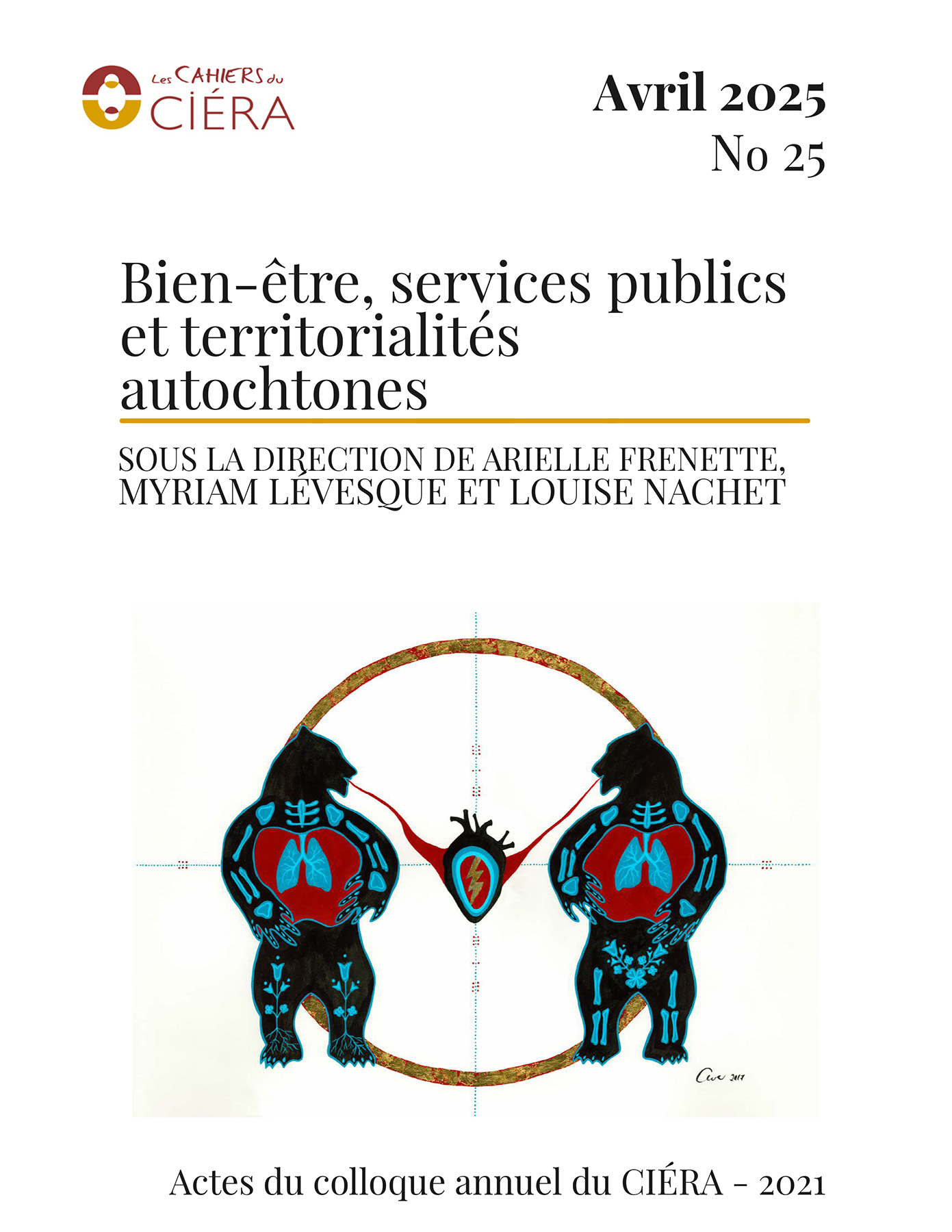Résumés
Résumé
Cette étude informe de la dynamique des pratiques muséales collaboratives de valorisation du patrimoine artistique autochtone à travers l’étude de cas du Musée des beaux-arts de Sherbrooke, institution régionale allochtone située en territoire abénaki depuis 1982. Des gestes de diffusion et de médiation, de gestion des collections, et de culture institutionnelle sont pensés selon la notion d’initiatives dans un contexte de décolonisation, d’autochtonisation et de muséologie collaborative des musées allochtones solidaires aux causes autochtones. Suivant une méthodologie de sensation participante reposant sur la muséologie sensorielle et la sociologie de l’art et de la culture, ce travail s’appuie sur des entrevues semi-dirigées avec des membres du personnel, les archives du Musée, ainsi que la position de la chercheuse. On aborde par exemple la situation géographique du Musée dans le Ndakina, laquelle est rendue explicite et touche à la fois la proprioception de ses publics et de son personnel. Il est proposé que ce type de pratiques est accessible et relève, dans le contexte sociohistorique actuel, d’initiatives du personnel tout comme de démarches d’implantation d’une culture organisationnelle adoptant une position collaborative. Sont également abordées les limites que cela implique, notamment à travers la gouvernance et la littératie décoloniale des équipes en place dans un musée donné.
Mots-clés :
- Muséologie collaborative,
- patrimoine autochtone,
- sociologie de la culture,
- muséologie sensorielle,
- sociologie de l’art
Abstract
This study delves into the dynamics of collaborative museum practices in terms of valorizing Indigenous artistic heritage through the case study of a non-Indigenous regional institution, the Musée des beaux-arts de Sherbrooke, which is located in Abenaki traditional territory since 1982. Acts of distribution and mediation, collections management, and institutional culture are apprehended in terms of initiatives in a context of decolonization, indigenization and collaborative museology of non-Indigenous museums that are united for Indigenous causes. Following a participant sensation methodology resting on sensory museology and the sociology of culture and art, this article uses semi-conducted interviews with museum staff, the museum archives as well as the researcher’s position. The Musée’s geographic position within Ndakina, for instance, is rendered explicit and taps into the public and staff’s sense of proprioception. In the present sociohistorical context, it appears that this type of practice is readily accessible and has to do with staff initiatives as well as implementing an organizational culture adopting a collaborative position. The article also discusses the limits of this approach through the notion of governance and decolonial literacy among museums’ staff.
Keywords:
- Collaborative Museology,
- Indigenous Heritage,
- Sociology of Culture,
- Sensory Museology,
- Sociology of Art
Corps de l’article
Tracé et contours : introduction
Cet article propose une étude de cas d’initiatives de mise en valeur des arts autochtones au Musée des beaux-arts de Sherbrooke (MBAS) situé en territoire abénaki, le Ndakina[1]. Il se situe dans le contexte de résurgence autochtone et de décolonisation des pratiques à l’échelle internationale, en appui à la continuité des patrimoines autochtones. Depuis plusieurs événements catalyseurs, les bonnes pratiques muséales quant aux patrimoines autochtones tendent à être davantage élaborées dans la littérature depuis plus de cinquante ans[2]. Or, qu’en est-il de l’action quotidienne des musées québécois qui adoptent ou tendent vers une position de solidarité avec les Autochtones, et de ses incertitudes sous-jacentes ?
À travers ma propre perspective et mon expérience en tant que conservatrice adjointe[3] et sociologue québécoise originaire de la ville de Nékitotegwak / Sherbrooke, j’adopte une méthodologie qualitative et un cadre théorique s’appuyant sur une épistémologie autochtone dans la mesure du possible avec des sources autochtones, et une muséologie sensorielle, ou sensory museology, les musées étant appréhendés comme sites où le sensorium et l’affect se déploient au-delà de l’appréciation purement esthétique d’un objet (Howes 2014). Ces approches permettent de considérer la multisensorialité significative au sein des patrimoines et cultures des Premières Nations, Métis et Inuit (PNMI)[4]. Je me réfère également à la sociologie de l’art, et à celle de la culture qui, comparativement à la sociologie culturelle plus vaste, permet d’analyser spécifiquement et respectivement le contexte artistique, ainsi que les pratiques d’une institution culturelle donnée. Ainsi, à partir de données issues des archives et de la programmation du MBAS, d’expériences relatives à mon mandat professionnel, et de trois entrevues semi-dirigées avec des employées du musée menées en 2021, j’analyse trois axes interdépendants d’initiatives sélectionnées dans les limites du présent exercice. Ce sont : 1) celles de diffusion et de médiation ; 2) celles de culture organisationnelle et 3) celles de gestion des collections. Une emphase particulière est mise sur le premier axe, car les musées, comme diffuseurs culturels auprès des collectivités dont ils sont au service selon leur mission respective, doivent conséquemment offrir une programmation généreuse et diversifiée. D’un point de vue quantitatif, la diffusion et la médiation regroupent également le plus d’actions compilées à ce jour. L’accent est également mis sur les initiatives liées à la relation nécessaire avec les communautés et le territoire abénakis.
En analysant ces processus et les relations qu’ils impliquent — avec le territoire, avec diverses formes de vie et avec les objets — on sera en mesure d’examiner si cette mise en valeur demeure ponctuelle et partielle, issue d’initiatives ou de facteurs facilitants. Par analogie, la restitution de biens culturels au Canada repose à l’heure actuelle sur la volonté des institutions (Bell, Lai et Skorodenski 2014 ; ICOFOM 2021). S’il en est autrement, on posera l’hypothèse selon laquelle cette mise en valeur devient la norme, la culture organisationnelle, l’action déjà prescrite dans le réseau muséal québécois. On part de la prémisse que les musées sont des acteurs sociopolitiques, culturels et économiques qui ont un impact majeur sur la perception des publics dont ils sont au service, et sur les bonnes pratiques à adopter selon Battiste (Mi’kmaw) et Henderson (Chickasaw / Cheyenne) (Battiste et Henderson 2000). Inversement, les musées ont historiquement participé à la dépossession de biens culturels et à la colonisation des Premiers Peuples (Lonetree et Cobb 2008 ; Boxer 2016), (néo)colonialisme persistant et protéiforme comme l’explicitent notamment Alfred et Corntassel (2005)[5]. L’autoreprésentation et la réappropriation de leurs patrimoines comme idéal partagé ont supplanté les représentations muséales réductrices de ces peuples (Tuhiway Smith 2012), lesquelles portent une autorité notable, lorsqu'elles sont diffusées par des musées nationaux (Clifford 2004).
En ce qui a trait au modèle de la muséologie collaborative, Jérôme et Kaine (2014), Blanchard et Howes (2014, 2019), Desmarais-Tremblay (2016) et Desmarais et Jérôme (2018) en ont détaillé les forces, défis et limites avec l’exemple de l’exposition permanente du Musée de la civilisation du Québec (MCQ) C’est notre histoire : Premières Nations et Inuit du XXIe siècle. En effet, la culture institutionnelle originellement occidentale de nombreux musées a souvent préséance sur plusieurs concepts de mise en valeur issus des communautés autochtones collaboratrices, ou sur les échéanciers de projets[6]. James Clifford (2004) soulignait le partage incontournable de l’autorité et des ressources pour une collaboration prometteuse.
Esquisse : analyse
La prudence et l’action comme impératifs
À la lumière de ces prémisses, on connaît donc en général, et l’on peut difficilement minimiser ce qu’il ne faut plus faire au sein des musées afin d’éviter de répéter des erreurs qui ont un impact intersectionnel négatif auprès des communautés autochtones. La prudence tout comme l’action semblent de mise en tant qu’organisation qui se veut solidaire des causes autochtones, car l'absence d'action rimerait avec l'invisibilisation une fois de plus. À titre d’exemple, prenons un récit narratif tenace dans plusieurs scénographies d’exposition, centré sur une ligne du temps qui a pour effet non prémédité d’escamoter l’apport pluriel et ininterrompu des Autochtones à partir de l’arrivée des colons sur les territoires.
La recherche de cet équilibre entre prudence et action constitue une dynamique du travail patrimonial d’une institution allochtone en relation avec les PNMI, que ce soit à travers l’interprétation, les objets, les actrices et acteurs avec qui elle interagit. Myriam Clavir (2002) décrivait les impressions du personnel des musées de n’en faire jamais assez, et les frustrations des communautés de ne pas constater suffisamment de progrès de la part des musées allochtones quant à leurs représentations. Ainsi, comme la relation entre les musées et les Premiers Peuples est en constant changement, la recherche de cet équilibre évoluerait conséquemment pour atteindre une aisance, des façons d’exposer, d’interpréter et de collaborer qui vont davantage de soi.
Portrait d’un musée d’art régional
Créé en 1982 par un regroupement d’artistes et de passionné-es d’art engagés, dont Jacques Barbeau et Jeannine Blais, le MBAS est un acteur culturel majeur dans les Cantons-de-l’Est, situé en plein coeur de Nékitotegwak / Sherbrooke et occupant l’ancien bâtiment patrimonial de la Eastern Townships Bank depuis 1996. Sa mission est de préserver, faire découvrir et faire apprécier l’indéniable richesse artistique des beaux-arts du Québec et des Cantons-de-l’Est. Agréé depuis 2019, le MBAS compte une équipe permanente de 19 employé-es, deux membres à la direction et un conseil d’administration de neuf membres. Sa collection de beaux-arts au sens large (peinture, sculpture, poterie, photographie, estampe, installation, etc.) de plus de 5 200 pièces et représente environ 880 artistes. Le musée présente Couleurs Manifestes, son exposition permanente d’oeuvres historiques et contemporaines en dialogue avec la symbolique des couleurs ; deux expositions temporaires intérieures cycliques ; et une (parfois deux) hors les murs. Le MBAS assure l’éducation, la médiation et l’action culturelle auprès de groupes scolaires de la maternelle à l’université, et de groupes divers (francisation, communautaire, loisirs, etc.). Cela passe par des Ruches d’art(-thérapie), des visites et ateliers spécialisés et adaptés, des vidéos éducatives, ou des partenariats structurants (danse Axile).
La première acquisition d’une oeuvre autochtone au musée remonte à 1986 — une sculpture de stéatite de Lizzie Sheeg (nunavimiuq). La proportion d’art autochtone, majoritairement contemporain, totalise moins de 1 % des collections. Le souci de diffusion d’art autochtone en particulier remonte notamment à 2014 avec un prêt d’exposition itinérante d’estampes inuit par le Musée canadien de l’histoire[7].
Figure 1
Lizzie Sheeg, Sans titre, 1978, stéatite, 21 x 15,5 x 14,5 cm, don de madame Ghislaine Marleau, collection Musée des beaux-arts de Sherbrooke (1986.6).
Les initiatives de diffusion et de médiation
L’exposition étant un média central aux musées, on retrouve plusieurs instances de mise en valeur des arts autochtones en ce sens au MBAS à travers des expositions surtout temporaires. Si celle-ci est pensée en tant que « média qui transforme l’institution » (Meunier et al. 2012 : 10) et en tant que témoin des relations entre musées et Premiers Peuples (Franco 2019), s’y attarder et la développer semble tout indiqué.
Expositions clé en main d’artistes autochtones
Analysons la genèse du jumelage du MBAS à la Biennale d’art contemporain autochtone (BACA, quatrième édition, 2018), propulsée par Art Mûr, partenariat majeur qui se poursuit à ce jour. Ce choix découlait d’une part du partenariat préexistant avec la galerie, maintenu par l’ancienne conservatrice du musée et muséologue, Sarah Boucher. D’autre part, c’était l’occasion de nourrir un « apport que le MBAS avait moins », c’est-à-dire une façon de promouvoir l’art autochtone contemporain « pas assez mis en valeur, qu’on connaît peu », avec ceux « qui le font, et le font bien », car ayant déjà cette expérience à leur actif (entretien du 30 avril 2021). De ce fait, les co-commissaires d’origine crie Niki Little et Becca Taylor avaient organisé le contenu avec pour contenant le musée qui accueillait l’exposition. L’initiative était en adéquation avec le fait qu’en « 30 ans d’histoire, nous avons rarement traité d’art autochtone dans notre programmation, vous comprendrez alors notre enthousiasme à présenter dans notre Musée une exposition de ce type » (lettre de participation envoyée à Art Mûr, 17 janvier 2018). Cette proposition, bien accueillie en comité de programmation et qui s’est renouvelée aux éditions 2022 et 2024 de la Biennale, était à la fois une mise en valeur d’art contemporain autochtone et un projet « pertinent pour le public, notre institution, notre positionnement », un acte d’ouverture que souhaitait communiquer l’institution. Notons le contexte de positionnement du MBAS dans le réseau de l’art contemporain auquel a participé la conservatrice d’alors au cours de son mandat, ayant axé presque exclusivement les expositions temporaires autour de l’art contemporain plutôt que de l’art historique (avant 1945).
Dans l’exposition Nimidetníchiwamiskwém | nimidet | ma soeur | my sister, une diversité de médiums était proposée aux visiteurs, conformément à l’objectif de la BACA, qui est de mettre de l’avant la diversité des pratiques culturelles autochtones (MBAS 2018 : §1). Étaient présentées selon la thématique de la sororité de la photo, des textiles suspendus, le tambour en peau de cerf avec installation sonore au centre de la salle par Lita Fontaine (Anishinabe), des impressions futuristes sur cartes avec perles, la série de portraits photo en noir et blanc de Kali Spitzer (Kaska Dena) de femmes autochtones légèrement plus hautes et grandes que nature. La sixième édition de la BACA commissariée par Michael Patten (Zagime Anishinabek), Land Back, avec son volet de la nordicité au MBAS, a permis de concrétiser la proposition de notre conservatrice Frédérique Renaud de mettre en dialogue les quatre sculptures inuit en stéatite du XXe siècle des collections, avec celles prêtées par la Guilde, ainsi qu’avec les oeuvres d’artistes inuit contemporains (Seaman, Pottle, Gruben et Takpannie).
Figure 2
Exposition présentée au MBAS du 5 mai au 9 septembre 2018.
Figure 3
Exposition présentée au MBAS du 28 avril au 26 juin 2022.
Quoique la mise en place de ce partenariat fécond et durable apporte des pratiques artistiques diversifiées et multisensorielles au sein de l’organisation, le succès auprès des publics d’une part et la collaboration institutionnelle d’autre part était mesuré par Sarah Boucher comme étant similaire à celui des autres expositions. Cette pratique avec les artistes va de soi dans son travail culturel (entretien du 30 avril 2021). Clémence Barbeau, médiatrice et adjointe à l’éducation muséale au Musée, a constaté l’attrait prolongé des publics, une fois l’exposition passée — des visiteurs évoquaient celle-ci et demandaient si la Biennale reviendrait au MBAS[8] (entretien du 21 mai 2021). Par ailleurs, il faut souligner le défi que rencontre le musée d’arrimer son calendrier de production et de diffusion de l’exposition, avec ses échéanciers distincts, à ceux propres à la BACA, qui compte de nombreux partenaires (six ou sept) avec qui se coordonner, ne se limitant pas qu’au MBAS. Le souhait partagé de maintenir ce partenariat est prometteur.
Cet exemple démontre donc que la recherche et l’argumentaire développés pour l’inclusion à la programmation d’une exposition d’artistes autochtones, puis la réception et l’approbation du comité et du C.A. quant aux intérêts partagés à collaborer, sont autant d’étapes à franchir pour la concrétisation de ladite exposition. Le développement d’un réseau incluant des relations avec les PNMI est également significatif[9]. Il serait pertinent de mesurer l’impact de la réception des publics dans la chaîne décisionnelle menant à une concrétisation d’exposition d’art autochtone.
Oeuvres autochtones d’un corpus exposé
En ce qui a trait à l’inclusion d’une ou plusieurs oeuvres autochtones exposées au MBAS, je prends pour exemple deux oeuvres de Rita Letendre (Abénakise / Québécoise) : Le voyage d’Isis (1980), exposée dans la section « rouge » de l’exposition permanente Couleurs Manifestes, inaugurée à l’automne 2019, et Sheena (1974), installée dans un espace de circulation du musée depuis 2023. Ayant participé à la rédaction des vignettes ainsi qu’au montage de Couleurs Manifestes, incluant la rotation de la première oeuvre pour un prêt, je constate que l’étape de révision et la réception de celle-ci[10] sont significatives. Cette artiste phare de l’art abstrait au Québec et de l’art contemporain au Canada est positionnée non seulement en tant que Québécoise, mais également par son origine abénakise, selon ce que l’artiste partageait, surtout en fin de carrière[11]. Cette révision ancrait l’oeuvre d’abstraction géométrique, classée bien culturel, dans le territoire dont l’artiste est originaire (Drummondville, près des Cantons-de-l’Est et dans le Ndakina). On entend participer à une forme d’éducation ou d’incitation — certes minimale — à se renseigner quant aux Premières Nations à partir des noms des nations concernées sur le territoire, et à agir face à la sous-représentation autochtone en art contemporain (CAM 2018).
Figure 4
Lancement de l’espace famille dans Couleurs Manifestes. Rita Letendre, Le voyage d’Isis, 1980, acrylique sur toile, 106,7 x 182,9 cm, don de monsieur Jacques Letendre et de madame Monique Letendre, collection Musée des beaux-arts de Sherbrooke (2010.17.1).
En effet, exposer des oeuvres contemporaines autochtones a l'avantage de rappeler massivement et de façon tangible que ce sont des peuples vivants à la collectivité. Selon les participants autochtones ayant pris part à l’étude de Desmarais et Jérôme (2018 : 125) à propos de l’exposition permanente C’est notre histoire du MCQ, exposer cet art est un « facteur de valorisation des cultures autochtones en termes positifs et dynamiques ». On peut douter de l’impact d’une seule pièce autochtone dans un corpus donné. Chaque objet et les réflexions entourant sa mise en scène ont néanmoins le potentiel d’être des « vecteurs » de décolonisation en muséologie au sens d’Elisabeth Kaine et Laurent Jérôme (Kaine et Jérôme 2014). L’objet est effectivement le témoin de nombreuses « histoires de vie » et porte plusieurs voix, notamment lorsqu'il est suffisamment contextualisé (ibidem : 236), et il incarne une dimension relationnelle inhérente autant qu’il est polysémique.
Du point de vue de la muséologie sensorielle, les objets incarnent des façons de sentir (ways of sensing) qui leur sont spécifiques, et doivent de ce fait être approchés par la sensorialité, car ils sont dotés de biographies sensorielles et sociales au sens de Classen et Howes (2006 : 200) et Howes (2019). Par exemple, ce bâton de parole Coast Salish de Jim Yelton conservé au MBAS portera, au-delà de son esthétique visuelle évidente de forme totémique, toute la pratique culturelle diplomatique et l’humilité de savoir attendre son tour de parole (oralité) lors de cercles de parole à travers l’objet (toucher) symbolique. En outre, l’objet d’art autochtone opère une souveraineté visuelle en ce qu’il opère à la fois une réappropriation des représentations culturelles autochtones en même temps qu’un discours actuel qui expose et dépasse le regard occidental (visual imperialism) passé et présent sur les PNMI (Adese 2015 : 131-132).
Médiation, création et mise en valeur
En tant qu’éléments constitutifs de la mission des musées, la médiation culturelle et l’éducation témoignent d’initiatives de mise en valeur des arts autochtones. Cela est d’autant plus pertinent considérant le besoin de réformes en matière d’éducation aux réalités autochtones des générations actuelles et futures au Québec. Comme l’expliquent Meunier et Luckerhoff (2012 : 4), l’éducation dite non formelle a un avantage par rapport à l’éducation formelle dispensée au sein des institutions de l’enseignement. Elle choisit ses contenus et méthodes sans être contrainte par l’instruction officielle et la remise de diplômes.
Considérons au MBAS la trousse de création « À la manière de Norval Morrisseau… activité familiale (8 ans et +) », distribuée à l’hiver 2021 en 40 exemplaires. Cette trousse invitait à créer par étapes, et à partir de l’oeuvre aux collections Thunderbird Dialogue (1980), un animal nous représentant, accompagné d’une légende[12]. En utilisant une toile avec des marqueurs acryliques aux couleurs vives, on s’inspire de la technique et des sujets du maître artiste peintre à l’origine de l’école Woodland. Initiée par Catherine Sanfaçon Dubé, muséologue responsable de la médiation et de l’action culturelle au Musée, cette trousse est née du « réflexe » de chercher des oeuvres autochtones au sein de la collection. Le contexte pandémique qui a entrainé la fermeture des musées a également fait en sorte « qu’on a exporté l’activité en formule trousse », plutôt qu’amener les gens au Musée pour un atelier. Un décalage général en muséologie, tout comme un (r)éveil général à s’intéresser aux patrimoines autochtones sont des faits : « Cela pourrait prendre beaucoup plus de place », d’où son réflexe d’aller vers des oeuvres d’artistes autochtones, selon elle bien discrètes et « en filigrane » au Musée. En effet, il est plus difficile de développer un projet éducatif sans amorce, l’exposition étant le « meilleur véhicule » en ce sens (entretien du 8 mai 2021).
Figure 5
Trousse de création « À la manière de Norval Morrisseau… activité familiale (8 ans et +) ».
Dans l’élaboration de cette trousse, la muséologue explique qu’il fallait d’abord « choisir une oeuvre acquise dans un contexte légitime » en raison de la conjoncture, ainsi que du vécu de l’artiste par trop de fois plagié (entretien du 8 mai 2021). La « double sensibilité » est donc de mise. Une recherche dans les dossiers d’acquisition a permis de retracer l’achat directement à l’artiste pour composer la collection ICI Canada destinée à une vaste diffusion au pays, qui a ensuite été offerte à des musées régionaux stratégiques dont le MBAS. La trousse vulgarise les notions d’inspiration et de plagiat ; son sujet permet de sensibiliser à plusieurs degrés. Son élaboration impliquait également de jongler avec « la gymnastique de comprendre le droit d’auteur » en contexte éducatif, de vérifier les modalités de reproduction de l’oeuvre pour éviter de « tomber dans une craque », en collaboration avec le département de conservation. Les frais engendrés pour couvrir les coûts du matériel de la trousse ont généré des réflexions anxiogènes. Quelle serait l’interprétation potentielle des coûts liés à cette activité par un musée non autochtone, bien qu’il n’y ait pas eu de profit ni de portée commerciale à l’activité ? Un autre enjeu pour la muséologue était la façon dont l’activité serait rapportée sur les réseaux sociaux et lors d’une entrevue radio – un « stress sur comment les médias allaient traduire » ses propos. Le choix de mots justes s’avérait crucial. Catherine Sanfaçon Dubé souligne que ces considérations touchent toute l’équipe, jusqu’aux préposés à l’accueil, qui distribue les trousses de création (entretien du 8 mai 2021). Selon elle, que l’objectif du projet soit bien défini et rapporté est un élément clé en ce qui touche la mise en valeur des arts autochtones au Musée (idem).
La muséologue constate un intérêt du public : chaque trousse a trouvé preneur en quelques jours et il y a eu plusieurs remerciements pour le lien pertinent avec les programmes éducatifs scolaires. Une usagère Facebook a témoigné de l’expérience à la fois formatrice et créative pour sa famille qui s’est documentée à la BAnQ : « Ça nous a tous permis de découvrir un artiste, de parler de la Nation Ojibway, d’inspiration et de plagiat ». Jennifer Biddle (2016) prône l’importance de penser une histoire de l’art qui étudie et inclut le vocabulaire des arts autochtones avec la même intensité que celle dont a bénéficié la peinture de la Renaissance. Des actions éducatives et valorisantes sur le style Woodland de Morrisseau, lequel ne peut se limiter à être nommé le « Picasso du Nord », abondent, on l’espère, en ce sens.
La muséologue note que l’oeuvre ainsi mise en valeur « bouge », en plus d’être « accessible à voir ». Cette mise en valeur peut devenir « exponentielle ». Il y a du mouvement dans l’acte de faire voyager l’oeuvre via la trousse (entretien du 8 mai 2021), ainsi que dans l’acte de créer tactilement, physiquement en s’inspirant de la technique de l’artiste. La condition est de le réaliser dans un contexte non commercial, familial, et qui valorise l’artiste et sa pratique, afin d’éviter une forme d’appropriation. Odile Joanette (Innue) décrit d’ailleurs les départements d’éducation dans les musées comme la porte d’entrée pour des initiatives d’autochtonisation, mais que le souhait demeure « d’aller à l’étage » (avoir davantage d’expositions), ainsi que d’avoir plus d’Autochtones parmi le personnel des musées (McCord et Wapikoni mobile : 2020).
Occasions ponctuelles
Des gestes de mise en valeur passent enfin par des occasions de diffusion et de médiation qui viennent cette fois de l’initiative d’acteurs externes, abordant explicitement la thématique d’art autochtone ou alors facilitant cette dernière. De façon directe, cela se présentait par exemple par la requête de données d’un historien de l’art élaborant avec l’Université de Sherbrooke une application sur l’art autochtone dans la région ; ou la demande de prêt d’oeuvres de Rita Letendre pour l’exposition itinérante rétrospective initiée par le Musée du Bas-Saint-Laurent, transitant par le MBAS en 2022. Le mouvement de l’art sur le territoire et sur le réseau numérique peut de ce fait atteindre des audiences qui n’y auraient autrement pas eu accès.
De façon indirecte, cela se présentait par des entrevues et vidéos à thématique coup de coeur des collections. Encore, lors de visites spéciales des réserves du Musée[13], que ce soit auprès de groupes spécialisés, de journalistes, de collaborateurs à la médiation ou de nouveaux membres du personnel — l’idéal serait de recevoir également des Autochtones qui souhaiteraient bénéficier de ces visites —, certaines pièces peuvent être mises en valeur par le département de la conservation, surtout si elles sont aisément accessibles en réserve. Les publications web se retrouvent aussi dans cette catégorie, le MBAS ayant dû redéfinir ses lignes directrices quant au traitement des oeuvres en relation au droit d’auteur pour les différents types d’utilisation et considère la notion de propriété collective, lorsqu’applicable (voir Bell, Lai et Skorodenski 2014 sur l’opposition des visions individualistes et collectivistes du droit d’auteur), ainsi que l’historique d’acquisition de l’oeuvre. Ce type de mise en valeur incarne la tension entre prudence et action quant au rôle de diffuseur de l’institution culturelle. Celle-ci a pour mandat de faire rayonner divers artistes dans l’espace public, tout en ayant la responsabilité d’appliquer les bonnes pratiques de reproduction, ce qui demande des ressources financières et temporelles, comparativement à ce qui relève du domaine public ou de l’utilisation équitable.
Néanmoins, cette mise en valeur indirecte relève plutôt du réflexe développé à l’interne de mettre en valeur des artistes autochtones et demeure limitée selon l’audience qui y est destinée, à défaut d’avoir des membres autochtones du personnel et du conseil d’administration qui incarnent cette inclusion. On voit au prochain ensemble analysé l’importance relationnelle sur le territoire.
Les initiatives de culture organisationnelle
Reconnaissance territoriale
En effet, à la suite de l’approbation des propositions en comité de conservation à l’été 2020, j’ai proposé un énoncé de reconnaissance territoriale préliminaire au Musée des Abénakis, afin d’obtenir révision et validation avant qu'il soit déposé au conseil d’administration du musée. En tant que partenaire déjà existant du MBAS, que musée autochtone pionnier au Québec, qu’ambassadeur de la nation concernée par notre énoncé, et que levier culturel utilisé par les communautés autochtones pour influencer la mise en place de bonnes pratiques à l’échelle nationale (Franco 2019 : 36), ce musée était sans conteste l’acteur le mieux placé pour ce travail. Il s’agissait d’une étape de plus pour nourrir ce partenariat. Comme d’autres institutions de la mémoire et de l’éducation ayant franchi ce premier pas, le MBAS bénéficie d’un énoncé révisé au moment d’écrire ces lignes, qui va comme suit, disponible en ligne avec ses énoncés de positionnement et sa mission : « Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke reconnaît être situé sur le territoire ancestral de la Nation W8banaki, le Ndakina, avec la gratitude de cohabiter et de valoriser l'art sur ce territoire ». Nous avons en outre reçu ces mots de formule d’usage en abénaki, et qui ont une portée solidaire prometteuse avec la communauté : K'wlipaï8ba W8banakiak wdakiw8k (traduction littérale : « Vous êtes bienvenus /Abénakis [au pluriel] /sur leur territoire »).
Cet énoncé peut se décliner de diverses façons afin de positionner publiquement le MBAS comme solidaire de la Première Nation avec qui il partage le territoire, et de participer à son rôle éducatif ayant un poids socioculturel. Il dit qu’une réalité géographique et culturelle n’en occulte pas une autre, mais la côtoie. Inclure l’énoncé dans les signatures courriel, sur le site internet de l’organisation, dans la politique de gestion des collections, ou optimalement sur une plaque ou un élément architectural du site environnant le bâtiment sont plusieurs avenues possibles (Favrholdt 2020 : 53-54). À l’heure actuelle, les trois premières avenues sont pratiquées au musée, mais celui-ci gagnerait à appliquer la dernière. Directement situé face à la Rue des Abénaquis au centre-ville, le bâtiment est tout près du croisement des rivières Alsigontegw / Saint-François et Pskasewantekw / Magog, dit « Grandes Fourches » ou Nékitotegwak, lieu historique de rassemblement, de pêche et de repos des Abénakis. L’officialisation d’un énoncé promet donc une résonance décuplée auprès des publics, des non-publics, du personnel et du réseau muséal et culturel du fait de cet emplacement géographique. Leur sens de l’emplacement (proprioception) est en outre rendu explicite, voire changé. Kari Norgaard (2020) définit l’importance des énoncés de reconnaissance territoriale en tant que connexion avec ce que l’on ne voit pas toujours, avec des relations « invisibles ».
Notons la prépondérance des lieux et territoires dans la définition identitaire de nombreux Premiers Peuples, une identité contraire à celle des immigrants issus d’un autre territoire (Alfred et Corntassel 2005), souvent confondue parmi la « diversité ». Reconnaître explicitement le territoire en tant qu’organisation — l’étymologie d’« institution » en soi pose son lot de questions, avec son caractère systémique et de réglementation — qu’elle soit régionale ou internationale, et d’autant plus qu'elle est située dans les Amériques colonisées, devient possiblement un acte de rencontre, selon la relation établie entre les parties. « We suggest that the emerging vision of shared, collaborative power is […] a geography of crossing paths, marking points of convergence between equals, always already inextricable » (Horton et Berlo 2013 : 28). L’art contemporain autochtone dans ce contexte se présente comme un terrain de rencontre (meeting ground). En outre, la mission du musée est historiquement et littéralement ancrée dans le territoire. Auparavant axée sur les artistes, collectionneurs et représentations des Cantons-de-l’Est, avec un volet international, la récente mouture de la mission garde central l’aspect régional (voir plus haut) qu’elle peut plus fidèlement et réalistement représenter. Les Cantons signifient et concernent aussi le Ndakina en tant que l’un des nombreux territoires ancestraux chevauchés par les frontières des provinces canadiennes. Les musées ont d’ailleurs cette visée représentative et inclusive pour rejoindre leurs publics depuis l’avènement du mouvement de musée forum lancé par Cameron, des visitor studies et du musée tourné vers les publics depuis les années 1980 (Meunier et al. 2012).
Sensibilisation des équipes et visiteurs
Assurant le premier contact avec les publics, l’équipe d’accueil du MBAS a développé un « Guide du visiteur » préventif dédié au personnel, participant de cette sensibilisation organisationnelle. Certaines méthodes y sont consignées afin de détourner ou de répondre à des commentaires à teneur raciste, sexiste, etc., et qui au même moment reflètent la posture qu’adopte l’institution, selon Catherine Sanfaçon Dubé. Participant à cette initiative, Clémence Barbeau ajoute que le Guide montre « comment le musée veut qu’on réagisse par rapport à ça […] le musée doit se positionner » (entretien du 21 mai 2021). Elle explique que cet outil est né de plusieurs propos racistes de gens visitant l’exposition d’une artiste sino-canadienne, au début de la pandémie de COVID-19, dont les premiers cas ont été répertoriés en Chine. La sensibilisation organisationnelle est nécessaire, car « ne pas agir parle » aussi (idem).
En somme, selon le conservateur Jonathan Lainey (Wendat), le processus d’autochtonisation des institutions touche tous les membres d’une équipe, tous ont à y penser et y travailler (McCord et Wapikoni mobile 2020). De même, Clémence Barbeau souligne la pertinence d’avoir un conseil d’administration outillé de connaissances en la matière. Catherine Sanfaçon Dubé définit comme « intersectorielle », voire « transectorielle » une mise en valeur des arts autochtones réussie dans un musée (entretien du 8 mai 2021). Elle envisage la muséologie collaborative dans les prochaines années en tant que processus complet — de l’acquisition à l’exposition à l’action culturelle — qui ne concerne plus simplement quelques objets isolés mais est « imbriqué », « plus diffus » dans les pratiques muséales courantes. La muséologue espère que le musée mette sur pied un comité de consultation auprès des Abénakis, et propose la sensibilisation individuelle, ainsi que des mises à jour entre collègues, ce processus de responsabilisation étant en « symbiose » (idem.). Clémence Barbeau envisage les institutions muséales comme « une belle place pour créer des espaces de discussion » tournant autour des causes autochtones. L’art a servi à beaucoup de luttes. Il a ce potentiel lorsqu’il arrive à créer un réseau de partage à l’intérieur comme à l’extérieur des murs. Tout musée à teneur artistique peut donner « une place aux artistes autochtones » (entretien du 2 mai 2021). De façon similaire, une exposition avec des contenus autochtones à caractère historique ou ethnologique se doit d’aborder les moments difficiles pour atteindre une guérison et participer à la décolonisation, selon les historiennes de l’art Heather Igloliorte (Inuk), Carla Taunton et Amy Lonetree (Ho-Chunk) (Lonetree 2012 : 166, citées dans Desmarais et Jérôme 2018 : 126-127 ; Sinclair 2012 : 31).
Les initiatives en gestion des collections
Trois processus de gestion des collections de tout musée sont pertinents à l’analyse, soit le catalogage et la normalisation, l’aliénation, et la révision de la politique de gestion des collections. Des initiatives de mise en valeur des arts autochtones passent entre autres par la documentation et la normalisation des fiches d’objets au système de gestion de collection, dont les données sont couramment partagées pour divers projets du Musée ou de partenaires. Par exemple, les sculptures en stéatite du Nunavik conservées au MBAS, auparavant qualifiées à tort d’art canadien sous le champ « discipline » (destiné à un autre usage) et d’Inuit sous le champ « culture », afficheront « inuk, nunavimiuq » sous ce dernier. Au champ « contexte culturel », une mention du mouvement communautaire et artistique des coopératives inuites à partir des années 1960 contextualise à présent ces pièces dans leur histoire. Je parle de révision minimale, dans la mesure où ma position n’est pas celle d’un-e expert-e de la culture en question qui pourrait détailler ces fiches à leur meilleur. Elle permet cependant de raffiner les informations sur un groupe culturel très vaste, ou de combler un champ vide qui peut contenir de l’information pertinente à la recherche, la diffusion et l’éducation.
Un décloisonnement des champs s’avère souhaitable, puisqu'ils sont surtout pensés en fonction de la nomenclature d’institutions occidentales et euro-canadiennes. Les champs et listes d’autorité n’incluent pas toujours des termes en concordance avec le patrimoine autochtone pourtant présent dans de nombreuses collections, pensé et vécu comme un tout difficilement divisible. En effet, le langage normalisé des qualités visuelles et esthétiques dans l’exercice de catalogage des pièces est très développé. De même, l’univers muséal priorise grandement le sens de la vue, dérivant des sociétés occidentales ayant mis en place ce type d’institution comme l’ont détaillé Constance Classen et David Howes avec la notion d’hégémonie visuelle (Classen et Howes 2006). La modification du paramétrage d’un système de gestion des collections et la création ou la révision de listes d’autorité spécifiques demeure entretemps possible par le personnel des départements de conservation de musées. L’équipe temporaire du MBAS dédiée au projet de migration des données en 2022-2023 vers un nouveau système de gestion des collections en a profité pour créer, parmi les listes d’autorité entièrement révisées, des listes ouvertes à partir de sources numériques autochtones : ethnonymes, territoires ancestraux correspondants, école / style et toponymes concernés par les champs des lieux d’origine des objets. Le nouveau système renforce ainsi le réflexe des catalogueurs-ses à considérer les réalités autochtones.
Figure 6
Liste d’autorité ouverte au système de gestion de collections pour les champs de lieux d’origine, d’utilisation, secteur géoculturel et territoire ancestral correspondant.
Un échange avec le Musée des Abénakis, que nous avions approché afin d’entrer en contact avec des spécialistes d’un patrimoine autochtone en particulier afin de cataloguer des objets de façon optimale, nous a appris qu’il peut y avoir des dérivés à l’aliénation systématique d’objets, à moins qu’ils ne fassent l’objet d’une demande de rapatriement ou qu’une organisation prenne l’initiative de restituer les biens culturels d’une communauté. Il ne faut toutefois pas négliger la guérison inhérente au rapatriement. Une étape pertinente est d’informer d’abord les institutions patrimoniales de la nation concernée quant à la présence d’objets de leur patrimoine dans les collections, et de travailler ensemble à leur catalogage. De ce fait, les personnes concernées retracent désormais où elles peuvent emprunter, visiter, être en contact avec ces biens culturels, et co-gérer leur patrimoine. Le code de déontologie de l’ICOM préconise par ailleurs la collaboration étroite des musées avec les communautés dont provient une collection donnée. De même, les propos de Vernier (2016) et la discussion de Gadoua (2014) sur le toucher des artefacts comme générateur de signification abordent la réappropriation de ce patrimoine par la gestion partagée et l’autogestion des collections concernées. Ce processus et cette responsabilité de co-catalogage est amorcé au MBAS, mais le temps hebdomadaire (crucial) dédié au catalogage et à la documentation dépend des autres livrables inhérents au département de conservation.
Ensuite, il survient l’enjeu d’espace restreint en raison du collectionnement au fil des années, et par conséquent le besoin de réaménager ses espaces de façon sécuritaire et/ou d’amorcer un processus d’aliénation. Celui-ci permettra aussi la conservation de certaines pièces dans une autre institution mieux habilitée pour ce faire, pour des pièces issues de cultures autochtones, soit très peu documentées, visées par des demandes de rapatriement, ou dont la provenance et la légitimité dans les collections sont floues ou carrément douteuses. Le Code de déontologie de l’ICOM réfère non seulement à des informations qui doivent être « fondées, exactes, et prennent en considération les croyances et groupes représentés » tout comme « éviter de présenter ou d’exploiter les pièces sans origine ou provenance attestée » (ICOM 2017 : 25-26). Le MBAS a donc amorcé un exercice d’analyse de collection en 2021 et aliéné en 2023 un corpus de trente oeuvres d’art africain acquises vers 1999 (selon l’un des axes de collectionnement d’alors), au profit de l’Afromusée dédié aux communautés afro-descendantes et africaines, qui agrandit ses collections. Même si les collections comptent peu d’oeuvres autochtones, l’exercice demeure pertinent à titre préventif et éducatif pour l’équipe qui s’occupe de ce patrimoine. En effet, comme l’explicite Vernier (2016 : 14), il y a pour de nombreux Autochtones un besoin de reconnexion avec la culture ancestrale et l’assurance d’une vitalité culturelle par des initiatives « où le passé est au service du présent ». Outre la guérison, la restitution signifie la possibilité pour plusieurs communautés de créer leurs propres organismes patrimoniaux, ainsi que des occasions de dialogue entre collectivités selon l’auteur (voir aussi Cobb 2005, ainsi que Lonetree et Cobb 2008).
Enfin, plusieurs éléments d’une politique de gestion des collections concernent les arts autochtones : portée géographique de collectionnement, procédure de documentation d’une pièce et de sa provenance dans le contexte d’une acquisition, droit d’auteur et de propriété collective, etc. Le sondage du programme de réconciliation de l’Association des musées canadiens (AMC) révélait que pour 243 institutions, 212 n’avaient pas de mesures en place dans leurs politiques, non par volonté mais par méconnaissance de ces enjeux touchant leurs collections (AMC 2020 : 17). Lors d’une réunion en comité de conservation, j’ai émis des propositions de révision suivant les recommandations d’instances muséales et autochtones. Celles-ci figurent à la politique révisée en 2024, entérinée par le conseil d’administration. Ainsi, le momentum de révision d’une politique permet l’inclusion de lignes directrices à jour à la condition que le personnel concerné ainsi que l’administration de l’institution y soient sensibles, ou déjà habitués.
Dernières touches : discussion et conclusion
À la lumière de ces réflexions, la mise en valeur des arts autochtones au musée se révèle synonyme de nombreuses occasions. Elle semble relever à l’heure actuelle, dans le cas d’un petit ou moyen organisme, des initiatives personnelles tout comme des démarches d’implantation d’une culture organisationnelle qui souhaite soutenir les causes autochtones. Cela s’inscrit dans un contexte de continuité du processus de décolonisation inévitable mais encore lent, qui structurera les pratiques muséales à grande échelle, au-delà des initiatives isolées. On pense au Québec à des directives claires de la Société des Musées du Québec et de l’AMC destinées aux musées allochtones, qui feraient par exemple partie de l’agrément et faciliteraient l’embauche de personnel et d’administration autochtone. On dénombre entretemps plusieurs facteurs facilitants de mise en valeur, soit les contacts et le réseautage ; le savoir et la formation ; la révision ; l’amorce éducative ; l’agentivité des artistes ; la vigilance, la sensibilisation et la sensibilité des équipes et administrateurs en dialogue ; etc.
On pourrait également évoquer d’autres occasions à portée variable, telles que la formation continue du personnel de musées allochtones sur la muséologie collaborative favorisée par une culture organisationnelle donnée ; la préparation de planifications stratégiques par la consultation de son équipe (la mouture 2024-2025 du MBAS prévoit une quantité d’actions à son objectif « s’ancrer dans la communauté », au point B.2.4., de « Développer et consolider des partenariats avec des diffuseurs autochtones en arts visuels ») ; ou encore les expositions allochtones vectrices de valorisation grâce à l’agentivité de certains artistes allochtones à utiliser leur voix, leur privilège et leur pratique artistique pour mettre en valeur des réalités autochtones. L’historique du musée fait état de plusieurs instances d’artistes ou commissaires allochtones abordant des réalités autochtones, mais il s’agit d’un modèle avec ses écueils abondamment traités dans la littérature.
Élise Dubuc détaille le rôle actuel multifonctions des musées en tant que passeurs plutôt que producteurs de savoir. Leur fonction sociale peut servir à l’entente entre peuples, l’inclusion de groupes marginalisés, rappelant les principes de la rencontre de Santiago de 1973 du « musée intégral » et du « musée comme action » (Meunier et al. 2012 : 158). Ensuite, leur fonction politique a tant contribué à la formation des identités nationales qu’elle peut aujourd’hui mettre en scène les jeux de pouvoir sur la scène internationale, et contribuer au rapatriement de biens culturels. La Commission de vérité et réconciliation du Canada atteste en outre que « les musées ont la responsabilité éthique de favoriser la réconciliation nationale » (CVR 2015 : 271).
Par ailleurs, il est à se demander si, à l’échelle régionale, une institution muséale de plus petite envergure a une influence ou une préséance de pratiques similaire à celle du Musée de la civilisation analysée dans la littérature. Doit-elle plutôt négocier cette préséance avec d’autres acteurs, s’adapter nécessairement dans un contexte de décolonisation rapidement changeant ? L’idée du musée « condamné à plaire » aux publics (Meunier et al. 2012 : 8) serait finalement bénéfique en ce qui a trait aux relations entre Autochtones et non-Autochtones au Québec ! L’équilibre prudence/action dans les musées quant à la mise en valeur d’arts autochtones fait écho à ces propos et témoigne du présent contexte sociohistorique. Rester sur ce sentier en relation avec les Autochtones jusqu’à ce que la confiance soit davantage rétablie est une voie logique. En outre, pour l’ethnologue Isabelle Picard (Wendat) (Picard 2018), l’oeuvre sera toujours le témoin, l’ethnographie de l’art d’une époque.
Si le domaine des arts visuels et les musées favorisent généralement des scénographies, un catalogage et une interprétation esthétique des oeuvres axées sur le sens de la vue, il n’en demeure pas moins que les publics influencent grandement la culture organisationnelle. Les visiteurs-euses ne veulent pas seulement procéder de l’information visuelle. Ils cherchent à établir une forme de connexion avec les pièces et leurs créateurs, et souhaitent se sentir physiquement liés, « ˝in touch˝ ˗ with other peoples and worlds through their material effects » (Classen, Howes 2006 : 217). La multisensorialité des arts autochtones ainsi que la tendance immersive en exposition sont prometteuses, couplées à la volonté et l’intérêt des équipes en place.
En abordant la collaboration entre musées et Premiers Peuples présentement et d’ici quelques années, Sarah Boucher détaille la conjoncture dans laquelle il y a « du travail encore à faire, de l’ajustement […] il y a une recherche d’équilibre » (entretien du 30 avril 2021). Elle considère qu’au sein de ce contexte, il y a la trappe réductionniste qui pourrait mener à la diffusion d’artistes autochtones non pour ce qu’ils font d’exceptionnel, mais du fait unique de leur nationalité. Quoi qu’il en soit, l’objectif serait que « ce soit aussi naturel qu’autre chose » (ibid.) d’exposer des oeuvres d’artistes autochtones, au même titre qu’il n’est plus surprenant d’exposer le travail d’artistes femmes, alors que cela était sujet à débats houleux vers la moitié du siècle dernier. En effet, les conservateurs ont pour rôle d’intégrer l’art autochtone, non de l’isoler en tant que tel, au sein de l’évolution de l’histoire de l’art (Nicastro 2020 : §13). Pour la muséologue, à ce stade des collaborations, la responsabilité est d’« apprendre à se connaître, à se respecter puis à travailler ensemble » (Boucher, entretien du 30 avril 2021). Et fort heureusement, l’oeuvre d’art est un catalyseur sur tous les fronts.
Parties annexes
Remerciements
Merci à l’équipe passée et présente du MBAS pour la concrétisation de cet article, aux artistes qui nourrissent sans relâche la réflexion et l’autoréflexion, et au soutien de David Howes du Centre for Sensory Studies de l’Université Concordia avec le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSHC).
Note biographique
Gabrielle Desgagné est originaire, vit et travaille à Nikitotegwak/Sherbrooke. Cumulant un parcours multidisciplinaire en animation et recherche culturelles (profil muséologie) (B.A., UQÀM et St. Thomas University, NB) et sociologie (M.A., Université Concordia), elle participe au dialogue sur la mise en valeur muséale des patrimoines autochtones, la muséologie collaborative et sensorielle, et la sociologie de l’art. Oeuvrant dans le milieu muséal depuis 2011, elle coordonne la collection au Musée des beaux-arts de Sherbrooke en contribuant à la gestion de la collection et aux expositions. Elle est Junior Fellow au Centre for Sensory Studies de l’Université Concordia depuis 2019. Elle est aussi une mère, une street skateboarder depuis l’âge de 11 ans, et une amoureuse du mouvement. Chaque planche qu’elle peint à l’acrylique incarne, par sa mémoire incorporée et son vécu « skaté » impliquant des altérations uniques, un état d’être ou d’apprentissage représenté par une créature ludique.
Notes
-
[1]
Il s’agit du territoire ancestral abénaki, qui inclut à ce jour les Cantons-de-l’Est et va de la rivière Richelieu (Masesoliantekw) jusqu’au Lac Champlain (Bitawbagok) à l’ouest, jusqu'au fleuve Saint-Laurent et à la Rivière-du-Loup au nord, jusque dans le Maine à l’est, et jusqu'à Boston au sud (Bastonki) (Wiseman 2001).
-
[2]
À l’échelle nationale, des événements clés sont l’autoreprésentation des Premières Nations avec le Pavillon des Indiens [sic] de l’Expo 67 à Montréal (Moses 2017) ; le rapatriement en 1986 du Starlight Bundle au peuple Sarcee, à l’initiative du Musée des Civilisations (Battiste et Henderson 2000) ; le soutien médiatisé aux Cree de Lubicon Lake avec l’exposition peu représentative de leur héritage The Spirit Sings au Glenbow Museum qui mena au rapport du groupe de travail pancanadien sur les musées et les Premières Nations, Tourner la page (Task Force 1992 / 1994) ; et, plus récemment, la mise en oeuvre des appels à action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015). Mentionnons les idéaux de muséologie collaborative en relation avec les communautés autochtones concernées et les processus de décolonisation et d’autochtonisation des musées, ou encore l’augmentation de la représentation autochtone au sein de la gouvernance des musées. Notons que tout ce progrès n’aurait pas vu le jour sans les revendications des communautés autochtones depuis plus de cinq décennies (Dubuc 2006 ; Desmarais et Jérôme 2018 ; Franco 2019).
-
[3]
Le mandat de la conservatrice adjointe est de prendre part à la gestion de la collection et à son rayonnement (prise en charge de la base de données, entretien, prêts, restaurations, réorganisation des réserves, initiatives numériques, etc.), ainsi que d’aider au montage et démontage d’expositions, en collaboration étroite avec la conservatrice et la technicienne en muséologie formant le département de conservation.
-
[4]
Dans ce texte, on privilégie le nom de la nation concernée lorsqu’il y a lieu, tout en identifiant la nationalité d’un-e auteur-trice qui s’identifie comme tel. D’ailleurs, de façon ponctuelle, les termes Premières Nations, Métis et Inuit (PNMI) ou Autochtones désignent les gens issus des Premiers Peuples sur l’île de la Tortue.
Ensuite, cette multisensorialité évoquée se présente notamment à travers les visions du monde autochtones, lesquelles sont holistiques, et où, comme le détaillent Ritenburg, Kovach et al., ou encore tout le travail de Margaret Kovach (Cree / Saulteaux) à propos des méthodologies autochtones, il y a le savoir incorporé (embodied knowledge) (Ritenburg et al. 2014). L’incarnation fait que le corps expérimente à la fois la vie dans le monde et devient un contexte pour connaître le monde (ibidem : 69). En outre, dans un contexte autochtone, le savoir incorporé implique la dimension supplémentaire d’être un savoir de résistance au colonialisme (ibidem : 70).
-
[5]
À la négociation des communautés avec les États pour leur continuité identitaire et pour la gestion territoriale, s’ajoute le mouvement de globalisation tendant à gommer la diversité culturelle et linguistique (voir Alfred et Corntassel 2005 et Adese 2015 sur la circulation accélérée d’imagerie stéréotypée de « l’indianité » avec la globalisation).
-
[6]
Michael Ames affirmait déjà ces limites institutionnelles au tournant du siècle (Ames 2000). Au MCQ, les rencontres de conception de l’exposition ont établi que la sensorialité devait être au coeur de l’expérience des visiteurs, mais cela est demeuré limité (Blanchard et Howes 2014) et le régime sensoriel du musée a eu préséance (Blanchard et Howes 2019). Laurence Desmarais et Laurent Jérôme notent le déséquilibre de pouvoir ayant perduré avec la prise de décision trop peu explicitée au début du projet, ultimement portée par l’équipe permanente de l’institution (Desmarais et Jérôme 2018 : 121). Notons toutefois que la dynamique d’un musée d’histoire (national) peut être nuancée avec celle d’un musée d’art (régional).
-
[7]
« La présentation de l'exposition “ESTAMPES INUITES…” permettra une incursion dans le monde fascinant de l'art autochtone, ce qui n'a encore jamais été fait au Musée des beaux-arts de Sherbrooke. Pour les visiteurs du Musée, autant francophones qu'anglophones, cela constitue une opportunité unique d'admirer et d'apprécier le travail d'artistes qui sont malheureusement encore peu connus au sud de l'Arctique canadien » (extrait autorisé de la demande de subvention au Programme d’aide aux musées de Patrimoine canadien, 2014). Avant cela, on peut davantage parler d’une diffusion au fil des dons de divers collectionneurs de la région acquérant de l’art autochtone.
-
[8]
Pour l’édition 2022, un bon achalandage et intérêt de la part des publics a été constaté lors de cette période d’exposition, de même que des publics venant moins régulièrement au MBAS, dont des familles autochtones.
-
[9]
Pensons aussi à Teiakwanahstahsontéhrha / Nous tendons les perches par Skawennati (Kanien’kehà:ka), mise en circulation par VOX Centre de l’image contemporaine en 2018, et qui a transité par le MBAS à l’automne 2023. Lors de la recherche de programmation, la conservatrice avait rejoint VOX qui proposait une banque d’expositions itinérantes intéressante. Celle de Skawennati correspondait bien, car 1) l’exposition « tourne autour de la médiation plutôt que l’objet » et l’expérience participative est un atout en complémentarité avec le reste de la programmation en cours ; 2) le groupe d’âge ciblé, soit les jeunes et les adolescents, rejoint les publics que le MBAS souhaite et a intérêt à développer ; 3) l’exposition est numérique, un volet généralement moins exposé au MBAS ; 4) « c’est un tout », quelque chose de nouveau que le MBAS ne produit pas à l’interne, et considéré comme « plus intéressant si l’artiste parle de son origine » que si l’institution le fait (entretien du 30 avril 2021). Le procès-verbal du comité de programmation fait état du « Format clé en main / Budget adéquat / Cohérent avec la Politique d’Éducation du MBAS — public cible enfant / famille / Projet “inclusif” — art autochtone » (26 juin 2019).
-
[10]
De façon similaire, la révision et la rédaction étaient cruciales pour apporter des précisions quant au corpus général d’un artiste québécois grandement inspiré par les cultures et valeurs des Premiers Peuples, soit Jean Paul Riopelle avec Dégâts d’oies (1985) représentant son animal emblématique. On a ajouté à sa vignette : « Selon l'écrivain et commissaire wendat Guy Sioui Durand, Riopelle réalise l'éthique autochtone autant par sa démarche artistique que la relation profonde qu'il a développée avec le territoire nordique et plusieurs de ses premiers habitants ». La justification, l’exactitude et la pertinence des propos par rapport à une oeuvre donnée, ainsi que la réception positive à ces révisions par le commissariat ou toute autre personne approuvant les textes finaux demeurent des éléments clés de leur application tangible.
-
[11]
Rendre explicite cette origine reconnaît une identité éclipsée et méconnue dans les discours courants du milieu à propos de l’artiste, tout comme dans le vécu de l’artiste née en 1928, dans un contexte discriminatoire où l’on cachait qu’on avait de la « famille indienne » au Québec.
-
[12]
En rétrospective, s’inspirer d’un animal présent dans la culture Ojibway plutôt qu’un animal représentant la personne faisant l’activité est davantage au diapason avec l’artiste et le concept. Cela a été ajusté en conséquence à la suite d’échanges externes et internes au MBAS.
-
[13]
Il y a ce sentiment de privilège et d’humilité des gens qui entrent en réserve, autrement peu accessible au grand public. À ce sentiment s’ajoute la proximité physique avec de nombreuses oeuvres, qui génère un respect tout en retenue de peur d’accrocher quelque pièce, ou devant l’abondance d’oeuvres exceptionnelles toutes réunies entre ses murs — on se déplace différemment dans une réserve que dans l’espace public, même en tant que personnel d’une institution muséale. Cela rejoint l’idée de Battiste et Henderson (2000 : 156) qui établissent que les collections et expositions muséales ont la responsabilité de renforcer le respect envers ces cultures du fait de leur pouvoir sur la perception des publics, dans le contexte de protection du savoir traditionnel.
Bibliographie
- ADESE, Jennifer, 2015, « Behaving unexpectedly in expected places. First Nations artists and the embodiment of visual sovereignty », in Elaine Coburn, More Will Sing Their Way to Freedom: Indigenous Resistance and Resurgence (pp. 129-147), Winnipeg : Fernwood Publishing.
- ALFRED, Taiaiake and Jeff CORNTASSEL, 2005, « Being indigenous: Resurgences against contemporary colonialism », Government and Opposition, 40(4) : 597-614.
- AMES, Michael M., 2000, « Are changing Representations of First Peoples in Canadian Museums and Galleries challenging the Curatorial Prerogative? », in Richard West, The Changing Presentation of the American Indian (pp. 73-88), Seattle : University of Washington Press.
- Association des musées canadiens, 2020, « National Survey results. CMA’s Reconciliation Program », Muse, été 2020 : 14-25.
- BATTISTE, Marie A. and James Y. HENDERSON, 2000, Protecting Indigenous Knowledge and Heritage: A Global Challenge, Saskatoon : Purich.
- BELL, Catherine E., LAI, Jessica C. et Laura K. SKORODENSKI, 2014, « Lois autochtones, loi sur la propriété intellectuelle et politiques muséales. Des diverses méthodes de protection du patrimoine immatériel autochtone. », Anthropologie et Sociétés, 38(3) : 25-59.
- BIDDLE, Jennifer L., 2016, Remote avant-garde: Aboriginal art under occupation, Durham : Duke University Press.
- BLANCHARD, Marie-Josée et David HOWES, 2014, « Se sentir chez soi au musée : tentatives de fusion des sensoria dans les musées de société », Anthropologie et Sociétés, 38(3) : 253-270.
- BLANCHARD, Marie-Josée et David HOWES, 2019, « Les sens assoupis : La vie sociale et sensorielle des artefacts dans l’espace muséal », Anthropologica, 61(2) : 322-333.
- BOXER, Majel, 2016, « ‘2,229’: John Joseph Mathews, the Osage Tribal Museum, and the Emergence of an Indigenous Museum Model. », Wicazo Sa Review, 31(2) : 69-93.
- CLASSEN, Constance and David HOWES, 2006, « The Museum as Sensescape: Western Sensibilities and Indigenous Artifacts », in Ruth B. Phillips, Chris Gosden and Elizabeth Edwards, Sensible Objects: Colonialism, Museums and Material Culture (pp. 199-222), Oxford : Berg Publishers.
- CLAVIR, Miriam, 2002, Preserving what is valued: Museums, Conservation, and First Nations, Vancouver : UBC Press.
- CLIFFORD, James, 2004, « Looking Several Ways: Anthropology and Native Heritage in Alaska. », Current Anthropology, 45(1) : 5-30.
- COBB, Amanda J, 2005, « The National Museum of the American Indian as Cultural Sovereignty. », American Quarterly, 57(2) : 485-502.
- Conseil international des musées, 2017, Code de déontologie de l’ICOM pour les musées, Paris : ICOM.
- Conseil des arts de Montréal, 2018, Journée de réflexion et dévoilement de l’étude « Pratiques professionnelles en arts visuels issues de l’autochtonie et de la diversité à Montréal », Montréal : Conseil des Arts de Montréal.
- DESMARAIS-TREMBLAY, Laurence, 2016, L'histoire de qui ? Une analyse critique des rapports entre les autochtones et le Musée de la Civilisation à Québec dans le cadre de l'élaboration de l'exposition C'est notre histoire : Premières Nations et Inuits du XXIe siècle (Mémoire de maîtrise), Université du Québec à Montréal.
- DESMARAIS, Laurence et Laurent JÉRÔME, 2018, « Voix autochtones au Musée de la civilisation de Québec. Les défis de la muséologie collaborative », Recherches amérindiennes au Québec, 48(1-2) : 121-131.
- DUBUC, Élise, 2006, « La nouvelle muséologie autochtone. », Muse, novembre 2006 : 28-33.
- FAVRHOLDT, Kenneth, 2020, « Déclarations de reconnaissance : une première étape vers la réconciliation », Muse, hiver 2020 : 52-59.
- FRANCO, Marie-Charlotte, 2019, « Faire de la recherche en muséologie : étudier l’histoire des expositions pour comprendre le positionnement du Musée McCord envers les Premiers Peuples », Histoire Québec, 25(3) : 35-37.
- GADOUA, Marie-Pierre, 2014, « Making Sense through Touch. Handling Collections with Inuit Elders at the McCord Museum », The Senses and Society, 9(3) : 323-341.
- HORTON, Jessica L. and Janet C. BERLO, 2013, « Beyond the Mirror. Indigenous Ecologies and ‘New Materialisms” in Contemporary Art », Third Text, 27(1) : 17-28.
- HOWES, David, 2014, « Introduction to Sensory Museology », The Senses and Society, 9(3) : 259-267.
- HOWES, David, 2019, « Multisensory anthropology », Annual Review of Anthropology, 48(1) : 17‑28. En ligne : https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-anthro-102218-011324.
- ICOFOM, 2021, 44e symposium : Décoloniser la muséologie : musées, métissages et mythes d’origine, 15 au 18 mars 2021, visioconférence, Comité international pour la Muséologie.
- KAINE, Elisabeth et Laurent JÉRÔME, 2014, « Représentations de soi et décolonisation dans les musées : Quelles voix pour les objets de l’exposition C’est notre histoire. Premières Nations et Inuit du XXIe siècle (Québec)? », Anthropologie et Sociétés, 383(3) : 231-252.
- RITENBURG, Heather, EARL YOUNG LEON, Alannah, LINDS, Warren, NADEAU, Denise Marie, GOULET, Linda M., KOVACH, Margaret and Mary (Meri) MARSHALL, 2014, « Embodying Decolonization. Methodologies and indigenization », Alternative, 10(1) : 67-78.
- LONETREE, Amy and Amanda J. COBB (dirs..), 2008, The National Museum of the American Indian: Critical Conversations, Lincoln : University of Nebraska Press.
- LONETREE, Amy, 2012, Decolonizing Museums: Representing Native America and Tribal Museums, Chapel Hill : University of North Carolina Press.
- MEUNIER, Anik et Jason LUCKERHOFF, Jason (dirs.), 2012, La muséologie, champ de théories et de pratiques, Québec : Presses de l’Université du Québec.
- MOSES, John, 2017, « The Curatorial Legacy of the Expo ‘67 Indians of Canada Pavilion and the Future of Indigenous Museum Practice », Museum Anthropology Futures, Montréal : Council for Museum Anthropology, Université Concordia.
- Musée McCord et Wapikoni Mobile, 2020, Processus de décolonisation : la cocréation entre institutions culturelles et organismes autochtones, 1er décembre 2020, visioconférence, Musée McCord.
- Musée des beaux-arts de Sherbrooke, 2018, « Biennale d’art contemporain autochtone (BACA) », 8 août 2018, MBAS. En ligne : https://mbas.qc.ca/biennale-dart-contemporain-autochtone-baca/.
- NICASTRO, Lylou, 2020, « Un art autochtone décomplexé dans les musées du Québec », 26 octobre 2020, Montréal campus. En ligne : https://montrealcampus.ca/2020/10/26/un-art-autochtone-decomplexe-dans-les-musees-du-quebec/.
- NORGAARD, Kari M, 2020, « ATMOSPHERES: Imaging the Air We Breathe - Developing sociological and ecological imaginations », October 29th 2020, videoconference, Université Concordia and Centre for Interdisciplinary Studies in Society and Culture.
- PICARD, Isabelle, 2018, « Petite histoire (de l’art) », 22 novembre 2018, Musée national des beaux-arts du Québec, En ligne : https://www.mnbaq.org/blogue/2018/11/22/la-sexualisation-de-la-femme-autochtone-dans-les-oeuvres-artistiques.
- SINCLAIR, Catherine (dir.), 2012, Decolonize Me, Ottawa : Lowe Martin Group.
- SMITH, Linda T., 2012, Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples, (2e ed.) Londres : Zed Books Ltd.
- Task Force on Museums and First Peoples, Assembly of First Nations, Canadian Museums Association, 1992 / 1994, Turning the Page: Forging New Partnerships between Museums and First Peoples, Ottawa : The Task Force / Le Groupe de travail.
- Commission de vérité et réconciliation du Canada — CVR, 2015, Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir, Sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, Montréal, Kingston, London, Chicago : McGill-Queen's Press-MQUP.
- VERNIER, Melissa, 2016, « Réappropriation du patrimoine autochtone : défis et nouvelles pratiques muséales et archivistiques. », Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research, 11(2) : 1-20.
- WISEMAN, Frederick M., 2001, The Voice of the Dawn: An Autohistory of the Abenaki Nation, Lebanon : University Press of New England.
Liste des figures
Figure 1
Figure 2
Figure 3
Figure 4
Lancement de l’espace famille dans Couleurs Manifestes. Rita Letendre, Le voyage d’Isis, 1980, acrylique sur toile, 106,7 x 182,9 cm, don de monsieur Jacques Letendre et de madame Monique Letendre, collection Musée des beaux-arts de Sherbrooke (2010.17.1).
Figure 5
Figure 6