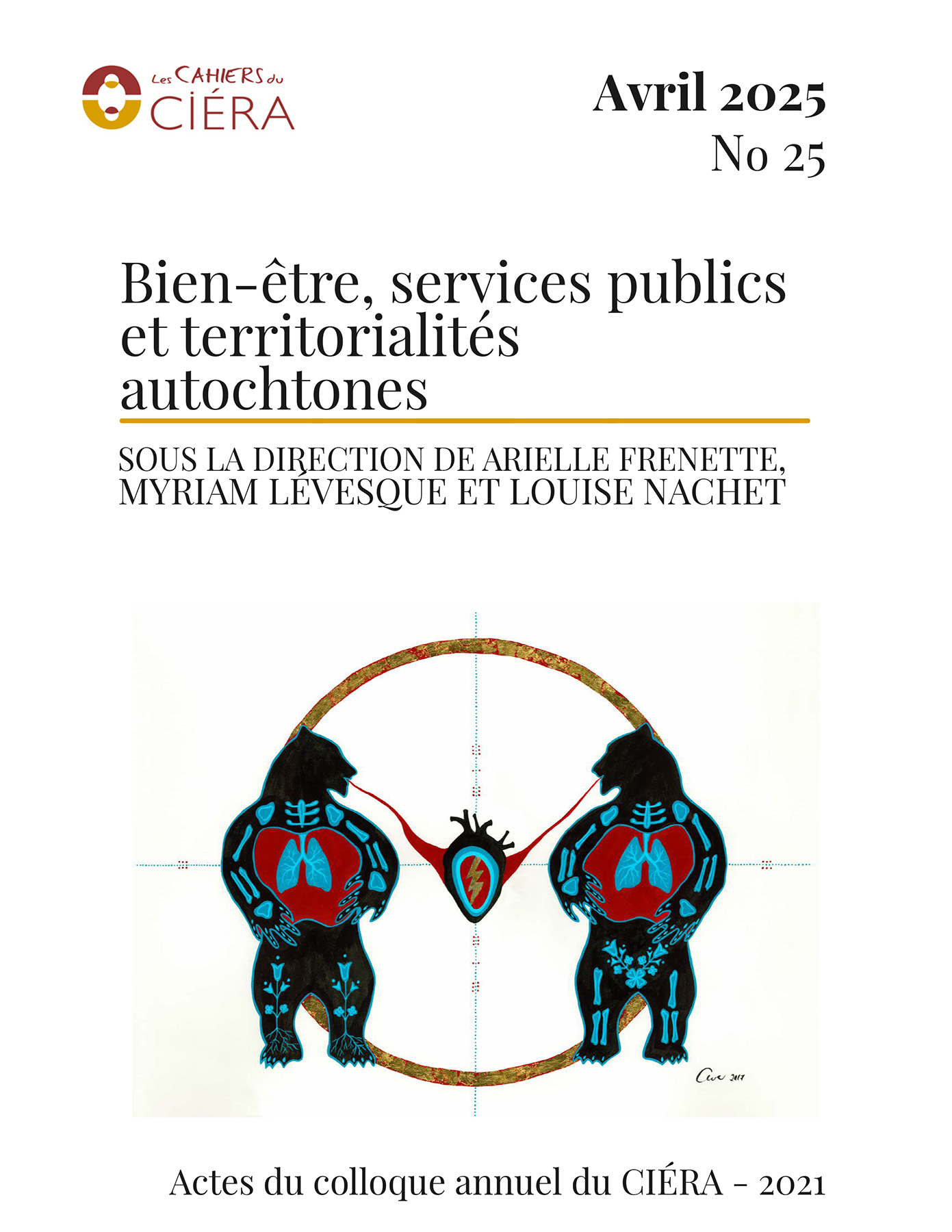Le pôle de l’Université Laval du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA-UL) organisait, en collaboration avec l’Association étudiante autochtone (AÉA) de l’Université Laval et le Cercle Kisis, les 10 et 11 mai 2021, un colloque d’échange et de réflexion intitulé « Bien-être, services publics et territorialités autochtones ». Le contexte de la pandémie de coronavirus (SARS-CoV-2) a poussé les différentes parties à organiser l’entièreté dudit colloque à distance via vidéoconférence sur Zoom. L’articulation des activités du colloque en ligne a présenté de nombreux défis logistiques et techniques, tout en permettant une plus grande accessibilité aux panélistes et au public situés dans des communautés autochtones et en milieu éloigné de la ville de Québec. La thématique du colloque s’est définie progressivement à la suite des observations des organisateurs et organisatrices vis-à-vis des répercussions sur la sécurité publique et la cohésion sociale explorées dans le fil de l’actualité 2020-2021 au Québec et ailleurs au Canada. La pandémie de COVID-19 a provoqué un resserrement des pouvoirs et une réorganisation des structures de gestion de crise intra- et inter-institutionnelles sur l’ensemble du réseau pancanadien en santé (incluant, mais sans s’y limiter, les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux) (Bellier 2020 ; First Nations Leadership Council 2020 ; Hillier et al. 2020 ; Hamel-Roy, Fauvel, Laurence-Ruel et Noiseux 2021 ; Kopp, Kumar et Aitken 2024). Plus encore, il a été noté que le contexte d'incertitude et d'instabilité de cette pandémie a entraîné des effets cumulés d’une organisation de crise locale à grande échelle (région administrative, province ou territoire, pays) et des bouleversements politiques, économiques et socioculturels (Hillier et al 2020 ; Wawanoloath 2021 ; Kopp, Kumar et Aitken 2024). Au Québec, on retiendra particulièrement l’application des mesures sanitaires, comme la quarantaine, l’isolement, la distanciation physique ou sociale, le port du masque, et la vaccination, ainsi que l’instauration d'un système d'alertes régionales selon un code de quatre couleurs ou encore la fermeture d'établissements publics ou privés. Or, bien que l’idée prédominante fût de s'adapter aux caractéristiques géographiques des mesures à adopter, ces mécanismes de surveillance et de sanctions ont laissé un souvenir indélébile dans la mémoire collective. À cet égard, la perception médiatique des périodes pandémiques a été un facteur significatif pour exposer les Allochtones, et susciter de nombreuses réactions dans l’espace public, à certaines causes systémiques des inégalités sociales de la santé et de la précarité dans laquelle vivent de nombreux autochtones habitant hors (ou en) communauté, y compris des pratiques et politiques coloniales multigénérationnelles, ainsi que l’accès réduit aux soins soulevés par plusieurs experts indépendants (Reading et Wien 2009 ; Mashford-Pringle et al. 2021 ; Huyser et al. 2022 ; Loppie et Wien 2022 ; Smylie et al. 2022 ; Williams et al. 2022 ; Yangzom et al. 2023). En effet, loin d’avoir des répercussions semblables sur l’ensemble des groupes culturels de la société québécoise, le contexte de la pandémie a notamment accentué les vulnérabilités et les inégalités préexistantes auxquelles sont sujettes les Premiers Peuples (Belaïdi et Koubi 2020 ; First Nations Leadership Council 2020; Hillier et al. 2020 ; Lane 2020), notamment en matière d'accès aux services sociaux et sanitaires, à la sécurité alimentaire, à l’éducation, à l’emploi ou encore au logement (Yang et Aitken 2021 ; Loppie et Wien 2022 ; Yangzom et al. 2023). Ces disparités profondes ont d’ailleurs renforcé de manière disproportionnée, bien que différentes, les écarts dans les expériences concernées par une plus grande vulnérabilité au virus (Black 2020 ; Smylie 2020 ; Hahmann et Kumar 2022 ; Williams et al. 2022). Par exemple, ce fut le cas pour les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents tels …
Parties annexes
Bibliographie
- ALHMIDI, Maan, 2020, « Canada “must build back better” for Indigenous people after COVID-19: Bellegarde », CTV News, December 8, 2020. Retrieved from: https://www.ctvnews.ca/politics/canada-must-build-back-better-for-indigenous-people-after-covid-19-bellegarde-1.5221399.
- ALHMIDI, Maan, 2021, « Le racisme s’est amplifié contre les femmes autochtones, dit la ministre Bennett », La Presse, 8 mars 2021. En ligne : https://www.lapresse.ca/actualites/covid-19/2021-03-08/pandemie/le-racisme-s-est-amplifie-contre-les-femmes-autochtones-dit-la-ministre-bennett.php.
- BARRERA, Jorge, 2020, « Northern Ontario Fly-in First Nation Faces “crisis within a Crisis” after Second COVID-19 Case », CBC News, June 12, 2020. Retrieved from: https://www.cbc.ca/news/indigenous/fn-covid-case-1.5610517.
- BELAÏDI, Nadia et Geneviève KOUBI, 2020, « Covid-19 et peuples autochtones. Des ‘‘faits informatifs’’ sur une relation au monde (Enquête de mars à juin 2020) », La Revue des droits de l’homme. Revue du Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux.
- BELLIER, Irène, 2020, Les peuples autochtones face au Covid-19 : un tour d’horizon au 20 mai 2020. En ligne : https://shs.hal.science/halshs-03090131/.
- BLACK, Meg, 2020, « COVID-19 in Canada : Fears Mount That Indigenous Communities Could Be Left Behind », Global Citizen, April 16, 2020. Retrieved from: https://www.globalcitizen.org/en/content/covid-19-in-canada-indigenous-communities/.
- Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones – CIÉRA, 2021, Bien-être, services publics et territorialités autochtones : 19e colloque annuel du Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones [brochure de conférences], En ligne : https://ciera-recherches.ca/wp-content/uploads/2022/08/colloque_ciera-programme_2021.pdf.
- Conseil des Atikamekw de Manawan et Conseil de la Nation Atikamekw, 2020, Principe de Joyce, Présenté au gouvernement du Canada et au gouvernement du Québec. En ligne : https://www.atikamekwsipi.com/public/images/wbr/uploads/telechargement/Doc_Principe-de-Joyce.pdf.
- DEER, Ka’nhehsí:io, 2020, « Mural in Kahnawake, Que., honours community health-care workers », CBC News, November 6, 2020. Retrieved from: https://www.cbc.ca/news/indigenous/kahnawake-hospital-mural-heath-care-workers-1.5793170.
- ENI, Rachel, PHILLIPS-BECK, Wanda, KYOON ACHAN, Grace, LAVOIE, Josée G., KINEW, Kathi Avery and Alan KATZ, 2021, « Decolonizing Health in Canada: A Manitoba First Nation Perspective », International Journal for Equity in Health, 20(1) : 206. Retrieved from: https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-021-01539-7.
- FERRANTE, Lucas and Philip M. FEARNSIDE, 2020, « Protect Indigenous peoples from COVID-19 », Science, 368(6488) : 251‑251.
- First Nations Leadership Council, 2020, Canada Must Implement Clearer, Stronger Measures to Protect First Nations and All Canadians from the COVID-19 (Coronavirus) Pandemic, Press Release, March 17, 2020. Retrieved from: https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ubcic/mailings/2798/attachments/original/2020_March17_FNLC_CovidCanadaResponse.pdf?1584424675.
- First Nations Leadership Council, 2024, FNLC Dismayed by Lack of Progress in Improving First Nations Housing and Infrastructure, Press Release, March 22, 2024. Retrieved from: https://www.bcafn.ca/sites/default/files/docs/news/2024March22_FNLC%20Press%20Release_Auditor%20General%20Housing%20Report_Final.pdf.
- Gouvernement du Canada, 2012, Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l’action, Commission de vérité et réconciliation du Canada, Gouvernement du Canada.
- Gouvernement du Canada, 2023, Cas confirmés de COVID-19 ». Le coronavirus (COVID-19) et les communautés autochtones, Services aux Autochtones Canada, Gouvernement du Canada. En ligne : https://stc-ndm-prod-wc.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2024001/article/00001-fra.htm.
- Gouvernement du Canada, 2024, Lever les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable. En ligne : https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1506514143353/1533317130660.
- Gouvernement du Québec, 2019, Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès. Rapport final, Commission Viens - Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, Gouvernement du Québec.
- Government of Manitoba, 2021, COVID-19 Infections in Manitoba: Race, Ethnicity, and Indigeneity. External Report, March 1, 2021. Retrieved from: https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/surveillance/docs/rei_external.pdf.
- HAMEL-ROY, Laurence, FAUVEL, Mylène, LAURENCE-RUEL, Corynne et Yanick NOISEUX, 2021, Rapport de recherche. Le « Grand confinement » et l’action publique durant la première vague de la COVID-19 au Québec : Regards croisés sur les rapports de genre, de race et de classe dans quatre secteurs d'emploi, Montréal : GIREPS.
- HAHMANN, Tara et Mohan B. KUMAR, 2022, Les besoins en soins de santé insatisfaits pendant la pandémie et leurs répercussions sur les Premières Nations vivant hors réserve, les Métis et les Inuits, Statistique Canada, Gouvernement du Canada. En ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2022001/article/00008-fra.htm.
- HILLIER, Sean A., CHACCOUR, Elias, AL-SHAMMAA, Hamza and Jessica VORSTERMANS, 2020, « Canada’s response to COVID-19 for Indigenous Peoples: a way forward? », Canadian Journal of Public Health, 111(6) : 1000‑1001. Retrieved from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7654339/#CR4.
- HOULE, Marie-Josée, 2022, Reimagining housing policy in Canada: First Nations leadership, vision and voices, Speaking Notes, March 22-23, 2022. Retrieved from: https://www.housingchrc.ca/en/reimagining-housing-policy-canada-first-nations-leadership-vision-and-voices.
- HUYSER, Kimberley, YELLOW HORSE, Aggie J., COLLINS, Katherine A., FISCHER, Jaimy, JESSOME, Marie G., RONAYNE, Emma T., LIN, Jonathan C., DERKSON, Jordan and Michelle JOHNSON-JENNINGS, 2022, « Understanding the associations among social vulnerabilities, Indigenous peoples and COVID-19 cases within Canadian health regions ». International journal of environmental research and public health, 19 : 12409. Retrieved from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9566440/pdf/ijerph-19-12409.pdf.
- JOSSELIN, Marie-Laure, 2021, « Itinérance : ‘‘On gérait un jour à la fois ; avec la COVID, c’est une minute à la fois’’ », Radio-Canada/Espaces Autochtones, 14 janvier 2021. En ligne : https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1763349/covid-itinerance-montreal-refuge-autochtone.
- JUNG, Delphine, 2021, « ‘‘Si on perd nos aînés à cause de la COVID-19, on perd notre histoire, notre culture’’ », Radio-Canada/Espaces Autochtones, 19 janvier 2021. En ligne : https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1763538/deces-aines-pandemie-menace-aussi-heritage-autochtone.
- KAKOL, Monika, UPSON, Dona and Akshay SOOD, 2021, « Susceptibility of southwestern American Indian tribes to coronavirus disease 2019 (COVID‐19) », The Journal of Rural Health 37(1) : 197. Retrieved from: https://pmc-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/articles/PMC7264672/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc.
- KOPP, Amanda, KUMAR, Mohan B. et Nicole AITKEN, 2024, Mortalité attribuable à la COVID-19 chez les Premières Nations et les Métis vivant dans un logement privé au Canada : une analyse des déterminants sociaux de la santé et des inégalités en matière de santé, Statistique Canada, Gouvernement du Canada. En ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/45-28-0001/2024001/article/00001-fra.pdf?st=jZ0dOP4G.
- KOVESI, Thomas, 2012, « Respiratory disease in Canadian First Nations and Inuit children », Paediatrics & Child Health, 17(7) : 376‑380. Retrieved from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3448538/.
- KOVESI, Thomas, MALLACH, Gary, SCHREIBER, Yoko, MCKAY, Michael, LAWLOR, Gail, BARROWMAN, Nick, TSAMPALIEROS, Anne, KULKA, Ryan, ROOT, Ariel, KELLY, Len, KIRLEW, Michael and J. David MILLER, 2022, « Housing conditions and respiratory morbidity in Indigenous children in remote communities in Northwestern Ontario, Canada », Canadian Medical Association Journal, 194(3) : E80-E88. Retrieved from: https://www.cmaj.ca/content/194/3/E80.
- La Presse canadienne 2021, « La scientifique qui protège les Mohawks contre la COVID-19 », Radio-Canada/Espaces Autochtones, 23 janvier 2021. En ligne : https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1765395/kahnawake-coronavirus-mesures-pandemie-annick-gauthier.
- LANE, Rosemary, 2020, The impact of COVID-19 on indigenous peoples. Policy brief No. 70, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
- LATOUCHE, Guy, 2018, « Les Premières Nations au Québec et le droit au logement », LDL - Ligue des droits et libertés, 14 mai 2018. En ligne : https://liguedesdroits.ca/les-premieres-nations-au-quebec-et-le-droit-au-logement/.
- LAVOIE, Josée G., 2023, Le droit à la santé issu de traités et l’héritage de la Politique sur la santé des Indiens (1979) : considérations législatives et stratégiques contemporaines. En ligne : https://afn.bynder.com/m/6050d5e8ebd50d7/original/Le-droit-a-la-sante-issu-de-traites-et-L-heritage-de-la-politique-sur-la-sante-des-Indiens-1979-Josee-Lavoie.pdf.
- LÉVESQUE, Fanny, 2022, « Les communautés autochtones frappées de plein fouet », La Presse, 11 janvier 2022. En ligne : https://www.lapresse.ca/actualites/covid-19/2022-01-11/variant-omicron/les-communautes-autochtones-frappees-de-plein-fouet.php.
- Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 2021, L.C. ch. 14. En ligne : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/u-2.2/.
- LOPPIE, Charlotte and Fred WIEN, 2022, Understanding Indigenous health inequalities through a social determinants model. Prince George : National Collaborating Centre for Indigenous Health. Retrieved from: https://www.nccih.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/10373/Health_Inequalities_EN_Web_2022-04-26.pdf.
- MASHFORD-PRINGLE, Angela, SKURA, Christine, STUTZ, Sterling and Thilaxcy YOHATHASAN, 2021, What we heard: Indigenous peoples and COVID-19, Supplementary Report for the Chief Public Health Officer of Canada’s Report on the State of Public Health in Canada, Toronto: Waakebiness-Bryce Institute for Indigenous Health. Retrieved from: https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/corporate/publications/chief-public-health-officer-reports-state-public-health-canada/from-risk-resilience-equity-approach-covid-19/indigenous-peoples-covid-19-report/cpho-wwh-report-en.pdf.
- NACHET, Louise et Sabrina BOURGEOIS, 2022, « Miner à tout prix : discours sur l’extraction minière en territoires autochtones durant la COVID-19 », Revue d’études autochtones, 52(1) : 113‑23.
- NARASIMHAN, Subasri and P. Paul CHANDANABHUMMA, 2021, « A Scoping Review of Decolonization in Indigenous-Focused Health Education and Behavior Research », Health Education & Behavior, 48(3) : 306‑19.
- O’BRIEN, Kathy, ST-JEAN, Marylène, WOOD, Patricia, WILLBOND, Stephanie, PHILLIPS, Owen, CURRIE, Duncan et Martin TURCOTTE, 2020, Comorbidités liées aux décès impliquant la COVID-19 au Canada, Statistique Canada, Gouvernement du Canada. En ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00087-fra.htm.
- Organisation des Nations Unies — ONU, 2008, Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Nations Unies. En ligne : https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf.
- Organisation mondiale de la Santé – OMS, 2023, « Une seule santé », OSM, 23 octobre 2023, En ligne : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/one-health.
- PATTERSON, Dayne, 2021. « COVID-19 : A Look at the Numbers in First Nations Communities in the West », APTN News, July 6, 2021. Retrieved from: https://www.aptnnews.ca/national-news/covid-19-western-canada-federal-government-pandemic/.
- READING, Charlotte Loppie and Fred WIEN, 2009, Health inequalities and social determinants of Aboriginal peop’ss’ health. Prince Geore : National Collaborating Centre for Aboriginal Health. Retrieved from: https://www.nccih.ca/docs/social%20determinates/NCCAH-Loppie-Wien_Report.pdf.
- SHAHEEN-HUSSAIN, Samir, 2021, Plus aucun enfant autochtone arraché : Pour en finir avec le colonialisme médical canadien, Montréal : Lux Éditeur.
- SMYLIE, Janet, 2020, « Indigenous Communities, Systemic Racism and COVID-19: Interview with Dr. Janet Smylie », MAP Centre for Urban Health Solutions. Retrieved from: https://maphealth.ca/indigenous-communities-systemic-racism-and-covid-19/.
- SMYLIE, Janet, MCCONKEY, Stephanie, RACHLIS, Beth, AVERY, Lisa, MECREDY, Graham, BRAR, Raman, BOURGEOIS, Cheryllee, DOKIS, Brian, VANDEVENNE, Stephanie and Michael A. ROTONDI, 2022, « Uncovering SARS-COV-2 vaccine uptake and COVID-19 impacts among First Nations, Inuit and Métis peoples living in Toronto and London, Ontario ». Canadian Medical Association Journal, 2 (194) : E1018-1026. Retrieved from: https://www.cmaj.ca/content/194/29/E1018.
- SOMOS, Christi, 2021, « A year later, Indigenous communities are fighting twin crises: COVID-19 and inequality », CTV News, January 25, 2021. Retrieved from: https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/a-year-later-indigenous-communities-are-fighting-twin-crises-covid-19-and-inequality-1.5280843.
- WAWANOLOATH, Maxime Auguste, 2021, « Les Autochtones face à la pandémie de la COVID-19 », Nouveaux Cahiers du socialisme, (25) : 42-49.
- WILLIAMS, Naomi G., ALBERTON, Amy M. and Kevin M. GOREY, 2022, « Morbid and mortal inequities among Indigenous people in Canada and the United States during the COVID-19 pandemic critical review of relative risks and protections », Journal of Indigenous social development, 11(1) : 3-32.
- WRIGHT, TERESA, 2020, « Indigenous group files legal challenge over 'inadequate' COVID-19 funding », CTV News, May 13, 2020. Retrieved from: https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/indigenous-group-files-legal-challenge-over-inadequate-covid-19-funding-1.4937682.
- YANG, Fei-Ju et Nicole AITKEN, 2021, Les personnes qui vivaient en appartement ou au sein d’un ménage plus nombreux étaient plus à risque de mourir de la COVID-19 au cours de la première vague de la pandémie, Statistique Canada, Gouvernement du Canada. En ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2021001/article/00004-fra.htm.
- YANGZOM, Kelsang, MASOUD, Huda et Tara HAHMANN, 2023, Accès aux soins de santé primaires chez les membres des Premières Nations vivant hors réserve, les Métis et les Inuit, 2017 à 2020, Statistique Canada, Gouvernement du Canada. En ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/41-20-0002/412000022023005-fra.htm.