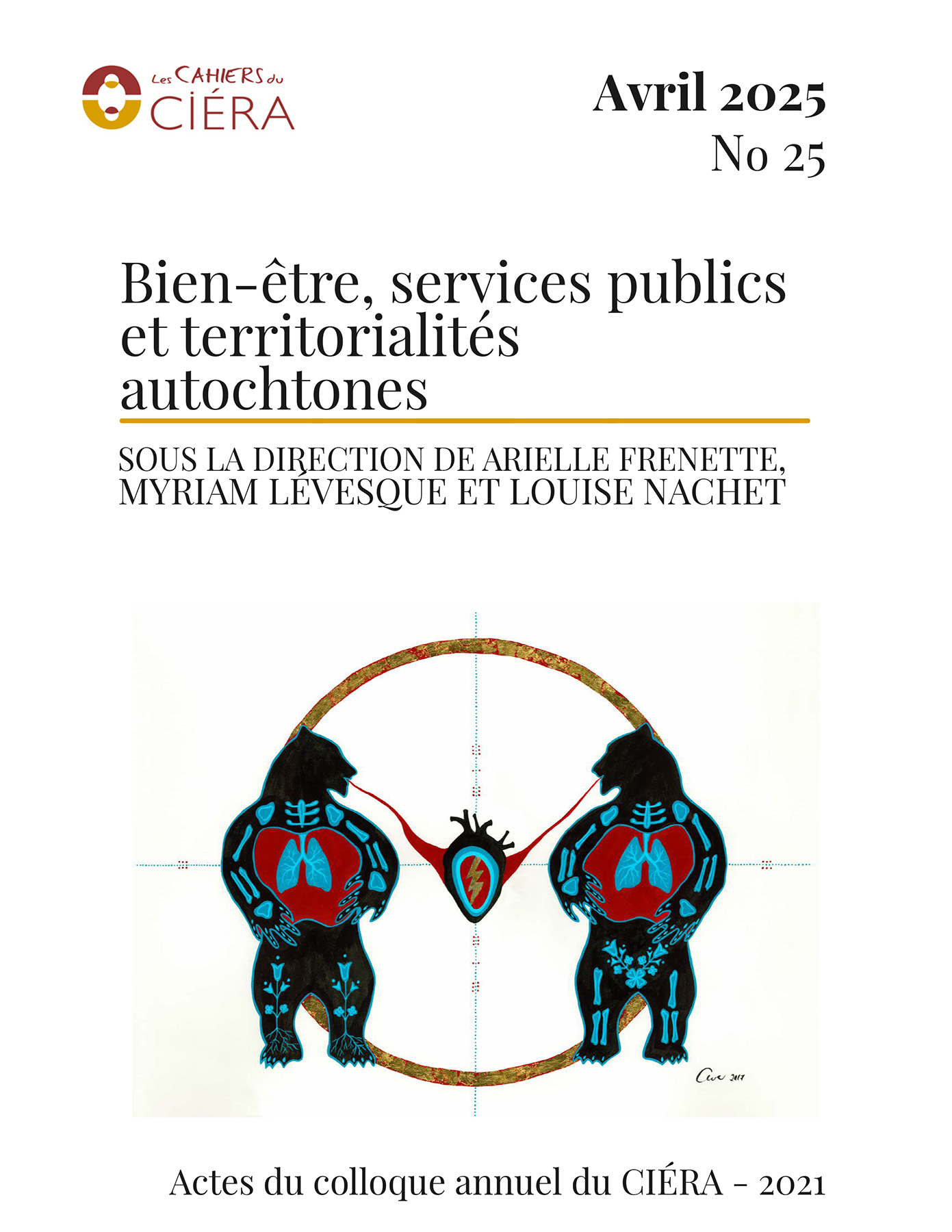Corps de l’article
Le pôle de l’Université Laval du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA-UL) organisait, en collaboration avec l’Association étudiante autochtone (AÉA) de l’Université Laval et le Cercle Kisis[1], les 10 et 11 mai 2021, un colloque d’échange et de réflexion intitulé « Bien-être, services publics et territorialités autochtones ». Le contexte de la pandémie de coronavirus (SARS-CoV-2)[2] a poussé les différentes parties à organiser l’entièreté dudit colloque à distance via vidéoconférence sur Zoom. L’articulation des activités du colloque en ligne a présenté de nombreux défis logistiques et techniques, tout en permettant une plus grande accessibilité aux panélistes et au public situés dans des communautés autochtones et en milieu éloigné de la ville de Québec.
La thématique du colloque s’est définie progressivement à la suite des observations des organisateurs et organisatrices vis-à-vis des répercussions sur la sécurité publique et la cohésion sociale explorées dans le fil de l’actualité 2020-2021 au Québec et ailleurs au Canada. La pandémie de COVID-19 a provoqué un resserrement des pouvoirs et une réorganisation des structures de gestion de crise intra- et inter-institutionnelles sur l’ensemble du réseau pancanadien en santé (incluant, mais sans s’y limiter, les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux) (Bellier 2020 ; First Nations Leadership Council 2020 ; Hillier et al. 2020 ; Hamel-Roy, Fauvel, Laurence-Ruel et Noiseux 2021 ; Kopp, Kumar et Aitken 2024). Plus encore, il a été noté que le contexte d'incertitude et d'instabilité de cette pandémie a entraîné des effets cumulés d’une organisation de crise locale à grande échelle (région administrative, province ou territoire, pays) et des bouleversements politiques, économiques et socioculturels (Hillier et al 2020 ; Wawanoloath 2021 ; Kopp, Kumar et Aitken 2024). Au Québec, on retiendra particulièrement l’application des mesures sanitaires, comme la quarantaine, l’isolement, la distanciation physique ou sociale, le port du masque, et la vaccination, ainsi que l’instauration d'un système d'alertes régionales[3] selon un code de quatre couleurs ou encore la fermeture d'établissements publics ou privés. Or, bien que l’idée prédominante fût de s'adapter aux caractéristiques géographiques des mesures à adopter, ces mécanismes de surveillance et de sanctions ont laissé un souvenir indélébile dans la mémoire collective. À cet égard, la perception médiatique des périodes pandémiques a été un facteur significatif pour exposer les Allochtones[4], et susciter de nombreuses réactions dans l’espace public, à certaines causes systémiques des inégalités sociales de la santé et de la précarité dans laquelle vivent de nombreux autochtones habitant hors (ou en) communauté[5], y compris des pratiques et politiques coloniales multigénérationnelles, ainsi que l’accès réduit aux soins soulevés par plusieurs experts indépendants (Reading et Wien 2009 ; Mashford-Pringle et al. 2021 ; Huyser et al. 2022 ; Loppie et Wien 2022 ; Smylie et al. 2022 ; Williams et al. 2022 ; Yangzom et al. 2023).
En effet, loin d’avoir des répercussions semblables sur l’ensemble des groupes culturels de la société québécoise, le contexte de la pandémie a notamment accentué les vulnérabilités et les inégalités préexistantes auxquelles sont sujettes les Premiers Peuples (Belaïdi et Koubi 2020 ; First Nations Leadership Council 2020; Hillier et al. 2020 ; Lane 2020), notamment en matière d'accès aux services sociaux et sanitaires, à la sécurité alimentaire, à l’éducation, à l’emploi ou encore au logement (Yang et Aitken 2021 ; Loppie et Wien 2022 ; Yangzom et al. 2023). Ces disparités profondes ont d’ailleurs renforcé de manière disproportionnée, bien que différentes, les écarts dans les expériences concernées par une plus grande vulnérabilité au virus (Black 2020 ; Smylie 2020 ; Hahmann et Kumar 2022 ; Williams et al. 2022). Par exemple, ce fut le cas pour les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents tels que le diabète et les maladies cardiaques, des conditions qui contribuent à créer des écarts persistants dans l’état de santé et qui augmentent le risque de complications liées à la COVID-19 (O’Brien et al. 2020 ; Kakol, Upson et Sood 2021 ; Kopp, Kumar et Aitken 2024). Les personnes expérimentant déjà les impacts de la tuberculose, ou autres infections pulmonaires, dues notamment à la désuétude de certaines infrastructures, au surpeuplement des logements et au manque de logement abordable, en bon état et de taille adéquate, en est un autre exemple (Kovesi 2012 ; Hillier et al. 2020 ; Yang et Aitken 2021 ; Kovesi et al. 2022 ; Kopp, Kumar et Aitken 2024). Aux États-Unis, entre autres, le manque d’eau courante et l’inadéquation des logements au sein de la nation Navajo auraient été un des facteurs déterminants pour expliquer le taux d’infection à la COVID-19 dix fois plus élevé que celui de la population générale de l'Arizona (Kakol, Upson et Sood 2021).
Pour contribuer à ce débat sur la santé et ses déterminants, le 19e colloque annuel du CIÉRA a formulé quatre axes de réflexions et d’observations[6] qui ont guidé les interventions des participants et des participantes tout au long de cet évènement. C’est d’ailleurs dans cet esprit que ce numéro souhaite poursuivre la démarche dudit colloque et présenter la voix de collaborateur·trice·s[7] issu·e·s de différents horizons professionnels.
En premier lieu, il importe de souligner que les Premiers Peuples situés au Québec, tout comme leurs aïeux vis-à-vis d’autres maladies (Wawanoloath 2021 ; Bousquet, Kistabush, Mowatt et Hamel-Charest 2022 : 43), n’ont pas été démunis pour faire face à la pandémie de coronavirus (SARS-CoV-2) et ne sont pas restés passifs (Hillier et al. 2020 ; Kopp, Kumar et Aitken 2024). La pandémie a mis en évidence la réactivité et l’innovation des organisations autochtones locales (comité d’urgence, direction santé, etc.) pour continuer à offrir des services de première ligne, secondaires et supplémentaires à leurs populations respectives, en particulier en considérant les mesures de distanciation. D’ailleurs, aux quatre coins du pays, des gestes ont été posés pendant les périodes pandémiques, entre autres, pour remercier et rendre hommage aux travailleurs et travailleuses de première ligne. Les centres de santé des communautés autochtones situés au Québec ne font pas exception à cet égard — Kahnawá:ke (voir Figure 1) en est un exemple éloquent où une murale fut créée, en 2020, pour célébrer ces figures marquantes de la santé publique.
Figure 1
To honor health-care workers in Kahnawá:ke, Québec.
Source : Ka’nhehsí:io Deer · CBC News, 2020
Crédit photographique : ©Ka’nhehsí:io Deer
Artiste/art thérapiste : Megan Kanerahtenháwi Whyte
Toutefois, force est de constater que malgré les efforts déployés par les différents secteurs d’activités de chacune des communautés autochtones, il existe un déséquilibre, voire une inadéquation, entre l'offre et la demande des services publics et des ressources disponibles pour les peuples autochtones. Une situation problématique, au Québec et ailleurs au Canada, qui affecte leur bien-être et leurs efforts d’autodétermination, et ce, bien avant la pandémie de COVID-19 (First Nations Leadership Council 2020 ; Hillier et al. 2020 ; Shaheen-Hussain 2021).
Nous sommes conscientes qu'il existe de nombreux éléments liés à ces obstacles et aux moyens de les surmonter qui ne sont pas mis en lumière dans le cadre restrictif de ce texte, notamment le racisme systémique. À cet effet, au Québec, dans un rapport édifiant publié quelques mois avant la pandémie, la Commission Viens[8] (2016-2019) avait rappelé que la relation entre les Premiers Peuples et les services publics du Québec était entachée de discrimination systémique (Gouvernement du Québec 2019). D’ailleurs, un an après avoir été rendu public, la mort tragique de Joyce Echaquan, une femme atikamekw victime de discrimination raciale et de maltraitance du personnel soignant de l'hôpital de Saint-Charles-Borromé dans la région de Lanaudière, est un exemple de la conséquence du racisme systémique, spécifique aux Autochtones, qui continue de façonner les systèmes de soins de santé.
Dans d’autres cas, ces discriminations systémiques se traduisent par l’absence de services de santé et de services sociaux adéquats, privant ainsi de nombreux individus et communautés de leurs droits fondamentaux et de leur dignité. Ce dernier aspect a profondément motivé les discussions du 19e colloque annuel du CIÉRA et, par conséquent, de ce numéro. Plusieurs questions ont émergé de ces discussions et nous ont poussés à réfléchir prioritairement à la manière dont s’articulent les revendications en santé des peuples autochtones, surtout en ce qui a trait aux services publics, dans différents contextes culturels et géodynamiques. Que ce soit par l'optimisation et l’amélioration de services existants hors et en communautés ou encore par la création et/ou l'expérimentation de services dirigés par les Autochtones eux-mêmes, les Premiers Peuples ne manquent pas d’initiatives communautaires et citoyennes pour améliorer leurs conditions de vie et pour renforcer leur capacité de développement endogène afin de répondre à leurs besoins fondamentaux dans une perspective décolonisatrice et émancipatrice (Eni et al. 2021 ; Narasimhan et Chandanabhumma 2021). À cet égard, nous souhaitons prendre position :
Louise Nachet : Au sein de la communauté universitaire, nombreux avaient alors l’espoir que la pandémie soit une occasion de favoriser de nouvelles orientations pour les relations entre les peuples autochtones, les services publics et l’État canadien et québécois. Trois ans plus tard, les avancées en la matière restent insuffisantes et insatisfaisantes et traduisent bien la continuation d’une relation fondamentalement coloniale.
Roxanne Blanchard-Gagné : Les gouvernements du Québec et du Canada doivent continuer à prendre des mesures pour, d’une part, lutter contre le racisme envers les Premiers Peuples dans les systèmes de soins de santé et, d’autre part, pour appuyer plus fermement le processus d'autodétermination des Autochtones en matière de santé, de mieux-être et de bien-être — via des pratiques décoloniales.
Les politiques au-delà des déterminants sociaux de la santé
Roxanne Blanchard Gagné : Derrière l’ensemble des déterminants autochtones de la santé, il y a cette question importante de l'autonomie et de l’autodétermination qui ne saurait être mise de côté et qui a été abordée, de façon plus systématique, dans l’espace public sur ses dimensions juridiques, politiques et socio-économiques pendant les épisodes les plus forts de la pandémie au Québec et ailleurs au Canada (p. ex., Hillier et al. 2020 ; Eni et al. 2021 ; Somos 2021 ; Wawanoloath 2021). D’ailleurs, bien avant les débats en cours en 2020-2022, les luttes rattachées aux expériences coloniales historiques et actuelles (qui ont contribué à ériger des structures de dominations, tels que dans les services collectifs comme le secteur de la santé et des soins) se sont surtout marquées par des revendications fondées sur divers systèmes de gouvernance autochtone (p. ex., Gouvernement du Québec 2019 ; First Nations Leadership Council 2020, 2024 ; Wawanoloath 2021).
Cet intérêt collectif à faire reconnaître leurs droits inhérents, notamment en matière de santé et de services sociaux, a par ailleurs suscité nombre de tentatives de transformer les mentalités, les institutions occidentales et les structures de pouvoir en place, que l’on qualifie souvent d’actes de décolonisation, d’autochtonisation ou encore de réconciliation ; elles-mêmes soutenues, par exemple, dans le contexte précis de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), des Appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) ou du Principe de Joyce.
Malheureusement, un examen des considérations de la législation (provinciale, territoriale et fédérale) et de certaines initiatives a révélé que le cadre et les limites propres à la gouvernance tripartite de la santé, pour sa part, contiennent les dispositions suivantes : ambiguïtés et lacunes des services offerts aux Premiers Peuples en et hors communautés (p. ex., Alhmidi 2020 ; Wright 2020 ; Lavoie 2023).
Louise Nachet : Plusieurs organisations et expert·e·s (non-)autochtones ont non seulement mis en lumière l’importance de renforcer réellement et durablement la résilience des systèmes de soins de santé, mais ont aussi fourni l’exemple d'envisager la santé et le bien-être de manière plus « globale » (cf. selon l'approche « une seule santé »[9] ou encore l’approche holistique de la santé, du bien-être et du mieux-être[10]), en y incluant d'autres dimensions telles que le patrimoine, la langue et l’identité culturelle ou encore le logement (p. ex., Bellier 2020 ; Eni et al. 2021 ; First Nations Leadership Council 2020 ; Hillier et al. 2020). Sur ce dernier point, certains ont notamment préconisé une approche du logement axée sur les droits de la personne, tandis que d'autres ont défendu une approche fondée sur les droits inhérents et collectifs des communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuit dans les régions urbaines, rurales et nordiques (p. ex., Latouche 2018 ; First Nations Leadership Council 2020, 2024 ; Houle 2022).
Quoi qu'il en soit, de nombreuses communautés et organisations ont souligné que les promesses de renouvellement des financements et des budgets, bien qu'importantes, ne devraient pas être considérées comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen de réduire les inégalités en santé (p. ex., Alhmidi 2020 ; First Nations Leadership Council 2020, 2024). Un rapport fébrile, qui nous rappelle que l'urgence sanitaire et politique a pris le relais d’une urgence économique qui elle-même a pour origine l’urgence sociale en et hors communautés. Notons au passage que les Autochtones situées en milieu urbain allochtone ont également été largement oubliés par ces politiques publiques, incluant les personnes sans-abri (Josselin 2021).
Au Canada, dans les six premiers mois de la pandémie de COVID-19, malgré une transmission importante du virus au Québec et en Ontario, l’épidémiologie a démontré un taux d’éclosion chez les Autochtones vivant en communauté sensiblement inférieur à celui du reste de la population, et ce, surtout chez les Premiers Peuples qui étaient situés loin des grands centres urbains (Wawanoloath 2021 ; Kopp, Kumar et Aitken 2024).
De manière générale, les communautés autochtones ont pris les devants pour réduire les risques de transmission et atténuer les impacts dudit virus respiratoire : elles ont mis à jour des arrêtés de santé publique, en plus de limiter les déplacements sur leurs territoires, elles ont adapté leurs cérémonies et mené leurs propres campagnes de communication en santé publique (Hillier et al. 2020 ; Kopp, Kumar et Aitken 2024). Cela étant dit, en utilisant des points de contrôle et des barrages pour assurer la sécurité des membres de leurs communautés, les Premiers Peuples ont également réaffirmé la matérialité de leurs territoires, et pour certaines, de leurs frontières.
Par ailleurs, le fait de résider dans des communautés éloignées dotées d'infrastructures sanitaires limitées signifiait qu'en cas de propagation de la maladie les membres de la communauté seraient en grand danger (Barrera 2020 ; Hillier et al. 2020). Nous sommes conscientes qu’à l’heure actuelle, de nombreuses lacunes persistent dans la littérature scientifique sur les répercussions du coronavirus, en particulier la répartition des hospitalisations et les taux de mortalité désagrégés par l’ensemble des Premiers Peuples (Kopp, Kumar et Aitken 2024). Il est crucial de mentionner toutefois que la prévalence de la maladie et de ces facteurs aggravants susmentionnés varie non seulement d’un individu à l’autre, mais également d’une communauté, voire d’une nation, à l’autre (Alhmidi 2020 ; Hahmann et Kumar 2022 ; Williams et al. 2022). En effet, malgré les données limitées qui permettent l’examen de la mortalité attribuable à la COVID-19, des disparités très importantes ont été observées entre les résultats en matière de santé des Autochtones partout au pays (Patterson 2021 ; Kopp, Kumar et Aitken 2024), en plus de répercussions du virus SARS-CoV-2 disproportionnellement plus élevées chez les Premiers Peuples que les Allochtones (Government of Manitoba 2021 ; Williams et al. 2022 ; Gouvernement du Canada 2023). Rappelons qu'au Canada, environ une trentaine de communautés des Premières Nations sont toujours sous le coup d'un avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable (Gouvernement du Canada 2024). Or, l'accès à l'eau a été désigné à plusieurs reprises comme un facteur essentiel, dans les mesures de prévention et de protection contre les risques de transmission, pour contenir la propagation du virus.
Quoi qu'il en soit, ces initiatives doivent être soulignées comme l'affirmation continue de leur souveraineté et illustrent à quel point elles sont essentielles pour l'amélioration continue de la qualité des soins offerts dans ces communautés. Ces actions, initiatives et actes de leadership tant du côté des Autochtones responsables de la santé, que de leurs allié·e·s ont été indispensables pour stimuler la campagne de vaccination[11] dans des communautés dont l'expérience avec les autorités de santé publique a été historiquement, et jusqu’à ce jour, marquée par la violence (sous toutes ses formes), le paternalisme et le (néo)colonialisme, ce qui a érodé la confiance envers les établissements publics du réseau de la santé au Québec, et ailleurs au Canada.
Louise Nachet : Le contexte de la pandémie et la récession économique imminente ont également constitué une opportunité pour de nombreux États de réduire les libertés civiles et d'instaurer davantage de réformes qui pourraient, entre autres effets néfastes, réduire l'accès des peuples autochtones aux services et ressources publics (Nachet et Bourgeois 2022).
Toutefois, le contexte actuel de COVID-19 a affecté les relations qui existaient entre les chercheur·euse·s et les populations autochtones, notamment en creusant les enjeux liés à l’accès aux technologies numériques de communication ou liés à l’impossibilité de mener des séjours de recherche sur le terrain. Pour les chercheur·euse·s, ces enjeux ont compliqué l’élaboration de méthodologies participatives et collaboratives permettant de partager les voix et épistémologies autochtones.
Roxanne Blanchard-Gagné : Plus que jamais, la recherche doit être engagée dans une perspective critique pour élaborer des solutions et mettre en place des changements positifs concrets pour et avec les communautés.
Comment mener une recherche dans un tel contexte, à fortiori des terrains de recherches ? Là encore, la pandémie a mis en évidence les difficultés déjà existantes et a offert aux chercheurs l'occasion de réévaluer la manière dont ils peuvent renforcer de manière positive la relation entre leur travail et les intérêts, priorités et épistémologies des communautés et organisations autochtones. La situation a encouragé de nombreuses réflexions sur le rôle et le positionnement des chercheur·euse·s allochtones, la réciprocité réelle des bénéfices du terrain de recherche et la charge imposée aux communautés par le milieu de la recherche.
Présentation des contributions
Les diverses contributions rassemblées dans ce numéro explorent plusieurs déterminants sociaux de la santé, que cela soit dans la section thématique ou hors-thème. À cet égard, l’ensemble des auteurs et autrices ont mis particulièrement l’accent sur l’impact du colonialisme et l’héritage des traumas historiques et intergénérationnels, la langue, le patrimoine et l'identité culturelle, le filet de sécurité sociale, les milieux physiques et la gérance de l’environnement.
Tout d'abord, en décrivant certains services publics de manière approfondie, les auteurs et autrices, dans la section thématique, examinent les problématiques et les enjeux sous-jacents aux différentes facettes des systèmes de soins de santé dans lesquels naviguent les Autochtones au Québec et témoignent de certaines de leurs expériences.
Dominique Gaulin, Shawn-Renée Hordyk et Lucie Nadeau ouvrent la réflexion en se penchant sur la décolonisation et l’autochtonisation de divers savoirs et pratiques dans le domaine de la santé mentale et des expériences dites psychotiques, en s’intéressant aux conceptualisations et expérimentations des Nunavimmiut, ainsi qu’au paradigme dominant chez les professionnel·le·s et intervenant·e·s travaillant auprès des Inuit. Cela pousse les autrices à mettre de l’avant leur positionnalité et, par la même occasion, à suggérer l’adoption de certaines formes d’engagement afin de transformer les services publics via la reconnaissance et le respect des valeurs, des cultures et des réalités des Nunavimmiut.
À ces réflexions sur la compétence culturelle et la sécurité culturelle en intervention auprès des Premiers Peuples, Yvan-Rock Awashish, Sandro Echaquan, Geneviève Olivier-d’Avignon, Amanda Ottawa, Taïsha Niquay, Marie-Claude Tremblay et Paul-Yves Weizineau se sont également questionnés sur ces démarches en se concentrant sur l’exemple d’un projet de co-développement d’intervention avec trois communautés atikamekw : Manawan, Wemotaci et Opitciwan. Il en a résulté un nouveau modèle d’intervention culturellement « sécuritaire » auprès des Atikamekw Nehirowisiwok, revue et approuvé localement pour les soins et services de santé. Il s'agit d'un exemple qui illustre des pistes d’action potentielles en faveur de la transformation des services publics dans une perspective de décolonisation et de promotion de la sécurité culturelle.
Dans la même approche « bottom-up », la table ronde « Réalités autochtones en temps de pandémie », animée par Marie-Pierre Bousquet, met de l’avant les réflexions de travailleurs et travailleuses de première ligne, Jason Coonishish, Sipi Flamand, Jimmy Siméon et Lisa Westaway, qui dispensent des services auprès des Premiers Peuples (que cela soit en et/ou hors communautés). En outre, la table ronde s'intéresse aux obstacles et iniquités que les participants et la participante ont remarqués dans le cadre de leur travail. À cela s’ajoute la question de la mobilisation et de la communication entre les communautés qui nous entourent, et les municipalités, pour travailler ensemble afin de se protéger et s’entraider collectivement.
Par la suite, plusieurs autrices se succèdent dans une section hors-thème afin de mettre en valeur le patrimoine artistique, foncier et culturel de plusieurs peuples autochtones.
Pour sa part, Gabrielle Desgagné consacre son article scientifique à la muséologie québécoise et son apport historique dans la diffusion et la gestion de l'indéniable richesse artistique des artistes autochtones. À travers l’étude de cas du Musée des beaux-arts de Sherbrooke, l’autrice nous informe de la dynamique des pratiques muséales collaboratives dans un contexte de décolonisation, d’autochtonisation et de valorisation du patrimoine abénaki.
Il s'ensuit ensuite une série de textes, de type « paroles et points de vue », menée et supervisée par Marie-Pierre Bousquet, dont l'essence même est de rassembler autour de l’identité culturelle et de l’affirmation des droits territoriaux, cinq sujets initialement abordés dans le cadre d’un travail universitaire de premier cycle.
Juliette Élie se penche sur les reconnaissances territoriales au Canada, et les liens significatifs qui les unis aux tentatives de (ré)conciliation et déresponsabilisation des institutions allochtones. Puis ses collègues de classe, Flore Janssen (le tambour à main), Marie Lallement (la coiffe à plume), Jade Lupien (le tambour à main) et Karine Villeneuve (la plume d’aigle) abordent divers significations et usages d’objets sacrés dans la (re)construction identitaire chez les Premières Nations au Canada et aux États-Unis.
Parties annexes
Remerciements
Les autrices adressent leurs remerciements aux conférencier·ière·s, panélistes, intervenant·e·s et organisateur·trice·s du 19e colloque annuel du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA) pour leurs contributions particulièrement riches et instructives dans les débats présentés dans le cadre de ce numéro sur le bien-être, les services publics et les territorialités autochtones. À cet égard, il est également essentiel de souligner l’apport inestimable des réflexions qui sont déjà en cours à ce sujet, incluant les propos éloquents de l’ensemble des personnes ayant contribué à ce 25e numéro des Cahiers du CIÉRA, que ce soit comme auteur trice·s ou autres.
Notes biographiques
Étudiante au doctorat à l’Université Laval, Roxanne Blanchard-Gagné a acquis au fil des années un vif intérêt pour l’anthropologie sociopolitique et l’ethnohistoire portant sur les réalités et les enjeux autochtones contemporains au Canada, particulièrement au Québec et au Nunavut. Plus précisément, son expertise est axée sur les relations humains-animaux [les chiens dans les communautés inuit, d’où son sujet de mémoire de maîtrise : Réveil de la pratique du traîneau à chiens à Iqaluktuuttiaq (Cambridge Bay, Nunavut) : perspective multiple sur les transformations des relations Inuinnait-Qinmit(2021)] et sur divers enjeux sociaux, notamment la pauvreté, l'exclusion, l'itinérance, le principe de souveraineté, l'empowerment, la santé holistique ainsi que les rapports de force entre les Premiers Peuples et les divers paliers gouvernementaux.
Louise Nachet est candidate au doctorat en science politique à l’Université Laval, membre du CIÉRA Université Laval et du réseau MinÉrAL. Elle travaille sur les politiques autochtones, les économies extractives, les relations entre l'industrie minière et les communautés locales et la justice environnementale.
Notes
-
[1]
Fondé en 2014, et depuis implanté à Québec et à Gatineau, le Cercle Kisis est un organisme autochtone à but non lucratif oeuvrant au rapprochement entre les peuples et au rayonnement des cultures, des arts et patrimoines autochtones. « Kisis » signifie soleil en Anishinaabemowin, à l’image de ce rayonnement et du cycle de la lumière. Festivals, documentaires, conférences, projections, et discussions font partie du large éventail d’activités culturelles et artistiques que propose le Cercle KISIS chaque année au Québec. Le Cercle Kisis offre également, depuis 2019, des cours de langue autochtones à Québec et agit à titre de plateforme de diffusion pour les événements culturels et artistes autochtones. (CIÉRA 2021 : 12)
-
[2]
Une infection plus couramment appelée la « COVID-19 ».
-
[3]
Chaque région administrative s’est vue (ré)assigner un palier d’alerte, celui-ci a une couleur associée : vigilance (vert), préalerte (jaune), alerte modérée (orange) et alerte maximale (rouge).
-
[4]
Bien que le mot « allochtone » s’utilise habituellement comme adjectif ou en opposition au nom et adjectif « (A/a)utochtone », nous proposons d’employer le terme comme un nom propre. Nous mettons donc la majuscule à « Allochtone », dérogeant ainsi de la langue française et suivant la logique du terme « non-(A/a)utochtone ».
-
[5]
À cet égard, voir notamment Bellier 2020 ou encore le dossier de presse de Radio-Canada / Espaces Autochtones (p. ex., Josselin 2021 ; Jung 2021 ; La Presse canadienne 2021), de CTV News (p. ex., Wright 2020 ; Somos 2021) ou du journal La Presse (p. ex., Alhmidi 2021 ; Lévesque 2022).
-
[6]
Voici les quatre axes de réflexions et d’observations : 1) services publics ; 2) recherche comme institution ; 3) perspectives internationales ; 4) itinérances et urbanités.
-
[7]
Dans ce texte, une attention particulière est accordée à la féminisation, et ce, sous une forme épicène caractérisée ou non par le point médian (par exemple, les chercheur·euse·s).
-
[8]
Il est question ici de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès, présidée par l’honorable Jacques Viens.
-
[9]
« Une seule santé » est une approche transdisciplinaire qui vise à « optimiser la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes, et à trouver un équilibre entre ces dimensions. Elle utilise les liens étroits et interdépendants qui existent entre ces domaines pour créer de nouvelles méthodes de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci » (Organisation mondiale de la Santé 2023 : §1).
-
[10]
L'approche holistique de la santé, du bien-être et du mieux-être relève d'une théorie selon laquelle un individu doit être considéré dans sa globalité, en tenant en compte ses dimensions physique, mentale, émotionnelle et spirituelle – rappelant ainsi le concept du cercle sacré, c’est-à-dire la roue de médecine.
-
[11]
Nous reconnaissons que ces campagnes de vaccination ont fait l’objet de débats houleux, et nous ne prendrons pas position sur le sujet.
Bibliographie
- ALHMIDI, Maan, 2020, « Canada “must build back better” for Indigenous people after COVID-19: Bellegarde », CTV News, December 8, 2020. Retrieved from: https://www.ctvnews.ca/politics/canada-must-build-back-better-for-indigenous-people-after-covid-19-bellegarde-1.5221399.
- ALHMIDI, Maan, 2021, « Le racisme s’est amplifié contre les femmes autochtones, dit la ministre Bennett », La Presse, 8 mars 2021. En ligne : https://www.lapresse.ca/actualites/covid-19/2021-03-08/pandemie/le-racisme-s-est-amplifie-contre-les-femmes-autochtones-dit-la-ministre-bennett.php.
- BARRERA, Jorge, 2020, « Northern Ontario Fly-in First Nation Faces “crisis within a Crisis” after Second COVID-19 Case », CBC News, June 12, 2020. Retrieved from: https://www.cbc.ca/news/indigenous/fn-covid-case-1.5610517.
- BELAÏDI, Nadia et Geneviève KOUBI, 2020, « Covid-19 et peuples autochtones. Des ‘‘faits informatifs’’ sur une relation au monde (Enquête de mars à juin 2020) », La Revue des droits de l’homme. Revue du Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux.
- BELLIER, Irène, 2020, Les peuples autochtones face au Covid-19 : un tour d’horizon au 20 mai 2020. En ligne : https://shs.hal.science/halshs-03090131/.
- BLACK, Meg, 2020, « COVID-19 in Canada : Fears Mount That Indigenous Communities Could Be Left Behind », Global Citizen, April 16, 2020. Retrieved from: https://www.globalcitizen.org/en/content/covid-19-in-canada-indigenous-communities/.
- Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones – CIÉRA, 2021, Bien-être, services publics et territorialités autochtones : 19e colloque annuel du Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones [brochure de conférences], En ligne : https://ciera-recherches.ca/wp-content/uploads/2022/08/colloque_ciera-programme_2021.pdf.
- Conseil des Atikamekw de Manawan et Conseil de la Nation Atikamekw, 2020, Principe de Joyce, Présenté au gouvernement du Canada et au gouvernement du Québec. En ligne : https://www.atikamekwsipi.com/public/images/wbr/uploads/telechargement/Doc_Principe-de-Joyce.pdf.
- DEER, Ka’nhehsí:io, 2020, « Mural in Kahnawake, Que., honours community health-care workers », CBC News, November 6, 2020. Retrieved from: https://www.cbc.ca/news/indigenous/kahnawake-hospital-mural-heath-care-workers-1.5793170.
- ENI, Rachel, PHILLIPS-BECK, Wanda, KYOON ACHAN, Grace, LAVOIE, Josée G., KINEW, Kathi Avery and Alan KATZ, 2021, « Decolonizing Health in Canada: A Manitoba First Nation Perspective », International Journal for Equity in Health, 20(1) : 206. Retrieved from: https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-021-01539-7.
- FERRANTE, Lucas and Philip M. FEARNSIDE, 2020, « Protect Indigenous peoples from COVID-19 », Science, 368(6488) : 251‑251.
- First Nations Leadership Council, 2020, Canada Must Implement Clearer, Stronger Measures to Protect First Nations and All Canadians from the COVID-19 (Coronavirus) Pandemic, Press Release, March 17, 2020. Retrieved from: https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ubcic/mailings/2798/attachments/original/2020_March17_FNLC_CovidCanadaResponse.pdf?1584424675.
- First Nations Leadership Council, 2024, FNLC Dismayed by Lack of Progress in Improving First Nations Housing and Infrastructure, Press Release, March 22, 2024. Retrieved from: https://www.bcafn.ca/sites/default/files/docs/news/2024March22_FNLC%20Press%20Release_Auditor%20General%20Housing%20Report_Final.pdf.
- Gouvernement du Canada, 2012, Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l’action, Commission de vérité et réconciliation du Canada, Gouvernement du Canada.
- Gouvernement du Canada, 2023, Cas confirmés de COVID-19 ». Le coronavirus (COVID-19) et les communautés autochtones, Services aux Autochtones Canada, Gouvernement du Canada. En ligne : https://stc-ndm-prod-wc.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2024001/article/00001-fra.htm.
- Gouvernement du Canada, 2024, Lever les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable. En ligne : https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1506514143353/1533317130660.
- Gouvernement du Québec, 2019, Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès. Rapport final, Commission Viens - Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, Gouvernement du Québec.
- Government of Manitoba, 2021, COVID-19 Infections in Manitoba: Race, Ethnicity, and Indigeneity. External Report, March 1, 2021. Retrieved from: https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/surveillance/docs/rei_external.pdf.
- HAMEL-ROY, Laurence, FAUVEL, Mylène, LAURENCE-RUEL, Corynne et Yanick NOISEUX, 2021, Rapport de recherche. Le « Grand confinement » et l’action publique durant la première vague de la COVID-19 au Québec : Regards croisés sur les rapports de genre, de race et de classe dans quatre secteurs d'emploi, Montréal : GIREPS.
- HAHMANN, Tara et Mohan B. KUMAR, 2022, Les besoins en soins de santé insatisfaits pendant la pandémie et leurs répercussions sur les Premières Nations vivant hors réserve, les Métis et les Inuits, Statistique Canada, Gouvernement du Canada. En ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2022001/article/00008-fra.htm.
- HILLIER, Sean A., CHACCOUR, Elias, AL-SHAMMAA, Hamza and Jessica VORSTERMANS, 2020, « Canada’s response to COVID-19 for Indigenous Peoples: a way forward? », Canadian Journal of Public Health, 111(6) : 1000‑1001. Retrieved from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7654339/#CR4.
- HOULE, Marie-Josée, 2022, Reimagining housing policy in Canada: First Nations leadership, vision and voices, Speaking Notes, March 22-23, 2022. Retrieved from: https://www.housingchrc.ca/en/reimagining-housing-policy-canada-first-nations-leadership-vision-and-voices.
- HUYSER, Kimberley, YELLOW HORSE, Aggie J., COLLINS, Katherine A., FISCHER, Jaimy, JESSOME, Marie G., RONAYNE, Emma T., LIN, Jonathan C., DERKSON, Jordan and Michelle JOHNSON-JENNINGS, 2022, « Understanding the associations among social vulnerabilities, Indigenous peoples and COVID-19 cases within Canadian health regions ». International journal of environmental research and public health, 19 : 12409. Retrieved from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9566440/pdf/ijerph-19-12409.pdf.
- JOSSELIN, Marie-Laure, 2021, « Itinérance : ‘‘On gérait un jour à la fois ; avec la COVID, c’est une minute à la fois’’ », Radio-Canada/Espaces Autochtones, 14 janvier 2021. En ligne : https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1763349/covid-itinerance-montreal-refuge-autochtone.
- JUNG, Delphine, 2021, « ‘‘Si on perd nos aînés à cause de la COVID-19, on perd notre histoire, notre culture’’ », Radio-Canada/Espaces Autochtones, 19 janvier 2021. En ligne : https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1763538/deces-aines-pandemie-menace-aussi-heritage-autochtone.
- KAKOL, Monika, UPSON, Dona and Akshay SOOD, 2021, « Susceptibility of southwestern American Indian tribes to coronavirus disease 2019 (COVID‐19) », The Journal of Rural Health 37(1) : 197. Retrieved from: https://pmc-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/articles/PMC7264672/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc.
- KOPP, Amanda, KUMAR, Mohan B. et Nicole AITKEN, 2024, Mortalité attribuable à la COVID-19 chez les Premières Nations et les Métis vivant dans un logement privé au Canada : une analyse des déterminants sociaux de la santé et des inégalités en matière de santé, Statistique Canada, Gouvernement du Canada. En ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/45-28-0001/2024001/article/00001-fra.pdf?st=jZ0dOP4G.
- KOVESI, Thomas, 2012, « Respiratory disease in Canadian First Nations and Inuit children », Paediatrics & Child Health, 17(7) : 376‑380. Retrieved from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3448538/.
- KOVESI, Thomas, MALLACH, Gary, SCHREIBER, Yoko, MCKAY, Michael, LAWLOR, Gail, BARROWMAN, Nick, TSAMPALIEROS, Anne, KULKA, Ryan, ROOT, Ariel, KELLY, Len, KIRLEW, Michael and J. David MILLER, 2022, « Housing conditions and respiratory morbidity in Indigenous children in remote communities in Northwestern Ontario, Canada », Canadian Medical Association Journal, 194(3) : E80-E88. Retrieved from: https://www.cmaj.ca/content/194/3/E80.
- La Presse canadienne 2021, « La scientifique qui protège les Mohawks contre la COVID-19 », Radio-Canada/Espaces Autochtones, 23 janvier 2021. En ligne : https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1765395/kahnawake-coronavirus-mesures-pandemie-annick-gauthier.
- LANE, Rosemary, 2020, The impact of COVID-19 on indigenous peoples. Policy brief No. 70, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
- LATOUCHE, Guy, 2018, « Les Premières Nations au Québec et le droit au logement », LDL - Ligue des droits et libertés, 14 mai 2018. En ligne : https://liguedesdroits.ca/les-premieres-nations-au-quebec-et-le-droit-au-logement/.
- LAVOIE, Josée G., 2023, Le droit à la santé issu de traités et l’héritage de la Politique sur la santé des Indiens (1979) : considérations législatives et stratégiques contemporaines. En ligne : https://afn.bynder.com/m/6050d5e8ebd50d7/original/Le-droit-a-la-sante-issu-de-traites-et-L-heritage-de-la-politique-sur-la-sante-des-Indiens-1979-Josee-Lavoie.pdf.
- LÉVESQUE, Fanny, 2022, « Les communautés autochtones frappées de plein fouet », La Presse, 11 janvier 2022. En ligne : https://www.lapresse.ca/actualites/covid-19/2022-01-11/variant-omicron/les-communautes-autochtones-frappees-de-plein-fouet.php.
- Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 2021, L.C. ch. 14. En ligne : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/u-2.2/.
- LOPPIE, Charlotte and Fred WIEN, 2022, Understanding Indigenous health inequalities through a social determinants model. Prince George : National Collaborating Centre for Indigenous Health. Retrieved from: https://www.nccih.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/10373/Health_Inequalities_EN_Web_2022-04-26.pdf.
- MASHFORD-PRINGLE, Angela, SKURA, Christine, STUTZ, Sterling and Thilaxcy YOHATHASAN, 2021, What we heard: Indigenous peoples and COVID-19, Supplementary Report for the Chief Public Health Officer of Canada’s Report on the State of Public Health in Canada, Toronto: Waakebiness-Bryce Institute for Indigenous Health. Retrieved from: https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/corporate/publications/chief-public-health-officer-reports-state-public-health-canada/from-risk-resilience-equity-approach-covid-19/indigenous-peoples-covid-19-report/cpho-wwh-report-en.pdf.
- NACHET, Louise et Sabrina BOURGEOIS, 2022, « Miner à tout prix : discours sur l’extraction minière en territoires autochtones durant la COVID-19 », Revue d’études autochtones, 52(1) : 113‑23.
- NARASIMHAN, Subasri and P. Paul CHANDANABHUMMA, 2021, « A Scoping Review of Decolonization in Indigenous-Focused Health Education and Behavior Research », Health Education & Behavior, 48(3) : 306‑19.
- O’BRIEN, Kathy, ST-JEAN, Marylène, WOOD, Patricia, WILLBOND, Stephanie, PHILLIPS, Owen, CURRIE, Duncan et Martin TURCOTTE, 2020, Comorbidités liées aux décès impliquant la COVID-19 au Canada, Statistique Canada, Gouvernement du Canada. En ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00087-fra.htm.
- Organisation des Nations Unies — ONU, 2008, Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Nations Unies. En ligne : https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf.
- Organisation mondiale de la Santé – OMS, 2023, « Une seule santé », OSM, 23 octobre 2023, En ligne : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/one-health.
- PATTERSON, Dayne, 2021. « COVID-19 : A Look at the Numbers in First Nations Communities in the West », APTN News, July 6, 2021. Retrieved from: https://www.aptnnews.ca/national-news/covid-19-western-canada-federal-government-pandemic/.
- READING, Charlotte Loppie and Fred WIEN, 2009, Health inequalities and social determinants of Aboriginal peop’ss’ health. Prince Geore : National Collaborating Centre for Aboriginal Health. Retrieved from: https://www.nccih.ca/docs/social%20determinates/NCCAH-Loppie-Wien_Report.pdf.
- SHAHEEN-HUSSAIN, Samir, 2021, Plus aucun enfant autochtone arraché : Pour en finir avec le colonialisme médical canadien, Montréal : Lux Éditeur.
- SMYLIE, Janet, 2020, « Indigenous Communities, Systemic Racism and COVID-19: Interview with Dr. Janet Smylie », MAP Centre for Urban Health Solutions. Retrieved from: https://maphealth.ca/indigenous-communities-systemic-racism-and-covid-19/.
- SMYLIE, Janet, MCCONKEY, Stephanie, RACHLIS, Beth, AVERY, Lisa, MECREDY, Graham, BRAR, Raman, BOURGEOIS, Cheryllee, DOKIS, Brian, VANDEVENNE, Stephanie and Michael A. ROTONDI, 2022, « Uncovering SARS-COV-2 vaccine uptake and COVID-19 impacts among First Nations, Inuit and Métis peoples living in Toronto and London, Ontario ». Canadian Medical Association Journal, 2 (194) : E1018-1026. Retrieved from: https://www.cmaj.ca/content/194/29/E1018.
- SOMOS, Christi, 2021, « A year later, Indigenous communities are fighting twin crises: COVID-19 and inequality », CTV News, January 25, 2021. Retrieved from: https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/a-year-later-indigenous-communities-are-fighting-twin-crises-covid-19-and-inequality-1.5280843.
- WAWANOLOATH, Maxime Auguste, 2021, « Les Autochtones face à la pandémie de la COVID-19 », Nouveaux Cahiers du socialisme, (25) : 42-49.
- WILLIAMS, Naomi G., ALBERTON, Amy M. and Kevin M. GOREY, 2022, « Morbid and mortal inequities among Indigenous people in Canada and the United States during the COVID-19 pandemic critical review of relative risks and protections », Journal of Indigenous social development, 11(1) : 3-32.
- WRIGHT, TERESA, 2020, « Indigenous group files legal challenge over 'inadequate' COVID-19 funding », CTV News, May 13, 2020. Retrieved from: https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/indigenous-group-files-legal-challenge-over-inadequate-covid-19-funding-1.4937682.
- YANG, Fei-Ju et Nicole AITKEN, 2021, Les personnes qui vivaient en appartement ou au sein d’un ménage plus nombreux étaient plus à risque de mourir de la COVID-19 au cours de la première vague de la pandémie, Statistique Canada, Gouvernement du Canada. En ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2021001/article/00004-fra.htm.
- YANGZOM, Kelsang, MASOUD, Huda et Tara HAHMANN, 2023, Accès aux soins de santé primaires chez les membres des Premières Nations vivant hors réserve, les Métis et les Inuit, 2017 à 2020, Statistique Canada, Gouvernement du Canada. En ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/41-20-0002/412000022023005-fra.htm.
Liste des figures
Figure 1