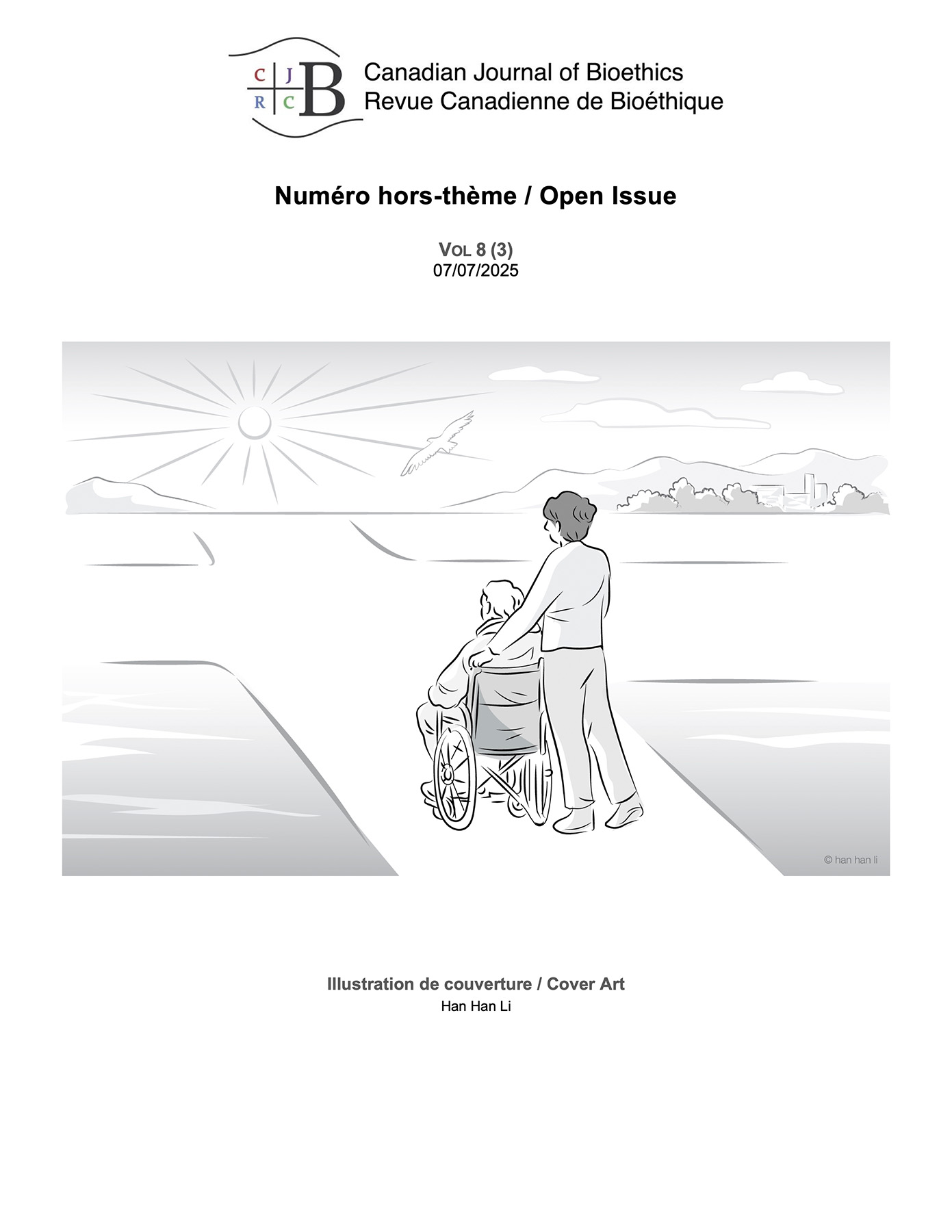Résumés
Résumé
Ce compte rendu critique comprend un résumé de la pièce de théâtre « Une vie intelligente », lequel est suivi d’un commentaire critique. Ce faisant, une perspective critique sur la forme et le contenu de la pièce est articulée.
Mots-clés :
- intelligence artificielle,
- ère numérique,
- technologies de l’information,
- technologies numériques,
- domination technologique
Abstract
This critical review includes a summary of the play “An Intelligent Life”, followed by a critical commentary. In so doing, a critical perspective on the form and content of the play is articulated.
Keywords:
- artificial intelligence,
- digital age,
- information technology,
- digital technologies,
- technological domination
Corps de l’article
introduction
Les technologies numériques, incluant l’intelligence artificielle (IA), se sont imposées à nous, sans que nous ayons notre mot à dire. Sournoisement et quasiment du jour au lendemain, lentement, elles se sont intégrées à notre quotidien et ont changé nos vies, certains diront pour le mieux, d’autres pour le pire. « Comment résister, collectivement et individuellement, aux monopoles technologiques et à la puissance des algorithmes? Comment repenser notre rapport au numérique de façon plus équitable et durable? » (1), telles sont les questions phares de la pièce de théâtre « Une vie intelligente », qui fut présentée au théâtre Jean Duceppe, à Montréal, du 26 février au 29 mars 2025. Ce texte consiste en un compte rendu critique de cette pièce. Il comprend deux parties : un résumé et une perspective critique.
Compte rendu
La pièce de théâtre « Une vie intelligente » a été écrite par Dominique Leclerc qui est co-directrice de Posthumains, une compagnie de création qui s'intéresse à « l'impact du développement des technologies NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l’information et sciences cognitives) sur le vivant » (2). En plus d’être autrice de la pièce, Dominique Leclerc en est l’interprète principale et sa co-metteuse en scène. Produite en collaboration avec l’Université de Montréal, la pièce porte sur le rapport des humains avec les technologies numériques, incluant l’IA. Thomas Emmaüs Adetou, un doctorant en philosophie à cette université dont les recherches actuelles portent sur « l’éthique des machines » (3), joue dans la pièce, en compagnie de six autres interprètes.
La pièce a pour point de départ le moratoire international sur le développement des systèmes d’IA réclamé en 2023 par une centaine de scientifiques, mais auquel aucune suite n’a été donnée. Il s’agit, le temps de la pièce, de réaliser ce moratoire. Après un bref historique du développement des technologies numériques, incluant une vidéo de Yoshua Bengio, professeur au Département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal considéré comme l’un des pères fondateurs de l’intelligence artificielle et pionnier de l'apprentissage profond (4), Dominique Leclerc nous invite à prendre « un peu de recul, loin de nos appareils intelligents, pour retrouver l’élan d’imaginer un futur différent? » (1). Le public est ainsi invité, pendant l’heure et les 45 minutes qui suivent, à faire une pause pour réfléchir aux impacts du numérique sur sa vie.
Plusieurs thèmes sont abordés comme les impacts de l’IA sur la vie démocratique, l’éducation, l’environnement, les liens sociaux, la souveraineté humaine, la réponse à des besoins affectifs, les personnes qui trient et récoltent les déchets numériques, etc. À divers moments durant la pièce, le public est invité à faire des choix et à se prononcer sur des thèmes ciblés comme la littératie numérique, le pouvoir d’agir ou l’environnement et un groupe de citoyens ciblés préalablement monte sur scène pour réfléchir au thème choisi par le public. Avec l’aide d’une prospectiviste, Catherine Mathys (5), ce groupe non-acteur ira dans une salle attenante à la scène pour co-imaginer un futur loin des dystopies pour le Québec de 10 ans dans le futur.
Perspective critique
En dépit du fait qu’à un moment donné durant la pièce, le public soit confronté à sa difficulté à vivre de l’ennui (pendant plusieurs minutes, il ne se passe strictement rien et c’est voulu), la pièce est loin d’être ennuyante. Diverses modalités scéniques sont utilisées pour donner un rythme entrainant et ludique à la pièce comme l’utilisation d’ombres chinoises pour narrer la genèse de l’IA et la diffusion d’une vidéo de Yoshua Bengio qui fait partie des scientifiques ayant demandé le moratoire sur le développement de l’IA. Pour soutenir l’attention du public, la mise en scène créative simule une rencontre zoom pour aborder des enjeux de l’usage de l’IA en éducation, utilise des monologues touchants où un ou une interprète met l’accent sur un enjeu spécifique et déploie des numéros théâtraux dansants et rythmés par une musique techno. Aussi, des discussions à distance avec la prospectiviste qui encadre le travail du groupe de citoyens sont réalisées, de même que des sondages à mains levées menés auprès du public. De plus, des vox pop réalisés avec des enfants sont diffusés. En somme, l’attention du public est sollicitée comme si celui-ci scrollait son téléphone. Le rythme entrainant de la pièce, les changements rapides de mise en scène et la diversité des tableaux dépeint créent ce sentiment chez l’auditoire. De fait, la pièce passe vite, peut-être un peu trop vite. On peine parfois à saisir toute la complexité et la profondeur du propos. Assurément la créativité et l’innovation ont été mobilisées pour rendre la pièce en cohérence avec la vie à l’ère du numérique.
Le contenu est dense. Dominique Leclerc aura voulu ratisser large, faire un bon tour des différents enjeux de notre usage individuel et collectif de l’IA. Or comme ceux-ci sont nombreux et préoccupants, le public peut être pris d’un vertige. Mais ne voulant pas opter pour un « discours moralisateur ou alarmiste » (1), l’autrice a fait appel à Catherine Mathys, une prospectiviste, pour mobiliser la voix citoyenne dans un projet collaboratif imaginatif non dystopique. Car il ne s’agit pas de traumatiser le public, mais de le laisser avec une forme d’espoir ainsi qu’avec des outils (par exemple, des ressources sont partagées avec le public à la sortie du théâtre via un code QR) pour mieux naviguer les enjeux. Donnant tantôt la voix aux détracteurs du numérique, tantôt à ceux qui l’encensent, la pièce tente un difficile équilibre entre ces pôles pour le moins opposés. C’est comme si l’autrice n’avait pas voulu décider pour le public, voulait plutôt semer des graines, le faire réfléchir. Plus encore, c’est comme si l’autrice avait tenu pour acquis que l’IA était là pour rester et que devant cette fatalité numérique, il fallait tenter à la fois comme personne et comme humanité de s’en accommoder bon an mal an, tout en minimisant ses conséquences.
Pourtant, plusieurs enjeux très préoccupants sont abordés, lesquels font, me semble-t-il, facilement le poids devant les avantages. Pensons par exemple au fait que des enfants en situation de pauvreté soient exploités pour extraire les minéraux requis pour fabriquer les téléphones intelligents (6), que des personnes africaines tombent malades en triant les montagnes de déchets que génère notre surconsommation des technologies numériques ou que des personnes racialisées soient traumatisées par les vidéos cruels et violents qu’elles visionnent sur le dark web dans le but d’alimenter les systèmes d’IA (7). Ces situations d’injustice et d’oppression ne sont-elles pas suffisamment graves pour qu’elles soient interdites et que les compagnies responsables condamnées en justice? Pensons ensuite à l’empreinte carbone titanesque de la fabrication et de l’utilisation de l’IA, aux nombreux déchets générés par les centres de données et à l’utilisation d’une très grande quantité d’eau pour refroidir les centres de données — c’est-à-dire au fait d’utiliser les systèmes d’IA si destructeurs de l’environnement dans un monde pourtant confronté à une crise climatique sans précédent (8). L’importante participation à l’écocide en cours n’est-il pas une autre raison suffisante pour exiger des GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) de ce monde des pratiques plus écoresponsables et plus justes dès maintenant? Pensons ensuite au fait qu’un nombre croissant d’individus développent une forte dépendance à ces technologies, qui par ailleurs participent à la diminution de leurs capacités cognitives, que celles-ci érodent nos liens sociaux, donnent lieu à de l’intimidation, de l’exploitation sexuelle et de la cyber violence. Ne devrions-nous pas nous préoccuper davantage des impacts du numérique sur la santé publique? Comme ce fut le cas pour la cigarette et la vapoteuse, il semble que nos sociétés soient mal équipées pour lutter contre des compagnies à but lucratif qui n’ont rien à foutre du bien-être collectif.
En conclusion, si vous souhaitez découvrir ce qu’est le techno-féodalisme et en apprendre davantage sur les impacts du numérique, la pièce de théâtre « Une vie intelligente » est un incontournable, de même que les autres ouvrages eu oeuvres de l’autrice (9). Elle devrait faire une tournée panquébécoise dans nos écoles, cégeps et universités.
Parties annexes
Bibliographie
- 1. Duceppe. Une vie intelligente. La Compagnie Jean Duceppe; 26 février au 29 mars 2025.
- 2. Bio & Cv. Dominique Leclerc.
- 3. Thomas Emmaüs Adetou. Centre de recherche en éthique.
- 4. Yoshua Bengio. Wikipedia l’encyclopédie libre; 11 février 2025.
- 5. Catherine Mathys. La Compagnie Jean Duceppe.
- 6. Amnesty International. Le travail des enfants derrière la production de smartphones et de voitures électriques. 19 janvier 2016.
- 7. Muldoon J, Graham M, Callum C. Feeding the Machine: The Hidden Human Labour Powering AI. Oxford: Canongate; 2024.