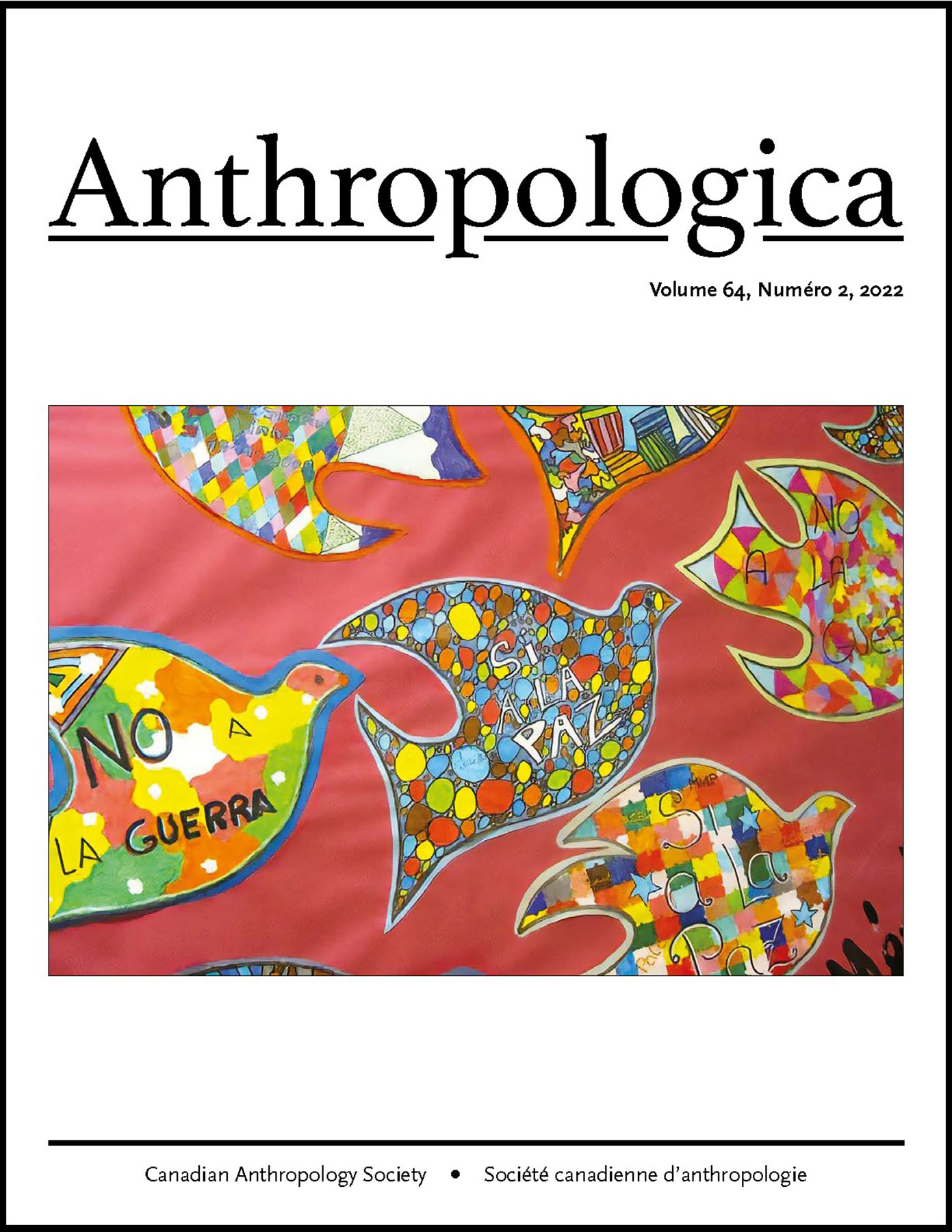Corps de l’article
Construire l’ethnologie en Afrique coloniale présente les actes d’un colloque organisé dans le cadre d’un « programme ANR/DFG Anthropos » (p. 7, note 2 ; p. 23). Le texte est bien écrit, clair, dans un style non jargonnant. Il est d’une lecture agréable, accessible à tout public. L’ouvrage est très documenté, notamment à travers les bibliographies accompagnant les contributions. Le lecteur appréciera également les documents iconographiques d’époque qui viennent compléter le texte et ajouter à la compréhension de l’ouvrage.
La première partie, « ethnologie et colonialisme », expose les faits contribuant à la construction de l’ethnologie aussi bien pendant la période pré-coloniale que celle coloniale à travers des voyages, dont ceux d’Heinrich Barth (1849-1855), celui des frères (Antoine et Arnaud) d’Abbadie (1838-1849), celui de Richard Thurnwald (juin 1930-avril 1931) et enfin, ceux de Leo Frobenius (1905-1929). Il est, ici, question d’une ethnologie en cours d’élaboration avec des acteurs non ethnologues. L’argumentaire scientifique est celui de la géographie, préfigurant ainsi une proximité des deux disciplines encore d’actualité.
La deuxième partie, « images et collections africaines », est pertinente, mais quelque peu problématique. Elle implique deux composantes de l’ethnologie : la culture matérielle et l’anthropologie visuelle. Les trois contributions la composant sont diversement inscrites dans le sujet du livre. La première, qui expose une histoire des collections ethnographiques dans deux royaumes du sud de l’Allemagne, la Bavière et le Wurtemberg, établit une histoire de ces royaumes par les collections coloniales. L’ethnologie est alors concernée ; une ethnologie s’édifiant selon deux visions : la volskunde, s’intéressant à l’identité populaire allemande ; et la völkerkunde, s’ouvrant aux autres cultures. L’ethnologie, en construction, passe par les musées ayant une politique d’acquisition instituée par les collectes. Ainsi, le chapitre montre un engagement des autorités politiques pour des collections au bénéfice des musées. Par ce biais, ceux-ci deviennent une vitrine pour le politique et donc pour l’action coloniale. Cette relation du politique au musée, conséquence de celle du politique à l’ethnologie implique un paradigme épistémologique légitime, celui du rapport entre ethnologie et musée. Malheureusement, les musées ne fournissent pas de réelles connaissances sur les populations à partir des objets. La construction de l’ethnologie par les collections est alors davantage dans le principe que dans la diffusion des représentations sociales, des objets.
Ces connaissances sont d’autant moins établies que le chapitre, « L’impossible collecte ? », qui présente le regard occidental sur les Africains, expose une perception assez décalée. En effet, ce regard posé sur les Noirs, par des Allemands, à partir d’images publiées dans des revues et documents d’illustrations, est raciste. Le texte montre, avec pertinence, que la connaissance des cultures africaines n’est absolument pas l’enjeu. C’est pourquoi, lorsque l’image bénéficie d’un intérêt ethnographique, le commentaire vient supplanter cet intérêt. Ce chapitre présente l’orientation d’une ethnologie raciste qui marqua la construction générale de la discipline laissant apparaître, dans sa forme institutionnalisée, le courant évolutionniste.
Le dernier chapitre (« Ars UNA ou le rêve d’un musée universel ») de cette partie entend présenter la « vision des galeristes et des collectionneurs » d’objets d’art extra-européens, notamment, à compter du début du XXe siècle. Ce texte, qui établit les relations entre les marchands, les galeristes, les collectionneurs et les musées, laisse comprendre que l’enjeu, de tous ces rapports, est la légitimation des objets extra-européens comme oeuvres d’art à l’image de l’art européen, d’où l’idée d’un « musée universel ». Cette ambition provoqua un débat bien connu, depuis 1920, avec la fameuse enquête de Félix Fénéon dont un questionnaire avait été adressé à des écrivains, poètes, ethnologues et autres intellectuels et dont l’objectif était d’appeler à l’entrée au Louvre des oeuvres d’art primitif. Un tel débat fut renouvelé, en France, en 1995, ce qui a abouti à la création d’un établissement public, le musée du Quai Branly. Par cette initiative, Jacques Chirac affirmait ainsi l’impossibilité d’un art unique et le non-sens de la notion d’un musée universel. L’enjeu aura eu pour mérite de susciter des positionnements épistémologiques donnant naissance à des courants : anthropologie de l’art, anthropologie de l’objet. En cette perspective, ce texte, par ricochet, inscrit le développement de la jeune science dans une orientation épistémologique à partir d’un objet précis : l’art.
La troisième partie de l’ouvrage présente l’action des « médiateurs africains ». Transformés par l’école européenne, ils sont entre les sociétés autochtones et le monde colonial, une position difficile à tenir, car perçus par les Africains comme déracinés et par les Européens comme pouvant s’opposer à l’action coloniale. Ce fut le cas de Boubou Hama. Situé entre la parole locale et celle administrative, l’intermédiaire africain est un « informateur » participant à la production d’un savoir établi comme « le produit d’une chaîne de médiations » (p. 164). Devenant ethnologue lui-même, il est un traducteur ; c’est ce que fut Amadou Hampâté Bâ, l’homme de la science orale collectant les traditions africaines qu’il rend en français, une langue étrangère. Dans la transcription et la traduction, Hampâté Bâ et Boubou Hama, chacun à sa manière, travaillant tantôt pour des Européens, tantôt pour soi-même, ont établi un espace patrimonial comme moyen de préservation et donc de sauvegarde des savoirs africains, même si pour Boubou Hama, dans sa première position, ces savoirs sont infondés, archaïques et donc incapables de contribuer au développement. Aujourd’hui, il n’est pas certain qu’une telle position soit totalement et entièrement éradiquée en Afrique ; en témoigne la quasi-absence institutionnelle de l’ethnologie dans les universités africaines.
Par ailleurs, et paradoxalement, la parole du médiateur africain ethnologue est introduite par une personnalité européenne jugée plus légitime, comme si un Africain ne pouvait faire oeuvre scientifique, lui qui, pourtant, se trouve à la source de la matière servant à la construction de la science. « Le rôle de médiateur ou de traducteur culturel [revenant] à l’administrateur ou à l’ethnologue [européen nécessairement]. » (p. 164). Un Autochtone ne saurait être ethnologue. Dans ce contexte, il est heureux d’apprendre qu’Henrique De Carvalho percevait favorablement ses intermédiaires, et défendait une posture de la « vertu du dialogue entre Européens et Africains » (p. 186). Bien qu’il ne fût pas « exempt d’exaspération et d’attitudes violentes sur le terrain » et sans renier la croyance en « la supériorité évolutive de la culture européenne de son temps » (p. 186), il souhaitait s’engager dans des relations franches avec les Africains, rejetant les préjugés raciaux et ceux de la supériorité des Européens sur les Africains. C’est pourquoi, pour lui, les Noirs (« ces compagnons » de chemin qu’il « n’oubliera jamais »), d’où qu’ils viennent quoiqu’ils soient, et quelque puisse être leur statut social « sont des hommes de sentiments » (p. 183) possédant « les mêmes affects et les mêmes penchants que nous-mêmes » (p. 184). Comment, ici, ne pas penser à Franz Boas décrivant les Inuit après son voyage de 1883 à l’île de Baffin !
Enfin, la quatrième partie s’intéresse à la « décolonisation des savoirs » dans la période post-coloniale. Les contributions, pertinentes, sont de qualité variable quant à la conformité de leur contenu au sujet de l’ouvrage. La première, s’interrogeant sur l’invention de l’ethnie par le système colonial, est très à propos. Elle montre, en effet, et selon une trame historique, que le regroupement des ensembles sociaux occupant un même territoire a donné naissance à des appellations qui ne correspondent pas à des configurations ethniques reconnues par les populations, même si quelquefois, cela peut créer une adhésion à un sentiment d’appartenance ; on peut le noter avec le Sénoufo. Bien que située dans la post-colonie, cette étude traite du sujet, notamment par la méthode de la classification utilisée avec l’appui de l’anthropologie physique qui, critiquée, participe du développement de la discipline.
La troisième contribution est également pleinement inscrite dans le sujet de l’ouvrage. Traitant de la musique, l’étude est technique, mais il y est surtout question de collecte de « vibrations sonores ». La pratique effective de l’enquête révèle une dense application de l’ethnographie. Que ce soit avec Léon Azoulay ou avec Herbert Pepper, qui ouvrira les archives culturelles du Sénégal à partir de 1967 à la demande de Léopold Sédar Senghor et après avoir dirigé l’ORSTOM à Libreville de 1960 à 1966, la collecte de la musique passe toujours par un sociogramme des acteurs, leur contexte social, les langues utilisées, les appartenances identitaires et donc ethniques, une notation de la musique et bien évidemment une photographie des acteurs, des instruments et l’enregistrement sonore à la faveur du phonographe ou du magnétophone, selon les époques. Il s’agit d’un réel déploiement de l’enquête ethnographique qui, examinant la musique, aborde plus amplement la vie des acteurs.
Enfin la contribution traitant de l’IFAN (Institut français d’Afrique noire qui deviendra l’Institut fondamental), dresse une histoire de l’instauration de la recherche en Afrique sur le modèle de la métropole coloniale d’Afrique noire française à l’indépendance. Cette histoire qui s’enracine dans le muséum d’histoire naturelle et le musée de l’Homme, à Paris, est reproduite en Afrique à travers l’IFAN de Dakar considéré comme une dépendance ayant, à son tour, d’autres dépendances que furent les centres IFAN créés dans les capitales des futurs pays indépendants de l’Afrique occidentale française.
Cette histoire de la recherche aboutit à la présentation d’une politique scientifique générale qui touche à différentes disciplines et s’occupe de la gestion de la recherche ainsi que de l’organisation de ses structures. À partir de là, le rapport entre science et politique devient inévitable et c’est probablement en cet enjeu qu’est redessiné le paradigme colonial dans lequel se joue l’émergence de l’ethnologie. Cette étude, bien qu’intéressante pour l’histoire de la construction de la science en rapport avec l’action coloniale en générale, offre une place assez marginale à la construction de l’ethnologie proprement dite. Il faut attendre la fin de la contribution et en particulier dans le dernier texte cité de Théodore Monod pour voir affirmer clairement et de manière quasi programmatique, l’enjeu de l’ethnologie pour des générations futures d’Africains.
En conclusion, Construire l’ethnologie en Afrique coloniale compte désormais dans l’histoire de la discipline malgré la relative disparité des contributions dans la conformité des contenus au sujet de l’ouvrage. Mais cet inconvénient peut être pondéré par la catégorie, Actes de colloques, qui impose, de fait, une écriture à mains multiples. Par ailleurs, la critique trouve une réponse possible dans l’introduction qui met le livre en contexte et en cohérence dans une présentation partie par partie. Il s’agit, en effet, d’une précaution méthodologique salutaire qui prépare le lecteur. En outre, cette même introduction établit une contextualisation thématique, organisée autour de l’histoire épistémologique de l’ethnologie, appréhendée sous le prisme d’une « histoire du terrain » et de son institutionnalisation (p. 7). C’est précisément par un attachement à ce paradigme que se conçoit l’unité de cet ouvrage. Malheureusement, cet attachement n’est pas toujours explicitement déployé par les différentes contributions.
Enfin, et c’est la seule réserve substantielle du lecteur, pourquoi l’absence de Marcel Griaule comme voyageur ethnographe dans cette construction de l’ethnologie, notamment par le terrain et surtout avec son institutionnalisation ? Est-il possible, dans ce livre, avec ce titre et avec cette présentation de l’introduction qui met le terrain au centre de l’argument scientifique, de passer sous silence les missions de Griaule et surtout celle de 1931 qui reçut le soutien, sans réserve, de l’État français ? Est-il besoin de préciser que la Loi du 31 mars 1931, destinée à donner un cadre juridique au soutien de l’État, fut votée favorablement à l’unanimité des parlementaires !