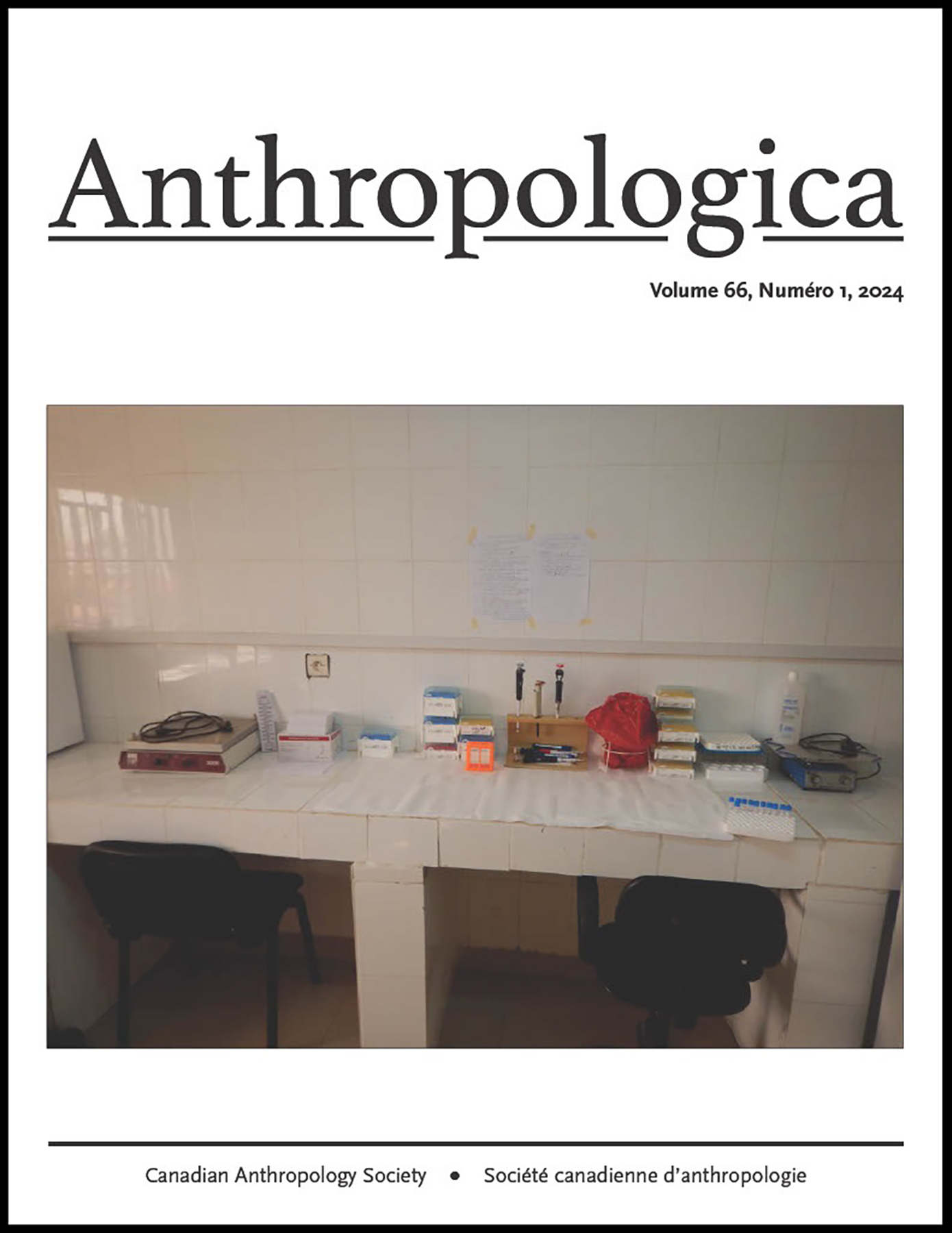Corps de l’article
À ce jour, L’Invention de la civilisation occidentale est le seul livre de l’anthropologue Thomas Patterson à avoir été traduit en français. Le but premier de cet ouvrage est de saisir anthropologiquement l’idée même de civilisation et des hiérarchies créées artificiellement entre les « civilisés » et les « non-civilisés » afin de remettre en question la position favorisée des élites (p. 26). L’approche est tour à tour historique, philosophique, anthropologique, voire même transdisciplinaire, puisque l’auteur part du concept de civilisation – et du concept de stratification sociale – pour l’explorer et l’articuler sous diverses dimensions, sans s’encombrer des cadres disciplinaires qui constitueraient des obstacles plutôt que des guides.
Un postulat fonde toute l’argumentation de L’Invention de la civilisation occidentale. Selon Thomas Patterson, professeur de psychologie affilié à l’Université de Californie, « des économistes français et écossais inventèrent le mot civilisation dans les années 1760-1770 afin de réfuter l’accusation de Jean-Jacques Rousseau qui affirmait que les hommes étaient moralement corrompus par la vie dans une société civilisée, et que ni une éducation plus conséquente ni le désir d’être meilleur que les autres n’avaient amélioré la condition humaine » (p. 47 ; voir aussi p. 77). Tout le premier quart de l’ouvrage révise et commente ce concept évanescent de civilisation, parfois comprise de manière péjorative ou discriminante. Or, Thomas Patterson la conçoit plutôt comme une sorte de construction sociale : « la civilisation n’est pas une chose : c’est une idée, un concept, une manière d’organiser la réalité » (p. 25).
L’Invention de la civilisation occidentale se divise en cinq chapitres brefs portant sur : 1) l’invention du mot « civilisation » ; 2) les principaux penseurs ayant promu cette idée ; 3) la critique de la civilisation et du colonialisme à partir du XVIe siècle ; 4) l’invention des « barbares » et d’autres incivilisés ; et enfin, 5) les discours et modes d’expression de ceux qui sont considérés comme étant « incivilisés ». Il n’y a pas vraiment de conclusion ni de récapitulation.
Le chapitre d’ouverture semblerait peut-être moins bien fondé sur le plan de la documentation académique ; l’auteur s’appuyant sur des articles de journaux, quotidiens états-uniens et magazines (comme le New Yorker) pour étayer sa problématique centrée sur la dilution apparente de la civilisation aux États-Unis. Ce manque de balises savantes ou fondées sur des articles parus dans des revues (avec des articles évalués par les pairs) étonne d’emblée ; on le reprocherait même à un étudiant de maîtrise. Néanmoins, les pages qui suivent reprennent l’argumentation du fameux essai du professeur Samuel Huntington sur Le Choc des civilisations (1996), et sur les identités civilisationnelles, pour élaborer le questionnement initial, axé sur les origines des inégalités sociales et culturelles (p. 26).
Le deuxième chapitre sur « la civilisation et ses laudateurs » apporte un long détour historique (pp. 32-52) sur dix siècles de rêves, d’espoirs et d’utopies sur le progrès, avant d’entrer spécifiquement dans l’analyse anthropologique proprement dite, par exemple en réitérant la réflexion de Julian Steward autour des mécanismes selon lesquels les changements industriels (comme ceux vécus dans l’Angleterre du XIXe siècle) pouvaient enclencher des mutations culturelles à grande échelle (quant aux modes de vie des classes ouvrières) (p. 58-59).
Le troisième chapitre, alignant une suite de critiques de la civilisation occidentale, s’apparente à un exercice d’anthropologie historique reprenant les idées fondatrices de nombreux philosophes et en particulier Montaigne, Nietzsche et Freud sur la conception de « l’Autre » (p. 65-95). Ce chapitre ressemble davantage à un état des lieux et ce bref survol historique s’arrête avec les années 1930, ce qui laisse le lecteur sur sa faim.
Peut-être le plus stimulant de tous, le quatrième chapitre sur l’invention de la barbarie – et de la nouvelle barbarie – est, comme les précédents, très centré sur l’histoire récente des États-Unis. Quelques éléments statistiques et démographiques sont amenés afin de bien saisir l’effritement de l’influence européenne sur le continent américain en l’espace d’un siècle : ainsi, aux États-Unis, « au début du XXe siècle, quatre-vingt-quinze pour cent des immigrés venaient d’Europe », tandis que dans la dernière moitié du XXe siècle, c’est soixante-quinze pour cent de la population immigrante qui provenait alors de l’Asie et de l’Amérique latine (p. 130). Selon Patterson, cette mutation profonde aurait contribué à la naissance d’une « politique identitaire » aux États-Unis (p. 130), qui est ici dénoncée. En outre, l’auteur s’inquiète du retour d’une conception contestée voulant que « ce seraient les différences raciales plutôt que le racisme qui auraient jeté les bases de l’inégalité sociale » (p. 130). Pour finir, le dernier chapitre porte sur les manières de formuler ou d’exprimer le rejet des hiérarchies et des élites.
On peut reconnaître certaines qualités à L’Invention de la civilisation occidentale : sa concision, sa clarté, son prix avantageux, sans oublier le style vivant de l’auteur. Du point de vue pédagogique, chaque chapitre se clôt par une synthèse de deux pages. Tout au long de l’exposé, le lecteur se pose deux questions persistantes : d’abord, à quel lectorat se destine ce livre ; et ensuite, ce qu’il apporterait de vraiment nouveau. On comprend très vite que Patterson s’adresse exclusivement à ses étudiants californiens et qu’il n’a pas en tête un éventuel lecteur au-delà des frontières des États-Unis. On pourrait imaginer des étudiants du niveau du baccalauréat ou des cégépiens capables d’apprécier ce livre engagé. Des étudiants de maîtrise en sciences sociales ou en philosophie politique pourraient également en tirer profit. Quant aux apports réels de cet exposé, au-delà de la récapitulation historique et de la critique sociale qui lui est inhérente, celle-ci serait plus contestable. Certes, la triple critique de la civilisation, du mythe du progrès et des élites reprise ici avec force par Thomas Patterson demeure indéniablement pertinente, mais sans être vraiment nouvelle. Même avant les années 1990 (à l’époque où cet essai a été rédigé), il existait des ouvrages classiques sur les dynamiques des élites comme L’Élite au pouvoir (1956), de Charles Wright Mills, et des critiques nuancées sur les illusions du progrès social apporté par l’innovation technique, par exemple dans les trois livres de Jacques Ellul sur la technique (comme Le Bluff technologique), ou encore dans Les désillusions du progrès : Essai sur la dialectique de la modernité de Raymond Aron, paru en 1969 et repris intégralement dans l’anthologie Penser la liberté, penser la démocratie (2005). Ces ouvrages fondamentaux couvrant le même sujet de L’Invention de la civilisation occidentale ne sont même pas mentionnés ici. Ils constituent non seulement des préalables, mais des ouvrages ayant atteint le statut de « classiques » et qui demeurent nettement supérieurs aux travaux de Patterson. C’est une lacune de ne pas les avoir cités, ou même mentionnés, surtout si l’on veut s’adresser à un lectorat francophone. Plus récemment, Jean-Pascal Daloz a fait paraître un excellent ouvrage sur The Sociology of Elite Distinction : From Theoretical to Comparative Perspectives (2010), très solide sur le plan théorique.
Sur le plan éditorial, cette première parution en français mérite d’être saluée, mais celle-ci arrive tardivement puisque la première édition du livre a été publiée en 1997. Il va sans dire que depuis l’avènement du XXIe siècle, beaucoup de choses ont changé, ne serait-ce que les évènements du 11 septembre 2001 qui ont provoqué un vaste questionnement sur la notion de choc des civilisations et sur la conception même de la barbarie. Surtout, les manières de concevoir et de conceptualiser la civilisation, l’occidentalisation et les élites ont considérablement changé en l’espace de seulement trois décennies, notamment avec l’avènement des mouvements sociaux en faveur des exclus de toutes sortes et la contrepartie idéologique créée par le wokisme. La contre-attaque s’est structurée, s’est propagée, a gagné en légitimité et s’est même institutionnalisée, notamment dans certaines universités. Or, on ne saurait reprocher au présent ouvrage de ne pas considérer ces dimensions devenues fondamentales, mais qui étaient insoupçonnables en 1997, même si certains passages font allusion à la discrimination positive apportée durant l’ère Reagan, au cours des années 1980 (p. 130). Pour l’éditeur Libre, une préface ou un avant-propos, de l’auteur lui-même ou d’un universitaire francophone pour « parrainer » l’ouvrage, aurait été nécessaire pour contextualiser ce livre dans un nouveau siècle et pour un lectorat européen.
Néanmoins, l’excellente traduction de Nicolas Casaux est précise et ajoute même des nuances entre parenthèses ou crochets, ou sous la forme de notes de bas de page plus élaborées (voir p. 13, 15, 33 et 149). Toutefois, si certains ouvrages cités sont accompagnés d’une référence bibliographique correspondante en français, l’exercice d’équivalence n’est pas fait systématiquement par le traducteur, par exemple pour les renvois aux livres traduits de Hobbes (voir note 15, p. 153) et d’Éric Hobsbawm (voir note 30, p. 154).
En somme, si on peut saluer l’initiative des Éditions Libre rendant possible cette première traduction en français d’un ouvrage de Thomas Patterson, le lecteur exigeant restera peut-être sur sa faim car cette parution de L’Invention de la civilisation occidentale survient sans doute un peu trop tard. Néanmoins, le sujet demeure d’intérêt, et on se réjouit de trouver ce titre dans les librairies québécoises.
Parties annexes
Bibliographie
- Aron, Raymond, 1969. Les désillusions du progrès : Essai sur la dialectique de la modernité. Paris, Gallimard.
- Aron, Raymond, 2005. Penser la liberté, penser la démocratie. Paris, Gallimard.
- Daloz, Jean-Pascal, 2010. The Sociology of Elite Distinction: From Theoretical to Comparative Perspectives. Basingstoke, Palgrave Macmillan.
- Ellul, Jacques, 1954. La Technique ou l’Enjeu du siècle. Paris, Armand Colin.
- Ellul, Jacques, 1977. Le Système technicien. Paris, Calmann-Lévy.
- Ellul, Jacques, 1988. Le Bluff technologique. Paris, Hachette.
- Huntington, Samuel P., 1997 [2021]. Le Choc des civilisations. Paris, Odile Jacob.
- Mills, Charles Wright, 1956 [2012]. L’Élite au pouvoir. Marseille, Agone.