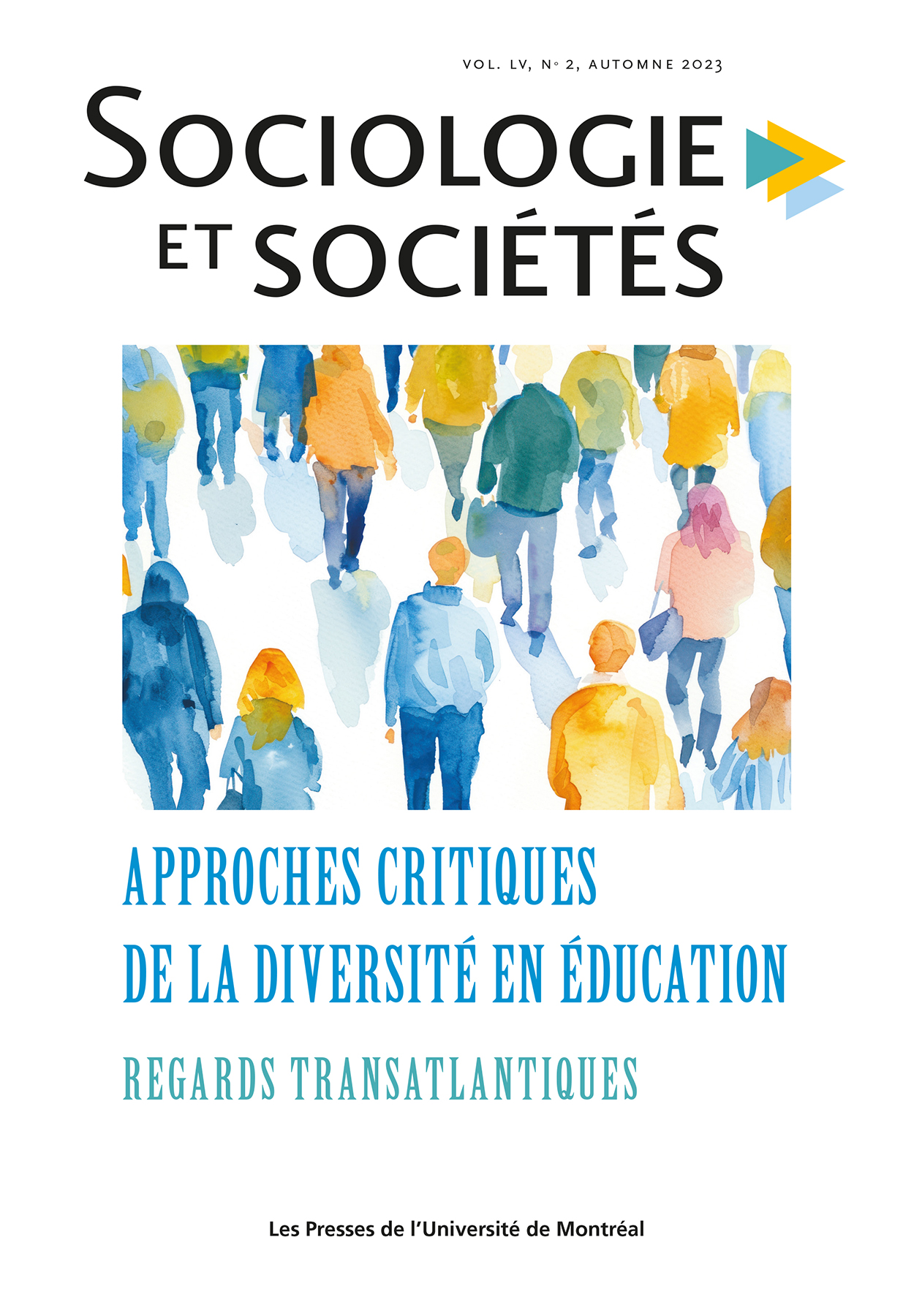Abstracts
Résumé
En prenant pour objet d’études les expériences vécues de racisme et les politiques conçues pour y remédier, cet article présente les résultats d’une recherche menée auprès d’étudiants de troisième cycle, inscrits dans une université d’élite au Royaume-Uni et aux États-Unis. Mobilisant les concepts de réalisme racial, convergence des intérêts, blanchité et « blanchité comme propriété », nous analysons la manière dont le racisme continue à être perçu comme un aspect « normal » de la vie des campus de l’élite. Alors que ces universités se présentent comme des institutions par essence méritocratiques, nous montrons en quoi cette vision repose sur la valorisation de formes de capital principalement détenu par les étudiants aisés et blancs. Les ruses de la raison méritocratique donnent ainsi à voir des incarnations privilégiées du capital blanc, dont nous analysons la reproduction comme un facteur essentiel de légitimation du racisme dans les universités de l’élite.
Mots-clés :
- capital blanc,
- blanchité,
- critical race theory (CRT, théorie critique du racisme),
- universités d’élite,
- EDI (équité, diversité et inclusion)
Abstract
This paper reports research conducted with postgraduate students at elite universities and focuses on their experiences of racism and policies designed to redress racism. We draw upon concepts from Critical Race Theory including ‘racial realism’, ‘interest convergence’, Whiteness and ‘Whiteness as property’ to argue racism is framed as a normal aspect of elite university practice. The research identified that equality and diversity initiatives (EDI), were readily absorbed into existing racist practice and discourse. Whilst the message of EDI measures was one of addressing inequality, in practice participants in our research identified this message often translated into discourse suggesting students of color were privileged at the expense of White students. We argue that elite universities portray themselves as meritocratic institutions to legitimize their status; but that their discourse of meritocracy privileges forms of capital predominantly possessed by affluent, White groups. We argue that such discourse undermines EDI measures and is an example of White capital reproducing and legitimizing racism.
Keywords:
- White capital,
- whiteness,
- critical race theory (CRT),
- elite universities,
- EDI
Resumen
A partir del estudio de situaciones de racismo vividas y de las políticas diseñadas para abordarlas, el presente artículo presenta los resultados de una investigación realizada con estudiantes de posgrado inscriptos en universidades de élite del Reino Unido y los EE. UU. Utilizamos los conceptos de realismo racial, convergencia de intereses, blancura y “blancura como propiedad” para analizar cómo el racismo aún se percibe como un aspecto “normal” de la vida universitaria de élite. Aunque estas universidades se presentan como instituciones meritocráticas por naturaleza, ilustramos cómo esta visión se basa en el aprovechamiento de formas de capital propias, en su mayoría, de los estudiantes blancos y ricos. Los artificios del razonamiento meritocrático revelan así encarnaciones privilegiadas del capital blanco, cuya reproducción analizamos como factor esencial de legitimación del racismo en las universidades de élite.
Palabras clave:
- capital blanco,
- blancura,
- critical race theory (CRT, teoría crítica de la raza),
- universidades de élite,
- EDI (equidad, diversidad e inclusión)
Article body
introduction
Aussi bien aux États-Unis qu’au Royaume-Uni, les universités d’élite ont depuis toujours été associées à des pratiques inéquitables (Karabel, 2005 ; Boliver, 2013 ; Bhopal, 2018, 2022 ; Bhopal, Myers et Pitkin, 2020 ; Myers, 2022). Cela inclut les procédures d’admission, l’expérience sur le campus, les résultats scolaires, ainsi que l’expérience du personnel universitaire. Si de nombreuses universités ont reconnu ces problèmes et se sont engagées à y remédier, au Royaume-Uni, cela a provoqué une réaction brutale de la part des institutions privées, ainsi que des médias conservateurs, accusant les établissements les plus élitistes, dont ceux de Bristol, Durham, Édimbourg, Cambridge et Oxford, d’adopter des politiques de démocratisation scolaire défavorables aux élèves issus du privé (BBC News, 2002 ; Hitchens, 2022). Aux États-Unis, les politiques de l’affirmative action, conçues pour corriger les inégalités raciales, ont été récemment considérées par la Cour suprême comme violant le principe d’égale protection du 14e amendement (Students for Fair Admissions v. Harvard, 2023). Aussi, malgré la preuve d’inégalités persistantes, les politiques susceptibles de les corriger ont été souvent, et de plus en plus, mises à mal dans l’actualité[1].
En nous appuyant sur une enquête qualitative réalisée auprès de 49 étudiant·e·s inscrit·e·s dans des universités d’élite aux États-Unis et au Royaume-Uni (Bhopal et Myers, 2023), cet article propose d’interroger la manière dont les politiques de justice raciale à l’université ont été mises à mal sous les effets de la reproduction du racisme qui opère à l’extérieur aussi bien qu’à l’intérieur de l’espace académique, au moyen de ce que nous appelons le capital blanc, soit les différentes formes de capitaux (sociaux, économiques, culturels et symboliques) associés à la blanchité. Pour cela, nous nous appuyons sur la théorie critique du racisme (critical race theory, désormais CRT) et les concepts qu’elle formule de réalisme racial (Delgado et Stefancic, 2017), de blanchité et de « blanchité comme propriété » (whiteness as property) (Harris, 1993), ainsi que sur les analyses de Derrick Bell (1980) du dilemme de la convergence des intérêts. Selon celles-ci, les batailles judiciaires pour la déségrégation n’ont pu être remportées qu’à la condition de recouper les intérêts politiques dominants de l’élite blanche.
Avec ce cadre théorique, nous proposons d’interroger la manière dont le racisme en est venu à être considéré comme un aspect normal de la vie des campus de l’élite, ainsi que le rôle joué dans ce processus par les initiatives institutionnelles en faveur de l’égalité et la diversité (EDI). L’enquête attire l’attention en effet sur la manière dont ces initiatives, en particulier les mesures dites d’affirmative action, sont aisément cooptées par des pratiques et des discours racistes sur les campus. Alors que le message des politiques EDI est celui de la lutte contre les inégalités, les participant·e·s à notre enquête ont estimé qu’il est souvent, dans les faits, détourné pour suggérer qu’un traitement privilégié fut accordé aux étudiant·e·s de couleur. Pour clarifier ces processus, l’article propose d’explorer la manière dont la race et le racisme sont vécus par les étudiant·e·s avancé·e·s, inscrit·e·s en études de troisième cycle, au sein d’universités d’élite avec, en toile de fond, la prétention de ces dernières à incarner par excellence la norme méritocratique. La recherche a permis de faire émerger plusieurs thèmes forts, dont la question des inégalités de race et de classe, du pouvoir réputationnel et de l’image de marque des universités d’élite, ainsi que celle des relations étroites qui unissent écoles privées et universités d’élite au Royaume-Uni. Dans cet article, toutefois, nous nous attachons à l’analyse des données portant sur la compréhension du racisme, en contexte de discours estampillés EDI, d’une part, et sur l’adhésion à l’engagement institutionnel en faveur de la norme méritocratique, d’autre part.
Après avoir précisé notre cadre conceptuel, ainsi que notre démarche méthodologique, nous montrerons en particulier comment ces constructions et usages de la norme méritocratique sont mobilisés pour délégitimer les politiques de diversité, cependant qu’ils oeuvrent à consolider le capital de blanchité et sa très forte rentabilité sur les campus de l’élite. Nous montrons que celui-ci se décline en deux modalités spécifiques, à savoir marque d’appartenance, d’une part, et label méritocratique, d’autre part : pour les étudiants les mieux pourvus sur le plan matériel, culturel et symbolique, les investissements du capital blanc en viennent à constituer un véritable avantage compétitif sur les campus de l’élite. Finalement, le travail accompli par le capital blanc dans ses différentes formes et modalités nous est apparu comme un mécanisme essentiel de reproduction et de légitimation du racisme dans les universités d’élite. À la suite de l’hypothèse fondatrice de Bell (1980), nous proposons d’analyser cette situation dans les termes d’une divergence d’intérêts entre minorités raciales et élites.
universités d’élite, blanchité, capital blanc : précisions conceptuelles et analytiques
La distinction entre universités « d’élite » et d’autres qui n’en seraient pas relève d’un domaine sémantique flou où il n’existe pas de règle à proprement parler (pour une discussion approfondie, voir Bhopal et Myers, 2023). Aussi, dans cet article, nous définissons les universités d’élite comme la poignée d’institutions globales, dont les noms de marque, immédiatement reconnaissables, occupent sans interruption les dix premières places des classements internationaux en matière de recherche et d’enseignement. Il s’agit généralement d’universités plutôt anciennes, situées aux États-Unis et au Royaume-Uni, que caractérise également un processus de sélection exclusif et individualiste (Bhopal et Myers, 2023). Surnommées la Global Super-League (The Economist, 2005), elles possèdent des ressources financières importantes, prenant souvent la forme de fondations, tandis que leurs anciens élèves dominent les sphères économiques, sociales et politiques. Ces universités relèvent souvent de nomenclatures collectives reconnues, telles que la « Ivy League » aux États-Unis ou « Oxbridge » au Royaume-Uni. Elles exercent une influence importante au sein de groupements professionnels comme le Russell Group au Royaume-Uni[2].
Blanchité et capital blanc
Les capitaux agissent comme des formes de pouvoir spécifiques dans leurs champs respectifs (Horvat, 2003 ; Bourdieu, 1986 ; 1998), les plus efficaces et légitimes étant ceux dont la logique s’ajuste le plus étroitement à la logique immanente du champ. Dans les universités d’élite, les étudiants racisés font l’expérience de pressions diverses au sein d’environnements majoritairement blancs, où le manque de capital culturel, en particulier de formes de capital culturel dont sont pourvus de manière disproportionnée les étudiants blancs, les désavantage significativement (Carter, 2005 ; Torres, 2009). Ces formes de capital — en matière par exemple de loisirs, goûts et styles de vie — sont davantage alignées avec les attentes des universités d’élite que ne le sont les capitaux dont sont pourvus les étudiants de couleur, ne serait-ce que parce qu’elles reflètent les intérêts majoritaires des universitaires - blancs et de classe moyenne — ainsi que des étudiants et de leurs parents. L’importance de la blanchité en tant que catégorie et forme de pouvoir a été largement reconnue (Dyer, 1997 ; Frankenberg, 1993 ; Hurtado, 1996 ; hooks, 1997 ; Ignatiev, 1995 ; Kidder, 1997 ; McIntosh, 1992 ; Roedigger, 1991), y compris en matière d’éducation, aux États-Unis (Apple, 1998 ; Giroux, 1997 ; Kincheloe et Steinberg, 1998 ; Sleeter, 1996), comme au Royaume-Uni (Chakrabarty et al., 2015 ; Gillborn, 2005 ; Preston, 2007 ; Warmington, 2014). Une grande partie de cette littérature montre la manière dont l’ethnicité des Blancs fonctionne comme une forme de privilège ou de prérogative, ouvrant droit à des avantages spécifiques. Par l’analogie du « sac à dos invisible », Peggy McIntosh (1992) dévoile son contenu composé d’un ensemble d’attentes qui ne sont pas accessibles de la même manière aux personnes non-blanches, telles que le fait de passer rapidement les contrôles aux frontières ou de conduire une voiture de luxe sans être aussitôt contrôlées. Selon Zeus Leonardo (2009), de telles attentes et prérogatives ont des incidences significatives dans l’organisation sociale, de sorte que « le regard critique sur le privilège blanc ou l’analyse de la blanchité hégémonique sont à compléter par un examen tout aussi rigoureux du suprématisme blanc et de la domination raciale blanche » (Leonardo, 2009, p. 75). En ce sens, le privilège blanc, soit les avantages systémiques accordés aux Blancs, la suprématie blanche ou le cadre idéologique de la supériorité raciale, et la domination blanche, à savoir la preuve historique de la concentration des ressources et du pouvoir entre les mains des Blancs, constituent ensemble les processus par lesquels le racisme est légitimé et consolidé en tant que caractéristique normale de l’organisation sociale.
Ce qui caractérise les différents types de capitaux est que leur valeur peut être convertie entre différentes économies de valeurs et de capital : ils peuvent s’échanger contre d’autres types de capitaux ; ils peuvent être hérités ; ils peuvent servir d’atouts dans la compétition pour plus et mieux de capital ; leur valeur peut évoluer dans le temps. Sous la forme du privilège blanc, le capital blanc est particulièrement efficace en raison de son invisibilité. Les avantages qu’il procure semblent en effet anodins et, de ce fait, ne méritent pas de remise en question. En tant que forme et incarnation de la suprématie blanche, le capital blanc constitue en particulier un moyen efficace pour nier l’existence du racisme et son incidence sur la vie des personnes racisées (Bonilla-Silva, 2006 ; Omni et Winant, 1994). Les universités, de leur côté, ont été identifiées comme « à la fois un site de normalisation et de bouleversement de blanchité » (Cabrera, 2014, p. 31). Bien qu’elles forment un champ où le racisme, en particulier le racisme structurel, est de plus en plus identifié et contesté, les universités restent aussi des espaces d’(auto)ségrégation, où les étudiants peuvent adopter des comportements ouvertement racistes, dont par exemple la pratique du « blackface » lors de soirées déguisées, souvent excusée par leur jeunesse et/ou naïveté supposées[3]. Pour Nolan Cabrera (2014, p. 33), les campus sont ainsi des espaces dans lesquels « les manifestations du privilège blanc permettent aux participants de mettre en oeuvre des stéréotypes racistes dans des environnements relativement sûrs, à l’écart de leurs pairs minoritaires ». Bien que certains étudiants blancs fassent preuve d’« envie culturelle » à l’égard de leurs pairs minoritaires (McKinney, 2004), ils considèrent généralement la blanchité et la suprématie blanche comme allant de soi et gardent leurs distances avec les étudiants de couleur. Kimberly Torres (2009) identifie ainsi un ensemble de comportements et de caractéristiques qui les différencient. En font partie les commentaires critiques que les étudiants blancs profèrent sur les corps noirs et la sexualité des Noirs, les codes vestimentaires, des goûts et des styles différents, une ségrégation sociale. Pour Torres (2009), il est à noter que ces comportements ont lieu dans un contexte où les étudiants noirs viennent de familles moins aisées : pour celles et ceux issus de quartiers majoritairement noirs ou mixtes, un « choc culturel » est décrit dans les espaces blancs de l’université.
Pour John Preston (2007), l’ethnicité blanche est « une catégorie politique, historiquement et socialement reproduite dans le temps ». Tout en soulignant les ambiguïtés inhérentes aux catégories « blanc », « Blancs » et « blanchité », il estime néanmoins qu’« il est inexact de décrire la blanchité comme un terme contesté — il s’agit plutôt d’un terme offensif par lequel s’exprime un certain nombre de débats sur la race en général » (Preston, 2007, p. 2). Les conceptions de la race sont également fluides et constituent des récits socialement construits, plutôt que des classifications systématiques et définitives (Gillborn, 2008). Par conséquent, dans le discours politique, bien que l’identification spécifique de qui est blanc évolue dans le temps, l’ascendant de la blanchité demeure. Comme le montre l’exemple des premiers migrants irlandais aux États-Unis, dont le statut fut à peu près identique à celui de la population noire, leur expérience n’a que récemment évolué pour devenir celle d’un groupe blanc (Ignatiev, 1995). L’expérience irlandaise fut socialement construite dans le cadre d’un modèle plus large de migration de ruraux européens vers des environnements américains urbains, où les immigrants étaient classés selon « une hiérarchie morale de différences nationales et culturelles dans laquelle les Européens de l’Ouest — à l’exception des Irlandais — se trouvent au sommet en tant que, pour la plupart, ouvriers qualifiés, assidus et travailleurs, tandis que Slaves, Bohémiens, Juifs et Européens du Sud sont tout en bas, taxés de saleté, dissimulation et paresse. » (Sennet et Cobb, 1972, p. 14)
Si ces exemples montrent comment la blanchité se reproduit dans de nouvelles configurations socioéconomiques, tout en conservant son importance sociale et politique, l’inverse peut également être vrai. Dans les banlieues auparavant respectables de la classe moyenne blanche, touchées désormais par une mobilité descendante, John Hartigan (1997) montre comment l’étiquette « white trash » (ordure blanche) est utilisée pour catégoriser certaines populations à qui on reproche de « perturber la compréhension implicite de qu’est-ce qu’être blanc ». White trash désigne ici la rupture avec les conventions qui perpétuent la blanchité en tant qu’ « identité non marquée et normative » ; « plus qu’un échange vexatoire, il matérialise le contrôle complexe des frontières incertaines qui délimitent les identités de classe et de race » (Hartigan, 1997, p. 47). Au Royaume-Uni, des distinctions similaires en termes de blanchité différencient les identités blanches respectables d’autres identités blanches qui sont, elles, racisées. En témoigne l’étiquette « chavs » accolée à certains Blancs, ou encore la diabolisation historique d’identités blanches altérisées, dont celles des Voyageurs et des Tsiganes.
White trash aussi bien que chavs montrent que les identités blanches ne sont ni homogènes ni fixes, sans pour autant impliquer que la blanchité elle-même s’en trouve dévalorisée. Au contraire, il s’agit d’une preuve supplémentaire de la blanchité en tant que régime de pouvoir où la race fonctionne « comme un système d’avantages différentiels qui bénéficie à tous les Blancs, quels que soient leur classe ou leur sexe » (Leonardo, 2009, p. 69). Selon David Gillborn (2008), si la blanchité comme moyen d’oppression et de marginalisation est structurellement reproduite, des groupes et personnes blanches sont individuellement complices du maintien d’un système qui avantage leurs propres positions. Dans le contexte des universités d’élite qui réunissent une population hétérogène en termes de race, de classe, de sexe et de statut académique, la blanchité est une caractéristique qui définit à la fois les individus et les structures institutionnelles.
Une participation élargie : la démocratisation de l’accès aux institutions d’élite
La preuve statistique de biais racistes est souvent difficile à produire, en partie parce qu’elle doit tenir compte d’indicateurs multiples et potentiellement concurrents (Maguire et Morris, 2018). Par exemple, ce n’est pas seulement le nombre de places offertes par les universités qui doit être considéré, mais aussi leur nature, leurs taux d’acceptation, le domaine et le type d’établissement, etc. Au Royaume-Uni, les politiques mises en place depuis la fin des années 1990 pour élargir l’accès à l’université furent généralement considérées comme un succès en raison de l’augmentation des effectifs étudiants aux profils « atypiques ». Si l’on examine de plus près ces données et les expériences étudiantes, cependant, il apparaît clairement que ces étudiants atypiques sont beaucoup plus susceptibles de fréquenter des universités moins prestigieuses, en faisant souvent l’hypothèse de « la parité relative entre différents établissements et la valeur de leurs diplômes » (Bhopal, Myers et Pitkin, 2020, p. 1333). Moins bien pourvus en capitaux, « les étudiants racisés entrent en général dans un jeu aux enjeux moins importants que les étudiants dotés d’un surplus de capitaux » (Bhopal, Myers et Pitkin, 2020, p. 1333). La situation est encore aggravée par les modalités financières, actuellement en place pour les étudiants britanniques, qui paient les mêmes droits d’inscription (souvent au moyen de prêts) quel que soit le type d’établissement. Les étudiants des universités d’élite les plus prestigieuses, population fortement dominée par la classe moyenne blanche, paient ainsi les mêmes droits que ceux et celles qui fréquentent des universités locales moins prestigieuses. Or, les diplômes délivrés par les universités d’élite confèrent une qualification plus forte que celle des universités moins prestigieuses — ils s’avèrent, par exemple, plus rentables sur le marché du travail. Les étudiants d’universités moins prestigieuses sont tenus de faire en conséquence le même investissement économique pour des diplômes de valeur moindre. Dans ce système, « le transfert de capital économique reflète les transferts de savoirs et de capital culturel, ainsi que le développement de réseaux sociaux au bénéfice des étudiants déjà privilégiés. En clair, les étudiants issus de milieux défavorisés, ouvriers, racisés et minoritaires paient plus pour un moindre retour » (Bhopal, Myers et Pitkin, 2020, p. 1333).
Critical race theory
Malgré ce que son nom laisse entendre, plutôt qu’une position théorique unifiée, la CRT forme davantage un ensemble de concepts partagés pour rendre compte de la race et du racisme dans les sociétés contemporaines. Ses outils théoriques, dont les concepts d’intersectionnalité ou encore de « convergence des intérêts » (interests convergence), s’avèrent aussi utiles pour théoriser la race et le racisme dans le champ éducatif et à l’université (Ladson-Billings et Tate, 1995). Soulignant la centralité du racisme dans ce contexte, ainsi que l’impératif d’une approche multidisciplinaire, William Tate (1997) identifie trois thèmes forts de la CRT pour la recherche en éducation. Premièrement, les remèdes juridiques contre l’inégalité sont entravés dans l’effectivité de leur mise en oeuvre. Cette situation est illustrée aux États-Unis par l’arrêt Brown v. Board of Education (1954) qui met fin à la ségrégation dans l’enseignement public (Bell, 1980). Malgré Brown et les politiques de déségrégation qui s’ensuivent, la ségrégation scolaire persiste dans le temps, s’appuyant désormais sur d’autres mécanismes, dont le zonage racial des quartiers (Rosiek, 2019 ; Trounstine, 2020). Au Royaume-Uni, David Gillborn (2008) met en évidence un phénomène comparable de repli du racisme au sein des politiques éducatives, cependant que celles-ci « principalement axées sur l’animosité raciste des Blancs, ont laissé intactes la plupart des inégalités » (Gillborn, 2008, p. 89). Deuxièmement, la CRT déconstruit « les revendications juridiques dominantes de neutralité, objectivité, indifférence à la couleur et méritocratie comme des manières de dissimuler les intérêts spécifiques d’entités puissantes de la société » (Tate, 1997, p. 235). Le récit dominant en matière éducative, qui suggère que la réussite scolaire est d’abord déterminée par des aptitudes individuelles plutôt que par le milieu social d’origine, décrit ainsi une vision manifestement fausse, comme l’attestent sans discontinuer les recherches en éducation (Bhopal, 2018 ; Reay, 2016). Le langage méritocratique qui mobilise invariablement une terminologie qui se veut inclusive plutôt qu’exclusive ; équitable plutôt qu’inéquitable ; continue à soutenir, nonobstant sa tonalité, la reproduction des inégalités. Troisièmement, enfin, Tate (1997) considère que la CRT permet de s’attaquer à l’anhistoricisme au coeur d’une bonne part des politiques éducatives, en reconnaissant et en valorisant les récits et les expériences des publics exclus du discours dominant.
enquêter sur le racisme dans les universités d’élite : questions de recherche et méthodologie
Partant de ces hypothèses et cadre théorique, notre enquête a visé à questionner la manière dont les étudiants avancés (de niveau master et plus), appréhendent et vivent l’expérience d’intégrer une université d’élite. Nous avons sélectionné quatre universités : deux aux États-Unis (anonymisées comme US1 et US2) et deux au Royaume-Uni (respectivement, UK1 et UK2). L’une des universités américaines fait partie de l’Ivy League, tandis que l’autre est une université « land-grant »[4] de recherche, privée. Bien que les deux universités soient privées, elles bénéficient d’un financement public important pour leurs programmes de premier et de deuxième cycle. Les universités britanniques bénéficient également d’un financement public considérable ; elles sont aussi des établissements indépendants. Les quatre universités sélectionnées ainsi figurent régulièrement dans le top 10 du classement mondial des universités QS (2019).
En tout, nous avons conduit 49 entretiens semi-directifs avec des étudiants de deuxième et troisième cycle. Les participants à l’enquête ont été recrutés par la méthode « boule de neige ». Après avoir choisi les universités pour leur qualité d’« élite », nous avons utilisé nos contacts personnels pour recruter les personnes interrogées. Dans les universités britanniques, aussi bien qu’étatsuniennes, l’un de nous fut invité à donner des interventions et des conférences, à l’occasion desquelles nous avons pris contact avec des étudiants pour les inviter à prendre part à l’étude. Ils et elles nous ont ensuite recommandé d’autres participants. Dans les universités étatsuniennes où nous n’avions pas de contacts préalables, nous avons utilisé nos réseaux personnels pour recruter les participants. En cas d’accord, la personne sollicitée nous envoyait son adresse électronique et le contact était de la sorte établi. L’échantillonnage en boule de neige peut comporter des inconvénients, donnant lieu à des biais de sélection en faveur d’un type particulier de répondants, puisque les participants ont tendance à s’adresser à des personnes qui leur ressemblent, faisant dépendre la sélection in fine des choix de ceux qui auront été contactés en amont (Van Meter, 1990). Cette manière de procéder peut également induire des biais dans la mesure où les personnes sont recrutées sur la base de leur appartenance à un réseau d’interconnaissance et que, de ce fait, les personnes qui n’en font pas partie seront exclues de l’enquête (Griffiths et al., 1983). Malgré ces limites, Atkinson et Flint (2001, p. 4) suggèrent que « la véritable promesse de l’échantillonnage en boule de neige réside dans sa capacité à dévoiler des aspects souvent cachés de l’expérience quotidienne, tant du point de vue du chercheur que de celui du profane ».
Les responsables de département et doyens de facultés de toutes les universités enquêtées ont été contactés au préalable pour recueillir leur assentiment. Nous avons présenté la recherche, y compris les risques associés à sa réalisation (minimes), et leur avons remis le formulaire de consentement et la fiche d’information du participant. Ces documents ont été également remis à l’ensemble des participants avant qu’elles ou ils ne prennent part à l’enquête. Ce faisant, nous avons eu conscience du fait de devoir négocier notre entrée sur le terrain avec des « gatekeepers » et avons insisté sur l’importance de la recherche qui vise à fournir une analyse et une compréhension approfondies des expériences étudiantes en université d’élite, en particulier sur les enjeux d’équité, d’inclusion et de justice sociale. Obligés de « gérer » notre relation avec les gatekeepers, nous fûmes conscients du rôle qu’ils jouaient en nous permettant d’accéder au terrain (Flick, 1998). Une fois cet accès obtenu, ils et elles ont toutefois continué à s’intéresser à la recherche, en nous laissant la liberté de la mener, sans chercher à en influencer le déroulement de quelque façon que ce soit. Nous avons ainsi pu nous positionner sur le terrain « de manière à garantir le temps, l’espace et les relations sociales nécessaires à la réalisation de la recherche » (Wolff, 2004, p. 195).
Trois questions de recherche principales nous ont guidés dans le processus :
-
Quel est l’effet des expériences éducatives antérieures, de l’identité personnelle et du milieu social d’origine des étudiant·e·s sur leurs trajectoires dans les universités d’élite (en termes, par exemple, de race, de milieu socioéconomique et de sexe) ?
-
Comment les étudiant·e·s vivent-ils et naviguent-ils et elles les espaces des universités d’élite, leur image de marque et réputation ?
-
Comment comprennent-ils et elles les manières dont leurs expériences antérieures contribuent à reproduire un système de privilèges ?
Les entretiens réalisés l’ont été en face-à-face avec 40 répondant·e·s, neuf entretiens ont été menés par Skype. Au total, 30 entretiens ont été enregistrés, pour les autres, des notes manuscrites ont été prises et reconstituées, les étudiants ayant demandé à ne pas être enregistrés. L’ensemble des entretiens ont été retranscrits et analysés. Le travail d’analyse s’est déroulé tout au long du projet, dans le but d’une élaboration réflexive des résultats et de leur théorisation. Nous avons été de la sorte en mesure de développer de nouveaux thèmes et d’affiner notre cadre d’analyse parallèlement au travail empirique. Le corpus d’entretiens a fait l’objet d’une analyse thématique avec le logiciel NVivo et un codage réalisé à la main. Utilisé pour faciliter le tri et l’organisation des données, NVivo nous a permis en particulier d’approfondir et de complexifier notre analyse (King, 2004). Nous avons mobilisé l’analyse thématique en tant que « méthode permettant de repérer, d’analyser et de rendre compte des régularités dans les données » (Braun et Clarke, 2006, p. 76). À partir de ces régularités, nous nous sommes efforcés de leur donner un sens, en élaborant les thèmes d’analyse dans un processus constant de définition et de révision qui nous a permis, par des allers-retours successifs, de corroborer nos interprétations (Lorelli et al., 2017) et de rendre compte de manière aussi juste que possible des expériences et ressentis recueillis dans l’enquête. Afin d’accroître la cohérence et la précision de cette analyse, nous avons également procédé à une vérification croisée de l’ensemble des variables thématiques.
Les profils des participant·e·s à l’enquête
Les profils des personnes interrogées se caractérisent par une très grande diversité, toutes étant inscrites en études de deuxième et de troisième cycle, notamment en humanités, sciences physiques et sciences sociales. Au total, 45 personnes interrogées préparent un diplôme de recherche (MPhil/PhD) et 4 autres, un diplôme de master spécialisé (MA/MSc). Âgées de 22 à 34 ans, elles proviennent d’origines et de milieux socioéconomiques diversifiés (enregistrés sur la base de la profession des parents)[5]. 28 répondantes sont des femmes et 21 sont des hommes. La majorité a intégré des universités d’élite dès leurs études de premier cycle, cinq seulement venaient d’établissements n’étant pas considérés comme faisant partie de l’élite, ou moins bien placés dans les classements respectifs. Nous nous sommes tout particulièrement intéressés aux expériences des étudiants de deuxième et de troisième cycle en raison de leur statut spécifique de transition entre parcours de formation et insertion professionnelle, d’une part, de leur connaissance approfondie du monde universitaire, d’autre part, mais aussi en raison de la probabilité accrue pour ces personnes d’envisager à terme une carrière académique.
L’enquête a permis de faire émerger plusieurs thèmes forts, dont la question des inégalités de race et de classe, du pouvoir réputationnel et de l’image de marque des universités d’élite, ainsi que celle des réseaux et relations étroites entre universités d’élite et écoles privées. Dans cet article, nous nous attachons à l’analyse des résultats portant sur la compréhension du racisme, en contexte de discours estampillés EDI, d’une part, sur l’adhésion à l’engagement institutionnel en faveur de la norme méritocratique, d’autre part.
élitisme et capital blanc : les ruses de la raison méritocratique
Le racisme fut souvent décrit par les personnes enquêtées comme une expérience banale et quotidienne, quelque chose qui « semble ordinaire et naturel à qui baigne dans le milieu » (Delgado et Stefancic, 2000, p. 12). Les témoignages recueillis suggèrent ainsi que l’une des conséquences de cette normalisation du racisme est la consolidation d’un récit à la faveur duquel les initiatives EDI sont à leur tour perçues et décrites comme discriminatoires à l’endroit des étudiantes et des étudiants blancs. Que ce soit dans le cadre des mesures d’affirmative action aux États-Unis ou des admissions contextuelles au Royaume-Uni, les personnes racisées et défavorisées sont généralement considérées à l’université comme moins « méritantes » que leurs pairs blancs, aisés et éduqués dans le privé. Leur présence dans cet espace est de ce fait construite comme dérogatoire à la règle méritocratique : adossée à des raisons spécifiques qui ont trait à l’inclusion et à la diversité, elle est censée reposer sur un avantage illicite qui leur aura été conféré dans le processus de sélection. Bien que cette posture méconnaisse les preuves empiriques attestant que les étudiants et les étudiantes blanches et aisées ont une probabilité statistique supérieure d’être recrutées et diplômées avec succès par les universités d’élite (Karabel, 2005 ; Warikoo, 2022 ; Bhopal et Myers, 2023), celles et ceux de notre enquête se saisissent de cette situation en investissant leur blanchité de manière stratégique en tant que 1) marque d’appartenance et 2) label méritocratique venant sanctionner la qualité de leur travail et parcours académiques. Ces investissements du capital blanc sont ensuite transformés en un véritable avantage compétitif, manié de manière stratégique dans et en dehors du champ de la compétition scolaire des universités de l’élite.
La blanchité comme marque d’appartenance
Les étudiantes et étudiants racisés, issus de milieux moins favorisés, ont en effet été nombreux quant à eux à exprimer des doutes sur leur droit d’appartenir à ces espaces. Elles et ils doutent en particulier que leurs pairs de classe moyenne, ainsi que le corps enseignant, reconnaissent leur légitimité à être là et à intégrer une université d’élite. Ces doutes ressentis se sont traduits dans l’enquête par des récits personnels de gêne et de malaise, dont la récurrence ne peut que surprendre, compte tenu de la prétention de ces établissements à incarner l’excellence méritocratique. Avec leur statut d’étudiant·e·s avancé·e·s, il aurait été logique au contraire de donner à voir la confiance en soi et la fierté ressentie d’appartenir aux espaces de l’élite. Ce fut, toutefois, rarement le cas de celles et ceux que nous avons interrogés et qui ont eu tendance, au contraire, à exprimer des doutes sur leur intégration. Zena, dont la famille est originaire d’Afghanistan et vient d’un milieu modeste, se fait ainsi l’écho du sentiment que sa présence à US1 est constamment remise en question, au point de miner sa propre confiance dans le fait d’y mériter sa place :
On me fait comprendre que je n’ai pas ma place ici et, lorsque cela arrive, je commence à me poser la question moi-même. L’un de mes camarades de classe m’a même dit que si le département compte autant d’étudiants de couleur, c’est parce qu’ils doivent remplir leurs quotas et se conformer aux lois sur l’affirmative action, à défaut de quoi US1 aurait mauvaise presse.
Nema, étudiante noire, également de milieu populaire, décrit les plaisanteries de ses pairs sur le fait d’avoir supposément bénéficié de mesures d’affirmative action à US1. Plus tard dans l’entretien, elle explique comment cela engendre chez elle des doutes persistants quant au fait de mériter réellement une place à US1 :
Parfois, je me demande si je suis là pour remplir un quota. Si je suis arrivée ici grâce à une sorte de mesure d’affirmative action ou d’une autre mesure spéciale. Et j’ai l’impression que mes pairs, et parfois mes professeurs, ils me font parfois ressentir cela.
Nema poursuit en explicitant son ressenti face à une situation où son droit à intégrer une université d’élite n’est pas nécessairement frontalement remis en question, cependant que l’on sous-entend qu’elle n’aurait pas moins bénéficié, en raison de ses origines, d’un traitement spécifique. Bien que Nema ait complété ses études de premier cycle dans une autre université de la Ivy League, elle explique :
Il y a toujours ce sentiment de comment êtes-vous arrivée là ? Quand on me pose cette question, et même des enseignants me la posent : « Comment êtes-vous arrivée là ? » Ce n’est pas une question anodine, il s’agit toujours de savoir qui je suis et quelle est mon histoire. On me dit que des milliers d’étudiants candidatent ici et que seulement une poignée, seulement une petite poignée, sont admis. C’est que nous devons être là pour une autre raison.
Ria, qui a des origines mixtes (indiennes et britanniques) et est également issue d’un milieu social modeste, a pareillement décrit la manière dont la suspicion d’avoir été favorisée dans le processus d’admission en raison de son ethnicité produit un effet durable sur sa façon de vivre son intégration à RU1. Tout comme Zena et Nema, Ria indique que la perception des autres étudiants a fini par semer le doute, chez elle aussi, sur sa propre légitimité à faire partie de cette université :
UK1 est considérée comme l’une des deux meilleures universités au monde, alors quelqu’un comme moi se demande : « Qu’est-ce que je fais là ? » Je dois continuer à penser que je suis là parce que je suis brillante et que j’y suis arrivée grâce à mes résultats. Mais lorsque je parle à des étudiants qui ont fait une classe prépa ou une école privée, ils me posent des questions. Ils se demandent : « Qu’est-ce qu’elle fait là ? » Certains ont même le culot de me le demander ouvertement, d’autres le font de manière plus subtile. Lorsqu’on me demande : « À quelle école êtes-vous allée ? » et que je réponds : « Dans un lycée de quartier… », les gens vous regardent et concluent que vous êtes là parce que vous avez coché une case. Je m’interroge donc si l’université ne veut pas avoir quelqu’un de milieu ouvrier, un étudiant noir ou un étudiant issu des minorités, juste pour dire : « Regardez, nous sommes diversifiés. » Cela leur donne une bonne image, ils ont le sentiment de contribuer à rendre UK1 accessible à tous les étudiants, mais en réalité, ils ne font ça que pour eux-mêmes. Ils ne se soucient pas vraiment de nous parce que nous ne sommes pas comme eux.
Les étudiant·e·s interrogé·e·s ont aussi identifié des formes de capital culturel associées à la blanchité qui bénéficient aux étudiants et étudiantes blanches sur les campus (loisirs, activités sportives, goûts musicaux, linguistiques ou vestimentaires, voir infra). Or, ce capital blanc non seulement légitime les croyances des étudiant·e·s blanc·he·s que leur place dans une université d’élite est pleinement méritée. En même temps, il fragilise celles d’étudiants et étudiantes racisées en les amenant à douter de leurs propres légitimité et droit d’appartenance sur les campus. Les affirmations selon lesquelles les politiques d’affirmative action avantagent indûment les étudiant·e·s de couleur, bien qu’inexactes et sans preuve empirique, ne conservent pas moins une crédibilité importante. À la faveur de ces croyances, les capitaux dont disposent les étudiant·e·s racisé·e·s sont dévalorisés, cependant que la valeur supérieure de ceux détenus par leurs pairs blancs est réaffirmée. L’empressement de ces derniers à embrasser ouvertement de telles positions, parfois sous forme de plaisanteries, témoigne de l’efficacité du capital blanc en tant que forme dominante de pouvoir au sein des campus de l’élite.
Le travail de distinction accompli par la blanchité nuit, cependant, au sentiment d’appartenance des étudiant·e·s minoritaires, dont il remet en question la légitimité des qualifications, en particulier sur le plan académique. Conscient·e·s de cette situation, les étudiant·e·s de couleur ne semblent pas moins l’accepter comme quelque chose d’ordinaire et de banal, contribuant de la sorte à normaliser encore davantage les doutes ressentis sur leur illégitimité à intégrer un établissement de l’élite. Dans son témoignage, Ria reconnaît le manque ressenti de légitimité du fait des croyances colportées par les étudiants blancs d’un processus d’admission biaisé ; simultanément, elle note comment l’université qui proclame activement son engagement en faveur de la diversité considère ces politiques comme emblématiques de son ethos égalitaire. Le récit de la diversité est ainsi, d’une part, utilisé pour dénier aux étudiant·e·s de couleur la capacité d’appartenir ; cependant que, d’autre part, l’université blanche renforce et valorise son image de marque sur la base de ces mêmes engagements.
Ces dynamiques sociales et institutionnelles contradictoires agissent en définitive pour saper la capacité des politiques EDI à produire un changement significatif sur les campus. Dans son analyse, Femi va plus loin que Ria. En suggérant que l’image d’inclusivité vis-à-vis du monde extérieur est la seule raison pour laquelle UK2 recrute des étudiant·e·s noir·e·s de milieu populaire, comme elle, elle explique :
Je dois continuer à me répéter que je suis là parce que je mérite d’être là, parce que j’ai de bons résultats, parce que j’ai réussi l’entretien, parce que je suis assez intelligente pour être là. Puis, je vois tous ces gens au pouvoir. Les président et vice-président de l’université expliquant qu’ils pensent qu’il est important d’avoir un corps étudiant diversifié, etc. Je ne peux m’empêcher de penser qu’ils ne font cela que pour faire bonne figure aux yeux du public. Ils veulent que le monde voie UK2 comme une université diversifiée et inclusive, mais en réalité, ils ne le font que pour eux-mêmes et non parce qu’ils veulent vraiment que des étudiants noirs qui ne sont pas spécialement huppés viennent dans leur université. Tout ce qu’ils veulent est que cela reste blanc et chic, le reste n’est qu’une façade.
Pour Femi, le fait d’être ainsi consciente et critique du racisme à l’université génère une double peine. D’une part, elle perçoit l’université comme une institution raciste où elle n’est pas la bienvenue. D’autre part, le manque de bienveillance à son égard, qu’enrobe le discours universitaire de lutte contre les inégalités, suggère que sa place fut obtenue non pas sur la base du seul « mérite », mais pour satisfaire au « politiquement correct » de l’institution. Bien qu’elle soit consciente de ses qualités et compétences, aussi bonnes que celles des étudiantes et étudiants blancs, Femi ne décrit pas moins un doute tenace qui la fait remettre sa valeur en question.
La blanchité comme label méritocratique
Les étudiant·e·s défavorisé·e·s ont été ainsi nombreux·ses à décrire les doutes engendrés par la croyance répandue que des concessions auraient été faites dans le processus d’admission sur la base de leur ethnicité. Ce ressenti ne fut toutefois pas partagé par les étudiant·e·s de couleur issu·e·s de familles aisées. Ils et elles ont, au contraire, souvent fait des déclarations similaires à celles de leurs pairs blancs et aisés quant à leur légitimité à intégrer une université de l’élite. Certain·e·s ont même affirmé se sentir plus proches, en termes de caractéristiques partagées, de leurs pairs blancs de la classe moyenne que des étudiant·e·s racisé·e·s et moins fortuné·e·s.
Lorna, étudiante coréenne d’origine modeste, décrit ainsi comment les étudiants de couleur aisés à US1 s’appuient sur leur richesse, goûts, styles linguistiques et vestimentaires pour « performer » la blanchité avec leurs pairs blancs :
Certains étudiants noirs veulent faire partie du même groupe que les étudiants blancs, ils veulent leur ressembler parce qu’ils ont accès à toutes sortes de privilèges. Parce qu’ils viennent du même milieu social, ils sont amis avec et vous pouvez voir à quel point ils se ressemblent. Ils pratiquent les mêmes sports, sortent ensemble, ont les mêmes goûts et s’habillent de la même façon. C’est une façon pour eux de se rassurer qu’ils ont leur place, qu’ils peuvent appartenir, parce qu’ils font partie de ce groupe.
Dans le récit de Lorna, la performance de la blanchité est directement associée à des caractéristiques physiques et matérielles. Loin d’être identifiée à la seule marque somatique qu’est la couleur de peau, la blanchité est associée à un ensemble de qualités incarnées et d’activités sociales partagées. C’est une manière d’être et d’appartenir autant qu’une marque biologique, liée à la couleur de peau. Les observations de Lorna font écho aux témoignages d’étudiant·e·s racisé·e·s plus aisé·e·s. Edward, étudiant à US2, déjà passé par une autre université de la Ivy League et dont les deux parents exercent une profession libérale, répond ainsi à la question qui lui est posée de son identification :
Bien sûr, je m’identifie à mes camarades afro-américains parce que nous sommes noirs, mais je me sens plus à l’aise avec mes camarades blancs avec qui je partage des expériences communes. Certains de mes amis qui étaient dans la même université que moi avant sont maintenant ici et ils sont blancs. Ils ont les mêmes expériences que moi, les mêmes centres d’intérêt et cela nous rapproche. Nous pratiquons les mêmes sports et faisons le même genre de choses. Je ne réfléchis pas au fait qu’ils sont blancs et moi noir, ce sont juste mes amis.
La position d’indifférence à la couleur qu’exprime Edward suggère que les caractéristiques partagées les plus pertinentes qui le lient au groupe de pairs sont celles qui découlent de connivences culturelles et de centres d’intérêt partagés (sports, musiques, loisirs). Ces caractéristiques et « goûts » partagés apparaissent définis à l’intérieur de formes de capital social lié à la blanchité, dont par exemple l’accès à l’aisance matérielle, et par opposition à ce qui seraient des formes de capital social lié à la noirité et associées avec la pauvreté. Les étudiants de couleur aisés eurent aussi tendance à se faire l’écho de positions se voulant apolitiques ou « racialement neutres » au sujet de la race et du racisme, ainsi qu’à être moins engagés dans les mobilisations étudiantes. Tom, étudiant noir de US1, qui a décrit la situation de sa famille comme « confortable » et « aisée », ses deux parents étant des professionnels accomplis, a terminé ses études de premier cycle dans une autre université d’élite. Non engagé politiquement, il fait aussi un compte-rendu se voulant racialement neutre de ses choix et expériences en tant qu’étudiant avancé à US1 :
Je ne vois pas cela comme une question de race, je ne vois pas la race de cette manière. Mes amis sont mes amis pour ce qu’ils sont et parce qu’on s’entend bien. Nous avons en commun beaucoup de choses — des choses que nous partageons et que nous faisons ensemble — c’est ça qui compte, plutôt que le fait qu’ils sont blancs et je suis noir.
Tom décrit l’affirmative action comme un moyen approprié pour lutter contre les inégalités causées par la pauvreté et souvent associées à la race. Il souligne que US2 est une institution méritocratique et se doit en conséquence de combattre les inégalités scolaires, mais prend bien soin de préciser que de telles considérations n’ont pas affecté sa propre trajectoire universitaire :
Je connais la question des quotas et de l’affirmative action, mais ce n’est pas pour les gens comme moi, c’est pour ceux qui n’ont peut-être pas eu les mêmes opportunités. Des personnes qui peut-être n’ont pas eu les mêmes chances que moi. Elles peuvent être par exemple de milieux sociaux défavorisés avec des écoles médiocres et US2 compense ces personnes. Mais pour moi, tel ne fut pas le cas, car je ne viens pas de ce type d’environnement.
En différenciant ses résultats universitaires de ceux d’étudiants de couleur venant de milieux défavorisés, Tom réitère la revendication d’étudiantes et étudiants blancs aisés d’avoir gagné leur place dans une université d’élite sur la base uniquement de leur « mérite » et leurs résultats scolaires. Tom souligne explicitement que sa place à US2 n’est pas le fruit de considérations liées à sa race ou ethnicité et que ce fait est bien compris et acté par d’autres étudiant·e·s, ainsi que par le corps enseignant. Les parallèles qu’il fait avec d’autres étudiant·e·s mettent en évidence sa proximité ressentie avec les majoritaires. Tom semble séparer son identité ethnique et de classe, dans la mesure où il aligne ses centres d’intérêt plus étroitement avec ceux des Blancs de classe moyenne que des Noirs en général. Or, une affirmation commune dans les témoignages d’étudiants et étudiantes blanches aisées fut de rappeler que : malgré la conscience des privilèges hérités de leur milieu social d’origine, elles et ils n’imputent guère leur place au sein de l’université à une conséquence directe de ces privilèges. Au contraire, nous l’avons vu, elles et ils attribuent leur réussite universitaire d’abord et avant tout à leurs propres qualités et travail soutenu. En retraçant le parcours qui l’a mené à US2, Tom avance ainsi un argument similaire, reprenant dans son récit personnel les traits associés à la blanchité :
Ma présence ici a à voir avec mes résultats, elle fait partie de mon parcours et ce parcours est le même que celui de mes pairs blancs. Je suis dans la même catégorie, nous avons reçu une éducation similaire et nous sommes donc sur la même trajectoire. Ce n’est pas une question d’origine raciale, c’est une question de qui peut réussir et arriver au top. Nous sommes dans la même position parce que nous avons eu les mêmes opportunités. Les étudiants qui sont ici en raison de quotas sont différents, ils n’ont pas eu les mêmes opportunités.
Tout en expliquant que les étudiants défavorisés sont aussi capables sur le plan académique, mais qu’ils ont été efficacement désavantagés par le système éducatif, Tom ne généralise pas cet argument pour conclure que son propre milieu social privilégié lui aura facilité l’accès à une université d’élite. Son récit légitime sa position en termes de réussite personnelle plutôt que de processus structurels. En cela, sa vision recoupe celle d’étudiants blancs aisés. Pour ceux comme Tom, l’importance accordée au fait de s’aligner sur les comportements, attitudes et visions du monde des Blancs montre à quel point la blanchité est confortée et privilégiée sur les campus de l’élite.
la blanchité comme avantage compétitif ou le dilemme de la divergence des intérêts
Destinées en apparence à remédier aux effets structurels du racisme, les initiatives estampillées EDI nécessitent d’être reproblématisées, à la lumière de l’enquête, à l’intérieur d’une analyse renouvelée de la persistance du racisme au sein des universités d’élite. En reconnaissant publiquement faire face à un problème de race et de racisme, ces institutions sont perçues comme faisant des efforts pour y remédier. Elles engrangent ainsi, d’une part, les bénéfices liés aux effets d’annonce de leurs politiques EDI — en même temps qu’elles conjurent les échecs à venir — la déclaration valant ici preuve d’engagement ; cependant, et d’autre part, ces prises de position publiques sont aisément traduites au sein des établissements en des discours qui épinglent la manière dont EDI nuit aux étudiants blancs. Beaucoup d’étudiant·e·s de couleur ont ainsi témoigné de leurs pairs blancs, évoquant ouvertement l’avantage supposé que leur ethnicité leur aura conféré par le biais de « quotas », « mesures spéciales » et « cases à cocher ». Ces croyances nous sont apparues dans l’enquête comme un moyen collectif de maintenir le récit méritocratique de l’institution, tout en sapant les fondements de l’estime de soi et les qualifications d’étudiants et étudiantes non pourvues en capitaux de blanchité. Ils et elles se voient ainsi exposés à une double peine. Beaucoup évoquent le sentiment qu’une place leur aura été « accordée » dans le seul but d’afficher une façade institutionnelle inclusive, plutôt qu’à la faveur d’un véritable engagement pour élargir la communauté éducative.
Un résultat important de la recherche fut ainsi de montrer l’échec relatif des politiques EDI dans les quatre universités enquêtées. D’un point de vue pratique, les engagements pris pour lutter contre le racisme structurel ou systémique n’ont pas abouti à des changements. Comme le montrent les témoignages recueillis, l’expérience du racisme est toujours considérée comme un événement banal et ordinaire dans la vie de l’université. Cet article a permis d’éclairer la manière dont sa persistance dans les espaces très compétitifs des universités d’élite a partie liée avec le travail accompli par le capital blanc. Nous en avons analysé deux modalités spécifiques — marque d’appartenance et label méritocratique — qui en viennent à constituer un véritable avantage compétitif que les étudiants majoritaires manient de manière stratégique dans et au-delà des campus.
Aussi, si dans les termes de l’analyse fondatrice de Bell (1980), les politiques de l’intégration raciale aux États-Unis relèvent historiquement d’un phénomène de « convergence des intérêts » ; la situation actuelle qui s’avère marquée par le repli des intérêts blancs et la remise en cause des politiques EDI est à analyser, au contraire, comme relevant d’une logique de divergence des intérêts blancs. Dans son analyse, à la fois célèbre et controversée, de Brown v. Board of Education, Bell fait valoir, en effet, que les arguments juridiques en faveur de la déségrégation des écoles publiques se sont imposés dans la mesure où ils recoupent les intérêts blancs du moment. Il note en particulier que le tournant judiciaire dans la lutte contre la ségrégation scolaire coïncide avec les intérêts politiques de l’élite blanche, modelés par la crainte que la politique étrangère des États-Unis dans les pays du tiers-monde ne soit entravée par les manifestations internes de violence raciste ; le retour des soldats noirs de la Seconde Guerre mondiale, désabusés par la persistance du racisme et peu disposés à se battre à nouveau ; ou, encore, le maintien de la ségrégation comme obstacle à l’industrialisation dans les États du sud des États-Unis. Dans ce contexte, la déségrégation des écoles publiques fut plus bénéfique à l’élite blanche, tant sur le plan national que global, que ne l’était la captation de ressources au profit des seules écoles réservées aux Blancs. Si l’arrêt Brown fut unanimement salué comme un triomphe du libéralisme, le processus de déségrégation s’est avéré long et contesté, avec des développements subséquents qui indiquent le repli des intérêts blancs et l’émergence d’une re-ségrégation scolaire (Feagin et Barnett, 2004 ; Rosiek, 2019 ; Trounstine, 2020).
De manière parallèle, les témoignages recueillis dans l’enquête suggèrent que l’engouement apparent des universités d’élite pour la diversité sert d’abord et surtout les intérêts des étudiants blancs (voir aussi Warikoo, 2016 et ici). Que ce soit pour éviter le discrédit public ou ne pas subir des pertes liées aux financements de l’État, ces institutions ont en effet de nombreuses raisons de vouloir donner l’image qu’elles combattent le racisme. Notre étude met toutefois en évidence les difficultés auxquelles elles font face pour maintenir la crédibilité de leurs discours méritocratiques, alors même que les données attestent sans discontinuer la probabilité moindre des étudiants minoritaires et moins aisés d’y accéder, parce que précisément minoritaires et défavorisés (voir pour les données les plus récentes Chetty et al., 2023). Dans ce contexte, les efforts déployés pour améliorer le fonctionnement méritocratique, dont les politiques estampillées EDI, démasquent de manière attendue l’avantage que le capital blanc confère à celles et ceux qui en sont pourvus. De ce point de vue, la blanchité n’est pas seulement liée à une plus forte probabilité d’accéder à une institution d’élite, elle est aussi l’apanage des universités d’élite, elles-mêmes, qui sans cesse affinent leurs propres pratiques racistes, comme en matière de recrutement, à l’avantage des candidats blancs (Karabel, 2005).
Pour des institutions qui tirent leur légitimité de la prétention à incarner l’essence même de la norme méritocratique — considérant que la valeur de leurs diplômes traduit une mesure objective de la performance des tout meilleurs étudiants, encadrés par l’élite — cela finit par créer cependant un problème aigu. La promesse méritocratique s’affaiblit au fur et à mesure que les universités reconnaissent la nécessité de combattre le racisme, admettant implicitement ainsi qu’elles n’auraient pas recruté les tout meilleurs étudiants. Leur légitimité à exercer leur pouvoir dans les sphères sociales, économiques et politiques repose en grande partie sur l’exclusivité de leurs pratiques (Bhopal et Myers, 2023), c’est-à-dire un large consensus qui scelle le caractère unique de leur production de savoirs. Leur élitisme est en conséquence terni si elles ne sont pas en mesure de soutenir une prétention convaincante à ce caractère unique et exclusif de leur pratique.
Aussi, les manoeuvres entamées depuis l’annonce d’un engagement en faveur de la diversité jusqu’à l’émergence d’un récit qui sape les bénéficiaires de ces politiques offrent un exemple frappant de capital blanc oeuvrant à la protection de ses propres besoins. Dans les champs hautement compétitifs des universités d’élite, EDI dévalorise les capitaux des étudiants racisés, dont les aptitudes et qualifications se trouvent désormais évaluées à l’aune d’un impératif institutionnel qui préside à l’adoption de ces politiques. Dans le même temps, les capitaux des étudiants blancs en sont rehaussés dans la mesure où leurs aptitudes et qualifications sont reconnues comme les résultats légitimes d’un travail personnel appliqué. Il est ainsi instructif de noter que, si le récit institutionnel de la méritocratie est corrodé, cela nuit d’abord et avant tout aux étudiants de couleur.
Selon Pierre Bourdieu, un champ institutionnel, tel que les universités d’élite, est un espace dans lequel « un effet du champ s’exerce, de sorte que ce qui arrive à tout objet qui traverse cet espace ne peut s’expliquer uniquement par les propriétés intrinsèques de l’objet en question » (Bourdieu et Wacquant, 1992, p. 100). Nos enquêté·e·s ont clairement identifié la valeur ajoutée, et supposée allant de soi, attachée au capital blanc. Que ce soit l’ensemble des qualifications et « savoir-être » qui s’attachent au corps blanc ; la fréquentation préalable d’écoles privées de l’élite ou l’affichage de marqueurs sociaux tels que la tenue vestimentaire, les goûts musicaux, la participation à des activités sportives, qui forgent le sentiment d’appartenance et apposent la marque de l’élite, le capital blanc est omniprésent. Dans certains cas, la blanchité a une valeur plus absolue (p. ex. : couleur de peau, marque somatique) ; dans d’autres, il s’agit davantage d’attributs sociaux. Dans tous les cas, cependant, la matérialisation de la blanchité dans ce champ institutionnel s’est vu accorder une valeur supérieure à celle d’autres formes de capitaux et a donc, en ce sens, constitué une ressource plus efficace dans la compétition pour d’autres capitaux. C’est dans ce contexte que le langage qui entoure les politiques EDI s’est déplacé de la reconnaissance du racisme à la dénonciation d’un « racisme inversé » qui positionne les Blancs en victimes.
conclusion
Nos conclusions (Bhopal et Myers, 2023) montrent ainsi que les étudiants qui détiennent les attributs de la blanchité détiennent une propriété, au double sens du terme, qui leur facilite l’accès aux universités d’élite, tout comme leur permet d’améliorer la qualité de leur expérience et résultats académiques. De même, les étudiantes et étudiants minoritaires les plus à l’aise et confiants dans leur position au sein de cet univers furent des personnes aisées, pourvues en conséquence de formes de capital blanc. Pour les étudiantes et étudiants de couleur moins fortunés, bien qu’ils et elles aient identifié les preuves factuelles de la dévalorisation de leurs propres expériences par le racisme, le doute s’est avéré tenace quant à leur légitimité et leur droit à occuper ces espaces. Malgré leurs déclarations publiques, les universités d’élite continuent à reproduire des formes de pouvoir et de capital blancs, en partie grâce à leur capacité à générer un discours qui affaiblit la portée de leurs propres agendas en matière de démocratisation et de diversité.
Si, dans ce processus, certaines différences nous sont apparues entre universités américaines et britanniques en termes par exemple de rapports entre identité de race et de classe — les deux ayant tendance à être davantage confondues dans le contexte américain, tandis que la classe à être considérée comme une caractéristique importante, dans le contexte britannique ; en termes de nomenclature et de terminologie associées aux politiques de diversité ; ou encore, en termes de formes et d’expériences vécues du racisme — une logique globale s’est également dégagée des deux côtés de l’Atlantique, selon laquelle dans le champ des universités de l’élite, le capital blanc demeure une forme dominante de pouvoir.
Son poids et sa capacité à réinventer le racisme dans des cadres sociaux en renouvellement nous sont clairement apparus dans l’enquête, à partir notamment des récits construits autour des politiques étiquetées EDI, dont les dispositifs d’affirmative action ou d’admission contextuelle au Royaume-Uni. En réinterprétant ces dispositifs en termes de barrières conçues pour les exclure, les étudiants et étudiantes blanches de classe moyenne se retranchent derrière une posture de supériorité méritocratique qui valorise et légitime leur engagement et aptitudes personnelles, cependant qu’elle fragilise ceux de leurs pairs racisés. L’idée qu’ils et elles puissent récolter les bénéfices de multiples privilèges accumulés se trouve, par là même, neutralisée. Aussi, la faculté de la blanchité à agir comme une forme presque invisible de capital ne saurait être sous-estimée. Elle démontre la manière dont le racisme demeure une caractéristique ordinaire, banale et routinière dans la vie des campus. La facilité avec laquelle les discours de la diversité glissent de la menace perçue à un discours favorable aux intérêts majoritaires suggère, en effet, la plasticité et la grande adaptabilité du capital blanc qui sans cesse coopte ou préempte les changements institutionnels de nature à bouleverser le statu quo et faire perdre aux Blancs les bénéfices de leur position dominante.
Appendices
Notes
-
[1]
La présentation des politiques d’affirmative action aux États-Unis et d’admission contextuelle au Royaume-Uni, ainsi que de leurs développements les plus récents dans le sillage de l’arrêt SFFA, est au-delà des objectifs des cet article. La temporalité de notre enquête de terrain, en particulier, n’inclut pas les retombées consécutives à la décision de la Cour suprême américaine. Pour une discussion d’ensemble, voir l’introduction de ce dossier.
-
[2]
La Ivy League, aux États-Unis, est formée de huit universités, parmi les plus riches et prestigieuses. Oxbridge est le nom donné aux deux universités les plus anciennes et les plus riches du Royaume-Uni que sont Oxford et Cambridge. Le Russell Group regroupe 24 universités d’élite du Royaume-Uni connues pour leur excellence en matière de recherche et qui se placent régulièrement dans le haut des classements internationaux.
-
[3]
Cette attitude n’est cependant pas sincère, étant donné le caractère offensant, établi de longue date, du « blackface » (par exemple, Douglass, 1848).
-
[4]
Créées à la fin du xixe siècle par une législation spécifique, les universités « land-grant » furent celles implantées sur des terres gracieusement données par l’État fédéral, souvent prises aux populations autochtones.
-
[5]
Les participant·e·s ont fait état de diverses caractéristiques démographiques : 23 étudiant·e·s se sont identifié·e·s comme blanc·he·s, 7 comme métis·se·s, 5 comme noir·e·s, 4 comme asiatiques et 2 comme latino·a·s. D’autres ont indiqué leur appartenance ethnique sur la base d’autres catégories, par exemple, « musulman malaisien ». Principalement de nationalité étatsunienne et britannique, les participant·e·s se sont identifié·e·s comme originaires d’Afghanistan, de France, de l’Inde, de Malaisie, de Nouvelle-Zélande et d’Écosse (par opposition au Royaume-Uni ou à la Grande-Bretagne). 20 étaient des étudiantes et étudiants internationaux, dont 10 Britanniques étudiant aux États-Unis et 2 étudiants américains au Royaume-Uni. Interrogé·e·s sur la profession et le niveau d’instruction de leurs parents, ainsi que sur leurs expériences éducatives antérieures, leurs réponses ont révélé un éventail large de statuts socio-économiques que nous indiquons au fur et à mesure afin d’analyser au plus près leurs récits et expériences respectives.
Bibliographie
- Apple, M. (1998). Foreword. Dans J. Kincheloe, S. Steinberg, N. Rodriguez et R. Chennault (dir.), White Reign. St Martin’s Griffin, p. ix-xiii.
- BBC News (2002, 30 septembre). Private schools claim university bias. BBC News World Edition. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/2288265.stm
- Bell, D. A. (1980). Brown v. Board of Education and the Interest-Convergence Dilemma. Harvard Law Review, 93(3), 518-533.
- Bhopal, K. (2018). White Privilege : The Myth of a Post-Racial Society. Policy Press.
- Bhopal, K. (2022). Academics of colour in elite universities in the UK and the USA : the ‘unspoken system of exclusion’. Studies in Higher Education, 47(11), 2127-2137.
- Bhopal, K. et Myers, M. (2008). Insiders, Outsiders and Others : Gypsies and Identity. UHP.
- Bhopal, K. et Myers, M. (2023). Elite Universities and the Making of Privilege : Exploring Race and Class in Global Educational Economies. Taylor & Francis.
- Bhopal, K., Myers, M. et Pitkin, C. (2020). Routes through higher education : BME students and the development of a ‘specialisation of consciousness’. British Educational Research Journal, 46(6), 1321-1337.
- Boliver, V. (2013). How fair is access to more prestigious UK universities ?. The British Journal of Sociology, 64(2), 344-364.
- Bonilla Silva, E. (2006). Racism Without Racists : Colour-Blind Racism and the Persistence of Racial Inequality in the United States. Rowman & Littlefield Publishers.
- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. Dans J. Richardson (dir.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (p. 241-258). Greenwood.
- Bourdieu, P. (1998). The State Nobility : Elite Schools in the Field of Power. Stanford University Press.
- Bourdieu, P. et Waquant, L. (1992). An Invitation to Reflexive Sociology. University of Chicago Press.
- Braun, V. et Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
- Cabrera, N. (2014). Exposing Whiteness in Higher Education : White Male College Students Minimising Racism, Claiming Victimization and Recreating White Supremacy. Race Ethnicity and Education, 17(1), 30-55.
- Carter, P. (2005). Keepin’ it Real : School Success Beyond Black and White. Oxford University Press.
- Chakrabarty, N., Roberts, L. et Preston, J. (dir.) (2014). Critical Race Theory in England. Routledge.
- Chetty, R., Deming, D. J. et Friedman, J. N. (2023). Diversifying Society’s Leaders ? The Causal Effects of Admission to Highly Selective Privatec Colleges (n° 31492). National Bureau of Economic Research.
- Delgado, R. et Stefancic, J. (2017). Critical Race Theory : An Introduction. New York University Press.
- Douglass, F. (1848, 27 octobre). The Hutchinson Family. Hunkerism. The North Star. https://lccn.loc.gov/sn84026365
- Dyer, R. (1997). White. Routledge.
- The Economist (2005, 8 septembre). The Brains Business.
- Feagin, J. R. et Barnett, B. M. (2004). Success and Failure : How Systemic Racism Trumped the Brown v. Board of Education Decision. University of Illinois Law Review, (5), 1099-1130. https://illinoislawreview.org/print/volume-2004-issue-5/success-and-failure-how-systemic-racism-trumped-the-brown-v-board-of-education-decision/
- Frankenberg, R. (1993). White Women, Race Matters : The Social Construction of Race. University of Minnesota Press.
- Gillborn, D. (2005). Education as an Act of White Supremacy : Whiteness, Critical Race Theory and Education Reform. Journal of Education Policy, 20(4), 485-505.
- Gillborn, D. (2008). Racism and Education : Coincidence or Conspiracy ? Routledge.
- Giroux, H. (1997). Racial Politics and the Pedagogy of Whiteness. Dans M. Hill (dir.), Whiteness : A Critical Reader (p. 294-315). New York University Press.
- Hartigan Jr, J. (1997). Name Calling. Dans M. Wray et A. Newitz (dir.), White Trash : Race and Class in American (p. 41-56). Routledge.
- Hartocollis, A. (2020, 18 février). The Affirmative Action Battle at Harvard Is Not Over. New York Times. https:// www.nytimes.com/2020/02/18/us/affirmative-action-harvard.html
- Hitchens, P. (2022, 5 novembre). The Oxbridge war on private schools doesn’t help the poor it punishes families who put education before houses and holidays, writes PETER HITCHENS. The Daily Mail. https://www.dailymail.co.uk/debate/article-11394109/The-Oxbridge-war-private-schools-doesnt-help-poor-writes-PETER-HITCHENS.html
- Hooks, b. (1997). Representing Whiteness in the Black Imagination. Dans R. Frankenberg (dir.), Displacing Whiteness (p. 165-179). Duke University Press.
- Horvat, E. (2003). The Interactive Effects of Race and Class in Educational Research : Theoretical Insights from the work of Pierre Bourdieu. Penn GSE Perspectives on Urban Education, 2, 1-25.
- Hurtado, A. (1996). The Color of Privilege. University of Michigan Press.
- Ignatiev, N. (1995). How The Irish Became White. Routledge.
- Karabel, J. (2005). The chosen : The hidden history of admission and exclusion at Harvard, Yale, and Princeton. Houghton Mifflin Harcourt.
- Kidder, L. (1997). Colonial Remnants : Assumptions of Privilege. Dans M. Fine, L. Weis, L. Powell et L. Wong (dir.), Off White, (p. 158-166). Routledge.
- Kincheloe, J. et Steinberg, S. (dir.) (1998). Addressing the Crisis of Whiteness : Reconfiguring White Identity in a Pedagogy of Whiteness. Dans N. Rodriguez et R. Chennault (dir.), White Reign (p. 3-29). St Martin’s Griffin.
- Ladson-Billings, G. et Tate, W. (1995). Toward a critical race theory of education. Teachers College Record, 97(1), 47-68.
- Leonardo, Z. (2009). Race, Whiteness and Education. Routledge.
- Maguire, D. et Morris, D. (2018). Homeward Bound : Defining, understanding and aiding ‘commuter students’. Higher Education Policy Institute.
- McIntosh, P. (1992). White Privilege and Male Privilege : A Personal Account of Coming to See Correspondences Through Work in Women’s Studies. Dans M. Andersen et P. Collins (dir.), Race, Class and Gender : An Anthology (p. 70-81). Wadsworth Publishing.
- McKinney, K. (2004). Being White : Stories of Race and Racism. Routledge.
- Myers, M. (2020). An Inheritance of Exclusion : Roma Education, Genetics and the Turn to Bio-social Solutions. Research in Education, 107(1), 55-71.
- Myers, M. (2022). Racism, Zero-Hours Contracts and Complicity in Higher Education. British Journal of Sociology of Education, 43(4), 584-602. https://doi.org/10.1080/01425692.2022.2042192
- Omni, M. et Winant, H. (1994). Racial Formation in the United States. Routledge.
- Preston, J. (2007). Whiteness and Class in Education. Spinger.
- Reay, D. (2018). Miseducation. Policy Press.
- Roediger, D. (1991). The Wages of Whiteness. Verso.
- Rosiek, J. (2019). School segregation : A realist’s view. Phi Delta Kappan, 100(5), 8-13.
- Sennett, R. et Cobb, J. (1972). The Hidden Injuries of Class. Cambridge University Press.
- Sleeter, C. (1996). White Silence, White Solidarity. Dans N. Ignatiev et J. Garvey (dir.), Race Traitor, (p. 257-265). Routledge.
- Students for Fair Admissions v. Harvard, 600 U.S. 181 (2023).
- Tate, W. F. (1997). Critical Race Theory and Education : History, Theory, and Implications. Review of Research in Education, 22, 195-247. https://www.jstor.org/stable/1167376
- Torres, K. (2009). Culture shock : Black students account for their distinctiveness at an elite college. Ethnic and Racial Studies, 32(5), 883-905.
- Trounstine, J. (2020). The geography of inequality : How land use regulation produces segregation. American Political Science Review, 114(2), 443-455.
- Van Meter, K. (1990). Methodological and Design Issues : Techniques for Assessing the Representatives of Snowball Samples. NIDA Research Monograph, 98, 31-43.
- Warikoo, N. (2016). The Diversity Bargain: And Other Dilemmas of Race, Admissions, and Meritocracy at Elite Universities. University of Chicago Press.
- Warmington, P. (2014). Black British Intellectuals and Education : Multiculturalism’s Hidden History. Routledge.