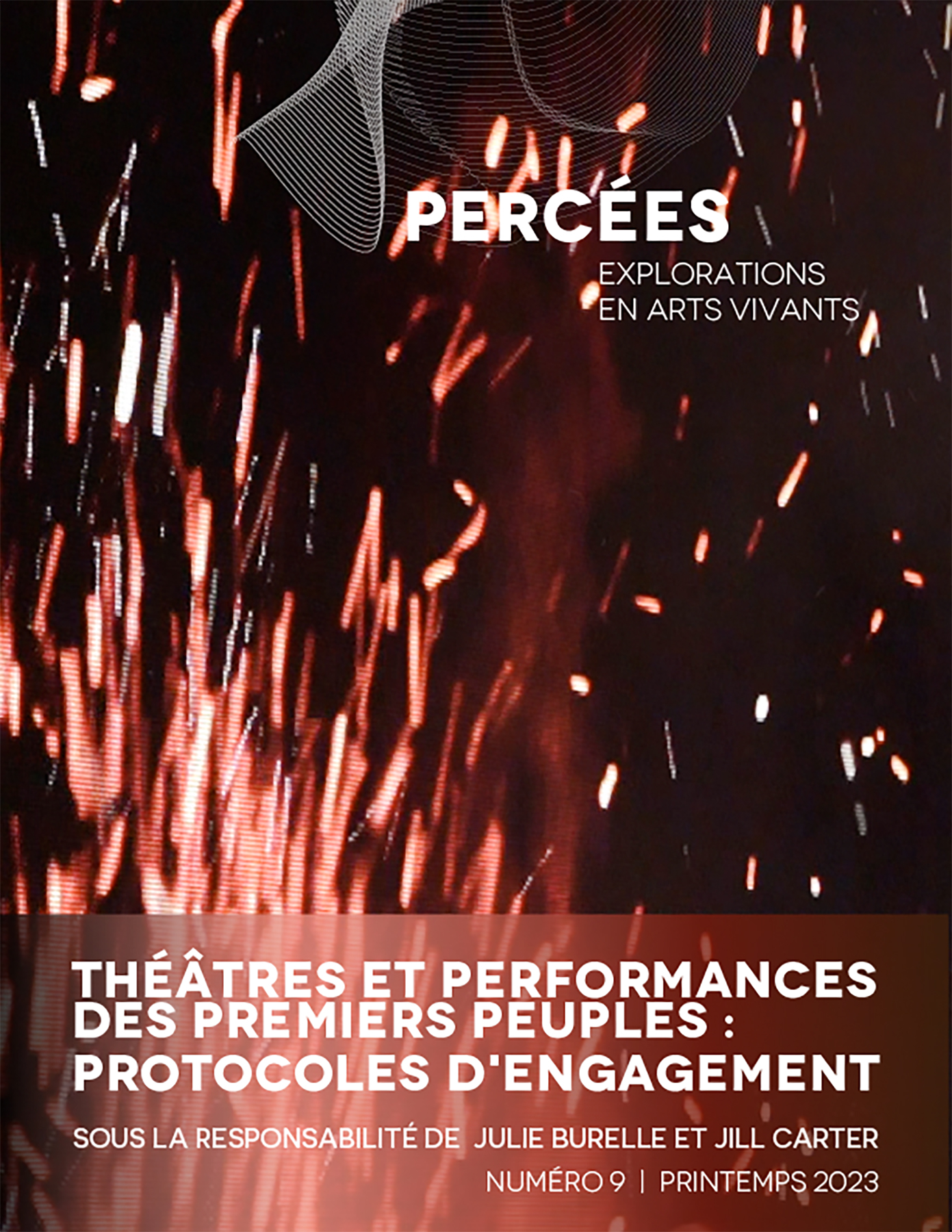Abstracts
Mots-clés :
- théâtre,
- dramaturgie,
- oblitération,
- lumière,
- traumatisme,
- voix
Qu’advient-il lorsque d’un théâtre comme espace où règne la vision, l’on se tourne vers une scène qui se méfie de la tentation spéculaire? Un théâtre qui résiste à l’oeil, peut-être, pour avancer d’autres voir que celui, primaire, de l’organe dont on dit qu’il constitue le miroir de l’âme... Ce sont les dramaturgies de l’absence et de l’évanescence des images que s’attarde à analyser Élisabeth Angel-Perez dans Le théâtre de l’oblitération : essai sur la voix photogénique dans le théâtre britannique contemporain, paru en décembre 2022 aux Sorbonne Université Presses. Explorant le paysage dramaturgique britannique depuis la Seconde Guerre mondiale, Angel-Perez y poursuit une réflexion apparentée à celle de son précédent ouvrage sur les dramaturgies du traumatisme. Impossible, en effet, de ne pas souligner la filiation entre ces deux textes, qui articulent des perspectives jumelles décrivant les horizons poétiques et esthétiques d’un art de la présence quand à celle-ci se substitue une absence dont on ne cesse de marteler la signifiance. C’est que l’oblitération est difficilement dissociable de l’imaginaire traumatique, chacune des dramaturgies abordées étant décrite, à un moment ou à un autre, comme disposant d’une dimension traumatique. Ici, les jeux de tension entre présence et absence agissent principalement au niveau de la vue qui, comme le rappelle Angel-Perez, apparaît comme le coeur historique des pratiques théâtrales : « Si le noir est par nature immersif, le théâtre, on le sait, se construit autour de la vue (théa, en grec), et le spectateur vient au théâtre mu par une pulsion scopique qu’il sait d’avance devoir être assouvie. Or […] que se passe-t-il quand précisément la pulsion scopique est niée ou pour le moins frustrée? » (30) Fondant sa définition de l’oblitération sur une série d’entretiens du philosophe Emmanuel Levinas avec le sculpteur Sacha Sosno, Élisabeth Angel-Perez avance que « l’oblitération – qui littéralement “raye la lettre” (ob-littera), efface, rature, plonge dans l’oubli – […] [est] destiné[e] à la fois “à biffer et dénoncer le scandaleux” et à “rendre sensible la part de non-sensible que recèle nécessairement le visage humain ou le corps humain” » (11). Cette dualité de l’oblitération ancre les réflexions de la chercheuse dans une série de juxtapositions (en apparence contradictoires) structurant les dramaturgies contemporaines britanniques, qu’elle aborde dans une perspective dialectique. À cet égard, le sous-titre de l’ouvrage fait office d’inscription inaugurale. Le photogénique, appliqué au contexte du théâtre de l’oblitération, désigne les multiples façons, au sein du texte dramatique ou de sa mise en scène, de faire advenir un sensible qui dépasse l’image. Ce concept, collé à la question de la voix, permet à Angel-Perez d’aborder les modalités d’énonciation des (im)personnages habitant les espaces dramatiques, mais plus largement d’évaluer comment certain·es praticien·nes optent pour des modes de représentation qui, en résistant à l’invitation d’une représentation qui s’inscrirait visuellement dans un rapport d’imitation fidèle du réel, deviennent des dramaturgies de la révélation, réorganisant les perceptions de la scène en faisant sentir quelque chose au-delà de la vue. C’est la richesse des nombreuses itérations d’un « ne pas montrer » (14) qui catalyse la pensée d’Angel-Perez. Par ailleurs, la langue employée dans ce texte semble faire en partie écho à son propos : rythmé par une multiplicité de formules oxymoriques, le langage est exploré poétiquement, parfois au détriment de la clarté du propos, plongeant en partie la pensée dans l’ombre. D’emblée, deux dimensions de l’essai irriguant l’ensemble des réflexions d’Angel-Perez méritent d’être explicitées : d’une part, du point de vue des influences, les modes de représentation abordés sont souvent informés par le cinéma et la photographie et participent, dans les pratiques dont il …