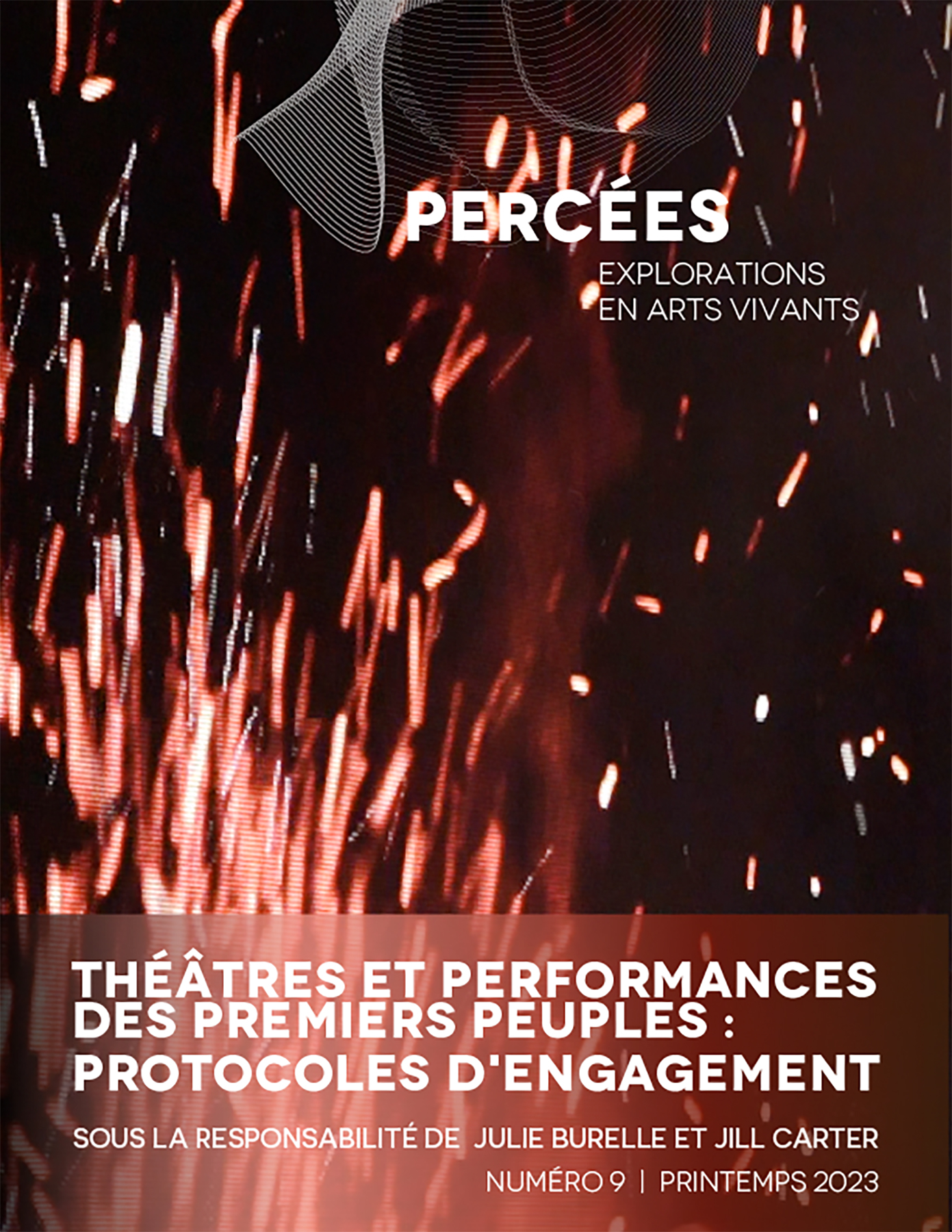Abstracts
Mots-clés :
- spectacle,
- théâtre contemporain,
- performance,
- épistémologie,
- méthodologie
Premier volume de la collection « Universcènes » des Presses Universitaires de Bordeaux, Observer le théâtre : pour une nouvelle épistémologie des spectacles est le fruit du colloque éponyme organisé en 2016 sous la direction de Sandrine Dubouilh et Pierre Katuszewski. Dans un contexte où, selon les deux directeur·trices, l’interprétation tend à précéder l’observation, L’observation est d’emblée posée comme thème structurant du livre, qui vise aussi bien à « réhabiliter la légitimité du spectacle et du spectaculaire dans les études théâtrales » qu’à « revaloriser les techniques qu’il s’agit […] d’observer et de comprendre » (7). Au-delà de ce double objectif, l’ouvrage concourt à renouveler le regard porté sur les spectacles « faisant école », dont il actualise dans un même mouvement le corpus. Devant le cloisonnement des différentes arènes consacrées aux arts vivants à l’échelle mondiale (dont les traditions et langues sont diversifiées) et la multiplication actuelle des pratiques, centres, groupes et laboratoires de recherche, la publication d’un ouvrage de synthèse tel que celui-ci constitue un événement important. Les six textes formant la première partie de l’ouvrage, intitulée « Observer un art éphémère et performatif : qu’observe-t-on? Avec quels outils? Quelles méthodes? », peuvent tout à fait être lus comme trois dyades thématiques et conceptuelles. La première, composée d’un premier texte rédigé par Guy Spielmann et d’un second par Arianna Beatrice Fabbricatore, engage un questionnement de fond sur le rapport que nous entretenons avec les faits et les données d’analyse. Spielmann aspire à développer une « histoire événementielle des spectacles du passé », qu’il nomme « spectaclologie »; celle-ci « s’intéresse à l’événement dans son irréductible spécificité, pour tenter d’en établir le sens et l’effet dans le contexte originel de son déroulement » (21). Pour l’auteur, la valeur événementielle d’un texte tiendrait à sa fonction et à sa relation avec les autres composantes de la « séance » bien plus qu’à une valeur esthétique (subjective) : la signifiance de l’événement serait liée à sa « valeur politique » (23). Le second texte, s’il ne répond pas aux arguments formulés par Spielmann, n’en propose pas moins des idées qui lui sont conceptuellement opposées. Fabbricatore se fonde en effet sur l’approche herméneutique pour fustiger le « mythe de l’objectivité » et défendre la « primauté de l’interprétation sur les faits » (28). Le principe fondamental que l’autrice développe s’appuie sur la pensée de ce que l’oeuvre « pouvait être » plutôt que de « ce qu’elle était » (30). Une conversation théorique émerge donc de cette première dyade, leur lien thématique nourrissant la réflexion existante sur la pérennité des spectacles du passé et les modalités d’interprétation des traces qu’ils laissent (ou ne laissent pas). La seconde dyade, composée d’un article de Véronique Muscianisi et d’une contribution de Thomas Bruckert, élabore deux rapports imaginaires à la chair et à l’importance de celle-ci dans les méthodologies fondées sur l’observation. La première développe une approche ancrée dans l’observation participante (OP) applicable à l’étude des arts vivants (dans ce cas précis, la danse), alors que le second prend en considération cinq figures ayant fait le choix de ne plus aller au théâtre (Roland Barthes, Stéphane Mallarmé, Gilles Deleuze, Maurice Maeterlinck et Edward Gordon Craig), pour évaluer ce que leurs discours peuvent nous apprendre sur notre rapport au théâtre et à la représentation. L’OP favorise selon Muscianisi une recherche incarnée, ce qui incite à interroger la notion même de public en art, puisqu’à partir du moment où l’observateur·trice entre en salle de répétition, la pratique artistique se voit renouvelée dans son statut par la relation de spectation qu’il·elle établit. L’enjeu englobant chez Bruckert est plutôt celui …