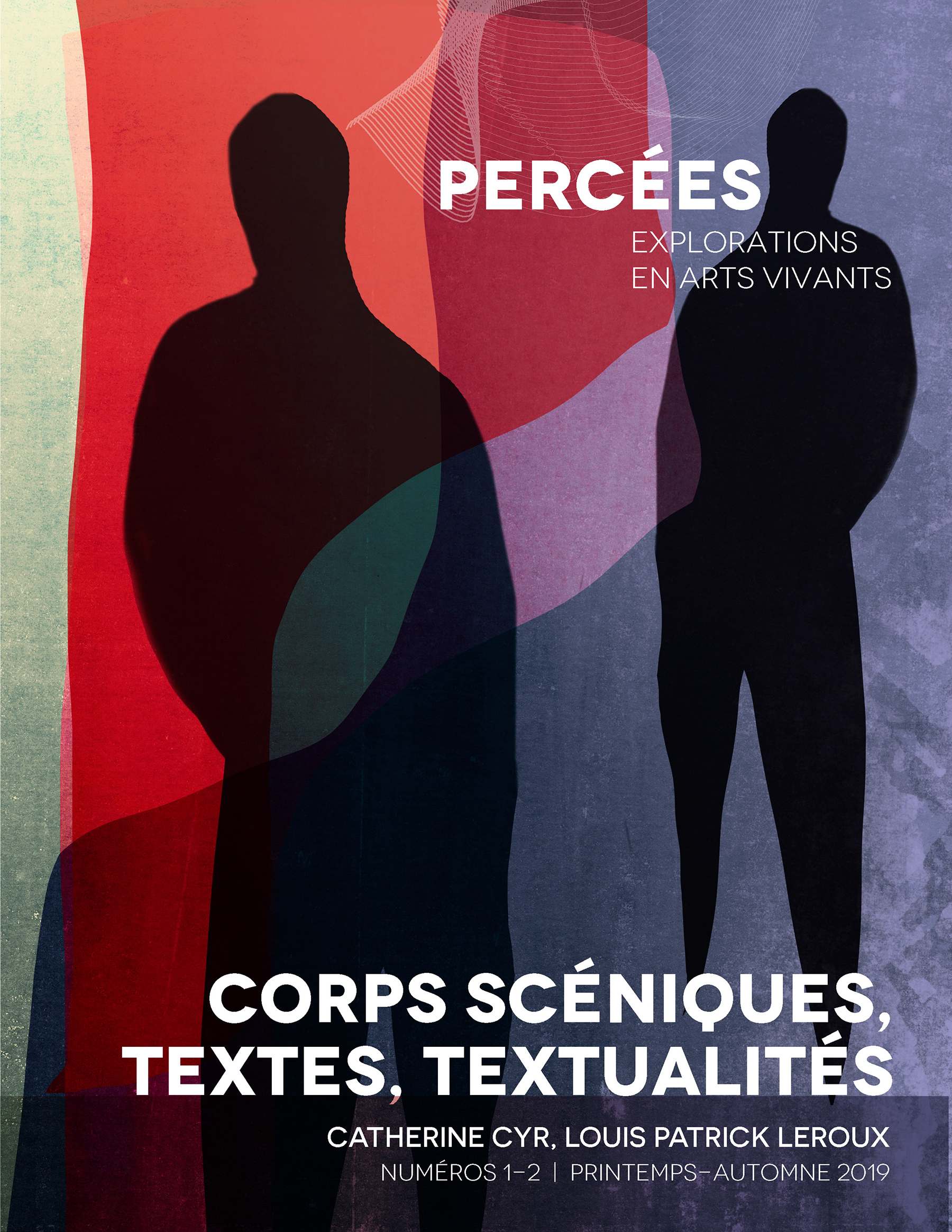Abstracts
Mots-clés :
- Motus,
- Antigone,
- tragique contemporain,
- montage,
- révolution
Nombreuses sont les représentations iconographiques qui représentent comment ceux qu’on appelle des « charlatans » mettent en scène leurs pratiques pour attirer un vaste public. Le Dictionnaire de Trévoux (1704-1771) en propose d’ailleurs une définition assez complète : « Charlatan : [...] Empyrique, vendeur de drogues, qui, monté sur des tréteaux dans une place publique, distribue au petit peuple, qu’il amuse par des bouffonneries, son orviétan et autres remèdes, auxquels il attribue des propriétés merveilleuses ». Certains d’entre eux, les opérateurs, faisaient quelques actes de chirurgie simples comme les extractions dentaires et vivaient de la vente de produits. Or, cette mise en scène de la médecine et des pratiques médicales est totalement inspirée du théâtre : tréteaux, rideaux, acteurs, tout y est, sans oublier le spectacle de la pratique elle-même. Le charlatan est une des figures emblématiques des théâtres de la foire. Mais on le retrouve aussi dans la rue, dans les salons mondains et même dans les salles de spectacle. Les études d’historien·nes de la médecine qui traitent des pratiques du charlatan sont nombreuses. De même, plusieurs spécialistes des études théâtrales se sont intéressé·es aux vrais et aux faux médecins qui abondent dans les pièces d’Ancien Régime. Or, la charlatanerie repose sur un art de l’oralité qui se décline en performances individuelles et fugaces qu’il importe de retracer. Le collectif Théâtre et charlatans dans l’Europe moderne dirigé par Beya Dhraïef, Éric Négrel et Jennifer Ruimi entend donc compléter ces travaux en s’intéressant tout particulièrement aux formes diverses que revêt le charlatanisme en Italie, en Espagne, en Angleterre et en France entre le Moyen Âge et le XIXe siècle. Issu d’un colloque tenu à Paris en 2014, l’ouvrage réunit vingt-cinq contributions pluridisciplinaires (études théâtrales, études littéraires, musicologie, histoire de l’art), de manière à cerner la réalité ambivalente du charlatan, les conditions de ce métier en marge des institutions, les rapports étroits qu’il noue entre médecine empirique et théâtralité, ainsi que les manières de faire et de dire. Il s’agit d’un ouvrage exceptionnel à bien des égards. La première partie, intitulée « Du triacleur au bonimenteur », est composée de six articles qui retracent d’abord l’évolution de la terminologie faisant référence au charlatan : mime, bateleur, histrion, triacleur, opérateur et, enfin, charlatan. Attesté dès 1572, le mot est emprunté à l’italien ciarlatano, lui-même issu du croisement de cerretano (habitant du village de Cerreto di Spoleto dont certains résidents vendaient des drogues sur les places publiques) et de ciarlare (signifiant « bavarder », « jaser »). Le charlatan est donc un expert de la parole, à la fois artiste, commerçant et savant, qui voyage souvent de ville en ville pour écouler des produits aux propriétés mirifiques. Le verbe « charlataner » conforte cette définition en ne faisant nullement allusion à la pratique médecine, mais en renvoyant aux moyens de la tromperie : « amadouer, par de belles paroles, par des promesses spécieuses » (13). Les charlatans utilisent en effet différentes stratégies pour convaincre : choix d’un emplacement stratégique, accompagnement musical à partir du XVIe siècle, extravagance vestimentaire, exhibition d’animaux étranges. Mais il y a plus. L’activité des charlatans repose sur le développement d’un art de la mise en scène. L’article de François Rémond décrit par exemple la variété des dispositifs scéniques qu’ils mobilisent de même que leur relation à l’institution théâtrale. Il montre que les distinctions entre comédie et performance, comédien et charlatan sont, somme toute, relatives (15). Les contributions suivantes confirment par ailleurs la remise en cause de ces différences en s’attardant d’abord au point de vue jésuite et à la figure de Jean-Dominique Otonelli pour qui le …