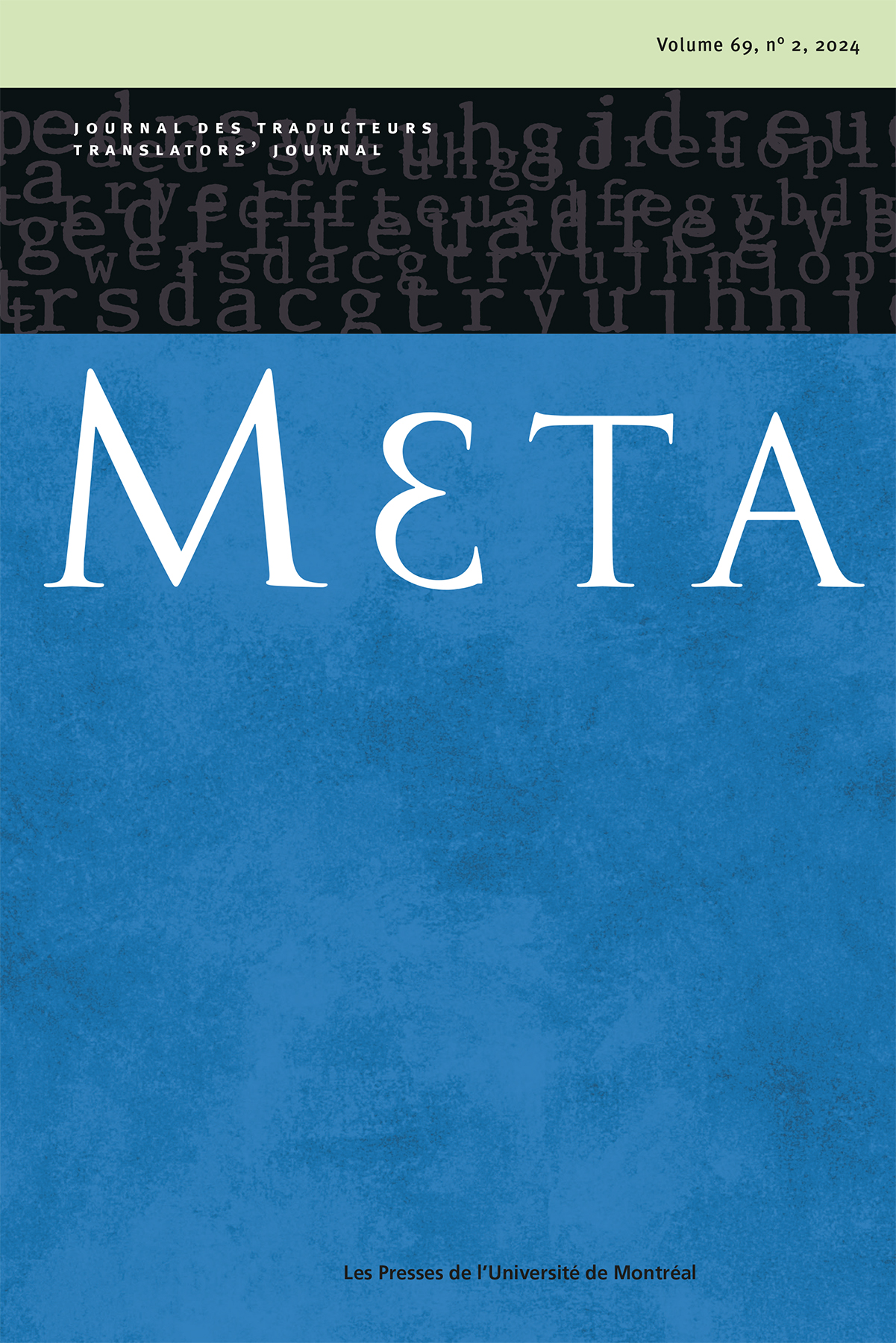Lorsque le volume La traduction dans une société interculturelle est arrivé dans ma boîte aux lettres électronique, je dois avouer qu’il y avait bien longtemps que je n’avais plus lu d’actes de colloques. Au fil des années, différents ateliers consacrés aux stratégies de publication ou à la carrière académique m’avaient convaincue que ce type de publication était d’une qualité inférieure aux ouvrages collectifs, qui sont évalués à l’aveugle et dont les chapitres obéissent à des normes scientifiques de qualité strictes. C’est donc avec un certain scepticisme que j’ai ouvert cet épais volume. En revanche, les contributions que j’y ai découvertes m’ont rappelé l’importance de ce type de publication : donner accès à un contenu scientifique au carrefour entre recherche, enseignement et pratique professionnelle. Même si leur conception de la traduction est large, Bond et al. n’ont pas exclu de leur ouvrage des travaux plus classiques sur la traduction littéraire, que l’on retrouve dans la cinquième partie des actes. Trois contributions tournent autour de la nécessaire annotation d’À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, que ce soit en français ou dans des langues cibles (ici, le néerlandais), pour faciliter la compréhension de « ses innombrables références à l’art ancien et la mythologie, à la musique, la littérature et l’histoire ; avec ses allusions à des faits divers et des potins datant de La Belle Époque » (p. 535-536) pour des lecteur·rice·s vivant dans un monde éloigné de celui de Proust. Dans une comparaison prescriptive entre deux traductions vers le néerlandais — l’une annotée, l’autre pas —, le chapitre de Schyns (p. 423-433) argumente que, même à l’heure d’Internet, les notes explicatives restent cruciales pour transporter les lecteur·rice·s « vers l’actualité politique de la jeunesse de Proust » (p. 432) et « générer de nouveaux horizons interprétatifs » (p. 433). Trois contributions s’inscrivent dans une réflexion sur l’enseignement de la traduction et la recherche en traductologie, celle d’El Qasem (directrice en 2020 de l’École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs [ÉSIT] à l’Université Sorbonne Nouvelle), celle de Segers et al. sur les compétences linguistiques des traducteur·rice·s littéraires et celle de Thibault portant sur la politique linguistique de la France dans les publications scientifiques. El Qasem expose sa vision de l’enseignement et de la place de la traduction dans un monde marqué par les avancées de l’intelligence artificielle. Même si cette vision semble plus relever d’une stratégie de communication de l’ÉSIT que d’une analyse scientifique, elle a le mérite de vulgariser les préoccupations partagées par les formations de traducteur·rice·s auprès d’agent·e·s économiques et politiques. Dans son chapitre intitulé « Langues, sciences et politique », Thibault argumente que la politique française en matière de publications scientifiques nuit à la recherche en sciences humaines parce qu’elle s’appuie sur des critères d’évaluation inadaptés (facteur d’impact et indice h). D’après Thibault, ces critères favorisent des publications en anglais lingua franca et des articles de revues savantes, alors que les sciences humaines valorisent les réflexions ancrées dans la langue-culture locale et les monographies. Cette position forte est destinée à des personnes qui ne sont pas actives dans le monde académique, ce qui est essentiel pour favoriser le dialogue entre la théorie et la pratique. Toutefois, elle ne tient pas compte des évolutions en la matière, comme la déclaration de DORA (2023), qui vise à changer les critères d’évaluation de la recherche et qui a été signée par 87 universités en France, 59 en Suisse, 50 au Canada et 27 en Belgique (pour faire un rapide tour d’horizon des pays francophones de l’hémisphère Nord). Dans le domaine de la traduction littéraire, Segers et al. se demandent …
Appendices
Bibliographie
- Cronin, Michael (2017) : Eco-Translation : Translation and Ecology in the Age of the Anthropocene. Londres : Routledge.
- DORA, Declaration on Research Assessment (2023) : About DORA. DORA. Consulté le 17 mars 2025, https://sfdora.org/about-dora.