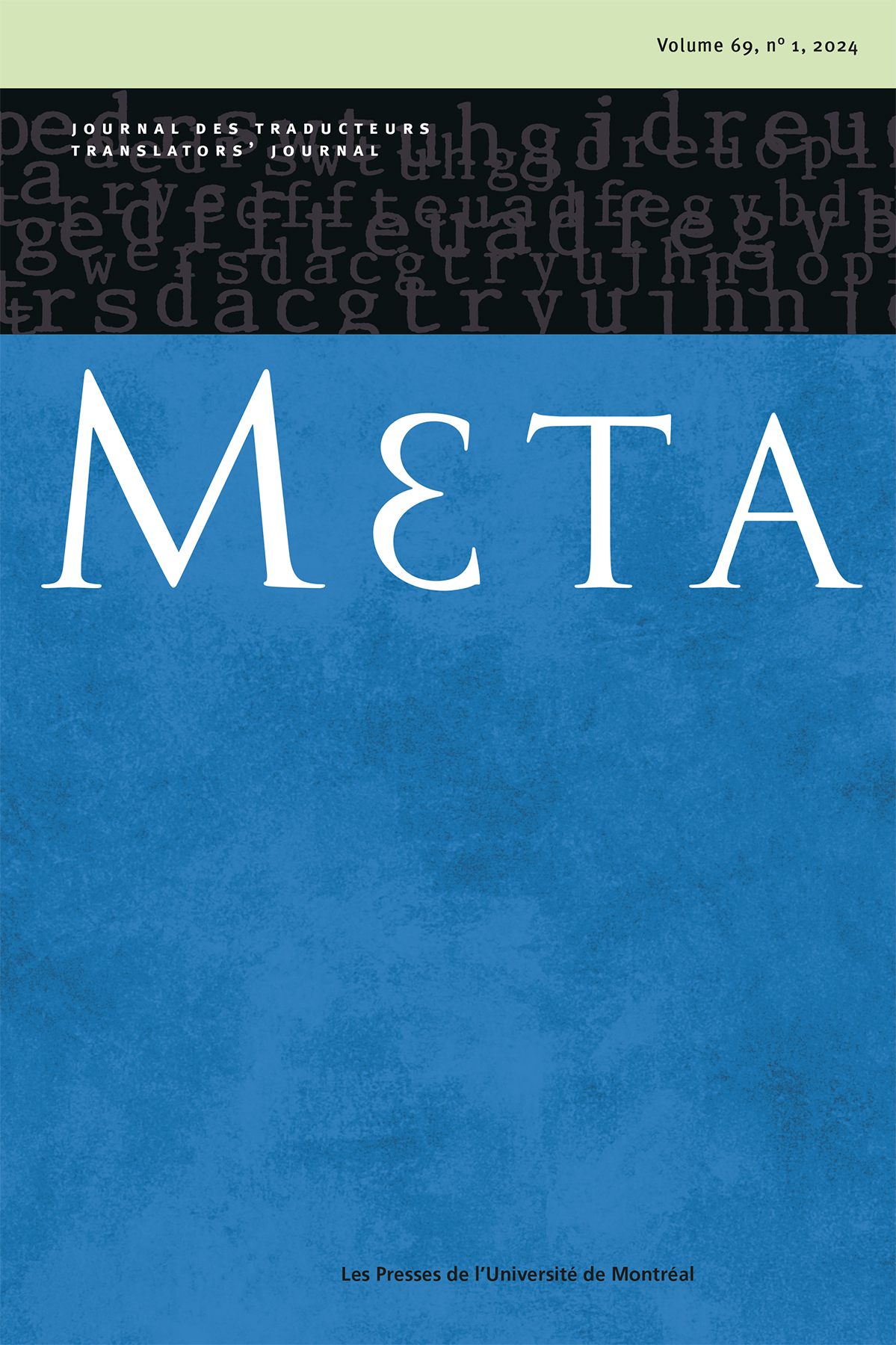Article body
Linguistique contrastive : énonciation et activité langagière rassemble en un volume unique un choix important de 21 articles de Jacqueline Guillemin-Flescher, publiés sur quatre décennies dans diverses revues et publications savantes. Le recueil représente un travail remarquable de sélection et de mise en forme par les membres de l’équipe éditoriale cités sur la page de garde. Les remerciements réciproques de l’auteur et de l’équipe sont suivis d’une note éditoriale, précisant la démarche de réédition. Une courte biographie de Jacqueline Guillemin-Flescher rappelle les points clés de la carrière de la linguiste, parmi lesquels figure notamment la publication d’une oeuvre tout à fait marquante pour l’approche énonciative et contrastive de la traduction, la Syntaxe comparée du français et de l’anglais (1981). La présentation du recueil, rédigée par Maryvonne Boisseau et Hélène Chuquet, souligne le caractère exemplaire de la recherche de Jacqueline Guillemin-Flescher, dans son attention minutieuse aux phénomènes linguistiques, dans sa constance théorique et dans la rigueur de sa méthode, avant d’énoncer les principes qui ont présidé à la construction des quatre parties de l’ouvrage, respectivement, « Traduction et linguistique contrastive », « Systèmes de repérage et prédication », « Assertion, modalités, détermination » et « Représentation de la perception ». S’ensuit un survol de chaque partie, qui situe chaque article dans la structure d’ensemble.
En fin d’ouvrage se trouve une postface de Françoise Doro-Mégy, hommage de la part d’une ancienne étudiante de Jacqueline Guillemin-Flescher qui témoigne de la générosité de la chercheuse et du rôle déterminant qu’elle a joué dans la carrière de nombreux anglicistes travaillant dans une optique énonciative et contrastive. Une annexe des résumés en français des articles publiés en anglais, une bibliographie exhaustive des travaux de JFG puis un index complet des notions abordées viennent compléter cet ouvrage de 436 pages.
Au cours des paragraphes suivants, nous nous proposons de résumer brièvement les articles rassemblés dans leurs grandes lignes, avant de livrer notre évaluation globale du volume.
Dans la première partie, « Traduction et linguistique contrastive », il est question du positionnement du travail de Jacqueline Guillemin-Flescher vis-à-vis des théories de la traduction. Le premier article, « Énonciation et traduction », passe en revue un échantillon de différences systématiques plus ou moins bien connues entre les textes anglais et français (l’antéposition, la coordination, la négation, la relation d’exclusion) pour conclure que le travail du traducteur, comme celui de l’auteur d’un texte, se fait en fonction d’« une activité langagière collective qui établit des contraintes d’ordre énonciatif » (p. 45). Sa réflexion se poursuit dans « Langue, culture et traduction », où l’on lit que « les effets stylistiques sont indissociables des phénomènes qui les conditionnent ». Ces phénomènes sont linguistiques, certes, mais aussi collectifs, « d’ordre culturel » (p. 61). Dans « Théoriser la traduction », Jacqueline Guillemin-Flescher se positionne dans une démarche théorique qui, au lieu de préconiser une quelconque posture traductive (sourcière, cibliste, etc.), ou encore d’étudier le traducteur à l’oeuvre, s’attache à « l’observation neutre des textes traduits [afin de] déterminer de façon objective les « normes » intériorisées qui conditionnent le texte cible » (p. 70). Il s’agit, à nouveau, des « paramètres culturels qui se reflètent dans l’organisation du discours » (p. 73) d’une langue à l’autre. Le dernier article de cette première partie, intitulé « Traduction et fonctionnement de la langue », fournit une illustration de la démarche, par une étude des traductions du plus-que-parfait et du pluperfect, dont les conditions d’emploi sont contraintes, d’après Jacqueline Guillemin-Flescher, selon une différence systématique entre les deux langues dans la localisation vis-à-vis d’une origine énonciative.
La deuxième partie du recueil, « Systèmes de repérage et prédication », regroupe six articles consacrés pour cinq d’entre eux à des problématiques de linguistique contrastive. Le premier, « Étude contrastive de la deixis », pose une définition de la deixis, avant de relever certaines différences systématiques dans les repérages privilégiés entre l’anglais et le français. Plus précisément, Jacqueline Guillemin-Flescher défend l’idée qu’« en français le pôle de la relation privilégié est l’origine énonciative, en anglais le terme contextuel » (p. 115). Dans « Représentation linguistique de l’activité, l’action et l’événement en français et en anglais », l’auteure considère plusieurs oppositions bien connues au sein du groupe verbal dans les deux langues, en concluant que « la grammaire et le style ne sont pas deux pôles distincts de l’activité de langage, mais […] s’inscrivent dans une gradation qui passe progressivement des contraintes syntaxiques aux récurrences relatives et de celles-ci aux choix subjectifs qui constituent les styles spécifiques » (p. 132). « Subject and Object », article en anglais, reste sur le même domaine d’étude, en se focalisant sur l’interaction complexe entre la transitivité et les contraintes aspectuo-temporelles de l’anglais et du français. « Verbes atéliques et constructions d’occurrences » est consacré aux contraintes d’emploi de locutions de type have a look, en anglais. L’article suivant, « Autour de la prédication de propriété », part, comme souvent chez Jacqueline Guillemin-Flescher, de faits simples, presque banals, à savoir les traductions d’énoncés de type he was a pharmacist (il était pharmacien) ou She is a fool (C’est une idiote !), pour montrer comment les différences relevées reflètent la manière dont les deux langues gèrent les repérages en jeu dans l’expression de la subjectivité. Le dernier article de cette partie, « Les constructions relatives dans le passage du français à l’anglais », expose les conditions, sémantiques, syntaxiques et énonciatives favorisant une traduction par which, that ou simple juxtaposition (Ø).
La troisième partie, « Assertion, modalités, détermination », regroupe sept articles. Le premier, « Traduire l’inattestable », présente des modifications récurrentes dans la traduction de certaines assertions, du français vers l’anglais, montrant ainsi que « l’assertion en français est loin d’aboutir systématiquement à une assertion en anglais » (p. 215). Dans « Qualification and point of view », rédigé en anglais, on retrouve des problématiques autour de la prédication de propriété déjà évoquées dans la deuxième partie, mais développées ici pour s’étendre à l’exclamation et à l’expression du haut degré. « De la qualité à la qualité » traite de l’expression en anglais et en français de deux valeurs qualitatives en jeu dans l’évocation de procès : QLT1 (choix notionnel) et QLT2 (qualification). « Questions rhétoriques et évaluation modale » répertorie les contraintes pesant sur une question rhétorique, en vue de dresser une liste des critères qui différencient ce procédé d’une véritable interrogation. « Les énoncés exclamatifs et intensifs dans le passage de l’anglais au français » fait écho à « Qualification and point of view », relevant les différences systématisables entre les deux langues dans la modalité exclamative. Les deux derniers articles de cette partie, « Construction du sens et mode d’énonciation » et « L’énoncé averbal : repérage et subjectivité », se penchent sur la tendance du français à employer plus volontiers que l’anglais l’énoncé averbal, pour conclure que c’est à nouveau la différence entre le repérage contextuel et le repérage énonciatif, que favorisent respectivement l’anglais et le français, qui permet de comprendre le caractère systématique des transformations opérées en traduction (p. 309).
La dernière partie, « Représentation de la perception », est consacrée à quatre articles qui traitent cette question en partant de supports littéraires en anglais et en français. « The Linguistic Representation of Perception in Benjy’s Monologue » offre une typologie des différentes façons dont Faulkner construit la représentation de la perception chez Benjy dans The Sound and the Fury. « Énonciation, perception et traduction » dégage plusieurs indices permettant de déterminer des passages qui mettent en jeu une perception représentée dans les deux langues. L’article suivant, « Temps et espace dans la représentation linguistique de la perception », continue dans la même lignée, en distinguant dans des textes anglais la perception ponctuelle, la perception continue et la neutralisation, dans certains contextes, de la valeur perceptive. Dans le dernier article du recueil, « Repère origine et repère translaté : la représentation linguistique de la perception visuelle et auditive », l’auteure différencie la perception directe et la perception indirecte, en étudiant, au moyen du concept de repère énonciatif translaté, diverses manifestations de la perception dans le texte littéraire en anglais.
Nous en venons maintenant à notre évaluation de Linguistique contrastive : énonciation et activité langagière, qui impliquera nécessairement deux volets : le premier portant sur le recueil et le travail éditorial qui l’a rendu possible, le second sur l’approche de Jacqueline Guillemin-Flescher telle qu’elle apparaît dans ses écrits rassemblés.
Les articles de Jacqueline Guillemin-Flescher réunis dans l’ouvrage ont été publiés sur une période allant de 1983 (« Énonciation et traduction ») jusqu’en 2018 (« Repère origine et repère translaté »). Les avoir rassemblés en un seul volume permet d’accéder à une réflexion riche et féconde, et d’en apprécier toute la constance théorique, par le biais des différentes problématiques abordées. Le travail éditorial est exemplaire, l’appareil critique qui accompagne les articles, sous forme de présentation, de postface, de bibliographie et d’index, remarquable, témoin du respect et du dévouement de l’équipe éditoriale envers Jacqueline Guillemin-Flescher.
Chaque article fait la preuve d’une observation minutieuse des phénomènes linguistiques patiemment relevés, ainsi que d’une rigueur et d’une constance exemplaires dans le maniement de la théorie des opérations prédicatives et énonciatives. Jacqueline Guillemin-Flescher refuse de mettre sur le compte d’effets stylistiques, plus ou moins arbitraires, de nombreuses tendances récurrentes, relevées dans les textes ou dans des traductions, préférant au contraire montrer comment ces phénomènes sont la manifestation en surface de différences fondamentales entre les systèmes linguistiques du français et de l’anglais. Il est important que la démarche que manifestent les travaux de Jacqueline Guillemin-Flescher puisse continuer à inspirer de nouvelles générations de chercheurs, et le présent ouvrage représente sans conteste une contribution très significative dans ce sens.
Les réserves que l’on peut exprimer sur un ouvrage de ce type sont sans doute, plus qu’autre chose, le reflet des évolutions dans les méthodes employées en linguistique, et même dans la sociologie de la recherche, depuis la première publication des articles de Jacqueline Guillemin-Flescher.
En effet, un premier point, anticipé déjà dans la présentation (p. 18), comme dans la postface (p. 410), concerne le sens à donner à la notion de « corpus », dans les écrits rassemblés. On admet généralement aujourd’hui qu’un corpus est un ensemble de textes authentiques, interrogeables par machine, échantillonnés pour représenter une langue ou une variété de langue (définition traduite et adaptée à partir de McEnery et al. 2006 : 5). Or, le rôle du corpus, chez Jacqueline Guillemin-Flescher, est essentiellement de garantir l’authenticité des exemples discutés. La notion de fréquence est très souvent évoquée, et la « récurrence » d’un phénomène langagier citée pour justifier son caractère systématique, mais ces notions ne reçoivent malheureusement pas l’assise statistique qui leur serait obligatoirement accordée aujourd’hui. On comprend que les exemples de textes et de leur traduction qui sont souvent confrontés résultent d’un énorme travail « à la main » pour ainsi dire, de repérage, de tri, de classification, etc. Les possibilités qu’offrent maintenant des corpus bilingues alignés, éventuellement annotés, n’étaient pas aussi accessibles aux chercheurs à l’époque où ces articles ont été rédigés.
Compte tenu du caractère non formalisé du travail mené sur le corpus, on peut s’interroger sur la représentativité des phénomènes évoqués. Cette représentativité concerne les aspects quantitatifs. Qu’est-ce qui nous permet de considérer qu’une fréquence est élevée, par exemple, si nous ne disposons pas d’information sur les fréquences attendues ? Elle concerne aussi les aspects qualitatifs, puisque les exemples retenus sont très majoritairement extraits de textes littéraires. On est par conséquent en droit de se demander dans quelle mesure un phénomène donné représente vraiment une manifestation de différences de fonctionnement linguistique entre deux langues. Ne serait-il pas plus prudent de limiter les conclusions que l’on peut tirer à un certain type de texte, à la modalité discursive de la narration littéraire (qui n’est sans doute pas l’utilisation la plus immédiate de la langue pour beaucoup de locuteurs) ? Malgré ces réserves, il reste que les arguments de Jacqueline Guillemin-Flescher sont souvent extrêmement convaincants, de nature à persuader le lecteur que bon nombre de phénomènes évoqués sont en effet révélateurs de fonctionnements qui dépassent de loin le registre littéraire qui sert de support aux réflexions. Il n’empêche, la recherche, telle qu’elle est menée dans les articles, ne permet pas d’aboutir à ces conclusions-là.
Nous avons déjà fait état de la constance qu’a montrée Jacqueline Guillemin-Flescher vis-à-vis de son cadre théorique, la théorie des opérations prédicatives et énonciatives, élaborée par Antoine Culioli et ses collaborateurs à la suite des travaux d’Émile Benveniste. La théorie, qui est aussi celle que nous pratiquons, constitue sans doute une faiblesse du recueil, mais aussi l’une de ses forces. Une faiblesse, car les articles rassemblés ont été publiés à une époque, et dans des revues, où l’on pouvait s’attendre à ce que les lecteurs aient déjà une connaissance certaine des principes théoriques à l’oeuvre. Aussi Jacqueline Guillemin-Flescher ne s’encombre-t-elle que rarement de préliminaires théoriques, du moins dans les articles écrits en français. La technicité n’est certes pas excessive, mais il est probable qu’un lecteur peu averti sentira le besoin de consulter des sources secondaires telles que le lexique de Groussier et Rivière (1996) ou encore le glossaire de la Syntaxe comparée du français et de l’anglais (1981), pour mieux saisir les enjeux.
La théorie, ou plutôt la théorisation, constitue en même temps l’une des grandes forces de l’ouvrage. Les corpus mobilisés par l’auteure sont peut-être peu représentatifs, le travail statistique qu’on attendrait aujourd’hui n’est pas en évidence, comme nous l’avons constaté plus haut. Mais chaque fois, Jacqueline Guillemin-Flescher s’efforce de franchir le pas qui va du local, du spécifique, vers le généralisable, vers l’universel, à l’aide d’une théorie qu’elle maîtrise parfaitement. L’ouvrage peut à ce titre servir d’exemple à suivre, en ce qu’il n’hésite pas devant « le coup de force théorique que représente l’abstraction par laquelle on passe de l’empirique au formel », selon les propos de Culioli (1991 : 28). On peut souhaiter que les hypothèses d’explication avancées par Jacqueline Guillemin-Flescher au fur et à mesure des articles rassemblés puissent servir de base pour de nouvelles recherches, alliant pratique et théorie, et qui vérifieraient leur application à partir de corpus conséquents, compilés en conformité avec les normes d’aujourd’hui, bilingues (ou multilingues), multigenres, comparables, parallèles et alignés, etc.
En résumé, Linguistique contrastive : énonciation et activité langagière représente un travail éditorial extraordinaire, grâce auquel la réflexion exigeante et féconde d’une grande théoricienne de la linguistique contrastive et de la linguistique énonciative parviendra à une nouvelle génération de chercheurs, pour inspirer, nous l’espérons, un renouveau des recherches énonciatives en linguistique contrastive.
Appendices
Bibliographie
- Culioli, Antoine (1991) : Pour une linguistique de l’énonciation : opérations et représentations. Tome 1. Gap : Ophrys.
- Groussier, Marie-Line et Rivière, Claude (1996) : Les mots de la linguistique : lexique de linguistique énonciative. Gap : Ophrys.
- Guillemin-Flescher, Jacqueline (1981) : Syntaxe comparée du français et de l’anglais : problèmes de traduction. Gap : Ophrys.
- McEnery, Tony, Xiao, Richard, et Tono, Yukio (2006) : Corpus-based language studies : An advanced resource book. New York : Routledge.